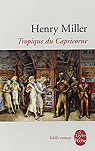Un roman envoûtant sur celle qui fût la muse de l'écrivain Henry Miller.
Au fin fond de l'Arizona, une femme affaiblie s'est réfugiée dans le ranch de son frère. À ses pieds, des malles contiennent les derniers souvenirs de son grand amour : le sulfureux écrivain Henry Miller. Après leur coup de foudre dans un dancing de Broadway, elle l'a encouragé à écrire, a été son épouse et l'a entretenu pour qu'il puisse donner naissance à son oeuvre. Elle s'appelle June Mansfield.
Tour à tour entraîneuse, serveuse ou comédienne, June n'a eu de cesse de brouiller les pistes. Sous la plume de l'auteur de Tropique du Cancer et d'Anaïs Nin, avec qui elle a formé un célèbre triangle amoureux, elle est devenue un personnage de fiction, mais n'a jamais livré sa vérité.
Emmanuelle de Boysson nous entraîne dans le New York de la Prohibition et le Paris des années 1930. Elle fait revivre cette personnalité fantasque, ô combien attachante, et recompose le puzzle d'une existence aux nombreuses zones d'ombre.
https://calmann-levy.fr/livre/june-9782702185117

Henry Miller
Henri Fluchère (Autre)/5 89 notes
Henri Fluchère (Autre)/5 89 notes
Résumé :
« C'est aujourd'hui le troisième ou le quatrième jour du printemps, et me voici assis à la place de Clichy en plein soleil. Aujourd'hui, assis au soleil, là, je vous dis que je me fous complètement que le monde aille à sa ruine ou non ; je me fous que le monde ait raison ou tort, qu'il soit bon ou mauvais. Il est : et ça suffit. Je le dis, non pas comme un Bouddha accroupi sur ses jambes croisées, mais inspiré par une sagesse à la fois joyeuse et solide... »
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Printemps noirVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (9)
Voir plus
Ajouter une critique
A vrai dire, je ne parlerai que d'une seule nouvelle de ce recueil inégal. En effet si les deux premières, "14ème district" et "Je porte un ange en filigrane", peuvent captiver l'attention du lecteur, les autres sont une longue logorrhée imbuvable, au point que je me suis posé la question de savoir si Henry Miller n'avait pas abusé de certaines substances illicites.
C'est grâce à la nouvelle intitulée " La boutique du tailleur " qu'Henry Miller évite la catastrophe.
J'ai enfin retrouvé là toute sa causticité, son humour qu'il utilise pour dépeindre ses semblables au sein d'une boutique de tailleur juif. Avec finesse il n'épargne personne, tous ridicules, autant le patron que les clients qui viennent pour un costume sur mesure.
Du Charles Bukowski avant la lettre !
Malheureusement cette embellie ne durera que soixante pages. Après, à vous le long désert de l'ennui avec les autres nouvelles. J'ai fermé le livre avant la fin, totalement démotivé.
Heureusement qu'Henry Miller a écrit des livres autrement intéressants et je vous conseille de lire celui-ci uniquement quand vous aurez épuisé sa production.
Ce n'était vraiment pas jours tranquilles et le titre aurait dû m'alerter.
C'est grâce à la nouvelle intitulée " La boutique du tailleur " qu'Henry Miller évite la catastrophe.
J'ai enfin retrouvé là toute sa causticité, son humour qu'il utilise pour dépeindre ses semblables au sein d'une boutique de tailleur juif. Avec finesse il n'épargne personne, tous ridicules, autant le patron que les clients qui viennent pour un costume sur mesure.
Du Charles Bukowski avant la lettre !
Malheureusement cette embellie ne durera que soixante pages. Après, à vous le long désert de l'ennui avec les autres nouvelles. J'ai fermé le livre avant la fin, totalement démotivé.
Heureusement qu'Henry Miller a écrit des livres autrement intéressants et je vous conseille de lire celui-ci uniquement quand vous aurez épuisé sa production.
Ce n'était vraiment pas jours tranquilles et le titre aurait dû m'alerter.
Bon sang ! qu'on songe combien de bravoure, délibérée ou non, il a fallu au traducteur de Henry Miller pour oser cette audace : traduire littéralement : Black spring ! Cet homme, sans doute à moitié fou – une sorte de forcené –, s'est certainement opposé à toutes sortes de confréries et d'usages pour risquer une telle aventure et franchir un pareil tabou : faire que Black spring devienne : Printemps noir ! Il est plus que certain que ce sauvage, que cette inconscience, que cet iconoclaste, a enduré toute une vie de lutte et de privation pour mettre ainsi sa réputation en jeu – c'est ce que l'exercice consommé d'une fine psychologie nous révèle : probablement un suicidaire rendu à sa dernière oeuvre et qui, à la façon du cygne mythique poussant son ultime chant, aurait pris soudain cette résolution inconsidérée. D'autant que l'ensemble du livre est d'une traduction apparemment inspirée et belle, rendant bien le caractère de l'auteur, alors…
Attendez donc ; je lis à l'instant : « Paul Rivert », nom de cet artisan énergumène. Ah ! un pseudonyme : voilà la raison ! N'importe, ne pas blâmer : c'est un homme qui, en dépit de son masque, ne manqua pas sans doute à être longtemps recherché par toute une corporation, poursuivi par nombre d'académiciens, traqué par bien des services d'espionnage : plaignons-le quand même, sa couverture n'enlève presque rien à son mérite ; une farouche clandestinité dut le contraindre à une existence de réclusion fort pénible. Louons les fermetés inébranlables et provocantes comme celles-ci, même dissimulées, et chantons à sa gloire le chant des partisans, des résistants, des maquisards ! pour que jamais ne soient oubliés les actes ô combien dignes et grandioses de ces vaillantes natures qui etc. etc.
Henry Miller est visiblement un grand jouisseur, un redoutable impertinent, un inadapté aux conventions, un extraordinaire-vivant, un risque-tout désinhibé, un misanthrope assumé, une forte-tête, un audacieux stylicien, un rêveur d'absolu, un incurable drogué de liberté et de poésie, un observateur de génie, un coeur supérieurement sensible sans le foutoir de la morale ordinaire… bref, un homme essentiellement fait pour me plaire, et pour plaire aux amateurs de littérature peu guindés ou conventionnels – voilà : aux vrais amateurs de littérature !
Printemps noir est un recueil d'impressions sur la vie, sur le monde et sur les gens. On y découvre cette énorme propension à la vérité qui caractérise les esprits les plus forts et purs, et à la nouveauté qui démontre une capacité à s'extraire d'une norme et donc à inventer son art, et à la liberté où se distinguent un ton et une parole magnifiquement décomplexés. Au surplus, une solitude terrible pèse sur cette somme, solitude d'un être qui ne se reconnaît nulle part, qui considère son environnement comme étranger à sa substance, et qui n'admet à peu près que son génie d'admirable mais sans pour autant assurer que ce génie fût nécessaire ou utile dans l'univers : Miller est un homme qui, à travers son oeuvre, cherche son individualité et qui aspire à l'exposer partout, comme preuve de son existence !
Et c'est presque en cela davantage un livre pour soi (je veux dire : pour lui) que destiné à être lu par d'autres. On n'y apprend rien que la singularité intérieure d'un être d'extrême vitalité, dans un lyrisme étonnant bâti d'assemblages hétéroclites, pour qui tout est visions, symboles et surréalisme – incluant aussi par ailleurs tous les défauts de cette école du perpétuel fumeur d'opium.
En cela, les récits les plus hallucinés sont aussi, à mon goût les plus vains et épuisants ; lire des dizaines de pages sur : la visite de rues, la création d'un tableau absurde, ou la narration de rêves incroyables… Miller pousse assez loin le genre de la divagation jusqu'à l'impatience et peut-être l'écoeurement du lecteur : cette introspection ne nous concerne pas, c'est tout à fait un exemple de quelque chose dont on ne peut qu'admirer l'exercice, mais difficile à « suivre », comme ces effets virtuoses de tous arts, pas compliqués cependant, pas incompréhensibles, mais où, cette fois, transparaît une identité à défaut de toute nécessité extérieure et curieuse ; autrement dit (et mieux dit sans doute !), on contemple un être évidemment artiste et qui le prouve, mais on manque d'une forme reconnaissable pour l'esprit rassis, on voudrait un récit, une description, un dialogue marquant un but, quelque chose de net, et l'on n'a la plupart du temps que des sortes de constructions mentales plus ou moins pathétiques selon l'adhésion et l'expérience personnelles. Cela pourtant « ne tombe pas des mains », cela signifie bien, mais je me suis souvent interrogé sur l'intérêt de cet essai en tant qu'ouvrage publié : car tout ce que veut transmettre Miller, c'est lui-même en se construisant, et – en se démontrant.
« La boutique du Tailleur » est néanmoins à mon sens un chef d'oeuvre d'observations foisonnantes et judicieuses, mais c'est presque le seul texte qui fonde son thème sur des réalités extérieures et transposable, à savoir les vies nombreuses et palpitantes gravitant autour de la boutique du père de l'auteur. C'est un monde de commérages, de misères, de simulacres, de turpitudes significatives et de banales grandeurs que déploie Miller à travers une galerie de portraits pittoresques et un éventail de souvenirs jaunes sans pudeur ni scrupules. C'est une plongée dans un milieu et dans une mémoire, avec quelque chose comme, enfin, le début d'un partage, une émotion plus spontanée et sincère, moins de désir d'art-pour-l'art et d'épate, moins d'égoïsme et d'essai : des relations véritablement formalisées pour un apport mutuellement profitable. Miller-esprit révèle alors Henry-coeur avec art et passion, et c'est cette alchimie qu'il me tardait de trouver, loin de l'introversion sans égards et de l'absurde pour la galerie. Une tendresse fébrile inonde ces caractères vrais, un réalisme neuf mêlé de suggestions essentielles constitue ces pages pleines de couleurs fauves et sauvages, et toute la bêtise fondamentale, tout l'aveuglement inhérent aux hommes, en ressortent dépeints, communiquant une vision crue, libre, défaite des préjugés communs et des voiles superficiels.
Et c'est sans doute là que réside le plus troublant de l'écriture de Miller, du moins pour celui qui peut entendre et voir loin, pour celui qui sait lire : toutes ces vérités tournent au vertige tant les valeurs humaines sont bousculées et anéanties ; partout du désordre, des postures et des faux-semblant, nul socle où reposer l'esprit sinon – et c'est essentiel – la conviction de sa propre identité, un univers entier figé autour d'une seule certitude : l'existence d'un soi-même fait d'altérité d'où naît la plus grande vitalité sans illusion, et pas la moindre morale, pas d'acquis, pas de point d'appui hors sa propre personne ni référence rassurante, une fusion vers un avenir abject en sa dégénérescence insensée, en somme une désespérance où n'émerge que le désir de jouissance, sans ordre, sans famille, sans repère – une sorte de mépris universel envers tout ce qui feint d'être au lieu d'être pour de vrai. Déstabilisant, cela, pour un philologue : un sentiment d'abandon qui confine à une conviction presque folle… en le changement et en la mutabilité de tout ! Il faut une solitude immense pour penser en loin (et faire de cette pensée le coeur même d'un être) : « Ni les hommes, ni rien sur quoi je puis poser le regard n'éveille en moi quelque chose de rassurant – il n'y a que moi ici, que moi et rien d'autre, comme tout le monde s'éteint continuellement au rythme de mes paupières. »
J'aime de plus en plus cette pleine assomption de la relativité de tout, qui confine à la négation même de l'idée de sacrifice puisqu'il n'y a que soi qu'on puisse perdre. La conscience de l'absence de valeur fondée, chez les hommes, cette impression que tout ce qui est social et mondain repose sur des imitations et des automatismes, donnent à n'importe quelle société une dimension sordide et mesquine, bouleversante d'abord et affligeante même, et puis de plus en plus exaltante parce que la vérité vaut mieux encore que tous les mysticismes hallucinés dont on ne ressort plus ensuite que pour sa propre blessure et sa définitive compromission.
Miller vit à travers son oeuvre, semble-t-il, avec l'esprit d'un enfant abandonné et trompé qu'on ne reprendra plus à des confiances superflues. Il ne redoute rien, nulle réalité, nulle vérité, c'est un chevalier téméraire qu'un bourgeois hautain estimerait négligé et dangereusement bohême : se méfier de tels êtres qui baisent vos femmes sans considération de dogmes ou de religions, de ces anarchistes qui n'entendent aucune de vos valeurs apprises par coeur, de ces transgresseurs extrêmement rationnels qui font de chaque moment de la vie ou bien un acte de bonheur suprême ou bien un geste de crachat majestueux, et qui ne savent rien respecter entre les deux, comme entre l'habit et la nudité certains ne connaissent point le sous-vêtement.
Mais en matière d'art, qui ne reçoit guère de conventions est libre d'une plus grande amplitude de manières, et le style de Miller est d'une ciselure baroque mâtinée de familiarités sincères. C'est à lire, cela, la façon dont un orfèvre ne dédaigne pas aussi de graver des bites et de représenter des orgasmes ; c'est la vie, cela, c'est toute la vie humaine : or, c'est ce tempérament voluptueux que je retiens avec le plus de jubilation, malgré les atermoiements de sujets – car il faudra bien à la fin que Henry ait trouvé quelque chose à raconter : un cri souverain de mépris universel ou un hurlement d'extase, les deux également impitoyables et indécents. Mais pitié et décence m'ont depuis longtemps lassé, et je veux, quand on parle de choses, qu'on les donne à voir ainsi telles qu'elles sont… sans plus jamais chercher à les améliorer.
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Attendez donc ; je lis à l'instant : « Paul Rivert », nom de cet artisan énergumène. Ah ! un pseudonyme : voilà la raison ! N'importe, ne pas blâmer : c'est un homme qui, en dépit de son masque, ne manqua pas sans doute à être longtemps recherché par toute une corporation, poursuivi par nombre d'académiciens, traqué par bien des services d'espionnage : plaignons-le quand même, sa couverture n'enlève presque rien à son mérite ; une farouche clandestinité dut le contraindre à une existence de réclusion fort pénible. Louons les fermetés inébranlables et provocantes comme celles-ci, même dissimulées, et chantons à sa gloire le chant des partisans, des résistants, des maquisards ! pour que jamais ne soient oubliés les actes ô combien dignes et grandioses de ces vaillantes natures qui etc. etc.
Henry Miller est visiblement un grand jouisseur, un redoutable impertinent, un inadapté aux conventions, un extraordinaire-vivant, un risque-tout désinhibé, un misanthrope assumé, une forte-tête, un audacieux stylicien, un rêveur d'absolu, un incurable drogué de liberté et de poésie, un observateur de génie, un coeur supérieurement sensible sans le foutoir de la morale ordinaire… bref, un homme essentiellement fait pour me plaire, et pour plaire aux amateurs de littérature peu guindés ou conventionnels – voilà : aux vrais amateurs de littérature !
Printemps noir est un recueil d'impressions sur la vie, sur le monde et sur les gens. On y découvre cette énorme propension à la vérité qui caractérise les esprits les plus forts et purs, et à la nouveauté qui démontre une capacité à s'extraire d'une norme et donc à inventer son art, et à la liberté où se distinguent un ton et une parole magnifiquement décomplexés. Au surplus, une solitude terrible pèse sur cette somme, solitude d'un être qui ne se reconnaît nulle part, qui considère son environnement comme étranger à sa substance, et qui n'admet à peu près que son génie d'admirable mais sans pour autant assurer que ce génie fût nécessaire ou utile dans l'univers : Miller est un homme qui, à travers son oeuvre, cherche son individualité et qui aspire à l'exposer partout, comme preuve de son existence !
Et c'est presque en cela davantage un livre pour soi (je veux dire : pour lui) que destiné à être lu par d'autres. On n'y apprend rien que la singularité intérieure d'un être d'extrême vitalité, dans un lyrisme étonnant bâti d'assemblages hétéroclites, pour qui tout est visions, symboles et surréalisme – incluant aussi par ailleurs tous les défauts de cette école du perpétuel fumeur d'opium.
En cela, les récits les plus hallucinés sont aussi, à mon goût les plus vains et épuisants ; lire des dizaines de pages sur : la visite de rues, la création d'un tableau absurde, ou la narration de rêves incroyables… Miller pousse assez loin le genre de la divagation jusqu'à l'impatience et peut-être l'écoeurement du lecteur : cette introspection ne nous concerne pas, c'est tout à fait un exemple de quelque chose dont on ne peut qu'admirer l'exercice, mais difficile à « suivre », comme ces effets virtuoses de tous arts, pas compliqués cependant, pas incompréhensibles, mais où, cette fois, transparaît une identité à défaut de toute nécessité extérieure et curieuse ; autrement dit (et mieux dit sans doute !), on contemple un être évidemment artiste et qui le prouve, mais on manque d'une forme reconnaissable pour l'esprit rassis, on voudrait un récit, une description, un dialogue marquant un but, quelque chose de net, et l'on n'a la plupart du temps que des sortes de constructions mentales plus ou moins pathétiques selon l'adhésion et l'expérience personnelles. Cela pourtant « ne tombe pas des mains », cela signifie bien, mais je me suis souvent interrogé sur l'intérêt de cet essai en tant qu'ouvrage publié : car tout ce que veut transmettre Miller, c'est lui-même en se construisant, et – en se démontrant.
« La boutique du Tailleur » est néanmoins à mon sens un chef d'oeuvre d'observations foisonnantes et judicieuses, mais c'est presque le seul texte qui fonde son thème sur des réalités extérieures et transposable, à savoir les vies nombreuses et palpitantes gravitant autour de la boutique du père de l'auteur. C'est un monde de commérages, de misères, de simulacres, de turpitudes significatives et de banales grandeurs que déploie Miller à travers une galerie de portraits pittoresques et un éventail de souvenirs jaunes sans pudeur ni scrupules. C'est une plongée dans un milieu et dans une mémoire, avec quelque chose comme, enfin, le début d'un partage, une émotion plus spontanée et sincère, moins de désir d'art-pour-l'art et d'épate, moins d'égoïsme et d'essai : des relations véritablement formalisées pour un apport mutuellement profitable. Miller-esprit révèle alors Henry-coeur avec art et passion, et c'est cette alchimie qu'il me tardait de trouver, loin de l'introversion sans égards et de l'absurde pour la galerie. Une tendresse fébrile inonde ces caractères vrais, un réalisme neuf mêlé de suggestions essentielles constitue ces pages pleines de couleurs fauves et sauvages, et toute la bêtise fondamentale, tout l'aveuglement inhérent aux hommes, en ressortent dépeints, communiquant une vision crue, libre, défaite des préjugés communs et des voiles superficiels.
Et c'est sans doute là que réside le plus troublant de l'écriture de Miller, du moins pour celui qui peut entendre et voir loin, pour celui qui sait lire : toutes ces vérités tournent au vertige tant les valeurs humaines sont bousculées et anéanties ; partout du désordre, des postures et des faux-semblant, nul socle où reposer l'esprit sinon – et c'est essentiel – la conviction de sa propre identité, un univers entier figé autour d'une seule certitude : l'existence d'un soi-même fait d'altérité d'où naît la plus grande vitalité sans illusion, et pas la moindre morale, pas d'acquis, pas de point d'appui hors sa propre personne ni référence rassurante, une fusion vers un avenir abject en sa dégénérescence insensée, en somme une désespérance où n'émerge que le désir de jouissance, sans ordre, sans famille, sans repère – une sorte de mépris universel envers tout ce qui feint d'être au lieu d'être pour de vrai. Déstabilisant, cela, pour un philologue : un sentiment d'abandon qui confine à une conviction presque folle… en le changement et en la mutabilité de tout ! Il faut une solitude immense pour penser en loin (et faire de cette pensée le coeur même d'un être) : « Ni les hommes, ni rien sur quoi je puis poser le regard n'éveille en moi quelque chose de rassurant – il n'y a que moi ici, que moi et rien d'autre, comme tout le monde s'éteint continuellement au rythme de mes paupières. »
J'aime de plus en plus cette pleine assomption de la relativité de tout, qui confine à la négation même de l'idée de sacrifice puisqu'il n'y a que soi qu'on puisse perdre. La conscience de l'absence de valeur fondée, chez les hommes, cette impression que tout ce qui est social et mondain repose sur des imitations et des automatismes, donnent à n'importe quelle société une dimension sordide et mesquine, bouleversante d'abord et affligeante même, et puis de plus en plus exaltante parce que la vérité vaut mieux encore que tous les mysticismes hallucinés dont on ne ressort plus ensuite que pour sa propre blessure et sa définitive compromission.
Miller vit à travers son oeuvre, semble-t-il, avec l'esprit d'un enfant abandonné et trompé qu'on ne reprendra plus à des confiances superflues. Il ne redoute rien, nulle réalité, nulle vérité, c'est un chevalier téméraire qu'un bourgeois hautain estimerait négligé et dangereusement bohême : se méfier de tels êtres qui baisent vos femmes sans considération de dogmes ou de religions, de ces anarchistes qui n'entendent aucune de vos valeurs apprises par coeur, de ces transgresseurs extrêmement rationnels qui font de chaque moment de la vie ou bien un acte de bonheur suprême ou bien un geste de crachat majestueux, et qui ne savent rien respecter entre les deux, comme entre l'habit et la nudité certains ne connaissent point le sous-vêtement.
Mais en matière d'art, qui ne reçoit guère de conventions est libre d'une plus grande amplitude de manières, et le style de Miller est d'une ciselure baroque mâtinée de familiarités sincères. C'est à lire, cela, la façon dont un orfèvre ne dédaigne pas aussi de graver des bites et de représenter des orgasmes ; c'est la vie, cela, c'est toute la vie humaine : or, c'est ce tempérament voluptueux que je retiens avec le plus de jubilation, malgré les atermoiements de sujets – car il faudra bien à la fin que Henry ait trouvé quelque chose à raconter : un cri souverain de mépris universel ou un hurlement d'extase, les deux également impitoyables et indécents. Mais pitié et décence m'ont depuis longtemps lassé, et je veux, quand on parle de choses, qu'on les donne à voir ainsi telles qu'elles sont… sans plus jamais chercher à les améliorer.
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Henry Miller, c'est simple : si vous êtes parvenu à aimer sa petite musique folle, son humanité pleine avec sa saleté, et ses lumières, ses impostures et ses courages, alors vous aimez Henry Miller.
Et si vous aimez Henry Miller, vous aimerez tout ce qu'il fait. Même quand c'est un peu moins bien. Objectivement.
Ce livre-ci est moins abouti que la trilogie de la Crucifixion en rose, par exemple. C'est un ensemble de textes-nouvelles relativement longs où Miller se perd, se retrouve, son style est là, débridé, parfois chiant, il faut le dire. Mais méfiance car une claque se trouve très vite au détours de certaines lignes.
Enfin bref, j'aime Henry Miller, j'aime donc ce Printemps noir, mais je ne le recommanderai pas à un lecteur vierge de cet auteur.
Et si vous aimez Henry Miller, vous aimerez tout ce qu'il fait. Même quand c'est un peu moins bien. Objectivement.
Ce livre-ci est moins abouti que la trilogie de la Crucifixion en rose, par exemple. C'est un ensemble de textes-nouvelles relativement longs où Miller se perd, se retrouve, son style est là, débridé, parfois chiant, il faut le dire. Mais méfiance car une claque se trouve très vite au détours de certaines lignes.
Enfin bref, j'aime Henry Miller, j'aime donc ce Printemps noir, mais je ne le recommanderai pas à un lecteur vierge de cet auteur.
Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens à propos de la nouvelle. Toute oeuvre chez le plus grand des auteurs peut paraître d'un intérêt inégal , mais dans l'absolu il n'y a pas de raison que ce que l'on aime se subdivise, on aime point barre.. et toute oeuvre d' art ne marche pas au kilo, peut se suffire à elle-même soit en une phrase, en vingt pages, en trente pages, en cinquante pages, en quatre-vingt pages.. Je n'en dirai pas davantage car c'est un casse-tête ce truc, et pour tout dire, ça m'excède !.. Il me semble que quand une idée part, on ne se pose pas la question combien va-t-elle faire de pages, comme le court ruisseau, le long ruisseau .. Maintenant, s'il plaît à un auteur, à un éditeur de faire un recueil de nouvelles en segmentant ça comme des mailles à saucisse, à peu près égales, c'est leur problème, mais il y a peu de chance pour que ça marche .. L'absurdité en fait est de les mettre à comparer et de nous livrer ça brut de décoffrage. Chaque texte a en principe son sujet, son histoire .. S'il y a un faisan qui gâterait tout le reste, il vaut mieux le séparer !
Monsieur Miller,
Cette fois ci ça a pris, cette fois ci le courant est passé entre nous ! Autant dans le Colosse de Maroussi je me suis ennuyée, autant dans printemps noir vous m'avez pris la main, je vous ai suivi et c'était la claque…Je me suis perdue, perdue dans votre style : rapide, entraînant, percutant, puissant tel un courant qui nous emmène dans tous vos délires, digressions, pensées et rêves. Vous m'avez secouée dans tous les sens et j'ai bu vos mots comme de l'eau fraîche. J'ai adoré la ballade à paris un samedi après midi et un troisième ou quatrième jour de printemps. J'ai adoré vous accompagner dans l'accomplissement dans votre peinture et voir naître le tableau « Je porte un ange en filigrane ». J'ai été ravie de faire la connaissance de tante Méli qui d'ailleurs m'a fait beaucoup de peine. En fermant le livre, j'ai eu envie de me balader au bord de la seine un jour ensoleillé et vous lire encore pour voir la vie de cette façon si particulière à travers vos yeux. Je vous dis donc : à très bientôt Monsieur Miller.
Cette fois ci ça a pris, cette fois ci le courant est passé entre nous ! Autant dans le Colosse de Maroussi je me suis ennuyée, autant dans printemps noir vous m'avez pris la main, je vous ai suivi et c'était la claque…Je me suis perdue, perdue dans votre style : rapide, entraînant, percutant, puissant tel un courant qui nous emmène dans tous vos délires, digressions, pensées et rêves. Vous m'avez secouée dans tous les sens et j'ai bu vos mots comme de l'eau fraîche. J'ai adoré la ballade à paris un samedi après midi et un troisième ou quatrième jour de printemps. J'ai adoré vous accompagner dans l'accomplissement dans votre peinture et voir naître le tableau « Je porte un ange en filigrane ». J'ai été ravie de faire la connaissance de tante Méli qui d'ailleurs m'a fait beaucoup de peine. En fermant le livre, j'ai eu envie de me balader au bord de la seine un jour ensoleillé et vous lire encore pour voir la vie de cette façon si particulière à travers vos yeux. Je vous dis donc : à très bientôt Monsieur Miller.
Citations et extraits (40)
Voir plus
Ajouter une citation
Assis là, sur le divan bas, la pièce noyée dans une douce pénombre, ses flancs lourds et palpitants pressés contre moi, le malaga qui faisait battre mes tempes, et tout cet absurde bavardage au sujet de Paul et de ses vertus, je finis par me pencher sur elle, et sans dire un mot, je soulevais sa robe et le lui mis. A mesure que je la pénétrais et commençais de la besogner, elle se mit à gémir. C'était une sorte de délire triste et coupable, ponctué de soupirs haletants et de petits cris de joie et d'angoisse, répétant inlassablement : "Je n'aurais jamais cru que vous feriez cela... Je n'aurais jamais cru que vous feriez cela..." Et quand ce fut fini, elle arracha la robe de velours, la belle robe de deuil décolletée, et elle m'abaissa la tête contre elle et me dit de l'embrasser, et de ses beaux bras vigoureux elle m'enfonça presque la tête entre ses cuisses, sans cesser de gémir et de sangloter. Enfin elle s'agenouilla près du divan où j'étais allongé et me dit d'une voix basse, tout éplorée : " Tu me promets de m'aimer toujours, n'est-ce pas ? Tu me le promets ? " Et je répondis oui, tandis que ma main fourrageait encore entre ses cuisses. Je répondis oui, tout en pensant en moi-même quel idiot tu as été d'attendre si longtemps. Elle était si mouillée, si juteuse là-dedans, et si enfantine, si confiante, eh quoi ! n'importe qui aurait pu entrer et se servir. Une femme à culbuter.
(La boutique du tailleur).
(La boutique du tailleur).
Pas un seul instant je ne crois à la lente et pénible, la glorieuse et logique, la sans gloire et illogique évolution des choses. Je crois que le monde tout entier - pas seulement la terre et les êtres qui la composent, ni l'univers dont nous avons inventorié les éléments, y compris les îlots d'univers hors d'atteinte de nos yeux et de nos instruments - mais le monde tout entier, connu et inconnu, est désaxé, hurlant de douleur et de démence. Je crois que si demain on découvrait le moyen de voler jusqu'à la plus lointaine étoile, jusqu'à un de ces univers dont la lumière, selon nos étranges calculs, ne nous atteindra que le jour où notre planète à nous sera éteinte, je crois que si demain nous étions transportés dans un temps qui n'a pas encore commencé, nous y trouverions une horreur identique, une misère identique, une identique folie.
Je vous le dis, ça ne porte jamais tort à un grand livre de l'emmener avec soi au cabinet. Seuls les petits en souffrent. Seuls les petits se changent en torche-culs. Par exemple "Le petit César", maintenant traduit en français, et appartenant à la série des "Passions". En le feuilletant, il me semble que je suis revenu en Amérique, en train de lire les manchettes, d'écouter ces saloperies de radios, de rouler dans des tape-culs de fer-blanc, de boire du gin de bas étage, de foutre des épis de maïs au cul de vierges-putains, de lyncher des nègres et de les brûler vifs.
De quoi vous donner la diarrhée.
Il en va de même pour l'Atlantic Monthly, ou pour tout autre "monthly", pour Aldous Huxley, Gertrude Stein, Sinclair Lewis, Hemingway, Dos Passos, Dreiser, etc.
Je n'entends sonner nulle cloche en moi quand j'amène ces oiseaux-là aux chiottes. Je tire la chaîne, et plouf ! les voilà dans l'égout ! au fond de la Seine, et dans l'océan Atlantique.
De quoi vous donner la diarrhée.
Il en va de même pour l'Atlantic Monthly, ou pour tout autre "monthly", pour Aldous Huxley, Gertrude Stein, Sinclair Lewis, Hemingway, Dos Passos, Dreiser, etc.
Je n'entends sonner nulle cloche en moi quand j'amène ces oiseaux-là aux chiottes. Je tire la chaîne, et plouf ! les voilà dans l'égout ! au fond de la Seine, et dans l'océan Atlantique.
Derrière le comptoir, il y avait alors trois vaillant Irlandais, trois de ces types abjects qui faisaient des bars de cette époque les lieux sympathiques qu'ils étaient. On les estimait tellement tous les trois, que l'on considérait comme un privilège si Patsy O'Dowd par exemple vous appelait sacré dégénéré, fils de putain, suceur de bite qui ne savait même pas boutonner sa braguette. Et si, en retour du compliment, vous lui proposiez de prendre un petit quelque chose, Patsy O'Dowd répondait froidement et sarcastiquement que seuls des gens de votre espèce pouvaient ingurgiter des tord-boyaux pareils, et, ce disant, il levait avec dédains votre verre par le pied pour essuyer l'acajou, puisque c'était son métier et qu'il était payé pour cela, mais nom de Dieu ! vous ne pourriez pas le persuader de s'empoisonner les tripes avec cette drogue infecte. Plus ses insultes étaient ordurières, plus il était estimé ; des financiers habitués à ce qu'on leur torchât le cul avec des pochettes de soie venaient en ville exprès, après la fermeture de la Bourse, rien que pour se faire traiter de sacré fils de putain dégénéré suceur de bite par ce sale cochon d'Irlandais mal embouché. C'était pour eux le couronnement d'un beau jour.
(La boutique du tailleur).
(La boutique du tailleur).
Je ne serais pas surpris que ce fût le cimetière de Cypress Hill devant lequel j'ai passé durant tant d'années dans le dégoût et l'humiliation, que je regardais du haut du chemin de fer aérien, sur lequel je crachais de la plate-forme du train. Ou le cimetière de Saint-Jean, avec ses burlesques anges de fer-blanc, où j'ai travaillé comme fossoyeur. Ou le Cimetière Montparnasse, qui en hiver, a l'air d'un commotionné. Cimetières, cimetières...Par Dieu ! Je refuse d'être enterré dans un cimetière ! Je ne veux pas de ces imbéciles autour de moi, avec un goupillon et un air funèbre. Je n'en veux pas !
(Je porte un ange en filigrane).
(Je porte un ange en filigrane).
Videos de Henry Miller (28)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Henry Miller (63)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Dead or Alive ?
Harlan Coben
Alive (vivant)
Dead (mort)
20 questions
1837 lecteurs ont répondu
Thèmes :
auteur américain
, littérature américaine
, états-unisCréer un quiz sur ce livre1837 lecteurs ont répondu