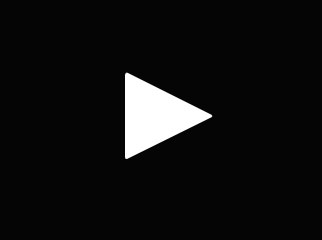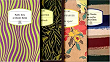Raharimanana/5
19 notes
Madagascar, 1947. Par la quête obsédante d'un amour mort, un tirailleur se rebelle et plonge dans le passé de la Grande île. Raharimanana, l'auteur, en fouillant dans les mythes et la mémoire malgaches, fait ainsi surgir la violence qui jalonne l'histoire de son pays ; violence coloniale qui massacre au nom de ses certitudes civilisatrices, mais aussi violence du pays déchiré par les rêves d'unification et de conqu&... >Voir plus
Résumé :
Madagascar, 1947. Par la quête obsédante d'un amour mort, un tirailleur se rebelle et plonge dans le passé de la Grande île. Raharimanana, l'auteur, en fouillant dans les mythes et la mémoire malgaches, fait ainsi surgir la violence qui jalonne l'histoire de son pays ; violence coloniale qui massacre au nom de ses certitudes civilisatrices, mais aussi violence du pays déchiré par les rêves d'unification et de conqu&... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Nour, 1947Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (5)
Ajouter une critique
Je m'en viens partager avec vous une certaine déception. En effet, tous les ingrédients étaient réunis, semblait-il, pour un beau moment de lecture : un auteur malgache que je ne connaissais pas, l'histoire de Madagascar et ses phases successives de colonisations puis de décolonisation pour la dernière d'entre elles, dont j'avais tout à découvrir. Une écriture a priori très belle…
Bref, beaucoup d'excellents ingrédients mais, finalement, une préparation qui ne m'a pas du tout séduite : d'abord une lourdeur sur l'estomac d'un bout à l'autre qui m'a moult fois donné l'envie de tout arrêter. Ensuite des écoeurements propres à créer des aversions et enfin, des associations de saveurs qui ne sont guère plaisantes à mes papilles.
Je m'explique : je n'ai ressenti absolument aucune empathie à aucun moment durant cette lecture. Il y a des morts atroces, il y a le destin de peuples et d'une île parmi les plus vastes au monde et je ne ressens rien. Soit cela vient de moi, ce qui n'est pas impossible, soit cela vient de la manière dont cela a été écrit, ce qui n'est pas impossible non plus. En tout cas, nous ne nous sommes pas trouvées elle et moi.
C'est très confus, très touffus, très diffus, on vous parle de ça 5 minutes, puis d'autre chose, puis encore d'autre chose ; tantôt c'est 1947, tantôt c'est le XVIIIè siècle, tantôt c'est 1943, c'est ici, c'est là, c'est partout à la fois et, moralité, c'est nulle part. Et puis on y revient, et ça se répète, et ça se répète encore plus loin et à nouveau plus loin : ce que ça m'a fatiguée (ce que ça m'a saoulée même, dans l'acception première du terme, pas celle qui s'utilise en langage familier).
Pfff ! ce patchwork incessant interdit toute identification vis-à-vis d'un quelconque personnage, d'intrigue, je n'en ai point trouvé. À de nombreuses reprises, l'auteur écrit qu'il veut tout retranscrire or, je serais tentée de lui dire que c'est justement le travail d'un écrivain d'effectuer des choix car là, ça ne crée que de l'embrouille et
absolument aucune impression d'exhaustivité.
On comprend que la colonisation française n'a pas été tendre, mais bon, ça on le savait déjà, du moins j'imagine. On comprend que les différentes ethnies de Madagascar se sont toujours plus ou moins étripées les unes les autres ou, à tout le moins, mis en position d'esclavage les unes vis-à-vis des autres. Un festival de douleurs qui s'étale sur des siècles, une narration totalement décousue, parfois très accessible (les lettres des religieux français des XVIII et XIXè siècles) parfois presque incompréhensible car absconse.
En somme, l'archétype d'une bonne grosse déception littéraire alors que j'aurais tellement aimé aimer. Mais voilà, définitivement, ce livre n'est pas pour moi. Que cela ne vous dissuade pas de le découvrir et, éventuellement, d'en dresser un tableau qui serait tout autre. Plus que jamais, nous avons besoin de diversité d'opinion, d'esprit critique et d'interprétations alternatives.
Ce n'est que mon avis de lémurienne, sans l'ombre d'une lumière, pour cette Nour malgache, c'est-à-dire pas grand-chose.
Bref, beaucoup d'excellents ingrédients mais, finalement, une préparation qui ne m'a pas du tout séduite : d'abord une lourdeur sur l'estomac d'un bout à l'autre qui m'a moult fois donné l'envie de tout arrêter. Ensuite des écoeurements propres à créer des aversions et enfin, des associations de saveurs qui ne sont guère plaisantes à mes papilles.
Je m'explique : je n'ai ressenti absolument aucune empathie à aucun moment durant cette lecture. Il y a des morts atroces, il y a le destin de peuples et d'une île parmi les plus vastes au monde et je ne ressens rien. Soit cela vient de moi, ce qui n'est pas impossible, soit cela vient de la manière dont cela a été écrit, ce qui n'est pas impossible non plus. En tout cas, nous ne nous sommes pas trouvées elle et moi.
C'est très confus, très touffus, très diffus, on vous parle de ça 5 minutes, puis d'autre chose, puis encore d'autre chose ; tantôt c'est 1947, tantôt c'est le XVIIIè siècle, tantôt c'est 1943, c'est ici, c'est là, c'est partout à la fois et, moralité, c'est nulle part. Et puis on y revient, et ça se répète, et ça se répète encore plus loin et à nouveau plus loin : ce que ça m'a fatiguée (ce que ça m'a saoulée même, dans l'acception première du terme, pas celle qui s'utilise en langage familier).
Pfff ! ce patchwork incessant interdit toute identification vis-à-vis d'un quelconque personnage, d'intrigue, je n'en ai point trouvé. À de nombreuses reprises, l'auteur écrit qu'il veut tout retranscrire or, je serais tentée de lui dire que c'est justement le travail d'un écrivain d'effectuer des choix car là, ça ne crée que de l'embrouille et
absolument aucune impression d'exhaustivité.
On comprend que la colonisation française n'a pas été tendre, mais bon, ça on le savait déjà, du moins j'imagine. On comprend que les différentes ethnies de Madagascar se sont toujours plus ou moins étripées les unes les autres ou, à tout le moins, mis en position d'esclavage les unes vis-à-vis des autres. Un festival de douleurs qui s'étale sur des siècles, une narration totalement décousue, parfois très accessible (les lettres des religieux français des XVIII et XIXè siècles) parfois presque incompréhensible car absconse.
En somme, l'archétype d'une bonne grosse déception littéraire alors que j'aurais tellement aimé aimer. Mais voilà, définitivement, ce livre n'est pas pour moi. Que cela ne vous dissuade pas de le découvrir et, éventuellement, d'en dresser un tableau qui serait tout autre. Plus que jamais, nous avons besoin de diversité d'opinion, d'esprit critique et d'interprétations alternatives.
Ce n'est que mon avis de lémurienne, sans l'ombre d'une lumière, pour cette Nour malgache, c'est-à-dire pas grand-chose.
La langue de Raharimanana est celle du silence qui succède au rêve et précède l'éveil. Sa poésie est un plat qui se mange cru, un cri qui dilate les dédales du vide. Elle entame les ciselures du coeur, ruisselle de larmes viscérales vers un ciel inversé, ouaté d'une transcendance sucrée-salée.
Ici il est le chef d'orchestre d'un récit-choral se déroulant lors des émeutes anticoloniales de 1947 à Madagascar où des dizaines de milliers de Malgaches ont été massacrés par l'armée française. Dans ce contexte dramatique, c'est l'histoire d'amours pour une terre et pour une femme, victimes de ce carnage.
"Transcrire. Tout transcrire."
Les apôtres des candeurs coquettes et doucereuses lui reprochent la violence de ses images... mais ce sont les civilisations humaines qui sont violentes !
Le poète est une colonne érigée en cortège de vertèbres qui soutiennent l'ossature de la résistance au scandale du monde. Il se saisit de l'abject à deux mains, comme nos ancêtres éblouis de voir le feu jaillir de la friction des silex, le décrasse, le lustre avec sa radieuse salive puis le dégrade en fines incandescences sublimées. Avec l'impudente pudeur de la lune lorsqu'elle éclaire le soleil, ses mots, acrobates des cloaques, déferlent dans la fosse des charniers et en distillent de l'or...
Raharimanana est, selon moi, le phénix des poètes contemporains.
Ici il est le chef d'orchestre d'un récit-choral se déroulant lors des émeutes anticoloniales de 1947 à Madagascar où des dizaines de milliers de Malgaches ont été massacrés par l'armée française. Dans ce contexte dramatique, c'est l'histoire d'amours pour une terre et pour une femme, victimes de ce carnage.
"Transcrire. Tout transcrire."
Les apôtres des candeurs coquettes et doucereuses lui reprochent la violence de ses images... mais ce sont les civilisations humaines qui sont violentes !
Le poète est une colonne érigée en cortège de vertèbres qui soutiennent l'ossature de la résistance au scandale du monde. Il se saisit de l'abject à deux mains, comme nos ancêtres éblouis de voir le feu jaillir de la friction des silex, le décrasse, le lustre avec sa radieuse salive puis le dégrade en fines incandescences sublimées. Avec l'impudente pudeur de la lune lorsqu'elle éclaire le soleil, ses mots, acrobates des cloaques, déferlent dans la fosse des charniers et en distillent de l'or...
Raharimanana est, selon moi, le phénix des poètes contemporains.
Un homme ère, tirant le cadavre de son amour, Nour.
Durant sept nuits, dans un récit assez décousu, possédé, quasi délirant, il nous raconte son histoire, celle de Nour fille d'esclave tombée sous les balles des colons français, celle de ses compagnons d'insurrection, celle de la « Grande Ile » et de ses peuples. Des siècles de violence : guerres tribales, esclavage, colonisation française avec ses missionnaires chrétiens chargés d'éradiquer l'impiété, jusqu'au carnage de la répression de l'insurrection en 1947.
Tirailleur enrôlé de force en France et plongé dans l'horreur d'une guerre qui n'est pas la sienne, à expédier des wagons d'humains vers la mort, à son retour sur son île il jure « de ne plus jamais obéir à aucun des coloniaux » et rejoint le camp des rebelles qui mènent l'insurrection. Survivant du massacre, il est à bout de forces, de désespoir, de maladie. Boue, putréfaction, mouches, pluie, vagues, feu, vent, sont omniprésents. Il est guidé dans son errance par des êtres légendaires : Konantitra, vieille femme danseuse et chanteuse de mort ; Dziny, la Mère, femme des eaux et des lumières ; Retany le maître des terres, à l'origine de toute plante, de tout arbre.
Chant de lamentation, complainte, désolation. Ambiance glauque. C'est un texte d'abord difficile, dans une langue poétique, il faut y pénétrer comme dans une transe, accepter de se laisser traverser et transporter par les esprits de cette terre, laisser opérer l'envoutement. Mais le voyage est rude, inconfortable, il vous remue les tripes.
C'est toute la magie et l'art du poète de rendre belles autant d'horreurs.
Durant sept nuits, dans un récit assez décousu, possédé, quasi délirant, il nous raconte son histoire, celle de Nour fille d'esclave tombée sous les balles des colons français, celle de ses compagnons d'insurrection, celle de la « Grande Ile » et de ses peuples. Des siècles de violence : guerres tribales, esclavage, colonisation française avec ses missionnaires chrétiens chargés d'éradiquer l'impiété, jusqu'au carnage de la répression de l'insurrection en 1947.
Tirailleur enrôlé de force en France et plongé dans l'horreur d'une guerre qui n'est pas la sienne, à expédier des wagons d'humains vers la mort, à son retour sur son île il jure « de ne plus jamais obéir à aucun des coloniaux » et rejoint le camp des rebelles qui mènent l'insurrection. Survivant du massacre, il est à bout de forces, de désespoir, de maladie. Boue, putréfaction, mouches, pluie, vagues, feu, vent, sont omniprésents. Il est guidé dans son errance par des êtres légendaires : Konantitra, vieille femme danseuse et chanteuse de mort ; Dziny, la Mère, femme des eaux et des lumières ; Retany le maître des terres, à l'origine de toute plante, de tout arbre.
Chant de lamentation, complainte, désolation. Ambiance glauque. C'est un texte d'abord difficile, dans une langue poétique, il faut y pénétrer comme dans une transe, accepter de se laisser traverser et transporter par les esprits de cette terre, laisser opérer l'envoutement. Mais le voyage est rude, inconfortable, il vous remue les tripes.
C'est toute la magie et l'art du poète de rendre belles autant d'horreurs.
Lecture mitigée que voici. C'est un livre étrange dont je ne sais quoi penser. J'ai aimé certains passages que j'ai trouvé très beaux, très poétiques, tanfis que je n'ai pas supporté d'autres passages très violent, à la limite du soutenable (pour un en particulier). J'ai eu des difficultés à comprendre l'histoire pendant le premier tiers du roman, puis par la suite je me suis habituée à cette narration hachée, mélangeant différentes époques.
Il faut tout de même reconnaître que l'auteur a une très belle plume, très poétique (comme dit plus haut), il y a un rythme, des phrases qui reviennent comme une rengaine, un refrain, un leitmotiv. J'ai également aimé la description faite des sentiments, la mise en lumière sur les sentiments des colonisés , la cruauté des colonisateurs. Mais je pense tout de même que j'ai dû passer à côté de quelque chose.
Il faut tout de même reconnaître que l'auteur a une très belle plume, très poétique (comme dit plus haut), il y a un rythme, des phrases qui reviennent comme une rengaine, un refrain, un leitmotiv. J'ai également aimé la description faite des sentiments, la mise en lumière sur les sentiments des colonisés , la cruauté des colonisateurs. Mais je pense tout de même que j'ai dû passer à côté de quelque chose.
Je retrouve ici tout le suc des écrits de Raharimanana : une langue aussi belle que violente, des tableaux cruels et révoltants qui se succèdent, l'histoire de la grande île qui s'entremêle aux esprits malgaches qui ne semblent jamais vouloir laisser en paix les victimes de la guerre.
Certains passages révulsent, repoussent le lecteur, bien qu'ils ne fassent rien d'autres que de décrire ce que subissent les corps face à la guerre et les pires bassesses de l'humanité. Les corps violentés et en putréfaction, mais non dénués d'attraction, ne sont pas sans rappeler Baudelaire.
Toujours aussi séduite par la plume de cet auteur qui sait si bien faire retranscrire le souffle de Madagascar à travers ses romans.
Certains passages révulsent, repoussent le lecteur, bien qu'ils ne fassent rien d'autres que de décrire ce que subissent les corps face à la guerre et les pires bassesses de l'humanité. Les corps violentés et en putréfaction, mais non dénués d'attraction, ne sont pas sans rappeler Baudelaire.
Toujours aussi séduite par la plume de cet auteur qui sait si bien faire retranscrire le souffle de Madagascar à travers ses romans.
Citations et extraits (26)
Voir plus
Ajouter une citation
On raconte qu'ils étaient des centaines dans ce boutre. […] Ils ne savaient vers quelle destinée leurs maîtres les déportaient. Jour et nuit, ils priaient. L'océan semblait s'étendre un peu plus à chaque invocation, s'étaler un peu plus à chaque pleur. […] Leurs maîtres les nourrissaient de moins en moins. Ils savaient qu'ils étaient perdus, qu'il y avait trop de bouches à nourrir. Leurs maîtres leur permirent de monter sur le pont et leur tinrent discours : « La terre est loin et nos vies raccourcissent… » Ils comprirent mais n'eurent pas le temps de réagir. Les armes des maîtres sortirent déjà. Ils furent poussés dans la mer, bousculés vers les flots. Seuls les plus valides parvinrent à se réfugier dans les cales. De là, ils menacèrent de crever le flanc du boutre. Les maîtres n'osèrent les en déloger. On raconte qu'ils y ont vécu des jours et des jours, qu'ils ne surent plus distinguer les soleil de la lune. On raconte que, poussés par la famine, ils ont dévoré étoffes et toiles. Surent-ils encore qu'ils étaient des hommes ? Plus aucun d'entre eux ne portait d'habits. Plus aucun d'entre eux n'osait se regarder. Leurs regards brillaient tandis que leurs âmes s'éteignaient petit à petit. Régulièrement un homme, une femme, entreprenait de crever le flanc du navire. Régulièrement cet homme, cette femme mourait d'épuisement. Les coups vibraient dans leurs veines et semblaient les atteindre au plus profond. Leurs maîtres leur proposèrent enfin de jouer leur destin à coups de dé, au hasard… Ils acceptèrent de remonter sur le pont. Furent disposés sur les bords dix cages de fer abritant chacune six personnes. Cinq cages pour les maîtres, cinq cages pour les esclaves. À chaque coup de dé perdant, une cage rejoignait aussitôt les abîmes océanes. On jouerait cinq coups.
On raconte que les deux premiers désignèrent les esclaves. On raconte que le troisième désigna encore les esclaves. Un maître lança son dé et un esclave l'attrapa au vol. Le dé ne comportait que le chiffre le plus élevé. Les maîtres ressortirent leurs armes et les embrochèrent de nouveau sur leurs sabres et leurs pointes de fer. Seuls une dizaine d'entre eux en réchappèrent et tinrent au sud du boutre. Les maîtres les y laissèrent errants, hagards, terrifiés.
Première nuit, 5 novembre 1947 : II.
On raconte que les deux premiers désignèrent les esclaves. On raconte que le troisième désigna encore les esclaves. Un maître lança son dé et un esclave l'attrapa au vol. Le dé ne comportait que le chiffre le plus élevé. Les maîtres ressortirent leurs armes et les embrochèrent de nouveau sur leurs sabres et leurs pointes de fer. Seuls une dizaine d'entre eux en réchappèrent et tinrent au sud du boutre. Les maîtres les y laissèrent errants, hagards, terrifiés.
Première nuit, 5 novembre 1947 : II.
Je détournais mes regards de la fenêtre, ne savais pourquoi cet homme, Willem Rueff, s'était donné la mission de me " protéger ". Ou plutôt si ! Par vanité. Par orgueil. Pour prouver à ses collègues l'immensité de sa culture, la magnificence des aventures qu'il avait rencontré dans les colonies. « Cet homme, disait-il en me montrant, appartient à la race des nègres la plus évoluée.
Mets-toi bien en face ! Ne bouge plus… »
Il releva mon menton, tira un peu dans mes cheveux.
« Voyez ses yeux… Ne sont-ils pas bridés ? Étonnant, pour un nègre, non ? Cela démontre parfaitement cette théorie qui soutient que l'homme traverse des périodes précises d'évolution. Vous avez devant vous un homme qui perd petit à petit ses caractéristiques négroïdes pour acquérir celles de la race asiatique, située sur un échelon plus élevé. Voyez ses cheveux… Sont-ils crépus ? Sont-ils lisses ? Avez-vous déjà rencontré un nègre pareil ? Avez-vous jamais entendu parler d'une telle race sinon sur cette île extraordinaire ? […] Sur cette île se retrouve résumée l'histoire de l'évolution humaine. Cet homme que vous voyez devant vous, vous le voyez bien, est tout ce qu'il y a de plus noir de peau. Regardez-le bien ! Il brille d'un noir d'ébène. Ses yeux sont pourtant bridés, ses cheveux presque lisses et la forme de son visage approche de celle d'un Asiatique. D'autres habitants de l'île sont encore plus extraordinaires. Ils ont perdu leur couleur d'ébène primitive et sont presque aussi clairs que les Asiatiques. On ne peut même pour certains faire la différence avec un véritable Asiatique. D'ailleurs, ces hommes plus clairs sont bien plus intelligents et plus dominateurs. Partout dans l'île, ils s'affirment et imposent aux autres races leurs propres modes de vie. Acquérant les vertus de notre science et de notre civilisation, ils se rapprochent à grands pas de l'échelon supérieur. »
Troisième journée, 7 novembre 1947 : II.
Mets-toi bien en face ! Ne bouge plus… »
Il releva mon menton, tira un peu dans mes cheveux.
« Voyez ses yeux… Ne sont-ils pas bridés ? Étonnant, pour un nègre, non ? Cela démontre parfaitement cette théorie qui soutient que l'homme traverse des périodes précises d'évolution. Vous avez devant vous un homme qui perd petit à petit ses caractéristiques négroïdes pour acquérir celles de la race asiatique, située sur un échelon plus élevé. Voyez ses cheveux… Sont-ils crépus ? Sont-ils lisses ? Avez-vous déjà rencontré un nègre pareil ? Avez-vous jamais entendu parler d'une telle race sinon sur cette île extraordinaire ? […] Sur cette île se retrouve résumée l'histoire de l'évolution humaine. Cet homme que vous voyez devant vous, vous le voyez bien, est tout ce qu'il y a de plus noir de peau. Regardez-le bien ! Il brille d'un noir d'ébène. Ses yeux sont pourtant bridés, ses cheveux presque lisses et la forme de son visage approche de celle d'un Asiatique. D'autres habitants de l'île sont encore plus extraordinaires. Ils ont perdu leur couleur d'ébène primitive et sont presque aussi clairs que les Asiatiques. On ne peut même pour certains faire la différence avec un véritable Asiatique. D'ailleurs, ces hommes plus clairs sont bien plus intelligents et plus dominateurs. Partout dans l'île, ils s'affirment et imposent aux autres races leurs propres modes de vie. Acquérant les vertus de notre science et de notre civilisation, ils se rapprochent à grands pas de l'échelon supérieur. »
Troisième journée, 7 novembre 1947 : II.
Nous avons oublié, ou feint d'ignorer, que nous venons d'ailleurs, d'un ailleurs qui nous avait chassés ou poussés sur les mers à bord de nos boutres chétifs. Inventant des origines célestes, créant des mythes nouveaux, nous avons effacé notre passé, occulté notre véritable histoire. Ceux-des-rivages affirment maintenant qu'ils descendent du Prophète, que jalousés, persécutés, ils avaient préféré quitter la Terre sainte et échoué sur ces rivages. Ceux-des-cimes soutiennent que la fille de Dieu était descendue sur cette terre pour épouser leur ancêtre, le premier homme. Que disent Ceux-des-savanes, que disent Ceux-des-rochers, que disent Ceux-des-îlots, Ceux-des-fleuves, Ceux-des-sables… ? L'oubli. Rien que l'oubli. Nous avons tant fermé les yeux sur nos origines que le fil des temps s'est rompu et nous a rendus aveugles. Qui maintenant peut se targuer de connaître nos véritables origines ? Nous avons perdu notre passé et notre temps est ainsi écorché. Notre présent boitille, notre avenir dépérit.
Saurons-nous un jour que nous ne formions qu'une seule nation ?
Première nuit, 5 novembre 1947 : I.
Saurons-nous un jour que nous ne formions qu'une seule nation ?
Première nuit, 5 novembre 1947 : I.
Nous y croyions, au départ des coloniaux. Nous n'en doutions nullement. Ne pouvions concevoir que venant de si loin ils puissent décréter cette terre comme étant la leur. Ne pouvions même pas comprendre comment cette idée avait pu germer dans leur esprit. Est-ce par ce Dieu qui leur recommande de peupler toutes les terres ? Est-ce par cet orgueil qui les porte et qui les incite à ne pas supporter d'autres cultures, d'autres façons de vivre ?
Je tentais d'expliquer à mes compagnons comment ils se massacraient mutuellement dans leur pays. Je tentais de leur décrire l'horreur des tranchées et la barbarie de leurs affrontements. Le silence me répondait. Seulement le silence. L'incompréhension…
Je me rends compte maintenant de combien nous avions manqué de lucidité, de combien nous avions oublié qu'ils n'étaient que des hommes, en réalité ! Des hommes qui rêvaient de conquête ! Des hommes qui brûlaient de désir de puissance ! Nos ancêtres avaient débarqué sur ces rivages. Migrants. Étrangers. S'y étaient installés. Enracinés. Jusqu'à oublier que la graine donnant les racines venait d'une autre terre, d'une autre contrée. Loin. Très loin d'ici. Désir d'affirmer et de croire que notre propre puissance s'assimile à celle que libère cette terre que nous foulons ! Nos rois n'avaient pas hésité à nous vendre pour assouvir ce même désir ! Nos peuples n'avaient pas hésité à s'affronter pour le contrôle d'une plaine ou d'un cours d'eau ! Les coloniaux étaient juste venus d'un peu plus loin, avaient utilisé d'autres moyens, d'autres dieux…
[…]
Quelle est cette idée d'appartenance qui nous pousse à nous entre-tuer ? À effacer toute trace ne convergeant pas dans notre sillage ? Peut-on décréter que toute terre ne doit correspondre qu'à une race, qu'à une nation, qu'à une civilisation ?
Sixième journée, 10 novembre 1947 : I
Je tentais d'expliquer à mes compagnons comment ils se massacraient mutuellement dans leur pays. Je tentais de leur décrire l'horreur des tranchées et la barbarie de leurs affrontements. Le silence me répondait. Seulement le silence. L'incompréhension…
Je me rends compte maintenant de combien nous avions manqué de lucidité, de combien nous avions oublié qu'ils n'étaient que des hommes, en réalité ! Des hommes qui rêvaient de conquête ! Des hommes qui brûlaient de désir de puissance ! Nos ancêtres avaient débarqué sur ces rivages. Migrants. Étrangers. S'y étaient installés. Enracinés. Jusqu'à oublier que la graine donnant les racines venait d'une autre terre, d'une autre contrée. Loin. Très loin d'ici. Désir d'affirmer et de croire que notre propre puissance s'assimile à celle que libère cette terre que nous foulons ! Nos rois n'avaient pas hésité à nous vendre pour assouvir ce même désir ! Nos peuples n'avaient pas hésité à s'affronter pour le contrôle d'une plaine ou d'un cours d'eau ! Les coloniaux étaient juste venus d'un peu plus loin, avaient utilisé d'autres moyens, d'autres dieux…
[…]
Quelle est cette idée d'appartenance qui nous pousse à nous entre-tuer ? À effacer toute trace ne convergeant pas dans notre sillage ? Peut-on décréter que toute terre ne doit correspondre qu'à une race, qu'à une nation, qu'à une civilisation ?
Sixième journée, 10 novembre 1947 : I
Contre mousquets, alcools, soies ou verreries, nous leur avons défriché nos forêts pour présenter ébènes et palissandres. Ceux-des-savanes ont cru qu'ils pourraient les aider à étendre leur royaume et à freiner la puissance de Ceux-des-cimes, tandis que Ceux-des-cimes acquéraient leurs sciences de la guerre. Nous n'avons pas pensé un instant qu'il fallait nous retrouver et nous reconnaître de nouveau. Nous n'avons pas su qu'ils avaient proclamé ce sol comme étant le leur dès qu'ils y avaient posé leur stèle et leur croix ! Ce sol que nos ancêtres avaient sanctifié et conquis ! Nous n'avons pas su ou voulu croire qu'ils venaient vers nous non comme un homme vers un autre homme mais comme un maître vers son esclave. Ainsi agissons-nous pourtant les uns contre les autres. Nous n'avons pas su qu'ils niaient notre humanité même. Mais à cela étions-nous vraiment préparés — nous qui nous croyions auparavant seuls hommes sur Terre ?
Première nuit, 5 novembre 1947 : I.
Première nuit, 5 novembre 1947 : I.
Video de Raharimanana (1)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : littérature malgacheVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Raharimanana (15)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Testez vos connaissances en poésie ! (niveau difficile)
Dans quelle ville Verlaine tira-t-il sur Rimbaud, le blessant légèrement au poignet ?
Paris
Marseille
Bruxelles
Londres
10 questions
1234 lecteurs ont répondu
Thèmes :
poésie
, poèmes
, poètesCréer un quiz sur ce livre1234 lecteurs ont répondu