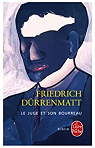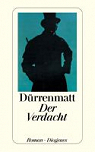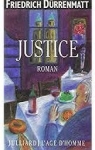Critiques filtrées sur 4 étoiles
Bienvenue chez les fous !
Voilà résumées les unités de temps, de lieu et même d’action puisqu’il s’agit d’une courte pièce de théâtre en deux actes, publiée en 1962 en pleine guerre froide, de l’auteur d’origine suisse Friedrich Dürrenmatt, qui se déroule exclusivement dans le salon d’une villa transformée en asile, au bord d’un lac sans histoire, quelque part en Europe.
Elle se dévore d’une traite, et si l’on accepte d’emblée l’absurdité totale de la situation, l’absence de repères traditionnels, c’est un petit bijou d’intrigue décalée à l’humour jubilatoire qui permet d’aborder légèrement en apparence des problèmes sérieux de l’humanité confrontée au progrès.
Jugez plutôt : au milieu de malades, spécimens issus de « l’élite mentalement dérangée de la moitié de l’Europe », un trio improbable de physiciens de renom, Einstein, Newton, Möbius, rien que cela, se trouve regroupé à l’écart des autres patients du fait, c’est évident n’est-ce pas, de la similitude de leurs mondes imaginaires respectifs. D’ordinaire très calmes, les deux premiers ont récemment étranglé leurs infirmières, quant au troisième qui obéit aux ordres du roi Salomon, il ne vaut guère mieux.
Inspecteur de police, infirmières, médecins vont et viennent, échangent, cherchent à comprendre, puis renoncent, manifestement déboussolés par l’attitude des physiciens qui donnent le change à merveille et finissent par les faire douter de leur propre santé mentale.
Qui est réellement fou dans cette histoire ?
Voilà en définitive LA véritable question. Les supposés scientifiques, les médecins ? Par extension, cette pièce soulève bien sûr le problème de la responsabilité des scientifiques directement impliqués dans le sort de l’humanité grâce à leurs découvertes. Serions-nous entre les mains de physiciens irresponsables ? Sommes-nous prisonniers ou eux-mêmes de leurs avancées ?
Impossible malheureusement de vous en dire davantage. Mais après avoir bousculé ses lecteurs et spectateurs, Dürrenmatt livre quelques pistes de réflexion regroupées à la fin de l'ouvrage : « La physique est l’affaire des physiciens, ses répercussions sont l’affaire de tous. » « Le drame peut duper le spectateur en le mettant face à la réalité, mais ne peut pas le contraindre à lui résister, et encore moins à la maitriser. "
Voilà résumées les unités de temps, de lieu et même d’action puisqu’il s’agit d’une courte pièce de théâtre en deux actes, publiée en 1962 en pleine guerre froide, de l’auteur d’origine suisse Friedrich Dürrenmatt, qui se déroule exclusivement dans le salon d’une villa transformée en asile, au bord d’un lac sans histoire, quelque part en Europe.
Elle se dévore d’une traite, et si l’on accepte d’emblée l’absurdité totale de la situation, l’absence de repères traditionnels, c’est un petit bijou d’intrigue décalée à l’humour jubilatoire qui permet d’aborder légèrement en apparence des problèmes sérieux de l’humanité confrontée au progrès.
Jugez plutôt : au milieu de malades, spécimens issus de « l’élite mentalement dérangée de la moitié de l’Europe », un trio improbable de physiciens de renom, Einstein, Newton, Möbius, rien que cela, se trouve regroupé à l’écart des autres patients du fait, c’est évident n’est-ce pas, de la similitude de leurs mondes imaginaires respectifs. D’ordinaire très calmes, les deux premiers ont récemment étranglé leurs infirmières, quant au troisième qui obéit aux ordres du roi Salomon, il ne vaut guère mieux.
Inspecteur de police, infirmières, médecins vont et viennent, échangent, cherchent à comprendre, puis renoncent, manifestement déboussolés par l’attitude des physiciens qui donnent le change à merveille et finissent par les faire douter de leur propre santé mentale.
Qui est réellement fou dans cette histoire ?
Voilà en définitive LA véritable question. Les supposés scientifiques, les médecins ? Par extension, cette pièce soulève bien sûr le problème de la responsabilité des scientifiques directement impliqués dans le sort de l’humanité grâce à leurs découvertes. Serions-nous entre les mains de physiciens irresponsables ? Sommes-nous prisonniers ou eux-mêmes de leurs avancées ?
Impossible malheureusement de vous en dire davantage. Mais après avoir bousculé ses lecteurs et spectateurs, Dürrenmatt livre quelques pistes de réflexion regroupées à la fin de l'ouvrage : « La physique est l’affaire des physiciens, ses répercussions sont l’affaire de tous. » « Le drame peut duper le spectateur en le mettant face à la réalité, mais ne peut pas le contraindre à lui résister, et encore moins à la maitriser. "
Le fou pense toujours que ce sont les autres qui sont fous; et dans cette pièce de théâtre aux allure de huis clos, on en a plus qu' un aperçu.
*
Trois hommes : Newton, Einstein et Möbius se succèdent devant un inspecteur de police, dans le salon d'un asile pour répondre de leurs actes.
Le personnel dudit asile fait son possible pour les dédouaner auprès de la maréchaussée.
Là ne s'arrête pas l'absurdité de la situation car les fous n'en sont pas, les physiciens non plus de même que les savants; mais la directrice de l'établissement pourrait bien avoir glisse dans un entre deux aliéné à force de ne fréquenter depuis des décennies que des situations absurdes.
Ironie de la situation, du récit et des différents acteurs, cette pièce est un petit bijou de l'auteur Suisse Friedrich Dürrenmatt.
*
Trois hommes : Newton, Einstein et Möbius se succèdent devant un inspecteur de police, dans le salon d'un asile pour répondre de leurs actes.
Le personnel dudit asile fait son possible pour les dédouaner auprès de la maréchaussée.
Là ne s'arrête pas l'absurdité de la situation car les fous n'en sont pas, les physiciens non plus de même que les savants; mais la directrice de l'établissement pourrait bien avoir glisse dans un entre deux aliéné à force de ne fréquenter depuis des décennies que des situations absurdes.
Ironie de la situation, du récit et des différents acteurs, cette pièce est un petit bijou de l'auteur Suisse Friedrich Dürrenmatt.
Les Physiciens de Dürrenmatt est une pièce peu jouée aujourd'hui en France alors qu'elle a connu un grand succès en Europe et particulièrement dans les pays germanophones dans les années qui ont suivi sa première en 1962. Elle est représentative d'un théâtre à thèse et engagé, dans l'esprit de celui de Brecht, qui n'est plus vraiment dans l'air du temps en ce début de XXIème siècle. Pourtant la pièce de Dürrenmatt me semble particulièrement d'actualité. Tout en développant une histoire avec des rebondissements et des situations comiques, son ambition, fort sérieuse, est de confronter le spectateur à la problématique de l'éthique dans la science et de le faire réfléchir à la possibilité d'un usage nocif des progrès scientifiques et à la façon dont il faut s'organiser collectivement pour empêcher les dérives. Certes le contexte n'est plus celui de 1962. La pièce fait référence aux éléments de l'époque : la menace s'appelait bombe atomique et le monde était déchiré entre deux blocs (USA contre URSS) qui utilisaient la science à des fins politiques ou idéologiques. Aujourd'hui, il faut lire la pièce en pensant aux biotechnologies ou à la capacité de traiter d'immenses quantités de données et aux changements que ceux-ci risquent d'introduire dans l'espèce humaine.
La force de la pièce est de poser ces questions philosophiques et politiques en se plaçant sur le terrain de la farce grotesque ou de l'absurde. Trois scientifiques sont internées dans une clinique psychiatrique. le premier se prend pour Einstein, le second pour Newton et le troisième du nom de Möbius s'entretient régulièrement avec le roi Salomon. Qui plus est, les trois malheureux commettent chacun un meurtre en étranglant leur infirmière attitrée (un parallèle est dressé avec les meurtres indirects dont la science et ses applications peuvent être l'origine). L'inspecteur de police Voss est présent sur place pour enquêter. La directrice de la clinique, l'héritière von Zahnd, règne sur son domaine.
En réalité, le savant Möbius n'a rien d'un fou. Il a découvert les lois de l'univers et pour ne pas que celles-ci soient mal utilisées et mettent en danger l'humanité, il a décidé de vivre coupé du monde dans un asile et de détruire ses travaux. Il réussit à convaincre ses deux collègues du bien-fondé de son approche. Ceux-ci, aussi peu fous que lui, viennent de deux puissances antagonistes et symbolisent deux attitudes possibles du scientifique, aussi peu satisfaisantes l'une que l'autre : se consacrer uniquement à la science pure sans se préoccuper de l'usage de son savoir ou se mettre au service du pouvoir politique en travaillant sur les applications de son savoir. Pourtant par le dénouement de la pièce, Dürrenmatt nous montre que le choix de Möbius n'est pas le bon. le savoir ne peut pas être mis sous clé et la politique de l'autruche n'empêche pas qu'il tombe en de mauvaises mains (politiques ou économiques). La pièce appelle à des choix faits de manière collective sur l'usage des avancées scientifiques.
Au-delà des trois physiciens, les autres personnages sont des archétypes de leur profession et en quelque sorte symbolisent chacun un corps social. le policier consciencieux du premier acte laisse couler au deuxième et peut être vu comme le symbole de la démission du pouvoir politique de nos sociétés européennes face aux enjeux fondamentaux. La directrice humaniste du premier acte devient une dingo prête à tout et avide de pouvoir et peut être vue comme le symbole de toutes les dérives mercantiles de certains acteurs de la société. Une de ses répliques à propos des fausses identités de ses patients fait directement référence à une phrase de Göring lorsqu'il disait ‘c'est moi qui décide qui est Juif'. L'ex-épouse de Möbius et son nouveau mari, un missionnaire sur le point de partir évangéliser les indigènes à l'autre bout du monde, sont des bien-pensants et des symboles de l'Eglise dont se moque Dürrenmatt.
En conclusion : une pièce qui recèle des possibilités de mise en scène intéressantes et qui gagne à être connue et à être vue sur scène plus souvent.
La force de la pièce est de poser ces questions philosophiques et politiques en se plaçant sur le terrain de la farce grotesque ou de l'absurde. Trois scientifiques sont internées dans une clinique psychiatrique. le premier se prend pour Einstein, le second pour Newton et le troisième du nom de Möbius s'entretient régulièrement avec le roi Salomon. Qui plus est, les trois malheureux commettent chacun un meurtre en étranglant leur infirmière attitrée (un parallèle est dressé avec les meurtres indirects dont la science et ses applications peuvent être l'origine). L'inspecteur de police Voss est présent sur place pour enquêter. La directrice de la clinique, l'héritière von Zahnd, règne sur son domaine.
En réalité, le savant Möbius n'a rien d'un fou. Il a découvert les lois de l'univers et pour ne pas que celles-ci soient mal utilisées et mettent en danger l'humanité, il a décidé de vivre coupé du monde dans un asile et de détruire ses travaux. Il réussit à convaincre ses deux collègues du bien-fondé de son approche. Ceux-ci, aussi peu fous que lui, viennent de deux puissances antagonistes et symbolisent deux attitudes possibles du scientifique, aussi peu satisfaisantes l'une que l'autre : se consacrer uniquement à la science pure sans se préoccuper de l'usage de son savoir ou se mettre au service du pouvoir politique en travaillant sur les applications de son savoir. Pourtant par le dénouement de la pièce, Dürrenmatt nous montre que le choix de Möbius n'est pas le bon. le savoir ne peut pas être mis sous clé et la politique de l'autruche n'empêche pas qu'il tombe en de mauvaises mains (politiques ou économiques). La pièce appelle à des choix faits de manière collective sur l'usage des avancées scientifiques.
Au-delà des trois physiciens, les autres personnages sont des archétypes de leur profession et en quelque sorte symbolisent chacun un corps social. le policier consciencieux du premier acte laisse couler au deuxième et peut être vu comme le symbole de la démission du pouvoir politique de nos sociétés européennes face aux enjeux fondamentaux. La directrice humaniste du premier acte devient une dingo prête à tout et avide de pouvoir et peut être vue comme le symbole de toutes les dérives mercantiles de certains acteurs de la société. Une de ses répliques à propos des fausses identités de ses patients fait directement référence à une phrase de Göring lorsqu'il disait ‘c'est moi qui décide qui est Juif'. L'ex-épouse de Möbius et son nouveau mari, un missionnaire sur le point de partir évangéliser les indigènes à l'autre bout du monde, sont des bien-pensants et des symboles de l'Eglise dont se moque Dürrenmatt.
En conclusion : une pièce qui recèle des possibilités de mise en scène intéressantes et qui gagne à être connue et à être vue sur scène plus souvent.
Dürrenmatt, définitivement trop peu connu en dehors des pays germanophones, signe peut-être ici un de ses plus grands chefs-d'oeuvre. Tout commence aux Cerisiers, asile psychiatrique où une infirmière vient d'être tuée par Einstein - ou plutôt, par Ernesti, physicien de métier, qui se prend pour Albert Einstein (rien que ça !). Et ce n'est pas le premier meurtre, ah non ! Par ici, les infirmières tombent comme des mouches : Newton - ou plutôt devrions-nous dire Beutler, encore un physicien - en avait tué une, lui aussi. Reste Mobiüs (devinez donc son métier) qui ne va pas tarder à suivre le mouvement. Mais pourquoi diable ?
Dans ce huis clos truculent au possible, on comprend peu à peu que ces physiciens sont loin d'être aussi fous qu'ils n'y paraissent. Dürrenmatt laisse son lecteur sur une question : à qui la faute, lorsque la science se révèle dangereuse, destructrice ? Aux savants ?
Dans ce huis clos truculent au possible, on comprend peu à peu que ces physiciens sont loin d'être aussi fous qu'ils n'y paraissent. Dürrenmatt laisse son lecteur sur une question : à qui la faute, lorsque la science se révèle dangereuse, destructrice ? Aux savants ?
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Friedrich Dürrenmatt (40)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Titres d'oeuvres célèbres à compléter
Ce conte philosophique de Voltaire, paru à Genève en 1759, s'intitule : "Candide ou --------"
L'Ardeur
L'Optimisme
10 questions
1308 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature française
, roman
, culture générale
, théâtre
, littérature
, livresCréer un quiz sur ce livre1308 lecteurs ont répondu