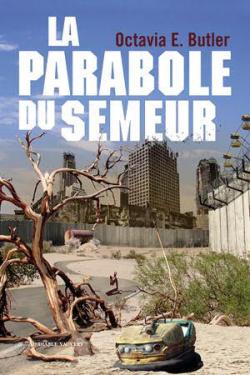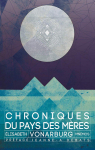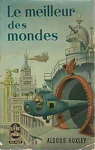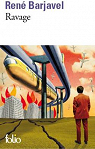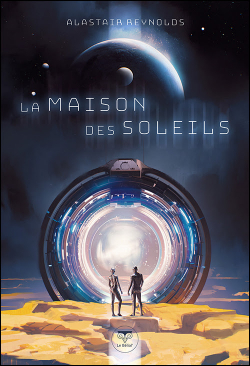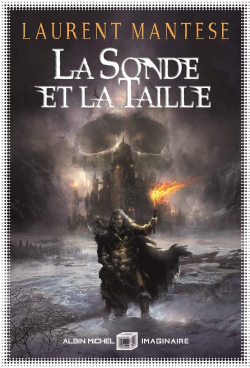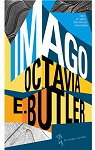Octavia E. Butler
Philippe Rouard (Traducteur)/5 297 notes
Philippe Rouard (Traducteur)/5 297 notes
Résumé :
Le nouveau président des Etats-Unis provoque une crise sans précédent. Dérèglement social et climatique, épidémies, pauvreté, violences... Dans ce décor post-apocalyptique, la barbarie règne, les murs s'élèvent. La fille d'un pasteur noir atteinte d'hyper-empathie entame la rédaction d'une Bible d'espoir et d'humanité, Le Livre des Vivants. Une anticipation visionnaire.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La Parabole du semeurVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (48)
Voir plus
Ajouter une critique
Ce livre est mon premier coup de coeur de l'année.
Ce roman est l'oeuvre d'une écrivaine noire, Octavia Butler. C'est la voix si singulière de sa narratrice, une jeune femme noire et empathique, nommée Lauren, qui lui donne son originalité et son intensité.
L'action se passe en 2024 aux Etats-Unis, les structures étatiques se sont effondrées sans qu'il nous soit donné une explication, l'insécurité règne partout.
Lauren, vit dans une petite communauté qui parvient à peu près à subvenir à ses besoins.
Elle tient un journal : la vie de cette petite communauté, les relations entre ses différents membres, et notamment les relations entre Lauren et son père, les petits incidents sont restitués avec le plus grand réalisme.
Dans ce journal, elle élabore une religion du changement, Semence de la Terre, une religion qui s'accorde parfaitement avec le monde instable qui est le sien.
Elle prévoit le pire pour sa petite communauté ; et le pire finit par arriver : sa communauté est détruite.
La deuxième partie du roman est absolument bouleversante.
Comment échapper aux prédateurs quand l'esclavage réapparaît ? Comment échapper à la mort quand les crimes racistes se multiplient ? Comment se défendre quand on ressent les blessures que l'on inflige ?
L'identification du lecteur à Lauren est totale, il partage au plus profond de lui-même les interrogations et les souffrances de la narratrice à la tête d'un petit groupe qui cherche désespérément à survivre.
Le journal de Lauren met en scène des êtres humains capables du meilleur comme du pire : alors que certains pillent, violent, tuent, d'autres se sacrifient pour que leurs compagnons puissent continuer leur route et gagner un lieu plus sûr...
Un livre magnifique.
P.-S. : le roman a été récemment réédité par les Editions Au Diable Vauvert.
Ce roman est l'oeuvre d'une écrivaine noire, Octavia Butler. C'est la voix si singulière de sa narratrice, une jeune femme noire et empathique, nommée Lauren, qui lui donne son originalité et son intensité.
L'action se passe en 2024 aux Etats-Unis, les structures étatiques se sont effondrées sans qu'il nous soit donné une explication, l'insécurité règne partout.
Lauren, vit dans une petite communauté qui parvient à peu près à subvenir à ses besoins.
Elle tient un journal : la vie de cette petite communauté, les relations entre ses différents membres, et notamment les relations entre Lauren et son père, les petits incidents sont restitués avec le plus grand réalisme.
Dans ce journal, elle élabore une religion du changement, Semence de la Terre, une religion qui s'accorde parfaitement avec le monde instable qui est le sien.
Elle prévoit le pire pour sa petite communauté ; et le pire finit par arriver : sa communauté est détruite.
La deuxième partie du roman est absolument bouleversante.
Comment échapper aux prédateurs quand l'esclavage réapparaît ? Comment échapper à la mort quand les crimes racistes se multiplient ? Comment se défendre quand on ressent les blessures que l'on inflige ?
L'identification du lecteur à Lauren est totale, il partage au plus profond de lui-même les interrogations et les souffrances de la narratrice à la tête d'un petit groupe qui cherche désespérément à survivre.
Le journal de Lauren met en scène des êtres humains capables du meilleur comme du pire : alors que certains pillent, violent, tuent, d'autres se sacrifient pour que leurs compagnons puissent continuer leur route et gagner un lieu plus sûr...
Un livre magnifique.
P.-S. : le roman a été récemment réédité par les Editions Au Diable Vauvert.
Hem hem ! du post-apocalyptique, j'avoue que j'en ai un peu trop bouffé ces dernières années, je sature un peu. Et le personnage est la fille d'un pasteur, le thème religieux est aussi très présent, et j'ai toujours une certaine méfiance vis à vis de ce sujet, surtout dans la SF. Alors je me suis lancé dans cette lecture avec quelques doutes, au bout d'une trentaine de pages, je me suis demandé si je n'allais pas le laisser de côté pour une autre fois. J'ai choisi de continuer, et j'ai bien fait.
Ce récit est écrit en 1993, il n'est pas dans le phénomène de mode actuelle, et reste assez éloigné des stéréotypes actuels, il se rapprocherait plutôt des oeuvres de Julia Verlanger ou surtout de David Brin, avec “Le facteur”, vu que l'action se déroule dans la même région. Alors si ce livre explore un thème vu et revu des milliers de fois, il apporte indéniablement sa pierre à l'édifice.
L'originalité de ce roman, c'est qu'il se passe non pas quand tout est devenu barbarie ou quand tout est en train de se reconstruire, mais qu'il raconte la montée progressive de la barbarie, avec le retour de l'esclavagisme, la corruption de la police, la libéralisation d'un capitalisme sans éthique (le président Donner du roman n'est pas loin dans ses idées d'un certain Donald Trump). L'aspect écologique est évoqué, avec cette situation de sécheresse sur les Etats-Unis qui entraîne la faim, la misère, la baisse de l'hygiène et la remontée du racisme… Sous certains points, ce monde ressemble encore un peu au nôtre, le travail salarié est encore une valeur en cours, la famille et les voisins se soutiennent, du moins dans certains quartiers épargnés, murés comme celui où vit Lauren. Mais on sent l'équilibre précaire et le Monde de Mad Max s'approche dangereusement.
Le traitement de cette évolution est présenté avec une rigueur réaliste qui rend le récit effrayant et passionnant, la tension est palpable. Et puis il y a ce personnage de Lauren qui est vraiment un des personnages les plus intéressant de la littérature post-apocalyptique, justement grâce à l'apport du thème de la religion. Elle se construit sa propre théosophie, comme un rempart contre le désespoir, et on suit au fil des pages cette construction comme la naissance d'une religion comme système de défense par la pensée, encore épargnée par les rites et les dogmes. L'approche est subtile, la raison de cette recherche se justifie dans l'évolution même de sa vie, l'auteure ne nous martèle pas de mystique ou de béatitude, mais au contraire, on suit le cheminement de la pensée de Lauren, comme une manière de survivre, une nécessité qui va justifier ses actes. La parabole du semeur est un texte des évangiles, avec son personnage, Octavia E. Butler nous en propose une interprétation face à la déliquescence de la civilisation. Avec cet aspect, ce roman va plus loin qu'un simple roman d'aventure, il explore le fond de la nature humaine, des manières de penser, et pour ne rien gâcher, en nous offrant de beaux moments d'émotions.
Est-ce que c'est le meilleur roman post-apocalyptique que j'ai lu ? J'en ai lu tellement, je ne pourrais pas l'affirmer, mais celui-ci est vraiment marquant, je ne l'oublierai pas de sitôt.
Ce récit est écrit en 1993, il n'est pas dans le phénomène de mode actuelle, et reste assez éloigné des stéréotypes actuels, il se rapprocherait plutôt des oeuvres de Julia Verlanger ou surtout de David Brin, avec “Le facteur”, vu que l'action se déroule dans la même région. Alors si ce livre explore un thème vu et revu des milliers de fois, il apporte indéniablement sa pierre à l'édifice.
L'originalité de ce roman, c'est qu'il se passe non pas quand tout est devenu barbarie ou quand tout est en train de se reconstruire, mais qu'il raconte la montée progressive de la barbarie, avec le retour de l'esclavagisme, la corruption de la police, la libéralisation d'un capitalisme sans éthique (le président Donner du roman n'est pas loin dans ses idées d'un certain Donald Trump). L'aspect écologique est évoqué, avec cette situation de sécheresse sur les Etats-Unis qui entraîne la faim, la misère, la baisse de l'hygiène et la remontée du racisme… Sous certains points, ce monde ressemble encore un peu au nôtre, le travail salarié est encore une valeur en cours, la famille et les voisins se soutiennent, du moins dans certains quartiers épargnés, murés comme celui où vit Lauren. Mais on sent l'équilibre précaire et le Monde de Mad Max s'approche dangereusement.
Le traitement de cette évolution est présenté avec une rigueur réaliste qui rend le récit effrayant et passionnant, la tension est palpable. Et puis il y a ce personnage de Lauren qui est vraiment un des personnages les plus intéressant de la littérature post-apocalyptique, justement grâce à l'apport du thème de la religion. Elle se construit sa propre théosophie, comme un rempart contre le désespoir, et on suit au fil des pages cette construction comme la naissance d'une religion comme système de défense par la pensée, encore épargnée par les rites et les dogmes. L'approche est subtile, la raison de cette recherche se justifie dans l'évolution même de sa vie, l'auteure ne nous martèle pas de mystique ou de béatitude, mais au contraire, on suit le cheminement de la pensée de Lauren, comme une manière de survivre, une nécessité qui va justifier ses actes. La parabole du semeur est un texte des évangiles, avec son personnage, Octavia E. Butler nous en propose une interprétation face à la déliquescence de la civilisation. Avec cet aspect, ce roman va plus loin qu'un simple roman d'aventure, il explore le fond de la nature humaine, des manières de penser, et pour ne rien gâcher, en nous offrant de beaux moments d'émotions.
Est-ce que c'est le meilleur roman post-apocalyptique que j'ai lu ? J'en ai lu tellement, je ne pourrais pas l'affirmer, mais celui-ci est vraiment marquant, je ne l'oublierai pas de sitôt.
2024. Dans une Amérique en déliquescence, Lauren et sa famille tâchent de survivre face à ce monde qui sombre dans le chaos...
''La Parabole du Semeur'' est le premier livre de Octavia Butler que je lis, mais j'en entends beaucoup de bien depuis bien des années. Elle est souvent qualifiée d'autrice exceptionnelle, et ses livres d'absolument géniaux. C'est donc avec une certaine attente que j'ai ouvert celui-ci. Une attente vague par contre, je pensais lire quelque chose d'à part, de vraiment supérieur en terme de qualité, mais sans avoir de précisions sur ces attentes. J'attendais d'être surprise dans le bon sens donc. Mais malheureusement, ce livre n'a pas été un coup de coeur, loin de là. Précisons tout de suite qu'il est effectivement bon, je ne dirais absolument pas le contraire, mais il m'a laissée sur une impression de malaise qu'il m'a fallu plusieurs jours pour comprendre. Ma critique sera peut-être trop désordonnée, ou trop ordonnée au contraire, mais je vais tâcher de partager au mieux mes ressentis.
1/ Un monde flou.
Tout le début du livre se situe dans un quartier entouré et protégé de hauts murs qui le sépare du reste de la ville, du reste du monde. En sortir est potentiellement dangereux, on se rend rapidement compte que la violence est omniprésente à l'extérieur. Les chiens sont redevenus sauvages, les hommes aussi. Aucun déplacement ne se fait seul ou sans arme, tout le monde est susceptible d'être un ennemi mortel. Dès le début, j'ai donc été emportée par cette atmosphère sombre, angoissante, violente. L'intérieur de ce petit quartier apparaît comme un ultime îlot de civilisation, tandis que tout ce qui se situe en dehors est diabolisé. On dit que le président Donner veut faire si, à dit ça. On dit que les grandes compagnies esclavagent les gens. On dit qu'on est en pleine catastrophe climatique. Sauf que rapidement, on se rend compte qu'aucune information n'est réelle, vérifiée, concrète. Dans son journal, Lauren rapporte des on-dit, retranscrit les avis des gens qui l'entourent, mais jamais on ne sait réellement ce qui se passe.
On nous parle ainsi du manque d'eau dramatique, et pourtant nous ne verrons personne mourir de soif, de même qu'il est certes mentionné plusieurs fois qu'il fait chaud, mais jamais cette sensation ne sera aussi vivace que dans ''Soleil Vert'' par exemple. Même durant le long exil de Lauren vers le nord, l'eau ne sera pas un problème. A un moment, il sera bien mentionné que c'est la dernière bouteille qui est ouverte, mais sans que cela n'ait de conséquence vu que les personnages arriveront aussitôt à un lac. Dont le niveau a diminué, certes, mais qui est toujours là pour étancher la soif de quiconque y passe. Partant de là, j'ai eu du mal à saisir ce qu'il se passait réellement : est-ce que l'autrice est restée un peu floue mais que le manque d'eau est réel ? Est-ce que ce manque est naturel (alors qu'il fait chaud mais moins que dans Soleil Vert) ou alors la pénurie est-il organisée par quelqu'un ? Ou alors, est-ce simplement le résultat de la paranoïa des personnages ? Difficile d'en être sûre, il demeure un flou qui malheureusement entoure absolument tout.
On nous parle ainsi du président Donner, mais s'il est entouré de on-dit, on ne sait jamais réellement ce qu'il fait. Il veut stopper le programme spatial, mais l'a-t-il vraiment fait ? Lauren s'en choquera d'ailleurs, mais n'est-ce pas raisonnable vu la situation sanitaire et sociale ? On apprend aussi que des compagnies achètent des villes, que le père de Lauren pense qu'il s'agit d'esclavage, mais en est-ce vraiment ? Les USA sont littéralement en train de s'effondrer, c'est à se demander si une administration d'état existe encore dans de telles conditions. Bientôt (et c'est déjà étonnant que ce ne soit pas le cas), l'argent ne vaudra plus rien, ce ne sera plus que des pièces et des bouts de papier. Vivre dans une communauté sécurisée, avec de la nourriture et de l'eau, c'est en revanche une richesse qui permet de survivre, que rien ne vient jamais atténuer.
Malheureusement, Lauren ne vient jamais questionner ces on-dit, elle bâtit son regard du monde extérieur dessus. Rien n'est objectif, tout en subjectif. Et si, dans un monde normal, être rémunéré en nature plutôt qu'en argent serait effectivement choquant, je trouve ça un peu simpliste de ne pas se poser la question sous l'angle de ce monde en déliquescence. C'est d'ailleurs l'un des soucis de ce livre : quelque fois, les personnages admettent des comportements amoraux à cause de la situation présente, là où pour d'autres éléments, ils envisagent toujours ce qu'il faut faire en prenant l'ancien monde comme référence. Il en ressort donc un monde extérieur trop flou, trop subjectif, en tout cas à mon goût.
2/ Une héroïne parfaite.
Avouons-le de suite, je n'ai pas ressenti de réelle empathie pour Lauren. C'est sans doute elle plus que tout le reste de l'histoire/ambiance qui a été source de malaise pour moi, et il m'a fallu un peu de recul pour comprendre pourquoi. Jeune fille intelligente, sensible, hyper-empathique, courageuse... elle cumule beaucoup de qualité, réfléchit beaucoup et oeuvre pour le bien de tous. Son intérêt pour la religion la ferait presque passer pour une sainte, et c'est là que le bât blesse : Sainte Lauren n'est pas si parfaite que ça. Tout le long du livre, je me suis rendue compte que pour quelqu'un de très religieux, elle jugeait quand même beaucoup les gens. A vrai dire, elle juge tout, tout le monde, et tout le temps. Elle porte un regard très particulier sur le monde, biaisé pourrait-on dire, mais qui n'est pourtant jamais remis en question ou presque. Quoi que dise Lauren, elle a raison. Peut-être pas maintenant, mais à terme l'histoire lui donnera forcément raison quand même.
Ainsi quand elle parle de préparer des paquetages de survie, l'idée prend de suite une ampleur que j'ai trouvé exagérée : c'est la fin du monde, les gens se sont murés pour ne pas vivre avec le reste des humains, ils sont tous armés et prêts à dézinguer leurs prochains... mais préparer un sac, c'est trop pour eux ? Même le père - qui pourtant enterre de l'argent dans le jardin - demande à sa fille de ne pas inquiéter les gens. La communauté vit littéralement dans la paranoïa, la peur et le dégout des humains qui ne vivent pas dans leur quartier, on constate la violence qui y règne. Institutionnalisée et présentée comme étant ''pour le bien de la communauté'' mais la violence reste tout de même la violence. J'avoue que ce moment m'a fait un peu décrocher : au final, Lauren propose juste de préparer un sac de secours, pas de creuser des bunker ou de fabriquer une bombe atomique dans son jardin, et pourtant le rejet de son idée est absolue. Même quand les feux et les intrusions deviendront plus courants (avec des gens de l'extérieur qui se font tirer dessus et qui meurent), son idée ne sera pas utilisée. Et bien sûr, lorsque le quartier tombe, on se rend compte que Lauren avait raison, que Lauren avait tout compris. Cet aspect m'a paru un peu incohérent, forcé, et sa pseudo résilience à ce moment-là m'est clairement apparu comme de l'hypocrisie. Ce quartier est profondément hypocrite, les gens ne s'aiment pas, ils ont les mêmes vices que les autres humains. La seule chose qui les distingue, c'est la chance qu'ils ont de vivre entourés d'un mur, ce qui ne les empêche pas de juger et critiquer les autres humains qui se sont organisés eux aussi. Et pourtant, Lauren est l'héroïne, pas l'antagoniste. En matière de poutre dans l'oeil, Lauren et son quartier sont de superbes exemples. Et pourtant, le livre ne remet jamais ça en cause, ce qui aurait pu être fait par le biais d'un personnage externe qui aurait pu intervenir pour expliquer que ces humains-là ne valaient ni plus ni moins que les autres.
3/ Sainte Lauren.
Bien que ne croyant pas en Dieu, je trouve que le sujet de la religion est passionnant, et j'aime beaucoup en parler avec des amis qui sont croyants (j'ai même un ami qui a failli devenir prêtre). Dans la pure tradition américaine, les habitants du quartier sont très croyants, mais croyants à leur façon. ''Tu ne tueras point'' semble avoir été un peu oublié au passage, et si l'on peut très bien comprendre la nécessité de défendre sa vie, on constate assez rapidement que prendre une vie ne déclenche aucune culpabilité, aucun dilemme moral. Lauren le dira elle-même plusieurs fois, qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, sans en éprouver de culpabilité ou de remords, comme s'il était finalement très facile de tuer. Même souci pour son père, qui bat quelque fois ses enfants, avec beaucoup de brutalité d'ailleurs, mais c'est ''pour leur bien''. Lorsque Keith et Lauren en parleront, elle ira d'ailleurs jusqu'à défendre son père. Mais battre des enfants, est-ce si bien que ça ? Est-ce moral ? Dans un monde comme celui-ci, n'est-ce pas rajouter du chaos au chaos ? Non, parce qu'ici (comme dans la réalité d'ailleurs), les américains semblent posséder une certaine dualité : on élève la religion au-dessus de tout, mais exclusivement quand ça nous arrange. Si l'autre tue, c'est un monstre, un animal, il sera châtié par Dieu. Mais si l'un des membres de la communauté tue ben... eh oh, c'était le mieux à faire hein, personne ne pourra ne me le reprocher, les autres étaient méchants et moi j'ai rendu la justice de Dieu, j'ai fait le Bien. Là encore, je trouve dans ce genre de respect de la religion à la carte, une forme profonde et dangereuse d'hypocrisie.
Mais si la religion traditionnelle est personnifiée par le père et le reste de la communauté, Lauren s'est inventé la religion. Ou plutôt non, comme elle insistera beaucoup dessus, elle n'a pas inventé, elle a découvert (se permettant même de comparer religion et sciences). D'un côté, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'elle essaye de s'inventer sa propre religion, son propre code moral finalement, ses espoirs aussi. Elle y mélange des morceaux d'autres religions, des phrases pseudo-philosophiques, un délire spatial, dans un résultat que j'ai trouvé un peu niais et simpliste. Mais au final, si elle choisit d'y croire et que ça l'aide, c'est très bien. Mon souci par contre, c'est quand elle entreprend de convertir des gens, parce qu'encore une fois, sa religion est beaucoup trop simpliste. J'ai eu l'impression de lire les délires pseudo-philosophiques d'une adolescente, ce qu'elle est, et je peine à croire que qui que ce soit puisse décider d'y croire aussi, ou alors c'est que tous ces gens sont vraiment trop influençables. Les preuves de Lauren relèvent d'ailleurs de la mauvaise foi : il y a du changement, Dieu est le changement, donc comme tu constates que le monde change, ça veut dire que tu crois en Dieu. Là encore, c'est hypocrite, et Lauren l'écrit d'ailleurs dans son journal : elle veut pousser les gens à penser à sa religion, elle les convertit petit à petit, en douceur, pour qu'ils ne se rendent même pas compte qu'elle les convertit. Lauren est un gourou de secte, ni plus ni moins.
D'autant plus que dans son entreprise, elle dispose d'un pouvoir ''surnaturel'' qui m'a semblé bien pratique : son hyper-empathie. Présentée comme un handicap, cette hyper-empathie ne se réveille pas tout le temps (ça m'a choquée à plusieurs reprises d'ailleurs), et si elle peut ressentir souffrances et plaisirs des autres, elle ne peut en revanche pas ressentir leurs peurs, leurs joies, leurs doutes... là encore, son pouvoir est ''à la carte'', et il lui permet de s'imposer plusieurs fois via un raisonnement assez simpliste : Lauren ressent la souffrance, donc si elle blesse/tue quelqu'un, elle en souffrira, ce qui veut dire qu'elle a bien pesé le pour et le contre, donc qu'elle ne peut pas se tromper. A l'image du Christ sur sa croix, l'hyper-empathie de Lauren la transforme ainsi en figure christique qui souffre pour les pêchés humains, les lavent et permet à ses fidèles de s'élever au-dessus de ceux qui sont décrit comme des bêtes.
Encore une fois, Lauren est un gourou de secte.
Enfin, si Lauren est le gourou de sa religion, elle est aussi une dictatrice ''bienveillante''. C'est particulièrement flagrant lorsque le groupe se créé sur la route : c'est elle qui commande, et si d'aventure quelqu'un l'a critique, critique ses choix, ou demande simplement à en parler, la sanction tombe : si tu n'es pas d'accord, tu peux partir. Dans un mécanisme particulièrement violent moralement, elle offre ainsi la sécurité d'un groupe à des gens esseulés, les rends finalement ''accros'' à cette sécurité relative procurée par le nombre, puis menace de jeter dehors quiconque ose remettre en doute ses choix. On le voit d'ailleurs bien tout à la fin, lorsque Mora propose de veiller avec elle, et qu'il demande s'il peut avoir une arme. Lauren lui précise qu'elle refuse, au motif qu'il ne sait pas tirer. le souci, c'est que c'est le cas pour tous ceux qu'elle a récupéré en cours de route : personne ne savait tirer, et la question est vite éludée dans son journal par un ''ils ont appris à tirer sur la route''. Vu le peu de cartouches et leur valeur, ils ont dû tirer quoi, une fois ? Deux à tout casser ? Finalement, Mora ne sait donc tirer ni plus ni moins que les autres, et pourtant Lauren s'acharne. En cas d'attaque, c'est pourtant Mora qui a raison : s'il n'est pas armé, que fera-t-il ? Devra-t-il se sacrifier et attaquer à mains nues un attaquant armé qui le tuera ? Hurler pour réveiller tout le campement, quitte à indiquer leur position à tout le monde et à les rendre encore plus vulnérable ? Perdre du temps à rejoindre Lauren ou réveiller quelqu'un qui possède une arme, qui à perdre de précieuses secondes qui pourraient couter la vie à quelqu'un ?
D'un point de vue purement pratique, Mora a entièrement raison, et pourtant Lauren refuse tout en restant dans une position neutre. Elle pourrait refuser que Mora s'occupe de la garde avec elle, désigner quelqu'un d'autre, mais elle préfère ne pas prendre cette responsabilité. Elle préfère que Bankole s'érige comme son bras et menace Mora de le virer en lui indiquant que s'il n'est pas content, il peut se casser et rejoindre un groupe de macho. Ah, parce que ne pas être d'accord avec une femme, c'est forcément être macho ? Quoi qu'il en soit, on voit rapidement que Lauren a instillé les graines du ''obéis ou part mourir seul'', et qu'elle a si bien opérer son travail d'amadouement des autres qu'elle n'a même plus à délivrer sa menace elle-même.
____
Au final, j'ai donc trouvé que Lauren était manipulatrice et hypocrite, et j'ai eu beaucoup de mal à la voir pourtant avancer, obéie et encensée par son petit groupe.
Après quelques recherches sur l'autrice, je me suis rendue compte qu'elle et Lauren se ressemblent énormément, Lauren est la version fantasmée de Octavia Butler, courageuse messie sauvant son peuple de la fin du monde. Je ne pense donc pas que Lauren soit vraiment un personnage négatif, je pense réellement que l'autrice voulait passer un message au contraire très positif. Malheureusement, le flou de l'ambiance et du monde, les facilités énormes de Lauren, l'histoire qui lui donne toujours raison, les gens qui la croient et lui obéissent avec tant de facilité... tout ça m'a laissée un certain malaise. La violence ''bienveillante'' n'est qu'une violence comme une autre, qui ne vaut pas mieux qu'une autre. En ne se questionnant jamais dessus, le livre (et Lauren par extension) tendent pourtant à la légitimer. Encore une fois, je pense qu'il s'agit simplement d'une maladresse, que l'autrice ne voulait pas dire ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, et ça m'a gênée.
''La Parabole du Semeur'' est le premier livre de Octavia Butler que je lis, mais j'en entends beaucoup de bien depuis bien des années. Elle est souvent qualifiée d'autrice exceptionnelle, et ses livres d'absolument géniaux. C'est donc avec une certaine attente que j'ai ouvert celui-ci. Une attente vague par contre, je pensais lire quelque chose d'à part, de vraiment supérieur en terme de qualité, mais sans avoir de précisions sur ces attentes. J'attendais d'être surprise dans le bon sens donc. Mais malheureusement, ce livre n'a pas été un coup de coeur, loin de là. Précisons tout de suite qu'il est effectivement bon, je ne dirais absolument pas le contraire, mais il m'a laissée sur une impression de malaise qu'il m'a fallu plusieurs jours pour comprendre. Ma critique sera peut-être trop désordonnée, ou trop ordonnée au contraire, mais je vais tâcher de partager au mieux mes ressentis.
1/ Un monde flou.
Tout le début du livre se situe dans un quartier entouré et protégé de hauts murs qui le sépare du reste de la ville, du reste du monde. En sortir est potentiellement dangereux, on se rend rapidement compte que la violence est omniprésente à l'extérieur. Les chiens sont redevenus sauvages, les hommes aussi. Aucun déplacement ne se fait seul ou sans arme, tout le monde est susceptible d'être un ennemi mortel. Dès le début, j'ai donc été emportée par cette atmosphère sombre, angoissante, violente. L'intérieur de ce petit quartier apparaît comme un ultime îlot de civilisation, tandis que tout ce qui se situe en dehors est diabolisé. On dit que le président Donner veut faire si, à dit ça. On dit que les grandes compagnies esclavagent les gens. On dit qu'on est en pleine catastrophe climatique. Sauf que rapidement, on se rend compte qu'aucune information n'est réelle, vérifiée, concrète. Dans son journal, Lauren rapporte des on-dit, retranscrit les avis des gens qui l'entourent, mais jamais on ne sait réellement ce qui se passe.
On nous parle ainsi du manque d'eau dramatique, et pourtant nous ne verrons personne mourir de soif, de même qu'il est certes mentionné plusieurs fois qu'il fait chaud, mais jamais cette sensation ne sera aussi vivace que dans ''Soleil Vert'' par exemple. Même durant le long exil de Lauren vers le nord, l'eau ne sera pas un problème. A un moment, il sera bien mentionné que c'est la dernière bouteille qui est ouverte, mais sans que cela n'ait de conséquence vu que les personnages arriveront aussitôt à un lac. Dont le niveau a diminué, certes, mais qui est toujours là pour étancher la soif de quiconque y passe. Partant de là, j'ai eu du mal à saisir ce qu'il se passait réellement : est-ce que l'autrice est restée un peu floue mais que le manque d'eau est réel ? Est-ce que ce manque est naturel (alors qu'il fait chaud mais moins que dans Soleil Vert) ou alors la pénurie est-il organisée par quelqu'un ? Ou alors, est-ce simplement le résultat de la paranoïa des personnages ? Difficile d'en être sûre, il demeure un flou qui malheureusement entoure absolument tout.
On nous parle ainsi du président Donner, mais s'il est entouré de on-dit, on ne sait jamais réellement ce qu'il fait. Il veut stopper le programme spatial, mais l'a-t-il vraiment fait ? Lauren s'en choquera d'ailleurs, mais n'est-ce pas raisonnable vu la situation sanitaire et sociale ? On apprend aussi que des compagnies achètent des villes, que le père de Lauren pense qu'il s'agit d'esclavage, mais en est-ce vraiment ? Les USA sont littéralement en train de s'effondrer, c'est à se demander si une administration d'état existe encore dans de telles conditions. Bientôt (et c'est déjà étonnant que ce ne soit pas le cas), l'argent ne vaudra plus rien, ce ne sera plus que des pièces et des bouts de papier. Vivre dans une communauté sécurisée, avec de la nourriture et de l'eau, c'est en revanche une richesse qui permet de survivre, que rien ne vient jamais atténuer.
Malheureusement, Lauren ne vient jamais questionner ces on-dit, elle bâtit son regard du monde extérieur dessus. Rien n'est objectif, tout en subjectif. Et si, dans un monde normal, être rémunéré en nature plutôt qu'en argent serait effectivement choquant, je trouve ça un peu simpliste de ne pas se poser la question sous l'angle de ce monde en déliquescence. C'est d'ailleurs l'un des soucis de ce livre : quelque fois, les personnages admettent des comportements amoraux à cause de la situation présente, là où pour d'autres éléments, ils envisagent toujours ce qu'il faut faire en prenant l'ancien monde comme référence. Il en ressort donc un monde extérieur trop flou, trop subjectif, en tout cas à mon goût.
2/ Une héroïne parfaite.
Avouons-le de suite, je n'ai pas ressenti de réelle empathie pour Lauren. C'est sans doute elle plus que tout le reste de l'histoire/ambiance qui a été source de malaise pour moi, et il m'a fallu un peu de recul pour comprendre pourquoi. Jeune fille intelligente, sensible, hyper-empathique, courageuse... elle cumule beaucoup de qualité, réfléchit beaucoup et oeuvre pour le bien de tous. Son intérêt pour la religion la ferait presque passer pour une sainte, et c'est là que le bât blesse : Sainte Lauren n'est pas si parfaite que ça. Tout le long du livre, je me suis rendue compte que pour quelqu'un de très religieux, elle jugeait quand même beaucoup les gens. A vrai dire, elle juge tout, tout le monde, et tout le temps. Elle porte un regard très particulier sur le monde, biaisé pourrait-on dire, mais qui n'est pourtant jamais remis en question ou presque. Quoi que dise Lauren, elle a raison. Peut-être pas maintenant, mais à terme l'histoire lui donnera forcément raison quand même.
Ainsi quand elle parle de préparer des paquetages de survie, l'idée prend de suite une ampleur que j'ai trouvé exagérée : c'est la fin du monde, les gens se sont murés pour ne pas vivre avec le reste des humains, ils sont tous armés et prêts à dézinguer leurs prochains... mais préparer un sac, c'est trop pour eux ? Même le père - qui pourtant enterre de l'argent dans le jardin - demande à sa fille de ne pas inquiéter les gens. La communauté vit littéralement dans la paranoïa, la peur et le dégout des humains qui ne vivent pas dans leur quartier, on constate la violence qui y règne. Institutionnalisée et présentée comme étant ''pour le bien de la communauté'' mais la violence reste tout de même la violence. J'avoue que ce moment m'a fait un peu décrocher : au final, Lauren propose juste de préparer un sac de secours, pas de creuser des bunker ou de fabriquer une bombe atomique dans son jardin, et pourtant le rejet de son idée est absolue. Même quand les feux et les intrusions deviendront plus courants (avec des gens de l'extérieur qui se font tirer dessus et qui meurent), son idée ne sera pas utilisée. Et bien sûr, lorsque le quartier tombe, on se rend compte que Lauren avait raison, que Lauren avait tout compris. Cet aspect m'a paru un peu incohérent, forcé, et sa pseudo résilience à ce moment-là m'est clairement apparu comme de l'hypocrisie. Ce quartier est profondément hypocrite, les gens ne s'aiment pas, ils ont les mêmes vices que les autres humains. La seule chose qui les distingue, c'est la chance qu'ils ont de vivre entourés d'un mur, ce qui ne les empêche pas de juger et critiquer les autres humains qui se sont organisés eux aussi. Et pourtant, Lauren est l'héroïne, pas l'antagoniste. En matière de poutre dans l'oeil, Lauren et son quartier sont de superbes exemples. Et pourtant, le livre ne remet jamais ça en cause, ce qui aurait pu être fait par le biais d'un personnage externe qui aurait pu intervenir pour expliquer que ces humains-là ne valaient ni plus ni moins que les autres.
3/ Sainte Lauren.
Bien que ne croyant pas en Dieu, je trouve que le sujet de la religion est passionnant, et j'aime beaucoup en parler avec des amis qui sont croyants (j'ai même un ami qui a failli devenir prêtre). Dans la pure tradition américaine, les habitants du quartier sont très croyants, mais croyants à leur façon. ''Tu ne tueras point'' semble avoir été un peu oublié au passage, et si l'on peut très bien comprendre la nécessité de défendre sa vie, on constate assez rapidement que prendre une vie ne déclenche aucune culpabilité, aucun dilemme moral. Lauren le dira elle-même plusieurs fois, qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, sans en éprouver de culpabilité ou de remords, comme s'il était finalement très facile de tuer. Même souci pour son père, qui bat quelque fois ses enfants, avec beaucoup de brutalité d'ailleurs, mais c'est ''pour leur bien''. Lorsque Keith et Lauren en parleront, elle ira d'ailleurs jusqu'à défendre son père. Mais battre des enfants, est-ce si bien que ça ? Est-ce moral ? Dans un monde comme celui-ci, n'est-ce pas rajouter du chaos au chaos ? Non, parce qu'ici (comme dans la réalité d'ailleurs), les américains semblent posséder une certaine dualité : on élève la religion au-dessus de tout, mais exclusivement quand ça nous arrange. Si l'autre tue, c'est un monstre, un animal, il sera châtié par Dieu. Mais si l'un des membres de la communauté tue ben... eh oh, c'était le mieux à faire hein, personne ne pourra ne me le reprocher, les autres étaient méchants et moi j'ai rendu la justice de Dieu, j'ai fait le Bien. Là encore, je trouve dans ce genre de respect de la religion à la carte, une forme profonde et dangereuse d'hypocrisie.
Mais si la religion traditionnelle est personnifiée par le père et le reste de la communauté, Lauren s'est inventé la religion. Ou plutôt non, comme elle insistera beaucoup dessus, elle n'a pas inventé, elle a découvert (se permettant même de comparer religion et sciences). D'un côté, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'elle essaye de s'inventer sa propre religion, son propre code moral finalement, ses espoirs aussi. Elle y mélange des morceaux d'autres religions, des phrases pseudo-philosophiques, un délire spatial, dans un résultat que j'ai trouvé un peu niais et simpliste. Mais au final, si elle choisit d'y croire et que ça l'aide, c'est très bien. Mon souci par contre, c'est quand elle entreprend de convertir des gens, parce qu'encore une fois, sa religion est beaucoup trop simpliste. J'ai eu l'impression de lire les délires pseudo-philosophiques d'une adolescente, ce qu'elle est, et je peine à croire que qui que ce soit puisse décider d'y croire aussi, ou alors c'est que tous ces gens sont vraiment trop influençables. Les preuves de Lauren relèvent d'ailleurs de la mauvaise foi : il y a du changement, Dieu est le changement, donc comme tu constates que le monde change, ça veut dire que tu crois en Dieu. Là encore, c'est hypocrite, et Lauren l'écrit d'ailleurs dans son journal : elle veut pousser les gens à penser à sa religion, elle les convertit petit à petit, en douceur, pour qu'ils ne se rendent même pas compte qu'elle les convertit. Lauren est un gourou de secte, ni plus ni moins.
D'autant plus que dans son entreprise, elle dispose d'un pouvoir ''surnaturel'' qui m'a semblé bien pratique : son hyper-empathie. Présentée comme un handicap, cette hyper-empathie ne se réveille pas tout le temps (ça m'a choquée à plusieurs reprises d'ailleurs), et si elle peut ressentir souffrances et plaisirs des autres, elle ne peut en revanche pas ressentir leurs peurs, leurs joies, leurs doutes... là encore, son pouvoir est ''à la carte'', et il lui permet de s'imposer plusieurs fois via un raisonnement assez simpliste : Lauren ressent la souffrance, donc si elle blesse/tue quelqu'un, elle en souffrira, ce qui veut dire qu'elle a bien pesé le pour et le contre, donc qu'elle ne peut pas se tromper. A l'image du Christ sur sa croix, l'hyper-empathie de Lauren la transforme ainsi en figure christique qui souffre pour les pêchés humains, les lavent et permet à ses fidèles de s'élever au-dessus de ceux qui sont décrit comme des bêtes.
Encore une fois, Lauren est un gourou de secte.
Enfin, si Lauren est le gourou de sa religion, elle est aussi une dictatrice ''bienveillante''. C'est particulièrement flagrant lorsque le groupe se créé sur la route : c'est elle qui commande, et si d'aventure quelqu'un l'a critique, critique ses choix, ou demande simplement à en parler, la sanction tombe : si tu n'es pas d'accord, tu peux partir. Dans un mécanisme particulièrement violent moralement, elle offre ainsi la sécurité d'un groupe à des gens esseulés, les rends finalement ''accros'' à cette sécurité relative procurée par le nombre, puis menace de jeter dehors quiconque ose remettre en doute ses choix. On le voit d'ailleurs bien tout à la fin, lorsque Mora propose de veiller avec elle, et qu'il demande s'il peut avoir une arme. Lauren lui précise qu'elle refuse, au motif qu'il ne sait pas tirer. le souci, c'est que c'est le cas pour tous ceux qu'elle a récupéré en cours de route : personne ne savait tirer, et la question est vite éludée dans son journal par un ''ils ont appris à tirer sur la route''. Vu le peu de cartouches et leur valeur, ils ont dû tirer quoi, une fois ? Deux à tout casser ? Finalement, Mora ne sait donc tirer ni plus ni moins que les autres, et pourtant Lauren s'acharne. En cas d'attaque, c'est pourtant Mora qui a raison : s'il n'est pas armé, que fera-t-il ? Devra-t-il se sacrifier et attaquer à mains nues un attaquant armé qui le tuera ? Hurler pour réveiller tout le campement, quitte à indiquer leur position à tout le monde et à les rendre encore plus vulnérable ? Perdre du temps à rejoindre Lauren ou réveiller quelqu'un qui possède une arme, qui à perdre de précieuses secondes qui pourraient couter la vie à quelqu'un ?
D'un point de vue purement pratique, Mora a entièrement raison, et pourtant Lauren refuse tout en restant dans une position neutre. Elle pourrait refuser que Mora s'occupe de la garde avec elle, désigner quelqu'un d'autre, mais elle préfère ne pas prendre cette responsabilité. Elle préfère que Bankole s'érige comme son bras et menace Mora de le virer en lui indiquant que s'il n'est pas content, il peut se casser et rejoindre un groupe de macho. Ah, parce que ne pas être d'accord avec une femme, c'est forcément être macho ? Quoi qu'il en soit, on voit rapidement que Lauren a instillé les graines du ''obéis ou part mourir seul'', et qu'elle a si bien opérer son travail d'amadouement des autres qu'elle n'a même plus à délivrer sa menace elle-même.
____
Au final, j'ai donc trouvé que Lauren était manipulatrice et hypocrite, et j'ai eu beaucoup de mal à la voir pourtant avancer, obéie et encensée par son petit groupe.
Après quelques recherches sur l'autrice, je me suis rendue compte qu'elle et Lauren se ressemblent énormément, Lauren est la version fantasmée de Octavia Butler, courageuse messie sauvant son peuple de la fin du monde. Je ne pense donc pas que Lauren soit vraiment un personnage négatif, je pense réellement que l'autrice voulait passer un message au contraire très positif. Malheureusement, le flou de l'ambiance et du monde, les facilités énormes de Lauren, l'histoire qui lui donne toujours raison, les gens qui la croient et lui obéissent avec tant de facilité... tout ça m'a laissée un certain malaise. La violence ''bienveillante'' n'est qu'une violence comme une autre, qui ne vaut pas mieux qu'une autre. En ne se questionnant jamais dessus, le livre (et Lauren par extension) tendent pourtant à la légitimer. Encore une fois, je pense qu'il s'agit simplement d'une maladresse, que l'autrice ne voulait pas dire ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, et ça m'a gênée.
En 2024, le réchauffement climatique a transformé la Californie en désert ravagé par la criminalité. L'eau coûte quatre fois plus cher que l'essence, la nourriture manque pour les plus pauvres, un président d'extrême-droite feint d'ignorer les conflits de race et de classe et permet aux entreprises de transformer les ouvriers en esclaves.
Sans catastrophe technologique ou naturelle, la fin du monde advient sournoisement dès lors que la sécheresse s'installe et que rien n'est fait pour partager les ressources.
Ecrit en 1993, le roman décrit une réalité terriblement proche, d'autant plus terrifiante à la date d'aujourd'hui mais déjà angoissante lors de la publication du roman.
On peut supposer que l'autrice a choisi un futur proche pour donner plus de poids à sa mise en garde sur le réchauffement climatique, mais aussi que le recours à la dystopie lui sert de tribune pour évoquer les dysfonctionnements de la société américaine: le sexisme, le racisme, l'ethnocentrisme, la peur de la différence, le libéralisme économique, la pauvreté, la violence ou la religion.
Si l'anticipation est aussi saisissante, c'est que l'on assiste au basculement d'un monde vers la barbarie. Les drames déjà induits par la pauvreté, la toxicomanie et le viol sont démultipliés et menacent chacun à chaque instant. Pour se protéger, les murs se dressent et les armes se multiplient, mais la survie relève plus de la chance que du courage.
Une nouvelle drogue est apparue qui transforme les drogués en pyromanes (les pyros), et les quartiers sont assiégés et brûlés.
"Les gens mettent le feu comme ils l'ont fait chez nous : pour mobiliser les voisins et en profiter pour entrer dans les maisons. Ils mettent le feu pour se débarrasser de leurs ennemis personnels ou de ceux qui ne sont pas de leur race ou de leur clan. Ils mettent le feu parce qu'ils sont frustrés, en colère, désespérés. Ils n'ont pas le pouvoir de se sortir de la misère mais il leur reste celui de faire du mal aux autres. "
Pire encore, Octavia Butler ose l'insoutenable en évoquant la pratique du cannibalisme qui se répand dans les populations affamées.
Elle renvoie alors ces anthropophages à leur nature bestiale, signe d'une monstruosité qui les exclut de toute survie possible et justifie leur exécution sans état d'âme.
La Parabole du semeur commence en 2024 comme le journal tenu par Lauren Oya Olamina, une jeune fille qui fête ses 15 ans et qui a perdu la foi dans la religion de son père. Une héroïne-narratrice plutôt jeune mais d'une grande maturité, peut-être justifiée par les efforts qu'elle fait pour ne pas dévoiler sa faiblesse, une hyperempathie qui lui fait ressentir physiquement la douleur des autres.
Caractérisée par son genre et sa couleur de peau, elle peut ainsi prendre en charge le discours féministe et fraternel d'Octavia Butler tout en déroulant l'effondrement d'un monde capitaliste qui porte la responsabilité de toutes ces catastrophes.
La résurgence de l'esclavage constitue un axe important dans la dénonciation d'une société incapable d'apprendre de ses erreurs. Alors que le monde s'enfonce dans la violence, des individus persistent dans leur volonté d'asservir d'autres individus pour en tirer profit.
Les entreprises, avec la complicité des politiques, achètent des terres et s'approprient des villes entières où des hommes, des femmes et des enfants travaillent comme des esclaves et sont enchaînés à leurs employeurs par des dettes qu'ils sont contraints de contracter pour survivre.
"On leur versa un salaire mais pas en argent : en bons n'ayant de valeur que dans l'enceinte de l'entreprise. Ils devaient désormais louer leur cabane et payer pour la nourriture et les vêtements, et ne pouvaient s'approvisionner ailleurs qu'au magasin de l'entreprise. Leurs bons ne suffisaient jamais à régler toutes leurs factures. Les nouvelles lois en matière d'emploi interdisaient à un travailleur débiteur de quitter son patron. Il devait travailler pour payer sa dette ; s'il refusait, il pouvait être emprisonné et, sa peine terminée, reconduit chez son employeur.
Bien entendu, les patrons forçaient quiconque leur devait de l'argent à travailler deux fois plus et usaient du fouet contre ceux qui rechignaient à la tâche. Ou bien ils les vendaient à d'autres compagnies, avec ou sans leurs familles. Pire, les enfants pouvaient être forcés de travailler pour rembourser la dette, au cas où les parents venaient à mourir ou n'étaient plus capables de trimer comme des bêtes."
Ceux qui refusent le refuge trompeur de ces villes-usines sont alors forcés au nomadisme et risquent leur vie car les routes sont parcourues par des bandes d'assassins et de pillards .
Lauren, qui veut atteindre le nord du pays, commence un voyage dangereux au cours duquel elle entreprend de rassembler des personnes qui partagent ses valeurs et sont désireux de fonder une utopie égalitaire. Elle se fait alors prophète d'une religion qu'elle perfectionne au cours de ses épreuves, à renfort d'aphorismes en incipit de chaque chapitre.
La doctrine de "Semence de la Terre" est plutôt pragmatique, loin de l'idée d'un Dieu qui dirigerait nos vies mais professant que "le changement fait partie de la vie" et que même "Dieu est changement". de cette manière, il n'est plus question d'une divinité transcendante qui fixerait des règles, mais de la possibilité pour chacun de prendre son destin en main et de s'adapter au mieux aux évolutions.
"Tout ce que tu touches,
Tu le changes
Tout ce que tu changes,
Te change"
Ma réserve viendra du fait que l'invocation constante du nom de Dieu est perturbante alors que la philosophie de vie prônée par Lauren n'a pas besoin du concept de religion. le modèle de société qu'elle propose, libéré de toutes formes de discrimination et articulé autour de l'acceptation du mouvement, est un classique de l'utopie et se suffit à lui-même.
De la même manière, j'ai regretté que la narratrice adopte une position de prophète, qu'elle se place dans une démarche de conversion ( largement entachée dans L Histoire) alors qu'il aurait suffi d'invoquer un partage de valeurs. L'impression d'une possible dérive sectaire vient alors gâcher l'utopie communautaire.
Octavia Butler dépeint un monde pas si lointain qui subit les conséquences dramatiques de problèmes connus de longue date mais volontairement ignorés par les politiques en place. Si le réchauffement climatique est le principal déclencheur, elle veut également montrer comment le racisme, la pauvreté, l'individualisme et le manque d'accès à l'éducation peuvent menacer la survie des populations.
Sans catastrophe technologique ou naturelle, la fin du monde advient sournoisement dès lors que la sécheresse s'installe et que rien n'est fait pour partager les ressources.
Ecrit en 1993, le roman décrit une réalité terriblement proche, d'autant plus terrifiante à la date d'aujourd'hui mais déjà angoissante lors de la publication du roman.
On peut supposer que l'autrice a choisi un futur proche pour donner plus de poids à sa mise en garde sur le réchauffement climatique, mais aussi que le recours à la dystopie lui sert de tribune pour évoquer les dysfonctionnements de la société américaine: le sexisme, le racisme, l'ethnocentrisme, la peur de la différence, le libéralisme économique, la pauvreté, la violence ou la religion.
Si l'anticipation est aussi saisissante, c'est que l'on assiste au basculement d'un monde vers la barbarie. Les drames déjà induits par la pauvreté, la toxicomanie et le viol sont démultipliés et menacent chacun à chaque instant. Pour se protéger, les murs se dressent et les armes se multiplient, mais la survie relève plus de la chance que du courage.
Une nouvelle drogue est apparue qui transforme les drogués en pyromanes (les pyros), et les quartiers sont assiégés et brûlés.
"Les gens mettent le feu comme ils l'ont fait chez nous : pour mobiliser les voisins et en profiter pour entrer dans les maisons. Ils mettent le feu pour se débarrasser de leurs ennemis personnels ou de ceux qui ne sont pas de leur race ou de leur clan. Ils mettent le feu parce qu'ils sont frustrés, en colère, désespérés. Ils n'ont pas le pouvoir de se sortir de la misère mais il leur reste celui de faire du mal aux autres. "
Pire encore, Octavia Butler ose l'insoutenable en évoquant la pratique du cannibalisme qui se répand dans les populations affamées.
Elle renvoie alors ces anthropophages à leur nature bestiale, signe d'une monstruosité qui les exclut de toute survie possible et justifie leur exécution sans état d'âme.
La Parabole du semeur commence en 2024 comme le journal tenu par Lauren Oya Olamina, une jeune fille qui fête ses 15 ans et qui a perdu la foi dans la religion de son père. Une héroïne-narratrice plutôt jeune mais d'une grande maturité, peut-être justifiée par les efforts qu'elle fait pour ne pas dévoiler sa faiblesse, une hyperempathie qui lui fait ressentir physiquement la douleur des autres.
Caractérisée par son genre et sa couleur de peau, elle peut ainsi prendre en charge le discours féministe et fraternel d'Octavia Butler tout en déroulant l'effondrement d'un monde capitaliste qui porte la responsabilité de toutes ces catastrophes.
La résurgence de l'esclavage constitue un axe important dans la dénonciation d'une société incapable d'apprendre de ses erreurs. Alors que le monde s'enfonce dans la violence, des individus persistent dans leur volonté d'asservir d'autres individus pour en tirer profit.
Les entreprises, avec la complicité des politiques, achètent des terres et s'approprient des villes entières où des hommes, des femmes et des enfants travaillent comme des esclaves et sont enchaînés à leurs employeurs par des dettes qu'ils sont contraints de contracter pour survivre.
"On leur versa un salaire mais pas en argent : en bons n'ayant de valeur que dans l'enceinte de l'entreprise. Ils devaient désormais louer leur cabane et payer pour la nourriture et les vêtements, et ne pouvaient s'approvisionner ailleurs qu'au magasin de l'entreprise. Leurs bons ne suffisaient jamais à régler toutes leurs factures. Les nouvelles lois en matière d'emploi interdisaient à un travailleur débiteur de quitter son patron. Il devait travailler pour payer sa dette ; s'il refusait, il pouvait être emprisonné et, sa peine terminée, reconduit chez son employeur.
Bien entendu, les patrons forçaient quiconque leur devait de l'argent à travailler deux fois plus et usaient du fouet contre ceux qui rechignaient à la tâche. Ou bien ils les vendaient à d'autres compagnies, avec ou sans leurs familles. Pire, les enfants pouvaient être forcés de travailler pour rembourser la dette, au cas où les parents venaient à mourir ou n'étaient plus capables de trimer comme des bêtes."
Ceux qui refusent le refuge trompeur de ces villes-usines sont alors forcés au nomadisme et risquent leur vie car les routes sont parcourues par des bandes d'assassins et de pillards .
Lauren, qui veut atteindre le nord du pays, commence un voyage dangereux au cours duquel elle entreprend de rassembler des personnes qui partagent ses valeurs et sont désireux de fonder une utopie égalitaire. Elle se fait alors prophète d'une religion qu'elle perfectionne au cours de ses épreuves, à renfort d'aphorismes en incipit de chaque chapitre.
La doctrine de "Semence de la Terre" est plutôt pragmatique, loin de l'idée d'un Dieu qui dirigerait nos vies mais professant que "le changement fait partie de la vie" et que même "Dieu est changement". de cette manière, il n'est plus question d'une divinité transcendante qui fixerait des règles, mais de la possibilité pour chacun de prendre son destin en main et de s'adapter au mieux aux évolutions.
"Tout ce que tu touches,
Tu le changes
Tout ce que tu changes,
Te change"
Ma réserve viendra du fait que l'invocation constante du nom de Dieu est perturbante alors que la philosophie de vie prônée par Lauren n'a pas besoin du concept de religion. le modèle de société qu'elle propose, libéré de toutes formes de discrimination et articulé autour de l'acceptation du mouvement, est un classique de l'utopie et se suffit à lui-même.
De la même manière, j'ai regretté que la narratrice adopte une position de prophète, qu'elle se place dans une démarche de conversion ( largement entachée dans L Histoire) alors qu'il aurait suffi d'invoquer un partage de valeurs. L'impression d'une possible dérive sectaire vient alors gâcher l'utopie communautaire.
Octavia Butler dépeint un monde pas si lointain qui subit les conséquences dramatiques de problèmes connus de longue date mais volontairement ignorés par les politiques en place. Si le réchauffement climatique est le principal déclencheur, elle veut également montrer comment le racisme, la pauvreté, l'individualisme et le manque d'accès à l'éducation peuvent menacer la survie des populations.
À la croisée entre dystopie, roman d'anticipation et roman post-apocalyptique, La parabole du semeur qui prend la forme d'un journal rédigé (doublement !) par une femme racisée, est un récit glaçant de vraisemblance avec notre monde actuel. À l'aide d'une plume précise et sagace, Octavia E. Butler aborde des thèmes profonds qui permettent un équilibre avec la violence dépeinte au sein du récit. La personnage de Lauren, qui souffre d'hyperempathie, expose des itinéraires, physique mais également réflexif sur l'impératif d'un bouleversement imminent, d'une nouvelle éthique de vie, dont la connotation religieuse forte peut parfois craindre la naïveté et un malaise dans la lecture.
Plus passionnant encore, l'autrice alarme sur nos choix de vie dévastateurs pour l'unvers et propose de nouveaux fondements, basés sur l'entraide et le collectif sans omettre les failles humaines et individuelles de chacun·e. C'est un roman de survie qui se dévore et qui éclaire sur l'importance de l'instruction, de la parole, souvent dévitalisée au sein des régimes républicains et dictatoriaux, comme moyens contre la barbarie. Saluons cette pilière de l'afro-futurisme qui élève la dignité humaine et animale face à une société autoritaire, corrompue et déviante.
[dans le cadre de l'opération masse critique. Merci à Babelio et Au diable Vauvert pour l'envoi de ce livre]
Plus passionnant encore, l'autrice alarme sur nos choix de vie dévastateurs pour l'unvers et propose de nouveaux fondements, basés sur l'entraide et le collectif sans omettre les failles humaines et individuelles de chacun·e. C'est un roman de survie qui se dévore et qui éclaire sur l'importance de l'instruction, de la parole, souvent dévitalisée au sein des régimes républicains et dictatoriaux, comme moyens contre la barbarie. Saluons cette pilière de l'afro-futurisme qui élève la dignité humaine et animale face à une société autoritaire, corrompue et déviante.
[dans le cadre de l'opération masse critique. Merci à Babelio et Au diable Vauvert pour l'envoi de ce livre]
Citations et extraits (47)
Voir plus
Ajouter une citation
"Tu as entendu parler de la Grande Peste en Europe au Moyen-Age? " je lui ai demandé.
Elle a hoché la tête. Comme moi, elle lit beaucoup, et toutes sortes de choses.
"Oui, elle a tué plus de vingt-cinq millions de gens en Europe. Les survivants pensaient que la fin du monde était arrivée.
- Oui, mais quand ils ont compris que ce n'était pas le cas, ils ont compris aussi beaucoup d'autres choses : qu'il y avait des terres libres que rien ne les empêchait de cultiver, qu'ils pouvaient exiger d'être mieux payés pour leur travail. La peste avait changé ceux qui y avaient survécu.
-Que veux-tu dire?
-Que les choses changent, qu'elles changent lentement, mais que, parfois, une catastrophe accélère le changement.
-Et alors?
-Alors, les choses sont en train de changer. Les grands attendent que leur cher passé revienne et ils ne voient pas que tout change autour d'eux. Ils sont responsables du changement de climat de la planète, mais ça ne les empêche pas d'attendre le retour du bon vieux temps.
Elle a hoché la tête. Comme moi, elle lit beaucoup, et toutes sortes de choses.
"Oui, elle a tué plus de vingt-cinq millions de gens en Europe. Les survivants pensaient que la fin du monde était arrivée.
- Oui, mais quand ils ont compris que ce n'était pas le cas, ils ont compris aussi beaucoup d'autres choses : qu'il y avait des terres libres que rien ne les empêchait de cultiver, qu'ils pouvaient exiger d'être mieux payés pour leur travail. La peste avait changé ceux qui y avaient survécu.
-Que veux-tu dire?
-Que les choses changent, qu'elles changent lentement, mais que, parfois, une catastrophe accélère le changement.
-Et alors?
-Alors, les choses sont en train de changer. Les grands attendent que leur cher passé revienne et ils ne voient pas que tout change autour d'eux. Ils sont responsables du changement de climat de la planète, mais ça ne les empêche pas d'attendre le retour du bon vieux temps.
«Dis-moi, tu ne penses pas vraiment que notre fin approche ?» il me demande.
Je fais un gros effort pour ne pas pleurer, parce que rien n'est plus triste que de se heurter à l'incompréhension, surtout celle des êtres les plus chers. J'ai envie de lui répondre : «La fin de ton monde à toi, sûrement, et peut-être toi avec.». C'est terrible. Je n'avais jamais pensé à ça avant, je veux dire, au risque de voir mon père disparaître. Je détourne la tête et regarde par la fenêtre jusqu'à ce que je retrouve un peu de calme. Quand je lui fais face de de nouveau, je lui dis :
«Oui, pas toi ?»
Il fronce les sourcils. Il ne s'attendait pas à cette réponse.
«Pourquoi as-tu dis ces choses à Joanne ?»
Je décide de lui dire la vérité. Je déteste lui mentir, de toute façon.
«Parce que je le pense.
- Tu n'es pas obligée de dire tout ce que tu penses.
- Joanne et moi, nous sommes amies. J'ai pensé que je pouvais lui parler de certaines choses.»
Il secoue la tête.
«Ces choses-là effraient les gens. Il vaut mieux ne pas leur en parler.
- Mais, p'pa, ne rien dire, c'est comme ignorer le feu qui gronde dans le salon, parce que nous sommes encore à l'abri dans la cuisine.
- N'empêche, inutile d'alarmer Joanne ou tes autres amies. Tu es peut-être persuadée d'avoir raison, mais tu ne leur fais pas du bien. Tu leur fiches la trouille, c'est tout.»
Je fais un gros effort pour maîtriser la colère que je sens monter en moi et je change de sujet.
Je fais un gros effort pour ne pas pleurer, parce que rien n'est plus triste que de se heurter à l'incompréhension, surtout celle des êtres les plus chers. J'ai envie de lui répondre : «La fin de ton monde à toi, sûrement, et peut-être toi avec.». C'est terrible. Je n'avais jamais pensé à ça avant, je veux dire, au risque de voir mon père disparaître. Je détourne la tête et regarde par la fenêtre jusqu'à ce que je retrouve un peu de calme. Quand je lui fais face de de nouveau, je lui dis :
«Oui, pas toi ?»
Il fronce les sourcils. Il ne s'attendait pas à cette réponse.
«Pourquoi as-tu dis ces choses à Joanne ?»
Je décide de lui dire la vérité. Je déteste lui mentir, de toute façon.
«Parce que je le pense.
- Tu n'es pas obligée de dire tout ce que tu penses.
- Joanne et moi, nous sommes amies. J'ai pensé que je pouvais lui parler de certaines choses.»
Il secoue la tête.
«Ces choses-là effraient les gens. Il vaut mieux ne pas leur en parler.
- Mais, p'pa, ne rien dire, c'est comme ignorer le feu qui gronde dans le salon, parce que nous sommes encore à l'abri dans la cuisine.
- N'empêche, inutile d'alarmer Joanne ou tes autres amies. Tu es peut-être persuadée d'avoir raison, mais tu ne leur fais pas du bien. Tu leur fiches la trouille, c'est tout.»
Je fais un gros effort pour maîtriser la colère que je sens monter en moi et je change de sujet.
Tout le monde sait que le changement est inévitable. Depuis Darwin, on sait que tout est évolution. Depuis Bouddha, on sait que rien n’est permanent, que la réalité est maya, illusion. Et le troisième chapitre de l’Ecclésiaste dit : Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Le changement fait partie de la vie, de l’existence, de la sagesse commune. Mais je ne crois pas qu’on en mesure vraiment le sens. Nous n’avons même pas commencé à nous pencher sur la question.
J'ai choisi dans l'évangile selon Saint Luc le chapitre 18 : le juge inique et la veuve importune, versets 1 à 8. J'ai toujours aimé cette parabole sur la prière, la persévérance et l'humilité. Une veuve demande justice contre son adversaire et persévère tant et si bien dans sa demande que le juge, un homme qui ne craint pas Dieu et n'a de considération pour personne, finit par lui accorder ce qu'elle réclame pour avoir la paix.
Moralité : le faible peut toujours vaincre le fort s'il persiste. Persister est quelquefois dangereux mais toujours nécessaire.
Moralité : le faible peut toujours vaincre le fort s'il persiste. Persister est quelquefois dangereux mais toujours nécessaire.
Toutes les luttes sont
Des luttes de pouvoir.
Qui gouvernera,
Qui régentera,
Qui définira,
Qui désignera,
Qui dominera.
Toutes les luttes sont
Des luttes de pouvoir,
Et la plupart
Ne sont pas plus intellectuelles
Que deux béliers
Se jetant l'un contre l'autre.
Des luttes de pouvoir.
Qui gouvernera,
Qui régentera,
Qui définira,
Qui désignera,
Qui dominera.
Toutes les luttes sont
Des luttes de pouvoir,
Et la plupart
Ne sont pas plus intellectuelles
Que deux béliers
Se jetant l'un contre l'autre.
Videos de Octavia E. Butler (3)
Voir plusAjouter une vidéo
Octavia E. Butler (1947-2006) est la première autrice afro-américaine de science-fiction.
En douze romans et un recueil de nouvelles, son oeuvre constitue une littérature qui pense l'oppression et la résistance. Plusieurs fois lauréate du prestigieux Prix Hugo, elle a aussi fait l'objet d'un hommage de la NASA sur... Mars ! Son chef-d'oeuvre visionnaire "La Parabole du semeur" (1993) prophétise l'avènement de Donald Trump dans un récit terriblement d'actualité, d'autant qu'il se déroule en 2024.
Pour parler de cette pionnière de la SF, Natacha Triou reçoit trois invités : Isis Labeau-Caberia, autrice de fiction et de non-fiction Jeanne-A Debats, autrice de science-fiction Marion Mazauric, créatrice et dirigeante des éditions Au Diable Vauvert
#sf #litterature #afrofuturism __________
Retrouvez d'autres grands entretiens scientifiques par ici https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDrr_Kd-8Hzj20Jo6qwhHOKI7
Écoutez l'ensemble des émissions de la science, CQFD https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd
Suivez La science, CQFD sur Twitter https://twitter.com/ScienceCQFD
Retrouvez-nous sur : Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture
Et abonnez-vous à la newsletter Culture Prime : https://www.cultureprime.fr/
En douze romans et un recueil de nouvelles, son oeuvre constitue une littérature qui pense l'oppression et la résistance. Plusieurs fois lauréate du prestigieux Prix Hugo, elle a aussi fait l'objet d'un hommage de la NASA sur... Mars ! Son chef-d'oeuvre visionnaire "La Parabole du semeur" (1993) prophétise l'avènement de Donald Trump dans un récit terriblement d'actualité, d'autant qu'il se déroule en 2024.
Pour parler de cette pionnière de la SF, Natacha Triou reçoit trois invités : Isis Labeau-Caberia, autrice de fiction et de non-fiction Jeanne-A Debats, autrice de science-fiction Marion Mazauric, créatrice et dirigeante des éditions Au Diable Vauvert
#sf #litterature #afrofuturism __________
Retrouvez d'autres grands entretiens scientifiques par ici https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDrr_Kd-8Hzj20Jo6qwhHOKI7
Écoutez l'ensemble des émissions de la science, CQFD https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd
Suivez La science, CQFD sur Twitter https://twitter.com/ScienceCQFD
Retrouvez-nous sur : Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture
Et abonnez-vous à la newsletter Culture Prime : https://www.cultureprime.fr/
+ Lire la suite
autres livres classés : science-fictionVoir plus
Les plus populaires : Imaginaire
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Octavia E. Butler (19)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les plus grands classiques de la science-fiction
Qui a écrit 1984
George Orwell
Aldous Huxley
H.G. Wells
Pierre Boulle
10 questions
4973 lecteurs ont répondu
Thèmes :
science-fictionCréer un quiz sur ce livre4973 lecteurs ont répondu