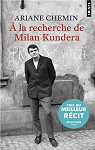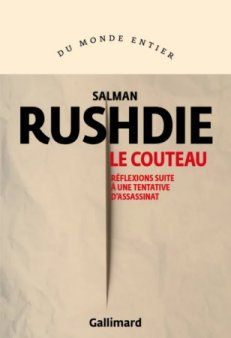Jean Birnbaum vous présente son ouvrage "Seuls les enfants changent le monde" aux éditions Seuil. Rentrée Sciences-Humaines automne 2023.
Retrouvez le livre : https://mollatpublic.azurewebsites.net/videos/jean-louis-cohen-des-fortifs-au-perif
Note de musique : © mollat
Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/
Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux :
Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/
Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts
Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/
Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat
Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/
Vimeo : https://vimeo.com/mollat

Jean Birnbaum
Note moyenne : /5 (sur 0 notes)
Note moyenne : /5 (sur 0 notes)
Résumé :
Au début, on pouvait croire à une mode passagère. Et puis la vogue est devenue lame de fond : aujourd'hui, l'amour de la philosophie constitue une passion partagée. Comme si notre société renouait avec une promesse des Lumières, que Diderot résumait ainsi : "Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ! " Voilà pourquoi on lira ici une réflexion critique : en effet, l'espérance de la "philo pour tous" menace sans cesse de nourrir le marketing démagogique du "déve... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Tous philosophes ?Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Tombé dessus par hasard dans une librairie, alléché par le titre « Tous philosophes », cet ouvrage reprend certaines contributions au 30ème Forum Philo le Monde / le Mans de novembre 2018.
Première chose qui saute aux yeux, le nombre important de femmes philosophes présentes. Notamment Elsa Dorlin, Cynthia Fleury, Nadia Yala Kisukidi et d'autres peut-être moins connues.
La thématique choisie comporte deux simples termes qui ne manqueront pas de soulever de fécondes questions : En premier lieu : Tous comprend-il tout le monde ? les classes les plus pauvres ? les cultures non occidentales ? les femmes ?
Sur ce dernier point, c'est tout à l'honneur du comité d'organisation d'avoir anticipé cela en invitant quasiment autant de femmes philosophes que d'hommes.
Dans l'ensemble, le fameux Tous suggère en creux de nombreux impensés :
Anne Cheng se demande si Tous comprend la philosophie orientale, et notamment chinoise. Anoush Ganjipour fait à peu près le même discours à propos de la Perse et Nadia Yala Kisukidi pour l'Afrique. Juliette Morice, elle, rappelle à la mémoire des auditeurs un autre continent oublié de la philosophie : la philosophie analytique.
Roger Pol-Droit disserte assez scolairement – et en accumulant un nombre improbable de poncifs philosophiques dans une si courte intervention ! – sur le caractère élitiste ou ouvert du questionnement philosophique. le sociologue Jean-Louis Fabiani reconnaît, avec une grande modestie, que la sociologie n'a pas enterré ce questionnement pluri-millénaire et choisit d'orienter sa réflexion sur l'intellectuel médiatique.
Elsa Dorlin se cantonne pour sa part à un registre historiographique : où sont passées les femmes philosophes ? Ce n'est pas tant qu'il n'y a pas eu de femmes philosophes que l'on ne s'est efforcé à en faire disparaître toutes traces. Lors de ses recherches, la philosophe a effectivement su exhumer plusieurs noms de femmes philosophes parfaitement inconnues, même par ceux d'entre nous qui pourraient être sensibles à ces questions.
Il serait difficile de développer ici chacune de ces interventions. Mais, par leurs propos extrêmement directs, audacieux et francs, surtout pour ce genre de manifestation grand public, je voudrais détailler un peu les interventions des philosophes Valérie Gérard et Catherine Malabou.
Catherine Malabou
Tous philosophes ? Dès le début de son intervention, Catherine Malabou renverse la table et souligne le paradoxe qu'il y a à poser cette question aujourd'hui.
Dans la tradition française, l'enseignement de la philosophie a une prétention universaliste inspirée des Lumières. de fait, l'enseignement de la philosophie est obligatoire dans les classes terminales depuis Napoléon !
« Si nous devions en effet être tous philosophes, dans un pays comme la France où la philosophie est obligatoire en terminale, philosophes, nous le serions déjà devenus. »
Nous n'avons pas encore trouvé la voie... C'est manifestement un échec.
La philosophe identifie en Sartre une première brèche entre la philosophie scolaire et universitaire et la philosophie que l'on nomme aujourd'hui populaire.
Sartre posa comme nécessaire le passage du professeur de philosophie au philosophe intellectuel. L'intellectuel est celui qui a pour fonction de « se mêler de ce qui ne le regarde pas ». Tandis que le professeur se cantonne à un rôle de technicien du savoir.
Être un intellectuel est plus une histoire d'attitude que de métier. En déclarant cela, Sartre faite évidemment de la philosophie une affaire politique et insiste sur la nécessité de s'engager.
Cette nécessité est d'ailleurs plus un état de fait, selon Catherine Malabou :
« Nous sommes condamnés à l'engagement de la même façon que nous sommes condamnés à être libres […] Je ne décide pas d'être ou non engagée car je suis toujours déjà engagée, comme je suis jetée dans le monde. »
Cependant, Catherine Malabou ne peut que déplorer le semi-échec de cette tentative de rendre la philosophie populaire. Si Sartre inaugure « la grande aventure des intellectuels médiatisés et de la philosophie 'produit de consommation' », le dernier avatar en date, Michel Onfray, lui semble tout autant victime de son succès. Pendant ce temps, la philosophie scolaire reste engluée dans le carcan de l'académisme universitaire. La philosophie est encore loin d'avoir trouvé la voix pour devenir véritablement populaire.
Valérie Gérard
Dans la même optique, alors que certains intervenants prennent le sujet comme une injonction du genre « comment faire pour que l'on devienne tous philosophes ? », Valérie Gérard2 rejette explicitement cette tentation de « faire un truc un peu démago : tout le monde peut-être philosophe... » et dénonce la fausseté de cette alliance entre Tous et Philosophes.
Comme celle de Catherine Malabou, l'intervention de Valérie Gérard est une véritable surprise. Elle tranche radicalement par sa franchise.
Valérie Gérard développe un questionnement et une réflexion des plus audacieuses, remettant en cause le statut même de philosophe dans sa masculinité.
D'une manière très humaine, Valérie Gérard évoque ses années estudiantines où ses amis masculins tenaient un groupe de réflexion en philosophie politique, à laquelle elle était bien sûr invitée mais ne se sentait pas d'y participer car de fait non mixte.
Ces discussions, elle les a fuit.
On a tendance à penser qu'il ne s'agit là que de timidité, de manque de confiance en soi, et que, dans un monde idéal, le groupe devrait tout faire pour que la femme se sente en confiance et puisse s'exprimer.
Valérie Gérard rejette cette énième condescendance. Fuir ces assemblées de discussion où il n'y a que des hommes ne relève pas d'un problème féminin de confiance en soi. C'est une manière de signifier qu'on ne se reconnaît pas dans cette pratique. Ce n'est pas une faiblesse mais un choix.
L'attitude adéquate n'est pas de faire plus de place pour que la femme se sente en confiance mais de tout changer pour que celles-ci aient envie de s'y exprimer.
Si l'expression « Tous philosophes » n'est pas neutre mais au masculin, ce n'est pas un hasard selon Valérie Gérard.
S'affirmer Philosophe, c'est quelque part revendiquer un statut qui donnerait une forme d'autorité pour s'exprimer dans l'espace politique.
La philosophe fait toutefois remarquer que « le fait que tout le monde ne soit pas philosophe n'implique pas que tout le monde ne pense pas et ne soit pas digne d'être entendu dans l'espace public. Que tout le monde ne soit pas philosophe ne fais pas de l'intelligence et de la pertinence l'affaire de spécialistes : les philosophes. Encore heureux ! »
Et de renchérir vertement :
« Outre que c'est souvent assez usurpé, encore une fois ce n'est pas parce qu'on pense avoir une opinion à infliger au monde, assorti de trois arguments, qu'on est philosophe... »
Valérie Gérard rappelle à nos souvenirs la position de Virginia Woolf sur le monopole masculin du discours théorique qui transforme la politique en chasse gardée. Un discours qui a besoin de tenir la femme pour inférieure.
La philosophe y décèle un lien intrinsèque entre l'exclusion de la femme du discours et la prétention à normer le monde à partir de la théorie.
Il y a un lien entre la pratique d'une raison désincarnée (rejet des nuances sensibles) et la prétention à légiférer et à uniformiser le monde, à le plier à ses déductions.
Ce passage du discours théorique à la prescription et au jugement est crucial.
Valérie Gérard fait le lien avec la prédication qui repose sur l'emploi du verbe être. Or, elle relève que « la philosophie naît en Grèce quand précisément on se met à réfléchir à ce que ça veut dire employer le verbe être ».
On a là un emploi oppressif du verbe être dans le discours qui s'oppose à la vie dans son mouvement, sa diversité, sa contingence, ses contradictions, etc.
Valérie Gérard continue sa critique du statut de « philosophe », en se référant à Hannah Arendt, et rejette cette idée un peu dingue de vouloir « se présenter dans le champ politique en tant que le philosophe, dans l'idée que les pensées qu'on aurait élaboré seule, à l'écart de l'échange des perspectives, auraient plus de valeur que celles des autres car elles seraient mieux fondées en raison »
Penser seul la coexistence est en soi une contradiction. C'est juste nier une donnée essentielle de la politique : les êtres humains existent à plusieurs et par conséquent doivent organiser leur coexistence ensemble.
Penser seul révèle même plutôt une volonté d'imposer ses idées au reste du monde.
La philosophe estime qu'affirmer l'égalité, par exemple, ce n'est pas se soumettre à une théorie élaborée à l'extérieur du champ politique mais prendre position sur la forme de coexistence politique que l'on désire.
Elle estime que cela doit rester une croyance, un principe parmi d'autres, au statut infondable. Elle nous enjoint donc à refuser de soumettre l'organisation de la coexistence aux prescriptions déduites à partir d'une théorie. La politique n'a pas et ne peut avoir de fondement transcendant.
Dans ce sens, la politique n'est pas affaire de vérité mais d'auto-organisation à plusieurs et de choix de manière de vivre ensemble.
Une invitation à faire de la politique autrement.
Article complet sur le Blog Philo-Analysis
Lien : http://philo-analysis.over-b..
Première chose qui saute aux yeux, le nombre important de femmes philosophes présentes. Notamment Elsa Dorlin, Cynthia Fleury, Nadia Yala Kisukidi et d'autres peut-être moins connues.
La thématique choisie comporte deux simples termes qui ne manqueront pas de soulever de fécondes questions : En premier lieu : Tous comprend-il tout le monde ? les classes les plus pauvres ? les cultures non occidentales ? les femmes ?
Sur ce dernier point, c'est tout à l'honneur du comité d'organisation d'avoir anticipé cela en invitant quasiment autant de femmes philosophes que d'hommes.
Dans l'ensemble, le fameux Tous suggère en creux de nombreux impensés :
Anne Cheng se demande si Tous comprend la philosophie orientale, et notamment chinoise. Anoush Ganjipour fait à peu près le même discours à propos de la Perse et Nadia Yala Kisukidi pour l'Afrique. Juliette Morice, elle, rappelle à la mémoire des auditeurs un autre continent oublié de la philosophie : la philosophie analytique.
Roger Pol-Droit disserte assez scolairement – et en accumulant un nombre improbable de poncifs philosophiques dans une si courte intervention ! – sur le caractère élitiste ou ouvert du questionnement philosophique. le sociologue Jean-Louis Fabiani reconnaît, avec une grande modestie, que la sociologie n'a pas enterré ce questionnement pluri-millénaire et choisit d'orienter sa réflexion sur l'intellectuel médiatique.
Elsa Dorlin se cantonne pour sa part à un registre historiographique : où sont passées les femmes philosophes ? Ce n'est pas tant qu'il n'y a pas eu de femmes philosophes que l'on ne s'est efforcé à en faire disparaître toutes traces. Lors de ses recherches, la philosophe a effectivement su exhumer plusieurs noms de femmes philosophes parfaitement inconnues, même par ceux d'entre nous qui pourraient être sensibles à ces questions.
Il serait difficile de développer ici chacune de ces interventions. Mais, par leurs propos extrêmement directs, audacieux et francs, surtout pour ce genre de manifestation grand public, je voudrais détailler un peu les interventions des philosophes Valérie Gérard et Catherine Malabou.
Catherine Malabou
Tous philosophes ? Dès le début de son intervention, Catherine Malabou renverse la table et souligne le paradoxe qu'il y a à poser cette question aujourd'hui.
Dans la tradition française, l'enseignement de la philosophie a une prétention universaliste inspirée des Lumières. de fait, l'enseignement de la philosophie est obligatoire dans les classes terminales depuis Napoléon !
« Si nous devions en effet être tous philosophes, dans un pays comme la France où la philosophie est obligatoire en terminale, philosophes, nous le serions déjà devenus. »
Nous n'avons pas encore trouvé la voie... C'est manifestement un échec.
La philosophe identifie en Sartre une première brèche entre la philosophie scolaire et universitaire et la philosophie que l'on nomme aujourd'hui populaire.
Sartre posa comme nécessaire le passage du professeur de philosophie au philosophe intellectuel. L'intellectuel est celui qui a pour fonction de « se mêler de ce qui ne le regarde pas ». Tandis que le professeur se cantonne à un rôle de technicien du savoir.
Être un intellectuel est plus une histoire d'attitude que de métier. En déclarant cela, Sartre faite évidemment de la philosophie une affaire politique et insiste sur la nécessité de s'engager.
Cette nécessité est d'ailleurs plus un état de fait, selon Catherine Malabou :
« Nous sommes condamnés à l'engagement de la même façon que nous sommes condamnés à être libres […] Je ne décide pas d'être ou non engagée car je suis toujours déjà engagée, comme je suis jetée dans le monde. »
Cependant, Catherine Malabou ne peut que déplorer le semi-échec de cette tentative de rendre la philosophie populaire. Si Sartre inaugure « la grande aventure des intellectuels médiatisés et de la philosophie 'produit de consommation' », le dernier avatar en date, Michel Onfray, lui semble tout autant victime de son succès. Pendant ce temps, la philosophie scolaire reste engluée dans le carcan de l'académisme universitaire. La philosophie est encore loin d'avoir trouvé la voix pour devenir véritablement populaire.
Valérie Gérard
Dans la même optique, alors que certains intervenants prennent le sujet comme une injonction du genre « comment faire pour que l'on devienne tous philosophes ? », Valérie Gérard2 rejette explicitement cette tentation de « faire un truc un peu démago : tout le monde peut-être philosophe... » et dénonce la fausseté de cette alliance entre Tous et Philosophes.
Comme celle de Catherine Malabou, l'intervention de Valérie Gérard est une véritable surprise. Elle tranche radicalement par sa franchise.
Valérie Gérard développe un questionnement et une réflexion des plus audacieuses, remettant en cause le statut même de philosophe dans sa masculinité.
D'une manière très humaine, Valérie Gérard évoque ses années estudiantines où ses amis masculins tenaient un groupe de réflexion en philosophie politique, à laquelle elle était bien sûr invitée mais ne se sentait pas d'y participer car de fait non mixte.
Ces discussions, elle les a fuit.
On a tendance à penser qu'il ne s'agit là que de timidité, de manque de confiance en soi, et que, dans un monde idéal, le groupe devrait tout faire pour que la femme se sente en confiance et puisse s'exprimer.
Valérie Gérard rejette cette énième condescendance. Fuir ces assemblées de discussion où il n'y a que des hommes ne relève pas d'un problème féminin de confiance en soi. C'est une manière de signifier qu'on ne se reconnaît pas dans cette pratique. Ce n'est pas une faiblesse mais un choix.
L'attitude adéquate n'est pas de faire plus de place pour que la femme se sente en confiance mais de tout changer pour que celles-ci aient envie de s'y exprimer.
Si l'expression « Tous philosophes » n'est pas neutre mais au masculin, ce n'est pas un hasard selon Valérie Gérard.
S'affirmer Philosophe, c'est quelque part revendiquer un statut qui donnerait une forme d'autorité pour s'exprimer dans l'espace politique.
La philosophe fait toutefois remarquer que « le fait que tout le monde ne soit pas philosophe n'implique pas que tout le monde ne pense pas et ne soit pas digne d'être entendu dans l'espace public. Que tout le monde ne soit pas philosophe ne fais pas de l'intelligence et de la pertinence l'affaire de spécialistes : les philosophes. Encore heureux ! »
Et de renchérir vertement :
« Outre que c'est souvent assez usurpé, encore une fois ce n'est pas parce qu'on pense avoir une opinion à infliger au monde, assorti de trois arguments, qu'on est philosophe... »
Valérie Gérard rappelle à nos souvenirs la position de Virginia Woolf sur le monopole masculin du discours théorique qui transforme la politique en chasse gardée. Un discours qui a besoin de tenir la femme pour inférieure.
La philosophe y décèle un lien intrinsèque entre l'exclusion de la femme du discours et la prétention à normer le monde à partir de la théorie.
Il y a un lien entre la pratique d'une raison désincarnée (rejet des nuances sensibles) et la prétention à légiférer et à uniformiser le monde, à le plier à ses déductions.
Ce passage du discours théorique à la prescription et au jugement est crucial.
Valérie Gérard fait le lien avec la prédication qui repose sur l'emploi du verbe être. Or, elle relève que « la philosophie naît en Grèce quand précisément on se met à réfléchir à ce que ça veut dire employer le verbe être ».
On a là un emploi oppressif du verbe être dans le discours qui s'oppose à la vie dans son mouvement, sa diversité, sa contingence, ses contradictions, etc.
Valérie Gérard continue sa critique du statut de « philosophe », en se référant à Hannah Arendt, et rejette cette idée un peu dingue de vouloir « se présenter dans le champ politique en tant que le philosophe, dans l'idée que les pensées qu'on aurait élaboré seule, à l'écart de l'échange des perspectives, auraient plus de valeur que celles des autres car elles seraient mieux fondées en raison »
Penser seul la coexistence est en soi une contradiction. C'est juste nier une donnée essentielle de la politique : les êtres humains existent à plusieurs et par conséquent doivent organiser leur coexistence ensemble.
Penser seul révèle même plutôt une volonté d'imposer ses idées au reste du monde.
La philosophe estime qu'affirmer l'égalité, par exemple, ce n'est pas se soumettre à une théorie élaborée à l'extérieur du champ politique mais prendre position sur la forme de coexistence politique que l'on désire.
Elle estime que cela doit rester une croyance, un principe parmi d'autres, au statut infondable. Elle nous enjoint donc à refuser de soumettre l'organisation de la coexistence aux prescriptions déduites à partir d'une théorie. La politique n'a pas et ne peut avoir de fondement transcendant.
Dans ce sens, la politique n'est pas affaire de vérité mais d'auto-organisation à plusieurs et de choix de manière de vivre ensemble.
Une invitation à faire de la politique autrement.
Article complet sur le Blog Philo-Analysis
Lien : http://philo-analysis.over-b..
Lire un extrait
Videos de Jean Birnbaum (30)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : philosophesVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean Birnbaum (19)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
445 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre445 lecteurs ont répondu