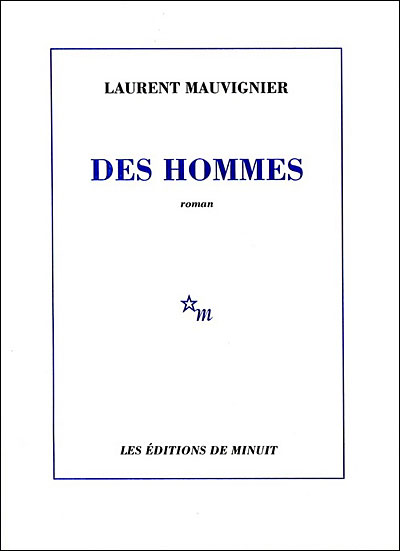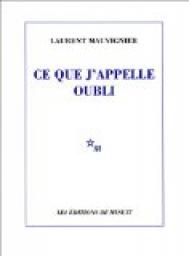Critiques filtrées sur 3 étoiles
Lu en 2022. Ma seconde lecture de l'auteur d'origine tourangelle, dont j'avais beaucoup apprécié "Continuer".
Un récit percutant qui parle du traumatisme de la guerre (d'Algérie), de la brutalité des hommes, de la rancoeur, et d'une impossible résilience... Je m'étais sentie un peu trop oppressée par la plume et le rythme du récit, et c'est surtout la seconde partie du livre qui avait retenu mon attention. Une écriture extrêmement ciselée et incarnée, mais à laquelle je n'ai pas totalement adhéré.
Un récit percutant qui parle du traumatisme de la guerre (d'Algérie), de la brutalité des hommes, de la rancoeur, et d'une impossible résilience... Je m'étais sentie un peu trop oppressée par la plume et le rythme du récit, et c'est surtout la seconde partie du livre qui avait retenu mon attention. Une écriture extrêmement ciselée et incarnée, mais à laquelle je n'ai pas totalement adhéré.
Je savais que ce livre évoque cette guerre d'Algérie dont les conséquences m'interpellent à titre personnel, c'est la raison pour laquelle j'ai persévéré dans ma lecture alors que l'écriture chaotique adoptée par l'auteur avait tout pour me rebuter. Peut-être faudrait-il lire ce récit, brisé et déstructuré à l'image des protagonistes, à haute voix ?
La description de l'état de délabrement du personnage principal, Bernard dit Feu-de-Bois, s'étale sur la moitié des 280 pages du roman, comme la partie émergée de l'iceberg qui puise son origine dans la guerre d'Algérie, laquelle n'est réellement abordée qu'à partir de la page 133, au début du chapitre intitulé "Nuit", nuit de violences extrêmes dans laquelle les jeunes appelés sont plongés dès leur arrivée sur le terrain d'un conflit dont ils ignorent tout ou presque.
La description de l'état de délabrement du personnage principal, Bernard dit Feu-de-Bois, s'étale sur la moitié des 280 pages du roman, comme la partie émergée de l'iceberg qui puise son origine dans la guerre d'Algérie, laquelle n'est réellement abordée qu'à partir de la page 133, au début du chapitre intitulé "Nuit", nuit de violences extrêmes dans laquelle les jeunes appelés sont plongés dès leur arrivée sur le terrain d'un conflit dont ils ignorent tout ou presque.
J'ai lu le roman de Laurent Mauvignier mais, sans véritable plaisir ni intérêt.
L'impression que cette lecture me donne est que l'auteur recherche les effets de style. de plus, son ton est terriblement moralisateur comme s'il n'y avait que des méchants d'un côté et des bons de l'autre.
La question qui me taraude est : Où Mauvignier veut-il en venir?
L'impression que cette lecture me donne est que l'auteur recherche les effets de style. de plus, son ton est terriblement moralisateur comme s'il n'y avait que des méchants d'un côté et des bons de l'autre.
La question qui me taraude est : Où Mauvignier veut-il en venir?
Plusieurs points positifs pour ce livre : la très belle plume de l'auteur, le thème de la guerre d'Algèrie (il n'y en a pas tant que ça) et la facilité avec laquelle l'auteur peut faire monter la pression en quelques lignes. Mais j'ai trouvé le récit inégal de très bons moments et d'autres beaucoup moins (surtout la 1er partie).
Brillamment, l'écriture de Laurent Mauvinier se déroule, lyrique avec des phrases longues, puis sèche avec des phrases pas terminées.
Mauvignier écrit non pas en se calquant sur le langage parlé, mais en choisissant de ne pas dire ce qui est inutile. « un miracle a eu lieu, et c'est elle, là, qui est venue vers lui, elle dont il s' étonne de ce qu'elle peut bien lui trouver de si, de tellement, enfin de, il ne comprend pas, il ne voit pas, mais bon, tant mieux, seulement tant mieux ».
Dans un monde de paysans pauvres du Nord de la France, qui parlent des bicots et des négros sans en avoir jamais vu un seul, une réunion de famille se trouve être le révélateur d'un racisme de la part du plus pauvre, Bernard, presque clochard. Puis l'incident arrive, et les langues se délient, son cousin rappelle le jour où Bernard avait traité sa soeur mourante de salope, les souvenirs remontent et c'est tout l'art de Mauvinier de nous faire assister à cette lente remontée pleine de questions sur le passé. Nous cherchons, au fil des pages à comprendre pourquoi ce Bernard soulève tant de questions, ce qui a pu se passer pour qu'il soit raciste de façon si bête et si inacceptable:
« Et lui il peut être là. Lui, le.
Arrête.
Le bougnoule ».
Et le souvenir de la guerre d'Algérie arrive, la « pacification », qui commence par l'intrusion dans un village où les recrutés français cherchent les hommes, et ne trouvent que femmes, enfants et vieillards. Ils sont où les hommes ?
Personne ne trouve les hommes.
Ces recrues qui n'ont rien choisi voudraient bien s'opposer à une résistance, trouver ces fameux fellahs qu'ils ont la mission d'achever, mais rien, que le silence des civils, parfois un meurtre horrible et le silence alentour. Ils voudraient bien finir, rentrer enfin chez eux au lieu d'être obligés de vivre cette parodie de guerre sans combat et sans ennemi déclaré. La destruction des villages continue donc, à la recherche des hommes. En repensant au meurtre d'un médecin, un des protagonistes (là dessus, je n'ai pas du tout compris qui parlait) se demande quel genre d'homme il faut être pour en arriver à cette ignominie: « pas des hommes qui font ça. Et pourtant. Des hommes. Il se dit pourtant parfois que lui ce serait un fellaga ». A la guerre il n'y a pas de type bien, tu es obligé de tuer et de détruire, tu n'es qu'un homme.
Et Mauvignier, par l'intermédiaire d'un de ses personnages, Rabut, ou Fevrier,( ?) se pose la question du pourquoi de la violence absolue, le meurtre sans pitié, sans rien d'humain, mutiler à coups de hache une famille algérienne innocente, fait très certainement par un harki lui aussi déboussolé. Ils se trouvent tous ces jeunes appelés comme dans un entonnoir, et décident d'arrêter de parler des fells, et de parler de bougnoules ou de moricauds, « on avait décidé que c'était pas des hommes ».
Mauvaise réponse à une bonne question et conclusion selon moi un peu ratée de ce livre qui n'en finit pas, pour exposer le racisme sans pourtant l'expliquer. Des jeunes, sans formation, jetés sans rien comprendre dans un conflit qui les dépasse, incapables de comprendre pourquoi on les oblige à y participer. La bonne question, c'est sur l'inanité de cette pacification qui a cassé tant de jeunes et leur ont même insufflé le racisme. La mauvaise réponse, c'est que l'on ne comprend pas vraiment ce qui a pu précipiter ces jeunes paysans dans le racisme. Car, de Bernard, et des raisons de son accès de fureur contre le « bougnoule », on ne sait rien, Ou alors je n'ai pas compris. Autant Mauvinier est un grand écrivain, avec un phrasé particulier et remarquable, autant son histoire ne tient pas debout. Et même, l'idée m'est venue que son écriture était remplie de tics de langage. Comme une particularité qui lui faisait faire l'économie d'écrire une vraie histoire. Je sais, c'est pas gentil ce que j'écris.
Mauvignier écrit non pas en se calquant sur le langage parlé, mais en choisissant de ne pas dire ce qui est inutile. « un miracle a eu lieu, et c'est elle, là, qui est venue vers lui, elle dont il s' étonne de ce qu'elle peut bien lui trouver de si, de tellement, enfin de, il ne comprend pas, il ne voit pas, mais bon, tant mieux, seulement tant mieux ».
Dans un monde de paysans pauvres du Nord de la France, qui parlent des bicots et des négros sans en avoir jamais vu un seul, une réunion de famille se trouve être le révélateur d'un racisme de la part du plus pauvre, Bernard, presque clochard. Puis l'incident arrive, et les langues se délient, son cousin rappelle le jour où Bernard avait traité sa soeur mourante de salope, les souvenirs remontent et c'est tout l'art de Mauvinier de nous faire assister à cette lente remontée pleine de questions sur le passé. Nous cherchons, au fil des pages à comprendre pourquoi ce Bernard soulève tant de questions, ce qui a pu se passer pour qu'il soit raciste de façon si bête et si inacceptable:
« Et lui il peut être là. Lui, le.
Arrête.
Le bougnoule ».
Et le souvenir de la guerre d'Algérie arrive, la « pacification », qui commence par l'intrusion dans un village où les recrutés français cherchent les hommes, et ne trouvent que femmes, enfants et vieillards. Ils sont où les hommes ?
Personne ne trouve les hommes.
Ces recrues qui n'ont rien choisi voudraient bien s'opposer à une résistance, trouver ces fameux fellahs qu'ils ont la mission d'achever, mais rien, que le silence des civils, parfois un meurtre horrible et le silence alentour. Ils voudraient bien finir, rentrer enfin chez eux au lieu d'être obligés de vivre cette parodie de guerre sans combat et sans ennemi déclaré. La destruction des villages continue donc, à la recherche des hommes. En repensant au meurtre d'un médecin, un des protagonistes (là dessus, je n'ai pas du tout compris qui parlait) se demande quel genre d'homme il faut être pour en arriver à cette ignominie: « pas des hommes qui font ça. Et pourtant. Des hommes. Il se dit pourtant parfois que lui ce serait un fellaga ». A la guerre il n'y a pas de type bien, tu es obligé de tuer et de détruire, tu n'es qu'un homme.
Et Mauvignier, par l'intermédiaire d'un de ses personnages, Rabut, ou Fevrier,( ?) se pose la question du pourquoi de la violence absolue, le meurtre sans pitié, sans rien d'humain, mutiler à coups de hache une famille algérienne innocente, fait très certainement par un harki lui aussi déboussolé. Ils se trouvent tous ces jeunes appelés comme dans un entonnoir, et décident d'arrêter de parler des fells, et de parler de bougnoules ou de moricauds, « on avait décidé que c'était pas des hommes ».
Mauvaise réponse à une bonne question et conclusion selon moi un peu ratée de ce livre qui n'en finit pas, pour exposer le racisme sans pourtant l'expliquer. Des jeunes, sans formation, jetés sans rien comprendre dans un conflit qui les dépasse, incapables de comprendre pourquoi on les oblige à y participer. La bonne question, c'est sur l'inanité de cette pacification qui a cassé tant de jeunes et leur ont même insufflé le racisme. La mauvaise réponse, c'est que l'on ne comprend pas vraiment ce qui a pu précipiter ces jeunes paysans dans le racisme. Car, de Bernard, et des raisons de son accès de fureur contre le « bougnoule », on ne sait rien, Ou alors je n'ai pas compris. Autant Mauvinier est un grand écrivain, avec un phrasé particulier et remarquable, autant son histoire ne tient pas debout. Et même, l'idée m'est venue que son écriture était remplie de tics de langage. Comme une particularité qui lui faisait faire l'économie d'écrire une vraie histoire. Je sais, c'est pas gentil ce que j'écris.
Comme il est dur d'avoir trop lu. Tout me semble une redite, tout est référence. Dans ce roman, par exemple, impossible de ne pas penser à Céline - avec cette phrase qui se cherche, qui chemine avant d'aboutir. le monologue intérieur heurté, hésitant. Pas tellement moins réussi que celui du Voyage. Combien d'éloges mériterait cette oeuvre ! Plus jeune, j'aurais adoré.
L'histoire de jeunes ruraux qui ont été appelés durant la guerre d'Algérie et qui sont restés marqués par ce qu'ils ont vécu. La construction est parfaite. Même la dysharmonie entre la première partie du roman (le premier tiers), où le propos du narrateur est dans un grand désordre, à la limite du touffu, et la suite du récit organisée de manière plus classique : changement justifié par la progression de l'histoire.
J'ai été particulièrement sensible à l'évocation des années soixante. Tableau impeccable de la vie rurale, de vie sociale d'un petit village, des moeurs de l'époque - tableau d'autant plus magistral que Mauvignier nous épargne l'énoncé des marques de l'époque, à quelques nécessaires exceptions près, comme des obligations matérielles - internet et bien d'autres choses n'existent pas encore. En fait-il trop ? Est-ce une caricature ? Je ne sais pas, il ne me semble pas.
Alors, doit-on critiquer la description des cruautés de la guerre ? Mauvignier n'en abuse pas - assez pour faire comprendre l'état d'esprit du troufion égaré dans les environs d'Oran. Et puis Jonathan Little, dont j'ai encensé le livre, a fait bien pire.
Bref, malgré le style que j'ai trouvé trop désarticulé au début (et donc parfois indigeste), je reconnaît énormément de qualités à ce roman. Sobriété, adéquation, construction, richesse de l'évocation historique - il n'y a rien de trop, le projet de l'auteur est parfaitement servi.
Alors pourquoi ne suis-je pas content ? Pourquoi ne pas voir en Mauvignier un genre d'Homère moderne ? Son livre se bornant à la narration d'une guerre telle que la vivent quelques anti-héros contemporains ? L'art de raconter ?
Non. Ce n'est pas encore cela.
Parce qu'il y a un message en filigrane. La guerre, c'est moche.
Un message un peu décevant. Ce n'est pas pour autant une thèse pacifiste. Ni un roman politique. Il ne dit pas qu'il y a des planqués, des profiteurs, des politiques irresponsables, des colonisateurs, des colons, une logique financière (oui, bien sûr, il y a la garde des citernes de pétrole, mais Mauvignier n'en fait pas tout un plat). Il dit : "la guerre, c'est moche, mais c'est comme ça".
Et il y a ce contenu insidieux. Cette humanité qui sourd, avec son odeur de vieilles chaussettes, la bière pression qu'on boit au bar en parlant avec la patronne qui essuie des verres, et qu'on connaît - on connaît la patronne, mais on a aussi lu Simenon. Ça me dérange. Oui, "ces gens-là" existent et ont le droit d'exister. Et alors ? Je vais en vouloir à Zola d'avoir raconté les cuites de Lantier ? Non, ce n'est pas ça encore que je reproche à ce livre. Sa description trop partielle de l'humanité - trop abstraite en fin de compte. Non.
Il y aurait même motif à un nouvel éloge : quand le narrateur revient sur son passé, on le sent "à la recherche du temps perdu". Le passage des années, l'abrasion sélective qui en résulte, les tricheries de la mémoire, Mauvignier les décrit avec finesse.
Difficile de cerner ce que je reproche à ce livre. Injustement, sans doute, car il remplit son contrat, et fort bien, il dit sobrement, fidèlement ce que l'auteur veut dire.
Mais oui ! Ça y est. J'ai trouvé. Ce que dit l'auteur ne m'intéresse pas. Il ne pose pas de question. Il dit : il y a eu une guerre. Atroce. Et l'homme se l'est infligée et il en a souffert des décennies après le retour des soldats au pays. Bravo... mais encore ?
Little a une thèse. Il pose la question de l'irresponsabilité de l'homme. Mauvignier se borne à déplorer. Déplorer en beauté, avec beaucoup d'art et de maîtrise. Mauvignier est un grand écrivain. Mais son roman prend fin à la dernière page. Il n'y a pas de point d'orgue. Ni de vision. Il restera une impression. Mais on ne pense plus quand on a fermé le livre.
L'histoire de jeunes ruraux qui ont été appelés durant la guerre d'Algérie et qui sont restés marqués par ce qu'ils ont vécu. La construction est parfaite. Même la dysharmonie entre la première partie du roman (le premier tiers), où le propos du narrateur est dans un grand désordre, à la limite du touffu, et la suite du récit organisée de manière plus classique : changement justifié par la progression de l'histoire.
J'ai été particulièrement sensible à l'évocation des années soixante. Tableau impeccable de la vie rurale, de vie sociale d'un petit village, des moeurs de l'époque - tableau d'autant plus magistral que Mauvignier nous épargne l'énoncé des marques de l'époque, à quelques nécessaires exceptions près, comme des obligations matérielles - internet et bien d'autres choses n'existent pas encore. En fait-il trop ? Est-ce une caricature ? Je ne sais pas, il ne me semble pas.
Alors, doit-on critiquer la description des cruautés de la guerre ? Mauvignier n'en abuse pas - assez pour faire comprendre l'état d'esprit du troufion égaré dans les environs d'Oran. Et puis Jonathan Little, dont j'ai encensé le livre, a fait bien pire.
Bref, malgré le style que j'ai trouvé trop désarticulé au début (et donc parfois indigeste), je reconnaît énormément de qualités à ce roman. Sobriété, adéquation, construction, richesse de l'évocation historique - il n'y a rien de trop, le projet de l'auteur est parfaitement servi.
Alors pourquoi ne suis-je pas content ? Pourquoi ne pas voir en Mauvignier un genre d'Homère moderne ? Son livre se bornant à la narration d'une guerre telle que la vivent quelques anti-héros contemporains ? L'art de raconter ?
Non. Ce n'est pas encore cela.
Parce qu'il y a un message en filigrane. La guerre, c'est moche.
Un message un peu décevant. Ce n'est pas pour autant une thèse pacifiste. Ni un roman politique. Il ne dit pas qu'il y a des planqués, des profiteurs, des politiques irresponsables, des colonisateurs, des colons, une logique financière (oui, bien sûr, il y a la garde des citernes de pétrole, mais Mauvignier n'en fait pas tout un plat). Il dit : "la guerre, c'est moche, mais c'est comme ça".
Et il y a ce contenu insidieux. Cette humanité qui sourd, avec son odeur de vieilles chaussettes, la bière pression qu'on boit au bar en parlant avec la patronne qui essuie des verres, et qu'on connaît - on connaît la patronne, mais on a aussi lu Simenon. Ça me dérange. Oui, "ces gens-là" existent et ont le droit d'exister. Et alors ? Je vais en vouloir à Zola d'avoir raconté les cuites de Lantier ? Non, ce n'est pas ça encore que je reproche à ce livre. Sa description trop partielle de l'humanité - trop abstraite en fin de compte. Non.
Il y aurait même motif à un nouvel éloge : quand le narrateur revient sur son passé, on le sent "à la recherche du temps perdu". Le passage des années, l'abrasion sélective qui en résulte, les tricheries de la mémoire, Mauvignier les décrit avec finesse.
Difficile de cerner ce que je reproche à ce livre. Injustement, sans doute, car il remplit son contrat, et fort bien, il dit sobrement, fidèlement ce que l'auteur veut dire.
Mais oui ! Ça y est. J'ai trouvé. Ce que dit l'auteur ne m'intéresse pas. Il ne pose pas de question. Il dit : il y a eu une guerre. Atroce. Et l'homme se l'est infligée et il en a souffert des décennies après le retour des soldats au pays. Bravo... mais encore ?
Little a une thèse. Il pose la question de l'irresponsabilité de l'homme. Mauvignier se borne à déplorer. Déplorer en beauté, avec beaucoup d'art et de maîtrise. Mauvignier est un grand écrivain. Mais son roman prend fin à la dernière page. Il n'y a pas de point d'orgue. Ni de vision. Il restera une impression. Mais on ne pense plus quand on a fermé le livre.
Ce livre, l'un des plus connus que Laurent Mauvignier ait publié, a un sujet grave: les ravages engendrés par la guerre – pas seulement dans les corps, mais aussi dans les esprits, longtemps après les événements. Je savais d'avance que l'écrivain a un style très particulier, qui le singularise parmi les auteurs contemporains et… qui me rebute, ainsi que j'en avais conclu autrefois en lisant "Apprendre à finir".
La première partie de "Des hommes" évoque la déchéance de Bernard, le personnage principal, alcoolique et aigri, maintenant sexagénaire; on le voit "déraper" lors d'une fête de famille. Et là, d'emblée, j'ai failli péter les plombs: l'écriture de Laurent Mauvignier m'a semblé particulièrement caricaturale. On y lit par exemple des phrases comme: « Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, évidemment, je vais ouvrir, il faut que je l'ouvre, je suis bête. Sacré Bernard, hein, il est fou, non ? Quand même. Je. Je » (p. 22). Ces lourdes redondances sont évidemment voulues: c'est pour nous faire entrer dans la subjectivité de ses personnages. Mais, à titre personnel, je ne supporte pas les excès de l'écrivain. De plus, il s'est fait une spécialité d'une forme de langage populaire utilisant abondamment le mot « ça », ou l'expression « nous on », etc... ça m'énerve !
Puis la partie centrale du roman évoque le vécu de plusieurs militaires français (dont Bernard) dans l'Algérie des années '60. Il y a une grande force dans l'évocation de ces jeunes "troufions" jetés sans ménagement dans la guerre cruelle qui conduisit le pays à l'indépendance. L'auteur accorde une grande place aux exactions de l'Armée, ainsi qu'aux meurtres atroces commis par le FLN. Ce sont des hommes qui ont commis ces crimes inhumains, des hommes tout à fait ordinaires et pourtant capables du pire... Bernard et les autres soldats avaient l'immaturité de la jeunesse, un esprit de banale camaraderie, un intérêt superficiel pour l'exotisme du pays, mais généralement pas d'opinion précise sur cette guerre. Ils se soumettaient sans discuter à l'autorité militaire, mais aussi ils crevaient parfois de peur - non sans raison, car la mort rôdait constamment autour d'eux. Leur vie était en même temps ennuyeuse et tragique. A mon avis, cette ambiance est très bien rendue. C'est parfois noyé dans une logorrhée pâteuse, mais celle-ci m'a semblé ici bien moins irritante que dans la première partie.
La fin du livre correspond au retour dans le présent: c'est l'épilogue de la séquence inaugurale du roman. Quand j'ai achevé cette lecture, je me suis senti épuisé et presque "sonné" par l'évocation de ce trop lourd passé, mais aussi… par l'écriture de Mauvignier. Je mets la note de ***, mais pour moi elle n'a pas grande signification.
La première partie de "Des hommes" évoque la déchéance de Bernard, le personnage principal, alcoolique et aigri, maintenant sexagénaire; on le voit "déraper" lors d'une fête de famille. Et là, d'emblée, j'ai failli péter les plombs: l'écriture de Laurent Mauvignier m'a semblé particulièrement caricaturale. On y lit par exemple des phrases comme: « Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, évidemment, je vais ouvrir, il faut que je l'ouvre, je suis bête. Sacré Bernard, hein, il est fou, non ? Quand même. Je. Je » (p. 22). Ces lourdes redondances sont évidemment voulues: c'est pour nous faire entrer dans la subjectivité de ses personnages. Mais, à titre personnel, je ne supporte pas les excès de l'écrivain. De plus, il s'est fait une spécialité d'une forme de langage populaire utilisant abondamment le mot « ça », ou l'expression « nous on », etc... ça m'énerve !
Puis la partie centrale du roman évoque le vécu de plusieurs militaires français (dont Bernard) dans l'Algérie des années '60. Il y a une grande force dans l'évocation de ces jeunes "troufions" jetés sans ménagement dans la guerre cruelle qui conduisit le pays à l'indépendance. L'auteur accorde une grande place aux exactions de l'Armée, ainsi qu'aux meurtres atroces commis par le FLN. Ce sont des hommes qui ont commis ces crimes inhumains, des hommes tout à fait ordinaires et pourtant capables du pire... Bernard et les autres soldats avaient l'immaturité de la jeunesse, un esprit de banale camaraderie, un intérêt superficiel pour l'exotisme du pays, mais généralement pas d'opinion précise sur cette guerre. Ils se soumettaient sans discuter à l'autorité militaire, mais aussi ils crevaient parfois de peur - non sans raison, car la mort rôdait constamment autour d'eux. Leur vie était en même temps ennuyeuse et tragique. A mon avis, cette ambiance est très bien rendue. C'est parfois noyé dans une logorrhée pâteuse, mais celle-ci m'a semblé ici bien moins irritante que dans la première partie.
La fin du livre correspond au retour dans le présent: c'est l'épilogue de la séquence inaugurale du roman. Quand j'ai achevé cette lecture, je me suis senti épuisé et presque "sonné" par l'évocation de ce trop lourd passé, mais aussi… par l'écriture de Mauvignier. Je mets la note de ***, mais pour moi elle n'a pas grande signification.
« On ne sait pas ce que sait une histoire, tant qu'on n'a pas soulevé celles qui sont en dessous, et qui sont les seules à compter » Des histoires cachées il y en a chez ces gens-là. Des non-dits, des silences, des souffrances des haines rentrées. Il suffit d'une réunion de famille, quarante après le retour de la guerre d'Algérie de Bernard, Rabut et Février, pour que tout s'enflamme. Et tout ça par la faute de Bernard ivrogne et presque clochard. Rabut, le cousin sera le narrateur. Mais c'est aussi son histoire comme celle de Février un copain de régiment. Une sale guerre, qui leur fait dire :on ne vaut pas mieux que les Allemands quand on terrorise dans les villages des femmes, des enfants, des bébés. Qu'est-ce qu'on fait ici, Est ce que les hommes de chez nous supporteraient l'éloignement de leur récoltes et les barbelés autour de leurs enfants. Et puis la peur des gardes de nuit, on ne sait pas pourquoi mais on a peur. Les copains du poste égorgés à cause d'une bagarre entre les deux cousins qui retarde le départ de la relève : silence. Ça n'a aucun sens d'être là, qu'on rentre à la maison. On ment partout. Et puis ils sont partis en abandonnant les harkis : on a regardé, sans rien dire, quand on les a obligés de boire de l'essence avant de les faire bruler vif. La guerre terminée Rabut et Février rentrent chez eux, pour reprendre une vie qu'ils pensent pouvoir être normale. Mais la sale guerre les a brisés. Ils n'en parleront à personne ni au village, ni à la famille : votre guerre ce n'était quand même pas Verdun. Il faut se taire. Sous cette blessure pour Bernard il y en a d'autres celles de l'adolescence, lui le mal aimé. Il est obsédé par l'argent gagné dans une loterie que va lui soustraire sa mère. Alors il a décidé ne pas rentrer au village et rêve qu'avec l'argent de la famille de Mireille, qu'il a connu en permission à Oran, il construira à Paris un grand garage, une nouvelle vie. Mireille n'aura pas l'argent et il faudra vivre en HLM à Paris. Tout est noir sans espoir. Quinze ans plus tard Bernard revient seul au village sans oser revoir sa mère et devient l'ivrogne Feux de Bois. Les plaies ne se referment jamais, elles deviennent des blessures béantes. Tout est sombre dans ce roman où on ne sait pas toujours qui parle. Les rancoeurs s'accumulent. Pour chacun la vie a été brisée par la sale guerre qu'on appelait les évènements d'Algérie. Mais bien sûr il y a plus que cela, on ne sait pas ce qu'est une histoire tant qu'on n'a pas soulevé celles qui sont en dessous. Ecriture nerveuse, précise, orale, Laurent Mauvignier délivre un roman désespéré sur la condition humaine. Pas de paix de l'âme possible après la guerre pour ces anciens soldats, qui comme Rabut, rêvent de ne plus entendre le bruit des canons, les cris, de ne plus savoir l'odeur d'un corps calciné, ni l'odeur de la mort. Je voudrais savoir si l'on peut vivre quand on sait qu'il est trop tard.
Laurent Mauvignier - «Des hommes» - éditions de Minuit, 2009 (ISBN-13: 978-2707320759)
Terrible et probablement irremplaçable récit tournant autour de la Guerre d'Algérie. «Autour» est bien le terme exact, puisque le roman commence par une évocation des conséquences de cette guerre, des décennies plus tard, dans un milieu de paysans très pauvres du Sud-Ouest de la France. Et ce n'est que vers la moitié du livre que l'auteur revient en arrière, avec des scènes tirées du vécu des appelés dans le bled.
Avec en permanence le contrepoint des deux guerres précédentes (1914-1918, 1939-1945). L'horreur des agissements de part et d'autre. Une technique narrative très accomplie, maîtrisée, bien vue (voir citation).
(attention : Ames sensibles s'abstenir ?)
Terrible et probablement irremplaçable récit tournant autour de la Guerre d'Algérie. «Autour» est bien le terme exact, puisque le roman commence par une évocation des conséquences de cette guerre, des décennies plus tard, dans un milieu de paysans très pauvres du Sud-Ouest de la France. Et ce n'est que vers la moitié du livre que l'auteur revient en arrière, avec des scènes tirées du vécu des appelés dans le bled.
Avec en permanence le contrepoint des deux guerres précédentes (1914-1918, 1939-1945). L'horreur des agissements de part et d'autre. Une technique narrative très accomplie, maîtrisée, bien vue (voir citation).
(attention : Ames sensibles s'abstenir ?)
On se laisse tout de suite attraper par cette histoire d'hommes, de ceux, non préparés (mais qui l'est ?) revenus brisés de la guerre d'Algérie portant le poids de l'impossible oubli et ne pouvant parler.
Encore un très beau livre, qui se place résolument à hauteur d'homme, au point d'en épouser le phrasé. Pas de descriptions ou de détails inutiles, pas de théories ou de "mises en perspective", on est dans le sujet, en plein dedans et ça... percute.
Encore un très beau livre, qui se place résolument à hauteur d'homme, au point d'en épouser le phrasé. Pas de descriptions ou de détails inutiles, pas de théories ou de "mises en perspective", on est dans le sujet, en plein dedans et ça... percute.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Laurent Mauvignier (20)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Petit quiz sur la littérature arabe
Quel est l'unique auteur arabe à avoir obtenu le Prix Nobel de littérature ?
Gibran Khalil Gibran
Al-Mutannabbi
Naghib Mahfouz
Adonis
7 questions
66 lecteurs ont répondu
Thèmes :
arabe
, littérature arabeCréer un quiz sur ce livre66 lecteurs ont répondu