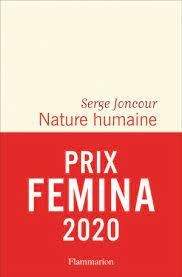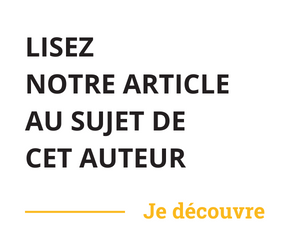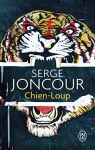En cette rentrée littéraire 2020 exceptionnelle, pas moins de cinq cents nouveaux romans ont été publiés, certainement nés pendant un confinement propice à l'inspiration et à la création. Cette année plus que jamais, la littérature française, marquée par un contexte particulier, semble intimement préoccupée par l'altération de l'environnement et par l'avenir commun des êtres humains. Aux côtés des romans les plus appréciés de la rentrée – Buveurs de vent de Franck Bouysse, L'Anomalie de Hervé le Tellier ou encore L'Enfant céleste de Maud Simonnot -, Nature humaine plonge à corps perdu dans ces thématiques brûlantes d'actualité. Lauréat du prix du roman d'écologie en 2019 pour Chien-loup, Serge Joncour revient aujourd'hui pour nous conter la France rurale des années 1970 à 1990, un territoire profondément bouleversé par l'arrivée du nouveau monde à la veille du XXIe siècle.
Dans cette magnifique fresque sociale qui revêt des allures de roman de terroir, Serge Joncour tisse au fil des pages le tableau édifiant de notre pays, à une époque particulièrement charnière : de la sécheresse de l'été 1976 jusqu'à la tempête de 1999, en passant par l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, l'avènement du nucléaire, la construction des autoroutes, les premières technologies, la catastrophe Tchernobyl, la suprématie grandissante des hypermarchés, l'épidémie de vache folle, la marée noire causée par le naufrage d'Erika ou encore la chute du Mur de Berlin, Nature humaine est un véritable morceau d'Histoire. Dépassant largement l'effet de mode du nature writing, le roman résonne comme un véritable témoignage d'un temps révolu, une mine d'or pour comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés là aujourd'hui, à force de décisions politiques arbitraires et de gestes collectifs visant à entrer une bonne fois pour toutes dans les rouages du capitalisme.
Au coeur de cette société en constante évolution, les personnages ont chacun leurs propres convictions et leur façon d'appréhender les changements : Alexandre, protagoniste dépassé par les événements, presque indifférent aux mouvements du monde, est un agriculteur amoureux de la nature et viscéralement attaché à ses terres ; ses trois soeurs, elles, ne songent qu'à vivre des aventures citadines, attirées par les lumières de la ville et par la couleur de l'argent ; leurs parents fermiers lorgnent du côté du progrès dans l'espoir de s'en sortir ; le vieux Crayssac, personnage savoureux et indécrottable, voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de la modernité dans les campagnes ; quant à Constanze, une jeune allemande dont Alexandre s'éprend, elle ne se rêve autrement qu'en citoyenne du monde, globe-trotteuse engagée dans l'humanitaire et la protection de la nature. À travers ces différentes générations, Joncour dresse surtout le portrait d'une jeunesse mue par un sentiment de révolte général, entre rébellions, attentats et activisme écologique, tandis que les anciens observent avec désespoir et résignation la disparition progressive de leur univers paysan.
Du style brut, presque oralisé de l'auteur, de ses personnages plus vrais que nature, de la succession incontrôlable des événements, finissent par se dégager une indéniable poésie, une puissance diffuse qui fait surgir le réel entre les lignes et une nostalgie infinie, qui nous étreint sans que l'on y prenne garde. Car la grande force de Nature humaine, en dehors de son écriture emportée et de son sujet engagé, c'est de nous faire (re)vivre pleinement, comme si nous y étions, les grands bouleversements de ce dernier quart de siècle, alors que l'avenir ne promettait que mondialisation, réchauffement climatique et urbanisation de masse. En reconstituant ce passé qui nous semble déjà loin, l'auteur ne manque pas de s'adresser à chacun de nous, de toucher en plein coeur toutes les générations, celles qui ont vécu à la même époque qu'Alexandre mais aussi les suivantes, les plus jeunes, qui n'ont pour seul héritage qu'une société en perte totale de repères qu'il s'agit constamment de réinventer.
Jamais passéiste ni moralisateur, bien plus vivant que simplement factuel, Nature humaine est aussi une immense déclaration d'amour à la nature, aux campagnes françaises et à l'homme dans ce qu'il a d'indissociable avec son essence profonde d'être vivant. Face à la dégradation de son environnement vital, Alexandre n'a plus qu'une chose à laquelle se raccrocher : l'espoir de construire des relations avec ses semblables. Véritable fil rouge de ces vingt ans de transformations, de promesses non tenues, de rêves déchus et de retrouvailles éphémères, le lien qui unit Constanze et Alexandre est la seule constante immuable du roman, une histoire d'amour passionnée, romantique, impossible. Alors que la France s'apprête à entrer dans une nouvelle ère – celle d'Internet, de la fonte des glaces et des pandémies planétaires -, ne restent en dernier ressort que l'attachement profond à ces champs qui nous font sentir vivants, à ces étendues de menthe sauvage aux fragrances réconfortantes, et à l'amour, la seule chose universelle et intemporelle qui continue de faire battre les coeurs et tourner le monde.
Lien : https://airsatz.wordpress.co..
Dans cette magnifique fresque sociale qui revêt des allures de roman de terroir, Serge Joncour tisse au fil des pages le tableau édifiant de notre pays, à une époque particulièrement charnière : de la sécheresse de l'été 1976 jusqu'à la tempête de 1999, en passant par l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, l'avènement du nucléaire, la construction des autoroutes, les premières technologies, la catastrophe Tchernobyl, la suprématie grandissante des hypermarchés, l'épidémie de vache folle, la marée noire causée par le naufrage d'Erika ou encore la chute du Mur de Berlin, Nature humaine est un véritable morceau d'Histoire. Dépassant largement l'effet de mode du nature writing, le roman résonne comme un véritable témoignage d'un temps révolu, une mine d'or pour comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés là aujourd'hui, à force de décisions politiques arbitraires et de gestes collectifs visant à entrer une bonne fois pour toutes dans les rouages du capitalisme.
Au coeur de cette société en constante évolution, les personnages ont chacun leurs propres convictions et leur façon d'appréhender les changements : Alexandre, protagoniste dépassé par les événements, presque indifférent aux mouvements du monde, est un agriculteur amoureux de la nature et viscéralement attaché à ses terres ; ses trois soeurs, elles, ne songent qu'à vivre des aventures citadines, attirées par les lumières de la ville et par la couleur de l'argent ; leurs parents fermiers lorgnent du côté du progrès dans l'espoir de s'en sortir ; le vieux Crayssac, personnage savoureux et indécrottable, voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de la modernité dans les campagnes ; quant à Constanze, une jeune allemande dont Alexandre s'éprend, elle ne se rêve autrement qu'en citoyenne du monde, globe-trotteuse engagée dans l'humanitaire et la protection de la nature. À travers ces différentes générations, Joncour dresse surtout le portrait d'une jeunesse mue par un sentiment de révolte général, entre rébellions, attentats et activisme écologique, tandis que les anciens observent avec désespoir et résignation la disparition progressive de leur univers paysan.
Du style brut, presque oralisé de l'auteur, de ses personnages plus vrais que nature, de la succession incontrôlable des événements, finissent par se dégager une indéniable poésie, une puissance diffuse qui fait surgir le réel entre les lignes et une nostalgie infinie, qui nous étreint sans que l'on y prenne garde. Car la grande force de Nature humaine, en dehors de son écriture emportée et de son sujet engagé, c'est de nous faire (re)vivre pleinement, comme si nous y étions, les grands bouleversements de ce dernier quart de siècle, alors que l'avenir ne promettait que mondialisation, réchauffement climatique et urbanisation de masse. En reconstituant ce passé qui nous semble déjà loin, l'auteur ne manque pas de s'adresser à chacun de nous, de toucher en plein coeur toutes les générations, celles qui ont vécu à la même époque qu'Alexandre mais aussi les suivantes, les plus jeunes, qui n'ont pour seul héritage qu'une société en perte totale de repères qu'il s'agit constamment de réinventer.
Jamais passéiste ni moralisateur, bien plus vivant que simplement factuel, Nature humaine est aussi une immense déclaration d'amour à la nature, aux campagnes françaises et à l'homme dans ce qu'il a d'indissociable avec son essence profonde d'être vivant. Face à la dégradation de son environnement vital, Alexandre n'a plus qu'une chose à laquelle se raccrocher : l'espoir de construire des relations avec ses semblables. Véritable fil rouge de ces vingt ans de transformations, de promesses non tenues, de rêves déchus et de retrouvailles éphémères, le lien qui unit Constanze et Alexandre est la seule constante immuable du roman, une histoire d'amour passionnée, romantique, impossible. Alors que la France s'apprête à entrer dans une nouvelle ère – celle d'Internet, de la fonte des glaces et des pandémies planétaires -, ne restent en dernier ressort que l'attachement profond à ces champs qui nous font sentir vivants, à ces étendues de menthe sauvage aux fragrances réconfortantes, et à l'amour, la seule chose universelle et intemporelle qui continue de faire battre les coeurs et tourner le monde.
Lien : https://airsatz.wordpress.co..
Nature humaine de Serge Joncour, éditions Flammarion, 2020
Ce roman de Serge Joncour nous mène de la sécheresse de l'été 1976 à la tempête des derniers jours de décembre 1999.
Alexandre Fabrier vit avec ses parents dans la ferme familiale dans le Lot. du haut de ses 15 ans il sait pertinemment qu'il restera ici, à la ferme, pour prendre la suite de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père. Ses trois soeurs ne s'y intéressent pas, d'une part, et d'autre part, lui aime la terre, sa région et ses vaches.
Durant presque 400 pages, nous assistons au lent démembrement de nos campagnes au travers de plus de trente ans de la vie d'Alexandre, de sa ferme, du Lot et de la France. La course éperdue vers la modernité, les centrales nucléaires parsemées dans le paysage, les autoroutes, pour aller plus loin et plus vite, la mondialisation.
Bientôt Alexandre se retrouve seul à la tête de sa ferme, ses parents prennent leur retraite, ses soeurs attendent leur part d'héritage, et les exploitations alentour s'arrêtent les unes après les autres.
Lui reste son amitié pour le vieux Crayssac, personnage fantasque et attachant, écolo avant l'heure et rebelle né, et son amour pour Constanze, étudiante allemande et colocataire de sa soeur aînée à Toulouse, en 1980. Leur histoire est ponctuée par les actions contre la centrale de Golfech, puis Tchernobyl. Constanze est une voyageuse, elle ne veut pas se fixer quelque part, et parcourt le monde, travaillant pour une ONG, pour « réparer ».
Dans ce magnifique roman alterne la poésie des descriptions, la rudesse de la vie quotidienne, la nostalgie d'un samedi où toute la famille part en ville faire les courses au « Mammouth », la musique, la politique, les déceptions. Et la tristesse de ces villages de campagne partout en France où une maison sur dix seulement est encore occupée, où il n'y a plus de poste, plus d'école, plus de gare...
Merci Monsieur Joncour !
Ce roman de Serge Joncour nous mène de la sécheresse de l'été 1976 à la tempête des derniers jours de décembre 1999.
Alexandre Fabrier vit avec ses parents dans la ferme familiale dans le Lot. du haut de ses 15 ans il sait pertinemment qu'il restera ici, à la ferme, pour prendre la suite de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père. Ses trois soeurs ne s'y intéressent pas, d'une part, et d'autre part, lui aime la terre, sa région et ses vaches.
Durant presque 400 pages, nous assistons au lent démembrement de nos campagnes au travers de plus de trente ans de la vie d'Alexandre, de sa ferme, du Lot et de la France. La course éperdue vers la modernité, les centrales nucléaires parsemées dans le paysage, les autoroutes, pour aller plus loin et plus vite, la mondialisation.
Bientôt Alexandre se retrouve seul à la tête de sa ferme, ses parents prennent leur retraite, ses soeurs attendent leur part d'héritage, et les exploitations alentour s'arrêtent les unes après les autres.
Lui reste son amitié pour le vieux Crayssac, personnage fantasque et attachant, écolo avant l'heure et rebelle né, et son amour pour Constanze, étudiante allemande et colocataire de sa soeur aînée à Toulouse, en 1980. Leur histoire est ponctuée par les actions contre la centrale de Golfech, puis Tchernobyl. Constanze est une voyageuse, elle ne veut pas se fixer quelque part, et parcourt le monde, travaillant pour une ONG, pour « réparer ».
Dans ce magnifique roman alterne la poésie des descriptions, la rudesse de la vie quotidienne, la nostalgie d'un samedi où toute la famille part en ville faire les courses au « Mammouth », la musique, la politique, les déceptions. Et la tristesse de ces villages de campagne partout en France où une maison sur dix seulement est encore occupée, où il n'y a plus de poste, plus d'école, plus de gare...
Merci Monsieur Joncour !
La vie d'Alexandre est toute tracée : il va reprendre l'exploitation agricole familiale. Il est le seul garçon de sa famille : c'est son rôle. Ses trois soeurs, Caroline, Vanessa et Agathe n'auront quant à elles qu'une idée en tête : partir, quitter la ferme, s'arracher à leur condition sociale d'origine. Alexandre n'est pas vraiment malheureux à l'idée de ce destin tout tracé. Il aime son métier, la nature, le contact avec les bêtes. Mais à 19 ans, il fait une rencontre, celle de Constanze qu'il croise dans la colocation où vit Caroline pour ses études. Elle représente pour lui l'altérité totale : elle est belle, elle est engagée, elle est Allemande, elle n'a qu'une idée en tête : voyager et travailler dans l'humanitaire. Elle devient pour lui une véritable obsession qui ne le quittera jamais totalement. Dans ce roman, Serge Joncourt nous offre une rétrospective de tout ce qui s'est passé d'important en France pendant 20 ans de 1979 à 1999. Il y est question pêle-mêle du Larzac, des attentats des années 80, de l'élection de Mitterrand, des antinucléaires, de la vache folle, de la tempête de 99 et surtout de l'évolution de l'agriculture, chaque exploitation ayant vocation à devenir toujours plus gigantesque. J'ai apprécié la construction du livre avec ces flash-back. J'ai été étonnée de me rendre compte que toutes les questions autour de l'environnement existaient déjà et que pourtant on a laissé faire ce qui n'augure rien de bon pour l'avenir (on a l'impression assez désespérante d'un éternel recommencement : on fait n'importe quoi, on le sait mais on continue quand même). J'ai beaucoup aimé aussi l'importance de la nature dans cette histoire : on la malmène mais elle est toujours là pour nous ressourcer (heureusement qu'elle n'est pas rancunière…pour le moment du moins…les diverses catastrophes naturelles qui se multiplient sont peut-être le signe du contraire…).
Lien : https://monpetitcarnetdelect..
Lien : https://monpetitcarnetdelect..
J'attendais avec impatience de lire ce roman, j'ai été contente qu'il obtienne le prix Fémina car j'aime bien les romans de Serge Joncour en général.
Le thème de ce roman est très ambitieux puisqu'il s'agit de retracer les évolutions du monde agricole sur une période de 30 ans à peu près, à travers la vie d'une ferme située dans le Lot. Il s'agit de la ferme de la famille Fabrier, que l'on se transmet depuis 4 générations. Alexandre est le seul garçon de la fratrie, il est pressenti pour reprendre la ferme, ses 3 soeurs sont attirées par la ville. le roman commence par la sécheresse de l'été 1976 et se termine par la tempête de 1999.
J'ai trouvé ce roman très intéressant sur le plan sociologique, historique et politique mais un peu froid et limite ennuyeux par moment car, selon moi, les personnages ne sont pas vraiment incarnés, ce sont un peu des stéréotypes. le roman reste théorique et je n'ai pas ressenti d'émotions. J'avais préféré "Chien-loup" ou "L'amour sans le faire". Mais c'est juste mon avis !
Le thème de ce roman est très ambitieux puisqu'il s'agit de retracer les évolutions du monde agricole sur une période de 30 ans à peu près, à travers la vie d'une ferme située dans le Lot. Il s'agit de la ferme de la famille Fabrier, que l'on se transmet depuis 4 générations. Alexandre est le seul garçon de la fratrie, il est pressenti pour reprendre la ferme, ses 3 soeurs sont attirées par la ville. le roman commence par la sécheresse de l'été 1976 et se termine par la tempête de 1999.
J'ai trouvé ce roman très intéressant sur le plan sociologique, historique et politique mais un peu froid et limite ennuyeux par moment car, selon moi, les personnages ne sont pas vraiment incarnés, ce sont un peu des stéréotypes. le roman reste théorique et je n'ai pas ressenti d'émotions. J'avais préféré "Chien-loup" ou "L'amour sans le faire". Mais c'est juste mon avis !
Bien m'en a pris de parcourir les critiques avant de déposer ce billet : tout a été dit et fort bien dit ; je n'en citerai que deux ( sans sélection aucune) : jeanfrançoislemoine et Kirzy qui expriment clairement mon ressenti personnel. Je me permettrai juste de préciser que je suis issue de cette campagne, et, bien qu'ayant imité les jeunes femmes de cette "histoire",à plusieurs reprises a retenti un écho de ma propre histoire ! Et... "mon" père Crayssac s'appelait Bariat !!
Lu pour répondre à une sollicitation de SallyRose dans le groupe "Pioche dans ma PAL", je ne saurai trop la remercier...
Lu pour répondre à une sollicitation de SallyRose dans le groupe "Pioche dans ma PAL", je ne saurai trop la remercier...
Nous suivons ici une famille de paysans du Lot de 1976 à 1999 : les parents attachés à l'agriculture d'après guerre, avec l'usage des engrais, des pesticides etc..., le fils destiné à reprendre l'exploitation, et les filles qui n'auront d'autre but que de fuir la campagne pour la ville. le récit est centré principalement sur le regard du fils, sur ce mode de vie traditionnel qui, face à la modernité et ses travers, s'effondre et se transforme à la fois. Nous traverserons avec lui les « années de plomb », les événements politiques majeurs, l'élection de Mitterrand et les espoirs suscités, la catastrophe de Tchernobyl et celle de la vache folle, etc...
Le regard de Joncour est un regard juste et empathique, et manifestement il sait ce dont il parle : un écrivain qui a remarqué en surface des champs "les tortillons remontés par les vers" (page 125), a mis ses pieds dans la glaise, on peut lui faire confiance.
Le style est simple, il va droit au but, le discours est parfois un peu convenu, mais c'est un livre qu'on lit avec plaisir.
Le regard de Joncour est un regard juste et empathique, et manifestement il sait ce dont il parle : un écrivain qui a remarqué en surface des champs "les tortillons remontés par les vers" (page 125), a mis ses pieds dans la glaise, on peut lui faire confiance.
Le style est simple, il va droit au but, le discours est parfois un peu convenu, mais c'est un livre qu'on lit avec plaisir.
un peu dubitative au départ en ouvrant ce livre. L'idée de la "vaste fresque historique de la paysannerie" au cours d'une période charnière ne m'attirait qu'à moitié mais ayant, comme beaucoup, des origines familiales de ce côté et ayant passé une partie de mon enfance à la ferme des mes grands-parents en ayant le même âge que le principal protagoniste, Alexandre, je me suis laissée tenter.
Et ce fut une bonne surprise car le livre se centre bien sur ses personnage, Alexandre, l'"héritier" de la ferme de ses parents et grands-parents, et sa famille, dont les soeurs qui partiront vivre à la ville, de même que sur l'amour de sa vie, l'inaccessible (?) Constanze. On a donc droit à une véritable histoire avec de vraies gens et non pas à des pions au service de la "fresque historique".
Ensuite c'est vrai que l'on a droit à un déroulé d'événements assez hallucinant sur une période de 23 ans, entre 1976 et 1999, soit cette période qui a suivi les "trente glorieuses", celle de la mondialisation et de l'emprise subséquente de la grande distribution sur l'activité paysanne, celle du réchauffement climatique et ses conséquences non moins grandes sur les campagnes, celle de l'activisme politique écologique et notamment ses "black blocs", qui existaient déjà dans les années 80 et dont l'auteur souligne bien les ambiguïtés. Les dates sont, mine de rien, toutes soigneusement choisies et font surgir, sur 23 ans, un monde qui apparaît proprement apocalyptique, entre guerres, effondrements, attaques terroristes, catastrophes naturelles et nucléaires dont on sort à vrai dire assez étourdi et dont on se dit : "oui, c'est vrai, tout cela s'est bien passé sur cette période aussi courte".
Paradoxalement on en sort en éprouvant presqu'un sentiment de soulagement. En effet à l'aube de l'an 2000, si l'on n'habitait pas le monde de ce bouquin on se dirait qu'il est impossible que la planète tienne encore plus de quelques années. Vingt ans plus tard elle est toujours là, certainement pas en meilleure forme qu'en 1999, mais, bizarrement, avec toujours les mêmes questions et immenses problèmes auxquels se confronter.
Paradoxalement aussi la fin n'est pas dénuée d'une certain souffle d'air frais, quelque chose comme une bouffée d'optimisme. Il est vrai qu'Alexandre et sa famille avaient "tout bon" selon les critères actuels au début, dans les années 70-80, avec leur élevage respectueux des bêtes et de la nature. Peut-être l'exploitation pourra-t-elle quand même être sauvée ? L'auteur laisse la question largement ouverte...
Et ce fut une bonne surprise car le livre se centre bien sur ses personnage, Alexandre, l'"héritier" de la ferme de ses parents et grands-parents, et sa famille, dont les soeurs qui partiront vivre à la ville, de même que sur l'amour de sa vie, l'inaccessible (?) Constanze. On a donc droit à une véritable histoire avec de vraies gens et non pas à des pions au service de la "fresque historique".
Ensuite c'est vrai que l'on a droit à un déroulé d'événements assez hallucinant sur une période de 23 ans, entre 1976 et 1999, soit cette période qui a suivi les "trente glorieuses", celle de la mondialisation et de l'emprise subséquente de la grande distribution sur l'activité paysanne, celle du réchauffement climatique et ses conséquences non moins grandes sur les campagnes, celle de l'activisme politique écologique et notamment ses "black blocs", qui existaient déjà dans les années 80 et dont l'auteur souligne bien les ambiguïtés. Les dates sont, mine de rien, toutes soigneusement choisies et font surgir, sur 23 ans, un monde qui apparaît proprement apocalyptique, entre guerres, effondrements, attaques terroristes, catastrophes naturelles et nucléaires dont on sort à vrai dire assez étourdi et dont on se dit : "oui, c'est vrai, tout cela s'est bien passé sur cette période aussi courte".
Paradoxalement on en sort en éprouvant presqu'un sentiment de soulagement. En effet à l'aube de l'an 2000, si l'on n'habitait pas le monde de ce bouquin on se dirait qu'il est impossible que la planète tienne encore plus de quelques années. Vingt ans plus tard elle est toujours là, certainement pas en meilleure forme qu'en 1999, mais, bizarrement, avec toujours les mêmes questions et immenses problèmes auxquels se confronter.
Paradoxalement aussi la fin n'est pas dénuée d'une certain souffle d'air frais, quelque chose comme une bouffée d'optimisme. Il est vrai qu'Alexandre et sa famille avaient "tout bon" selon les critères actuels au début, dans les années 70-80, avec leur élevage respectueux des bêtes et de la nature. Peut-être l'exploitation pourra-t-elle quand même être sauvée ? L'auteur laisse la question largement ouverte...
Dans le Lot, aux Bertranges, il y a la ferme des Fabrier.
L'environnement est idyllique.
Les parents, les trois filles, qui partiront à la ville, et le fils Alexandre, 15 ans, qui reprendra la ferme.
De 1976 à 1999, nous allons suivre la vie d'Alexandre.
Outre la vie d'une famille, il y a tous les évènements sociaux qui ont secoué cette période.
La sécheresse, Mitterrand, les émeutes anti-nucléaires, Tchernobyl, le mur de Berlin, la vache folle, la tempête…….
La nature est menacée par le progrès. : construction d'autoroute, élevage intensif, pesticides….
Saura-t-elle résister ?
C'est une belle rétrospective d'une fin de siècle.
Si certains personnages sont dynamiques, j'ai trouvé Alexandre un peu fade et son historie d'amour avec Constanze pas très plausible.
IL a eu d'autres aventures, c'est un peu l'amour est dans le pré.
Le début du livre m'a paru d'un rythme moins soutenu que la deuxième partie, plus dynamique.
Ceci dit c'est un bon livre, bien mené.
C'est l'histoire du dernier quart du vingtième siècle, à travers un homme et sa famille, c'est l'histoire des derniers sursauts d'agonie de la grande civilisation paysanne qui liait l'homme et la terre depuis le néolithique, c'est notre histoire, parce que cette civilisation nous a faite et que ce quart de siècle nous l'avons vécu.
Parlera-t-on de roman total ? Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que c'est finalement qu'un roman total, Alors disons simplement que c'est un grand roman qui aborde de grands sujets.
Le personnage central, appelons-le le héros, mais je préférerais le protagoniste, c'est Alexandre,fils, petit-fils, arrière-petit-fils...de paysans, éleveur dans une région montagneuse non précisée du sud-ouest, entre Toulouse et Rodez, pas loin du Larzac. le Larzac, justement, c'est sa grande époque, on ne parlait pas encore de zone à défendre, mais l'idée y était, on y rencontrait un peu de tout, beaucoup de marginaux dont certains feront souche et deviendront des néo-ruraux, pas mal de gauchistes bien sûr, dont certains à la frontière et pas qu'à la frontière du terrorisme, c'est l'époque de la Bande à Bader et des Brigades Rouges, et Alexandre va, un peu par hasard, se frotter à tout cela, y faire des rencontres, mais ne basculera pas. Même s'il y rencontrera Constanze, l'amour de sa vie, un amour profond, difficile et douloureux, la grande affaire de cette vie restera sa terre, cette ferme qui est dans la famille depuis quatre générations, et qu'il exploite avec ses parents et ses grands parents, dans l'une de ces dernières familles élargies du Sud-Ouest , dont Emmanuel Todd, a parlé dans L'invention de la france » et qui font partie de ce monde paysan qui meurt ; qui meurt parce que le monde change, parce que le progrès, parce que l'Europe, parce que la mondialisation, parce que le Crédit Agricole, parce que la Chambre d'Agriculture, parce que la FNSEA, parce que...ce sont d'ailleurs les mêmes ; et le lecteur craindra un moment que ces vents mauvais n'emportent Alexandre, comme tant d'autres. Mais....
C'est un roman de la nature et de la terre, presque un document sociologique, au point que Jérôme Fourquet le cite dans « La France d'après », son dernier ouvrage, et mieux qu'un document sociologique puisque c'est un roman, et que les romans peignent mieux la société que les études doctrinales, comme un tableau en dit plus qu'une photographie.
Bon, il y a aussi les soeurs d'Alexandre, elles iront à la ville et y réussiront, on pense à jean Ferrat, « les filles, elles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de voulir vivre sa vie », et les liens se distendent.
Mais il y a aussi la grande histoire : l'élection de Mitterand (enfin, grande histoire si l'on veut, mais les personnages le pensent sur le moment), Tchernobyl, la vache folle, et les grandes peurs qu'elles ont engendrées ; et puis aussi une des facettes de la modernité, l'autoroute A20, dont la construction menace.
Et la tempête de 1999, qui sera finalement une eucatastrophe, comme dirait Tolkien...
Bref, beaucoup de choses, et j'en aurais dit plus n'eût-été la crainte de spoiler, quoique pour ma part je ne vois pas grand mal à cela.
Et en tout cas, je le répète, un grand livre, et un livre à lire, un de ces livres trop rares dont on (en tout cas moi) a la sensation bizarre de sortir meilleur.
Avant de conclure, précisions que ce livre est la première partie d'un diptyque, la seconde a été publiée cette année sous le titre "Chaleur humaine", on y retrouve les mêmes personnages, "Vingt ans après", comme chez Dumas
Parlera-t-on de roman total ? Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que c'est finalement qu'un roman total, Alors disons simplement que c'est un grand roman qui aborde de grands sujets.
Le personnage central, appelons-le le héros, mais je préférerais le protagoniste, c'est Alexandre,fils, petit-fils, arrière-petit-fils...de paysans, éleveur dans une région montagneuse non précisée du sud-ouest, entre Toulouse et Rodez, pas loin du Larzac. le Larzac, justement, c'est sa grande époque, on ne parlait pas encore de zone à défendre, mais l'idée y était, on y rencontrait un peu de tout, beaucoup de marginaux dont certains feront souche et deviendront des néo-ruraux, pas mal de gauchistes bien sûr, dont certains à la frontière et pas qu'à la frontière du terrorisme, c'est l'époque de la Bande à Bader et des Brigades Rouges, et Alexandre va, un peu par hasard, se frotter à tout cela, y faire des rencontres, mais ne basculera pas. Même s'il y rencontrera Constanze, l'amour de sa vie, un amour profond, difficile et douloureux, la grande affaire de cette vie restera sa terre, cette ferme qui est dans la famille depuis quatre générations, et qu'il exploite avec ses parents et ses grands parents, dans l'une de ces dernières familles élargies du Sud-Ouest , dont Emmanuel Todd, a parlé dans L'invention de la france » et qui font partie de ce monde paysan qui meurt ; qui meurt parce que le monde change, parce que le progrès, parce que l'Europe, parce que la mondialisation, parce que le Crédit Agricole, parce que la Chambre d'Agriculture, parce que la FNSEA, parce que...ce sont d'ailleurs les mêmes ; et le lecteur craindra un moment que ces vents mauvais n'emportent Alexandre, comme tant d'autres. Mais....
C'est un roman de la nature et de la terre, presque un document sociologique, au point que Jérôme Fourquet le cite dans « La France d'après », son dernier ouvrage, et mieux qu'un document sociologique puisque c'est un roman, et que les romans peignent mieux la société que les études doctrinales, comme un tableau en dit plus qu'une photographie.
Bon, il y a aussi les soeurs d'Alexandre, elles iront à la ville et y réussiront, on pense à jean Ferrat, « les filles, elles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de voulir vivre sa vie », et les liens se distendent.
Mais il y a aussi la grande histoire : l'élection de Mitterand (enfin, grande histoire si l'on veut, mais les personnages le pensent sur le moment), Tchernobyl, la vache folle, et les grandes peurs qu'elles ont engendrées ; et puis aussi une des facettes de la modernité, l'autoroute A20, dont la construction menace.
Et la tempête de 1999, qui sera finalement une eucatastrophe, comme dirait Tolkien...
Bref, beaucoup de choses, et j'en aurais dit plus n'eût-été la crainte de spoiler, quoique pour ma part je ne vois pas grand mal à cela.
Et en tout cas, je le répète, un grand livre, et un livre à lire, un de ces livres trop rares dont on (en tout cas moi) a la sensation bizarre de sortir meilleur.
Avant de conclure, précisions que ce livre est la première partie d'un diptyque, la seconde a été publiée cette année sous le titre "Chaleur humaine", on y retrouve les mêmes personnages, "Vingt ans après", comme chez Dumas
Chronique d'une société annoncée ? Plus que des personnages, ce roman met en scène un territoire. Derrière l'histoire d'une famille du Lot, le roman pointe des changements, infimes et quotidiens. Et ces changements conduisent peu à peu à l'effacement d'un petit monde. Puis à sa disparition.
A qui la faute ? A personne semble dire l'auteur. Paysans, citadins, partisans, opposants... Tous participent à une évolution qui les dépasse. Chacun, de grès ou de force, est aspiré par les bouleversements technologiques, sociétaux et environnementaux. Finalement, sans même en avoir conscience, ils acceptent tous à leur manière ce nouveau monde... Et parfois, les conséquences de leur décisions les prennent à la gorge.
C'est cela la force de ce roman, je trouve. Il se concentre sur le quotidien, avec vigilance. Il montre comment les trajectoires individuelles, innocentes en apparence, semblent conduire à une faute collective. Il montre comment les transformations technologiques du monde affectent peu à peu un territoire reculé et ses habitants.
Même la politique est reléguée au second plan, justement. On en parle, mais finalement personne n'est d'accord sur le chemin à prendre. Car justement, a-t-on le choix ? le monde d'avant, incarné par quelques personnages âgés est déjà trop loin. Les discours alternatifs sonnent aussi creux que les discours progressistes.
La force du roman est bien de mettre en perspective le mondial et le local, l'avènement d'une société que peu semblent vouloir mais dont tous désirent bénéficier. Sauf que le prix à payer semble toujours plus élevée, à mesure que tournent les pages.
A qui la faute ? A personne semble dire l'auteur. Paysans, citadins, partisans, opposants... Tous participent à une évolution qui les dépasse. Chacun, de grès ou de force, est aspiré par les bouleversements technologiques, sociétaux et environnementaux. Finalement, sans même en avoir conscience, ils acceptent tous à leur manière ce nouveau monde... Et parfois, les conséquences de leur décisions les prennent à la gorge.
C'est cela la force de ce roman, je trouve. Il se concentre sur le quotidien, avec vigilance. Il montre comment les trajectoires individuelles, innocentes en apparence, semblent conduire à une faute collective. Il montre comment les transformations technologiques du monde affectent peu à peu un territoire reculé et ses habitants.
Même la politique est reléguée au second plan, justement. On en parle, mais finalement personne n'est d'accord sur le chemin à prendre. Car justement, a-t-on le choix ? le monde d'avant, incarné par quelques personnages âgés est déjà trop loin. Les discours alternatifs sonnent aussi creux que les discours progressistes.
La force du roman est bien de mettre en perspective le mondial et le local, l'avènement d'une société que peu semblent vouloir mais dont tous désirent bénéficier. Sauf que le prix à payer semble toujours plus élevée, à mesure que tournent les pages.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Serge Joncour (17)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Nature humaine : Serge Joncour
Les événements du roman se déroulent entre 1976 et 1999
VRAI
FAUX
10 questions
29 lecteurs ont répondu
Thème : Nature humaine de
Serge JoncourCréer un quiz sur ce livre29 lecteurs ont répondu