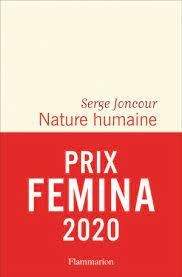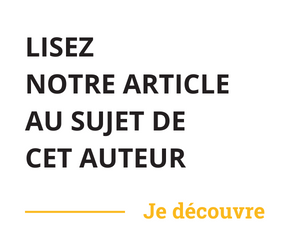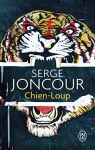Critiques filtrées sur 3 étoiles
De la sécheresse de l'été 1976 aux tempêtes de l'hiver 1999, Serge Joncour égrène vingt cinq ans de fléaux qui ont défrayé la fin du XX siècle, rappelle ce qu'ont été les luttes du Larzac et de Golfech et évoque le mythe errant du socialisme à la française et ses désillusions, l'épidémie de la vache folle et le bug de l'an 2000…
Ces plaies frappent la famille Fabrier, des paysans enracinés dans le Lot, qui vivent tant bien que mal aux Bertranges, une ferme isolée, bâtie sur les réminiscences d'une villa gallo romaine, en cultivant leurs terres avec des techniques séculaires et naturelles et en vendant leurs produits à des petits commerçants … jusqu'à ce que les Grandes Surfaces Alimentaires bouleversent ce fragile équilibre. Alexandre, seul mâle de la nouvelle génération, prend la relève de ses parents et grands parents pendant que ses trois soeurs migrent vers la ville…
Quatre cent pages sans intrigue, sans personnages attachants, se lisent vite, car l'auteur maitrise parfaitement sa plume, mais, à mes yeux, le livre s'égare dans les chemins vicinaux et passe à coté de la question posée par le titre de l'ouvrage : qu'est ce que la nature humaine ?
En conclusion, une lecture plutôt décevante, qui me laisse sur ma faim en offrant un reportage de télé réalité en lieu et place de la question anthropologique et philosophique soulevée. Dommage !
Ces plaies frappent la famille Fabrier, des paysans enracinés dans le Lot, qui vivent tant bien que mal aux Bertranges, une ferme isolée, bâtie sur les réminiscences d'une villa gallo romaine, en cultivant leurs terres avec des techniques séculaires et naturelles et en vendant leurs produits à des petits commerçants … jusqu'à ce que les Grandes Surfaces Alimentaires bouleversent ce fragile équilibre. Alexandre, seul mâle de la nouvelle génération, prend la relève de ses parents et grands parents pendant que ses trois soeurs migrent vers la ville…
Quatre cent pages sans intrigue, sans personnages attachants, se lisent vite, car l'auteur maitrise parfaitement sa plume, mais, à mes yeux, le livre s'égare dans les chemins vicinaux et passe à coté de la question posée par le titre de l'ouvrage : qu'est ce que la nature humaine ?
En conclusion, une lecture plutôt décevante, qui me laisse sur ma faim en offrant un reportage de télé réalité en lieu et place de la question anthropologique et philosophique soulevée. Dommage !
Ça commençait plutôt bien. La canicule de 1976, la campagne du sud-ouest, encore préservée, presque sauvage, évoquaient des souvenirs ensoleillés et enfouis de mon enfance.
J'ai été d'emblée séduit par l'ambition de Serge Joncour, celle de peindre les luttes d'une époque, la fin du septennat de Giscard d'Estaing, qu'on regarde aujourd'hui avec nostalgie, en oubliant les nombreux attentats et les diverses violences qui l'émaillaient.
Le romancier fait mouche en s'attaquant à la fin des trente glorieuses, ces quelques années où le monde bascule vers le modèle néo-libéral qui régit toujours notre époque. C'est ce moment charnière entre l'ancien monde et le nouveau, cet instant où la fracture entre les « somewhere », les enracinés, les gens du terroir et les « anywhere », les élites mondialisées, les habitants des métropoles devient béante, que tente de saisir le roman. Les figures archétypales de cette fracture sont le héros Alexandre, resté fidèle à la ferme familiale, au prix d'un labeur sans fin et d'une vie quasi monacale et sa bien-aimée, Constanze, une allemande de l'est engagée contre le nucléaire qui parcourt le monde dans un tourbillon continu.
« Nature humaine » nous narre ces années 1976-1981 qui voient se produire en temps réel, la disparition programmée de la ruralité en dépit de promesses politiques jamais vraiment tenues, la victoire du grand sur le petit, celle de l'hypermarché sur le petit commerce, des grandes villes sur les petits bourgs, le développement de l'énergie nucléaire et de ses gigantesques centrales en étant l'illustration emblématique. le jeune Alexandre va, le temps de quelques allers-retours à Toulouse, où étudie sa soeur cadette, découvrir une jeunesse en colère, prête à lutter contre le développement de l'atome, et entrevoir la possibilité d'un destin différent de celui que son histoire familiale a façonné.
Et pourtant la magie romanesque n'opère pas, le roman ne m'a jamais captivé, l'histoire d'amour inextricable entre le taiseux Alexandre et l'exubérante Constanze m'a un instant fait songer à un épisode de « l'amour est dans le pré », tant le roman insiste sur l'impossibilité ontologique d'une vie amoureuse épanouie pour un jeune agriculteur enraciné à son lopin de terre. le style souvent neutre, l'absence de lyrisme, une certaine froideur, la forme de distance avec laquelle sont traités la plupart des personnages, ont achevé de me « sortir » du livre de Serge Joncour.
Voilà, ça commençait plutôt bien, mais j'ai parcouru le roman sans passion, et je n'ai pas été transporté par la beauté apocalyptique du dénouement qui se déroule au coeur de la tempête de 1999, cet instant rare où la nature se met en colère, emporte tout sur son passage, nous rappelle la fragilité de toutes choses, et tente une fois encore de nous prévenir de la terrible impasse où conduit inéluctablement l'hubris humaine.
J'ai été d'emblée séduit par l'ambition de Serge Joncour, celle de peindre les luttes d'une époque, la fin du septennat de Giscard d'Estaing, qu'on regarde aujourd'hui avec nostalgie, en oubliant les nombreux attentats et les diverses violences qui l'émaillaient.
Le romancier fait mouche en s'attaquant à la fin des trente glorieuses, ces quelques années où le monde bascule vers le modèle néo-libéral qui régit toujours notre époque. C'est ce moment charnière entre l'ancien monde et le nouveau, cet instant où la fracture entre les « somewhere », les enracinés, les gens du terroir et les « anywhere », les élites mondialisées, les habitants des métropoles devient béante, que tente de saisir le roman. Les figures archétypales de cette fracture sont le héros Alexandre, resté fidèle à la ferme familiale, au prix d'un labeur sans fin et d'une vie quasi monacale et sa bien-aimée, Constanze, une allemande de l'est engagée contre le nucléaire qui parcourt le monde dans un tourbillon continu.
« Nature humaine » nous narre ces années 1976-1981 qui voient se produire en temps réel, la disparition programmée de la ruralité en dépit de promesses politiques jamais vraiment tenues, la victoire du grand sur le petit, celle de l'hypermarché sur le petit commerce, des grandes villes sur les petits bourgs, le développement de l'énergie nucléaire et de ses gigantesques centrales en étant l'illustration emblématique. le jeune Alexandre va, le temps de quelques allers-retours à Toulouse, où étudie sa soeur cadette, découvrir une jeunesse en colère, prête à lutter contre le développement de l'atome, et entrevoir la possibilité d'un destin différent de celui que son histoire familiale a façonné.
Et pourtant la magie romanesque n'opère pas, le roman ne m'a jamais captivé, l'histoire d'amour inextricable entre le taiseux Alexandre et l'exubérante Constanze m'a un instant fait songer à un épisode de « l'amour est dans le pré », tant le roman insiste sur l'impossibilité ontologique d'une vie amoureuse épanouie pour un jeune agriculteur enraciné à son lopin de terre. le style souvent neutre, l'absence de lyrisme, une certaine froideur, la forme de distance avec laquelle sont traités la plupart des personnages, ont achevé de me « sortir » du livre de Serge Joncour.
Voilà, ça commençait plutôt bien, mais j'ai parcouru le roman sans passion, et je n'ai pas été transporté par la beauté apocalyptique du dénouement qui se déroule au coeur de la tempête de 1999, cet instant rare où la nature se met en colère, emporte tout sur son passage, nous rappelle la fragilité de toutes choses, et tente une fois encore de nous prévenir de la terrible impasse où conduit inéluctablement l'hubris humaine.
Impression mitigée...
J'ai aimé la rétrospective des quarante dernières années en France sur la montée de la société de consommation et de la vague de mondialisation qui emporte tout, traditions, rapport à la nature, bon sens paysan et velléités de s'extraire de ce modèle asservissant , le tout saupoudré de name dropping de marques désuètes qui ponctuent l'évolution des usages : entre acheter son Tang au Mammouth et rechercher une personne perdue sur les annuaires du Minitel, il y a en effet un monde!
J'ai aussi aimé l'évocation du Lot, terre de mes racines familiales, son herbe grasse et ses vallons retirés, ses paysans aux modes de vie déjà bien assez éloignés il y a quarante ans de ceux des citadins pour que la fracture se referme un jour.
Mais tout cela ne fait pas forcément un bon roman, d'autant que l'écriture sans relief n'est pas au rendez-vous pour relever l'ossature un peu maigre de l'intrigue.
J'ai plutôt eu l'impression de me retrouver dans le scénario du prochain film de Guillaume Canet, avec le susnommé dans le rôle du brave exploitant agricole balayé par le progrès et François Cluzet dans celui du vieil anar qui a fait le Larzac. So french, so déjà vu, so manichéen sur le mode "c'était mieux avant"... j'ai beau être en phase avec l'ensemble du constat posé, ça m'emm.. un peu le discours larmoyant sur ce thème. Et puis l'A20 pour aller à Cahors, c'est vachement bien.
J'ai aimé la rétrospective des quarante dernières années en France sur la montée de la société de consommation et de la vague de mondialisation qui emporte tout, traditions, rapport à la nature, bon sens paysan et velléités de s'extraire de ce modèle asservissant , le tout saupoudré de name dropping de marques désuètes qui ponctuent l'évolution des usages : entre acheter son Tang au Mammouth et rechercher une personne perdue sur les annuaires du Minitel, il y a en effet un monde!
J'ai aussi aimé l'évocation du Lot, terre de mes racines familiales, son herbe grasse et ses vallons retirés, ses paysans aux modes de vie déjà bien assez éloignés il y a quarante ans de ceux des citadins pour que la fracture se referme un jour.
Mais tout cela ne fait pas forcément un bon roman, d'autant que l'écriture sans relief n'est pas au rendez-vous pour relever l'ossature un peu maigre de l'intrigue.
J'ai plutôt eu l'impression de me retrouver dans le scénario du prochain film de Guillaume Canet, avec le susnommé dans le rôle du brave exploitant agricole balayé par le progrès et François Cluzet dans celui du vieil anar qui a fait le Larzac. So french, so déjà vu, so manichéen sur le mode "c'était mieux avant"... j'ai beau être en phase avec l'ensemble du constat posé, ça m'emm.. un peu le discours larmoyant sur ce thème. Et puis l'A20 pour aller à Cahors, c'est vachement bien.
Un avis mitigé sur ce roman dont je sais pourtant que beaucoup de mes ami-e-s babeliotes l'ont apprécié.
Certes, l'auteur nous fait une fresque formidable de la vie de notre pays de 1976 à 1999, de la grande sécheresse et de l'impôt spécifique qui en suivit, à la grande tempête de l'hiver 1999, en passant par tous ces grands événements, l'élection de Mitterand en 1981 si porteuse d'espoirs pourtant bien déçus, la catastrophe de Tchernobyl de 1986, la chute du mur de Berlin, la crise de la vache folle, etc.. et tous ces « petits » événements de la vie, le développement du téléphone, les nouveaux courants musicaux, la mode et j'en passe.
Il m'a rappelé, à nous qui venons de vivre et vivons des crises, attentats terroristes, gilets jaunes, pandémie, combien ça pouvait être mouvementé et violent aussi « avant », avec notamment les manifestations contre le nucléaire, les attentats de la mouvance gauchiste, etc..
La description du monde paysan des années 80 subissant le développement effréné de la société de consommation, des hypermarchés, de la mondialisation, la désertification des campagnes, la volonté des jeunes de quitter le monde rural pour la ville, est juste, parfois émouvante. Il est important de se souvenir de ces années, alors que de nos jours (est ce pérenne?) le mouvement semble s'inverser, que les consciences changent, que le réchauffement climatique et la pandémie ont contribué à faire bouger les lignes, et qu'on entend parler de la volonté de consommer local, d'acheter du seconde main, du retour de certains jeunes dans le monde rural, du souci de produire moins mais mieux, du développement durable.
L'histoire d'Alexandre Fabrier, adolescent au début, adulte approchant la quarantaine à la fin, et de sa famille de paysans sur ces si belles terres du Lot illustre cette période de notre histoire. Alexandre si attaché à ses bêtes, à ses pâtures, à cette nature « humaine », c'est à dire où l'être humain respecte et aime la nature, fait partie de tous ces jeunes paysans qui furent confrontés à tant de changements dans leurs pratiques, dans leur relation au reste de la nation, ainsi qu'à l'effondrement d'un certain monde rural. Alexandre chargé du lourd héritage de continuer le chemin tracé par des générations de paysans, a la force des faibles, « la force des discrets ». Ce taiseux qui tout en ayant l'air de suivre le mouvement, d'être plutôt docile à l'égard des manoeuvres de ses soeurs, par exemple, sait en fait ce qu'il veut faire ou plutôt ne veut pas faire, jusqu'à ce que la nature produise à sa place l'apocalypse qu'il avait programmé.
Mais deux choses m'ont gêné dans ce livre.
D'abord, et même si je sais que « l'amour, l'amour, l'amour, dont on parle toujours » peut prendre des chemins improbables (une actrice de cinéma américaine épouser un prince de Monaco, par exemple), je n'ai pas su adhérer à celui d'Alexandre et de la belle allemande de l'Est Constanze. Tout cela m'a paru fabriqué pour illustrer le choc des cultures, entre un paysan du monde du passé, attaché à ses racines et une femme
du monde des villes et du bloc de l'Est, voulant s'émanciper de ce bloc, une femme libérée, utopiste, voulant changer « le village » du monde.
Vraiment je n'ai pas cru à cette histoire, j'ai peut-être tort, mais c'est comme ça.
Et puis, j'ai été déçu par la froideur et la platitude, sans doute délibérée, de l'écriture de ce roman. En adoptant ce style pour nous montrer, au travers de l'histoire de cette famille Fabrier, la perte de repères des paysans face à la pression du monde qui les entoure, en évitant tout lyrisme,(par exemple j'aurais aimé ressentir les sentiments d'Alexandre à l'égard de la nature qu'il aime) le résultat en est pour moi un récit et des personnages auxquels j'ai eu du mal à m'attacher.
Certes, l'auteur nous fait une fresque formidable de la vie de notre pays de 1976 à 1999, de la grande sécheresse et de l'impôt spécifique qui en suivit, à la grande tempête de l'hiver 1999, en passant par tous ces grands événements, l'élection de Mitterand en 1981 si porteuse d'espoirs pourtant bien déçus, la catastrophe de Tchernobyl de 1986, la chute du mur de Berlin, la crise de la vache folle, etc.. et tous ces « petits » événements de la vie, le développement du téléphone, les nouveaux courants musicaux, la mode et j'en passe.
Il m'a rappelé, à nous qui venons de vivre et vivons des crises, attentats terroristes, gilets jaunes, pandémie, combien ça pouvait être mouvementé et violent aussi « avant », avec notamment les manifestations contre le nucléaire, les attentats de la mouvance gauchiste, etc..
La description du monde paysan des années 80 subissant le développement effréné de la société de consommation, des hypermarchés, de la mondialisation, la désertification des campagnes, la volonté des jeunes de quitter le monde rural pour la ville, est juste, parfois émouvante. Il est important de se souvenir de ces années, alors que de nos jours (est ce pérenne?) le mouvement semble s'inverser, que les consciences changent, que le réchauffement climatique et la pandémie ont contribué à faire bouger les lignes, et qu'on entend parler de la volonté de consommer local, d'acheter du seconde main, du retour de certains jeunes dans le monde rural, du souci de produire moins mais mieux, du développement durable.
L'histoire d'Alexandre Fabrier, adolescent au début, adulte approchant la quarantaine à la fin, et de sa famille de paysans sur ces si belles terres du Lot illustre cette période de notre histoire. Alexandre si attaché à ses bêtes, à ses pâtures, à cette nature « humaine », c'est à dire où l'être humain respecte et aime la nature, fait partie de tous ces jeunes paysans qui furent confrontés à tant de changements dans leurs pratiques, dans leur relation au reste de la nation, ainsi qu'à l'effondrement d'un certain monde rural. Alexandre chargé du lourd héritage de continuer le chemin tracé par des générations de paysans, a la force des faibles, « la force des discrets ». Ce taiseux qui tout en ayant l'air de suivre le mouvement, d'être plutôt docile à l'égard des manoeuvres de ses soeurs, par exemple, sait en fait ce qu'il veut faire ou plutôt ne veut pas faire, jusqu'à ce que la nature produise à sa place l'apocalypse qu'il avait programmé.
Mais deux choses m'ont gêné dans ce livre.
D'abord, et même si je sais que « l'amour, l'amour, l'amour, dont on parle toujours » peut prendre des chemins improbables (une actrice de cinéma américaine épouser un prince de Monaco, par exemple), je n'ai pas su adhérer à celui d'Alexandre et de la belle allemande de l'Est Constanze. Tout cela m'a paru fabriqué pour illustrer le choc des cultures, entre un paysan du monde du passé, attaché à ses racines et une femme
du monde des villes et du bloc de l'Est, voulant s'émanciper de ce bloc, une femme libérée, utopiste, voulant changer « le village » du monde.
Vraiment je n'ai pas cru à cette histoire, j'ai peut-être tort, mais c'est comme ça.
Et puis, j'ai été déçu par la froideur et la platitude, sans doute délibérée, de l'écriture de ce roman. En adoptant ce style pour nous montrer, au travers de l'histoire de cette famille Fabrier, la perte de repères des paysans face à la pression du monde qui les entoure, en évitant tout lyrisme,(par exemple j'aurais aimé ressentir les sentiments d'Alexandre à l'égard de la nature qu'il aime) le résultat en est pour moi un récit et des personnages auxquels j'ai eu du mal à m'attacher.
Voici un roman que j'ai eu plaisir à lire et pourtant, quelques semaines plus tard, j'en avais oublié son contenu... C'est en relisant la quatrième de couverture que tout m'est revenu en mémoire.
Elle est belle la vie d'Alexandre. Ou ce qu'il veut en faire. Beaucoup de travail, certes. Peu de temps pour conter fleurette. Mais, cette vallée, ces champs de luzerne, le ruisseau, les milliers de petites fleurs dont son troupeau de vaches se régalent !
Il est le seul enfant pour qui la question ne se pose pas. Il travaille à la ferme de ses parents et reprendra l'exploitation quand ils seront trop vieux. Quant à ses soeurs, elles sont trop attirées par la ville, leurs études et s'orienteront vers des métiers bien différents. Un monde tout proche et pourtant si éloigné, mais un monde qui a tendance à développer rapidement ses ramifications. Ce n'est pas le désert qui avance ici, mais la ville avec ses nouvelles technologies, ses moyens de communication, ses routes et transports divers.
Sur une trentaine d'années à partir de 1976, l'auteur retrace à travers l'histoire de cette famille, les grands événements et la politique en France. Il défend l'idée que ceux qui ont goûter au progrès ne peuvent plus faire marche arrière, étant pris dans une toile d'araignée qui ne cesse de s'élargir.
Alexandre est l'un des derniers à vouloir maintenir un élevage sain dans un environnement sain. Jusqu'où iront ses convictions ? Aura-t-il la force pour s'opposer aux avancées technologiques dont il doute du bien-fondé et à la bureaucratie de plus en plus lourde et complexe ?
C'est un roman accessible à tous, la plume y est simple et sans fioriture. Je ne sais pourquoi mas je m'attendais à découvrir une écriture plus riche et plus recherchée et je ne lui ai rien trouvé d'exceptionnel. Un petit peu de déception de ce côté-là. Nature humaine est un roman mais le message écologique sur fond d'histoire familiale est trop perçant et ça m'a déplu. Si j'avais envie d'approfondir le sujet, j'aurais choisi un essai, une étude ou une satire sociale pourquoi pas ? Mon opinion (qui n'engage que moi bien évidemment) est que l'auteur a voulu faire un arrêt sur image dans le temps. J'ai trop ressenti le "c'était mieux avant". le progrès ne s'arrêtera pas, il ne s'est jamais arrêté, qu'on le veuille ou non même armés de notre bonne volonté, ce n'est pas nous petites fourmis laborieuses qui l'arrêteront et il faut accepter de le reconnaître, tout n'est pas à jeter non plus.
Donc pour moi, avis mitigé. Je vais maintenant lire quelques autres critiques mais comme toujours je tiens avant tout à donner un ressenti personnel sans risquer d'être influencée.
Elle est belle la vie d'Alexandre. Ou ce qu'il veut en faire. Beaucoup de travail, certes. Peu de temps pour conter fleurette. Mais, cette vallée, ces champs de luzerne, le ruisseau, les milliers de petites fleurs dont son troupeau de vaches se régalent !
Il est le seul enfant pour qui la question ne se pose pas. Il travaille à la ferme de ses parents et reprendra l'exploitation quand ils seront trop vieux. Quant à ses soeurs, elles sont trop attirées par la ville, leurs études et s'orienteront vers des métiers bien différents. Un monde tout proche et pourtant si éloigné, mais un monde qui a tendance à développer rapidement ses ramifications. Ce n'est pas le désert qui avance ici, mais la ville avec ses nouvelles technologies, ses moyens de communication, ses routes et transports divers.
Sur une trentaine d'années à partir de 1976, l'auteur retrace à travers l'histoire de cette famille, les grands événements et la politique en France. Il défend l'idée que ceux qui ont goûter au progrès ne peuvent plus faire marche arrière, étant pris dans une toile d'araignée qui ne cesse de s'élargir.
Alexandre est l'un des derniers à vouloir maintenir un élevage sain dans un environnement sain. Jusqu'où iront ses convictions ? Aura-t-il la force pour s'opposer aux avancées technologiques dont il doute du bien-fondé et à la bureaucratie de plus en plus lourde et complexe ?
C'est un roman accessible à tous, la plume y est simple et sans fioriture. Je ne sais pourquoi mas je m'attendais à découvrir une écriture plus riche et plus recherchée et je ne lui ai rien trouvé d'exceptionnel. Un petit peu de déception de ce côté-là. Nature humaine est un roman mais le message écologique sur fond d'histoire familiale est trop perçant et ça m'a déplu. Si j'avais envie d'approfondir le sujet, j'aurais choisi un essai, une étude ou une satire sociale pourquoi pas ? Mon opinion (qui n'engage que moi bien évidemment) est que l'auteur a voulu faire un arrêt sur image dans le temps. J'ai trop ressenti le "c'était mieux avant". le progrès ne s'arrêtera pas, il ne s'est jamais arrêté, qu'on le veuille ou non même armés de notre bonne volonté, ce n'est pas nous petites fourmis laborieuses qui l'arrêteront et il faut accepter de le reconnaître, tout n'est pas à jeter non plus.
Donc pour moi, avis mitigé. Je vais maintenant lire quelques autres critiques mais comme toujours je tiens avant tout à donner un ressenti personnel sans risquer d'être influencée.
Nous suivons ici une famille de paysans du Lot de 1976 à 1999 : les parents attachés à l'agriculture d'après guerre, avec l'usage des engrais, des pesticides etc..., le fils destiné à reprendre l'exploitation, et les filles qui n'auront d'autre but que de fuir la campagne pour la ville. le récit est centré principalement sur le regard du fils, sur ce mode de vie traditionnel qui, face à la modernité et ses travers, s'effondre et se transforme à la fois. Nous traverserons avec lui les « années de plomb », les événements politiques majeurs, l'élection de Mitterrand et les espoirs suscités, la catastrophe de Tchernobyl et celle de la vache folle, etc...
Le regard de Joncour est un regard juste et empathique, et manifestement il sait ce dont il parle : un écrivain qui a remarqué en surface des champs "les tortillons remontés par les vers" (page 125), a mis ses pieds dans la glaise, on peut lui faire confiance.
Le style est simple, il va droit au but, le discours est parfois un peu convenu, mais c'est un livre qu'on lit avec plaisir.
Le regard de Joncour est un regard juste et empathique, et manifestement il sait ce dont il parle : un écrivain qui a remarqué en surface des champs "les tortillons remontés par les vers" (page 125), a mis ses pieds dans la glaise, on peut lui faire confiance.
Le style est simple, il va droit au but, le discours est parfois un peu convenu, mais c'est un livre qu'on lit avec plaisir.
Dans le Lot, aux Bertranges, il y a la ferme des Fabrier.
L'environnement est idyllique.
Les parents, les trois filles, qui partiront à la ville, et le fils Alexandre, 15 ans, qui reprendra la ferme.
De 1976 à 1999, nous allons suivre la vie d'Alexandre.
Outre la vie d'une famille, il y a tous les évènements sociaux qui ont secoué cette période.
La sécheresse, Mitterrand, les émeutes anti-nucléaires, Tchernobyl, le mur de Berlin, la vache folle, la tempête…….
La nature est menacée par le progrès. : construction d'autoroute, élevage intensif, pesticides….
Saura-t-elle résister ?
C'est une belle rétrospective d'une fin de siècle.
Si certains personnages sont dynamiques, j'ai trouvé Alexandre un peu fade et son historie d'amour avec Constanze pas très plausible.
IL a eu d'autres aventures, c'est un peu l'amour est dans le pré.
Le début du livre m'a paru d'un rythme moins soutenu que la deuxième partie, plus dynamique.
Ceci dit c'est un bon livre, bien mené.
J'ai terminé ce livre avec un sentiment très mitigé et en décalage avec la Babelio sphère.
Le sujet est beau et important : l'évolution de nos campagnes depuis les années 80, la mutation d'une agriculture de proximité à une industrialisation anonyme, le rapport à la terre, à la famille, les liens entre écologie et culture. Bref, des sujets qui me touchent et me passionnent même.
Le personnage d'Alexandre est touchant. J'ai apprécié le traitement toute en finesse de ce personnage, ses paradoxes, le lien à sa famille. L'homme est brave et vit dans le rêve de poursuivre la voie tracée par ses aïeux sans se méfier de ces nouveaux progrès, de ces nouvelles demandes... La mutation du paysage et des pratiques est bien saisie. L'arrivée des grandes enseignes, des infrastructures autoroutières et le clivage que cela entraîne entre les générations.
Néanmoins, j'ai été gênée par de nombreuses situations qui me semblent assez invraisemblables . Tout d'abord, le traitement des personnages féminins très (trop) progressistes dans un milieu qui ne l'est pas du tout. . La littérature est-elle là pour faire vraisemblance ? Doit-elle créer une jolie carte postale pour mieux servir des idées ? C'est un vaste sujet dont je n'ai pas la réponse. Mais il y a, à mes yeux, une idéalisation de la campagne et de la ruralité dans ce roman dans lequel je ne me reconnais pas.
Mais ce n'est que mon avis ...
Bonne lecture
Le sujet est beau et important : l'évolution de nos campagnes depuis les années 80, la mutation d'une agriculture de proximité à une industrialisation anonyme, le rapport à la terre, à la famille, les liens entre écologie et culture. Bref, des sujets qui me touchent et me passionnent même.
Le personnage d'Alexandre est touchant. J'ai apprécié le traitement toute en finesse de ce personnage, ses paradoxes, le lien à sa famille. L'homme est brave et vit dans le rêve de poursuivre la voie tracée par ses aïeux sans se méfier de ces nouveaux progrès, de ces nouvelles demandes... La mutation du paysage et des pratiques est bien saisie. L'arrivée des grandes enseignes, des infrastructures autoroutières et le clivage que cela entraîne entre les générations.
Néanmoins, j'ai été gênée par de nombreuses situations qui me semblent assez invraisemblables . Tout d'abord, le traitement des personnages féminins très (trop) progressistes dans un milieu qui ne l'est pas du tout. . La littérature est-elle là pour faire vraisemblance ? Doit-elle créer une jolie carte postale pour mieux servir des idées ? C'est un vaste sujet dont je n'ai pas la réponse. Mais il y a, à mes yeux, une idéalisation de la campagne et de la ruralité dans ce roman dans lequel je ne me reconnais pas.
Mais ce n'est que mon avis ...
Bonne lecture
un roman social qui balaie les flancs du Larzac des années 80 à 1999. On suit la trajectoire d'une famille, et surtout du fils, destiné à reprendre l'exploitation familiale. Tendu entre la tradition, la modernité, le refus du capitalisme et l'envie d'une nouvelle vie, ce garçon incarne les questionnements d'une génération d'agriculteurs, sans aucun doute.
J'ai aimé le contexte, la trame, le terroir dans lequel s'enracine ce roman.
Par contre, cette lecture confirme mon avis sur Serge Joncour, j'ai du mal avec son écriture, je trouve ses textes un peu mous et le style terne, je m'ennuie malheureusement un peu vite... Lecture en demi-teinte, donc.
J'ai aimé le contexte, la trame, le terroir dans lequel s'enracine ce roman.
Par contre, cette lecture confirme mon avis sur Serge Joncour, j'ai du mal avec son écriture, je trouve ses textes un peu mous et le style terne, je m'ennuie malheureusement un peu vite... Lecture en demi-teinte, donc.
Il est rare de trouver de l'objectivité dans la description du monde paysan, peut-être parce qu'il nous semble en venir et avons tendance à couvrir ses erreurs de trop d'indulgence.
La ferme d'Alexandre et de sa famille est idyllique. Ici, pas de surexploitation des terres à coups d'engrais, de pesticides, d'herbicides, pas de destruction des bocages et des haies, pas d'élevage intensif. Seuls « les méchants » des villes bousculent l'enclos d'un paradis où l'homme est le gardien de la nature.
Mais, c'est bien la génération des paysans d'après guerre qui a détruit, sous l'effet des conseils délétères du monde scientifique et politique et de l'appât du gain, les sols et les rivières, gavé ses élevages d'antibiotiques, accumulé les lisiers en Bretagne. C'est bien celle d'Alexandre qui a perpétué le mouvement en tuant oiseaux et mammifères qui ont ingéré les graines enrobées qu'ils répandaient au sol, éliminant toute diversité en semant des variétés OGM ou "certifiées". Ce sont bien les Alexandre qui continuent à s'asphyxier au gas-oil de leur tracteurs, attrapent des cancers en respirant la poussière des graines qu'ils chargent dans leur semoirs ou en manipulant leur bidon de Round-up …
Rien de tout cela aux Bertranges, la ferme d'Alexandre. le contraste est ainsi créé.
Notre héros n'a pas étudié en école supérieure d'agronomie, n'a pas fait son service militaire, n'adhère à aucun mouvement syndical et n'a même jamais avoir entendu parler de José Bové, ne chasse pas, ne pèche pas… Il semble ainsi échapper à son temps.
La naissance d'une conscience écologique ne le touche que parce qu'une belle allemande s'y intéresse ou que l'autoroute menace ses terres. Il est falot, pusillanime et manque à ce point de relief que l'on aurait bien du mal à le décrire.
Et il déteint finalement sur l'ensemble ce roman qui ne choisit jamais réellement son camp et comme lui ne s'engage dans aucun combat réel.
Mais le combat du petit n'est-il pas, de toute manière, condamné à l'échec par la tempête permanente de l'Histoire de la domination par l'argent.
La ferme d'Alexandre et de sa famille est idyllique. Ici, pas de surexploitation des terres à coups d'engrais, de pesticides, d'herbicides, pas de destruction des bocages et des haies, pas d'élevage intensif. Seuls « les méchants » des villes bousculent l'enclos d'un paradis où l'homme est le gardien de la nature.
Mais, c'est bien la génération des paysans d'après guerre qui a détruit, sous l'effet des conseils délétères du monde scientifique et politique et de l'appât du gain, les sols et les rivières, gavé ses élevages d'antibiotiques, accumulé les lisiers en Bretagne. C'est bien celle d'Alexandre qui a perpétué le mouvement en tuant oiseaux et mammifères qui ont ingéré les graines enrobées qu'ils répandaient au sol, éliminant toute diversité en semant des variétés OGM ou "certifiées". Ce sont bien les Alexandre qui continuent à s'asphyxier au gas-oil de leur tracteurs, attrapent des cancers en respirant la poussière des graines qu'ils chargent dans leur semoirs ou en manipulant leur bidon de Round-up …
Rien de tout cela aux Bertranges, la ferme d'Alexandre. le contraste est ainsi créé.
Notre héros n'a pas étudié en école supérieure d'agronomie, n'a pas fait son service militaire, n'adhère à aucun mouvement syndical et n'a même jamais avoir entendu parler de José Bové, ne chasse pas, ne pèche pas… Il semble ainsi échapper à son temps.
La naissance d'une conscience écologique ne le touche que parce qu'une belle allemande s'y intéresse ou que l'autoroute menace ses terres. Il est falot, pusillanime et manque à ce point de relief que l'on aurait bien du mal à le décrire.
Et il déteint finalement sur l'ensemble ce roman qui ne choisit jamais réellement son camp et comme lui ne s'engage dans aucun combat réel.
Mais le combat du petit n'est-il pas, de toute manière, condamné à l'échec par la tempête permanente de l'Histoire de la domination par l'argent.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Serge Joncour (17)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Nature humaine : Serge Joncour
Les événements du roman se déroulent entre 1976 et 1999
VRAI
FAUX
10 questions
29 lecteurs ont répondu
Thème : Nature humaine de
Serge JoncourCréer un quiz sur ce livre29 lecteurs ont répondu