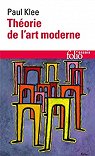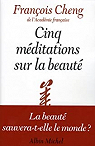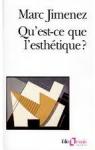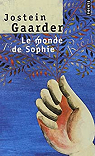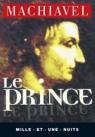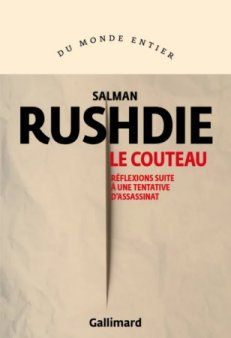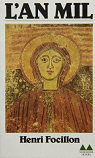Henri Focillon/5
12 notes
Résumé :
L'ESPRIT fait la main, la main fait l'esprit. Le geste ne crée pas, le geste sans lendemain provoque et l'état de conscience. Le geste qui crée exerce une action continue sur la vie intérieure. La main arrache le toucher à sa passivité réceptive, elle l'organise pour l'expérience et pour l'action. Elle apprend à mme à posséder l'étendue, le poids, la densité, le nombre. Créant un univers inédit, elle y laisse partout son empreinte. Elle se mesure avec la matière qu'... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Vie des formesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
Voici un essai fondateur d'histoire de l'art datant de 1934 donnant une approche formaliste de l'oeuvre. Pour Henri Focillon l'oeuvre - qu'elle soit sculpture, peinture, gravure ou architecture - est une forme conditionnée par la matière, le geste naissant dans l'esprit, créant un nouvel espace et s'émancipant des aspects de peuple, de territoire ou de géographie. Prenant appui sur des formes simples et universelles tel l'entrelacs, il décortique avec minutie son point de vue entre 5 chapitres : le monde des formes, les formes dans l'espace, les formes dans la matière, les formes dans l'esprit et les formes dans le temps.
L'essai est rigoureux (voir vigoureux) et il faut prendre garde de ne pas lutter contre les phrases de Focillon qui témoigne également d'une approche poétique et philosophique de l'objet oeuvre.
L'essai est rigoureux (voir vigoureux) et il faut prendre garde de ne pas lutter contre les phrases de Focillon qui témoigne également d'une approche poétique et philosophique de l'objet oeuvre.
Citations et extraits (15)
Voir plus
Ajouter une citation
La forme n’est qu’une vue de l’esprit, une spéculation sur l’étendue réduite à l’intelligibilité géométrique, tant qu’elle ne vit pas dans la matière. Comme l’espace de la vie, l’espace de l’art n’est pas sa propre figure schéma¬tique, son abréviation justement calculée. Bien que ce soit une illusion assez communément répandue, l’art n’est pas seulement une géométrie fantastique, ou plutôt une topologie plus complexe, il est lié au poids, à la densité, à la lumière, à la couleur. L’art le plus ascétique, celui qui vise à atteindre, avec des moyens pauvres et purs, les régions les plus désintéressées de la pensée et du sentiment, n’est pas seulement porté par la matière à laquelle il fait vœu d’échapper, mais nourri d’elle. Sans elle, non seulement il ne serait pas, mais encore il ne serait pas tel qu’il souhaite d’être, et son vain renoncement atteste encore la grandeur et la puissance de sa servitude. Les vieilles antinomies, esprit-matière, matière-forme, nous obsèdent encore avec autant d’empire que l’antique dualisme de la forme et du fond. Même s’il reste encore quelque ombre de signification ou de commodité à ces antithèses en logique pure, qui veut comprendre quoi que ce soit à la vie des formes doit commencer par s’en libérer. Toute science d’observation, surtout celle qui s’attache aux mouvements et aux créations de l’esprit humain, est essentiellement une phénoménologie, au sens étroit du mot. Ainsi nous avons chance de saisir d’authentiques valeurs spirituelles. L’étude de la face de la terre et de la genèse du relief, la morphogénie, donne un socle puissant à toute poétique du paysage, mais ne se propose pas cet objet.
Le physicien ne s’emploie pas à définir l’« esprit » auquel obéissent les transformations et les comportements de la pesanteur, de la chaleur, de la lumière, de l’électricité. Au surplus, on ne saurait confondre désormais l’inertie de la masse et la vie de la matière, puisque cette dernière, dans ses plus infimes replis, est toujours structure et action, c’est-à-dire forme, et plus nous restreignons le champ des métamorphoses, mieux nous saisissons l’intensité et la courbe de ses mouvements. Il n’y aurait que de la vanité dans ces controverses sur le vocabulaire, s’il n’engageait les méthodes.
Au moment où nous abordons le problème de la vie des formes dans la matière, nous ne séparons pas l’une et l’autre notion, et, si nous nous servons de deux termes, ce n’est pas pour donner une réalité objective à un procédé d’abstraction, mais pour montrer au contraire le caractère constant, indissoluble, irréductible d’un accord de fait. Ainsi la forme n’agit pas comme un principe supérieur modelant une masse passive, car on peut considérer que la matière impose sa propre forme à la forme. Aussi bien ne s’agit-il pas de matière et de forme en soi, mais de matières au pluriel, nombreuses, complexes, changeantes, ayant un aspect et un poids, issues de la nature, mais non pas naturelles.
Le physicien ne s’emploie pas à définir l’« esprit » auquel obéissent les transformations et les comportements de la pesanteur, de la chaleur, de la lumière, de l’électricité. Au surplus, on ne saurait confondre désormais l’inertie de la masse et la vie de la matière, puisque cette dernière, dans ses plus infimes replis, est toujours structure et action, c’est-à-dire forme, et plus nous restreignons le champ des métamorphoses, mieux nous saisissons l’intensité et la courbe de ses mouvements. Il n’y aurait que de la vanité dans ces controverses sur le vocabulaire, s’il n’engageait les méthodes.
Au moment où nous abordons le problème de la vie des formes dans la matière, nous ne séparons pas l’une et l’autre notion, et, si nous nous servons de deux termes, ce n’est pas pour donner une réalité objective à un procédé d’abstraction, mais pour montrer au contraire le caractère constant, indissoluble, irréductible d’un accord de fait. Ainsi la forme n’agit pas comme un principe supérieur modelant une masse passive, car on peut considérer que la matière impose sa propre forme à la forme. Aussi bien ne s’agit-il pas de matière et de forme en soi, mais de matières au pluriel, nombreuses, complexes, changeantes, ayant un aspect et un poids, issues de la nature, mais non pas naturelles.
Nous sommes ainsi conduits à rattacher à la notion de matière la notion de technique qui, à la vérité, ne s’en sépare point. Nous l’avons mise au centre de nos propres recherches, et jamais il ne nous a paru qu’elle leur imposât une restriction. Bien loin de là, elle était pour nous comme l’observatoire d’où la vue et l’étude pouvaient embrasser dans la même perspective le plus grand nombre d’objets et leur plus grande diversité. C’est qu’elle est susceptible de plusieurs acceptions : on peut la considérer comme une force vivante, ou bien comme une mécanique, ou encore comme un pur agrément. Elle n’était pour nous ni l’automatisme du « métier » ni la curiosité et les recettes d’une « cuisine », mais une poésie toute d’action et, pour conserver notre vocabulaire, même dans ce qu’il a d’incertain et de provisoire, le moyen des métamorphoses. Il nous a toujours paru que, dans ces études si difficiles, sans cesse exposées au vague des jugements de valeur et des interprétations les plus glissantes, l’observation des phénomènes d’ordre technique non seulement nous garantissait une certaine objectivité contrôlable, mais encore qu’elle nous portait au cœur des problèmes, en les posant pour nous dans les mêmes termes et sous le même angle que pour l’artiste. Situation rare et favorable, et dont il importe de préciser l’intérêt. L’objet de l’enquête du physicien et du biologiste est de reconstituer par une technique dont le contrôle est l’expérience la technique même de la nature, méthode non pas descriptive, mais active, puis¬qu’elle reconstitue une activité. Nous ne saurions avoir l’expérience pour contrôle, et l’étude analytique de ce quatrième « règne » qu’est le monde des formes ne saurait constituer qu’une science d’observation. Mais en envisageant la technique comme un processus et en essayant de la reconstituer comme telle nous avons la chance de dépasser les phénomènes de surface et de saisir des relations profondes.
Il existe entre la main et l'outil une familiarité humaine. Leur accord est fait d'échanges très subtils et que ne définit pas l'habitude. Ils laissent apercevoir que, si la main se prête à l'outil, si elle a besoin de ce prolongement d'elle-même dans la matière, l'outil est ce que la main le fait. Outil n'est pas mécanique. Si sa forme même dessine déjà son activité, si elle engage un certain avenir, cet avenir n'est pas une prédestination absolue, ou, s'il l'est, il y a insurrection. On peut graver avec un clou. Mais ce clou même a une forme qui n'est pas indifférente. Les rébellions de la main n'ont pas pour but d'annuler l'instrument, mais d'établir sur de nouvelles bases une possession réciproque. Ce qui agit est agi à son tour. Pour comprendre ces action et ces réactions, cessons de considérer isolément forme, matière, outil et main et plaçons-nous au point de rencontre, au lieu géométrique de leur activité.
Nous emprunterons à la langue des peintres le terme qui désigne le mieux et qui fait d'un seul coup l'énergie de l'accord: la touche. Il nous semble qu'il peut s'étendre aux arts graphiques et à la sculpture aussi.
Nous emprunterons à la langue des peintres le terme qui désigne le mieux et qui fait d'un seul coup l'énergie de l'accord: la touche. Il nous semble qu'il peut s'étendre aux arts graphiques et à la sculpture aussi.
Nous rêvons tous. Nous inventons dans nos songes, non seulement un enchaînement de circonstances, une dialectique de l'évènement mais des êtres, mais une nature, un espace d'une authenticité obsédante et illusoire. Nous sommes les peintres et les dramaturges involontaires d'une série de batailles, de paysages, de scènes de chasse et de rapt, et nous nous composons tout un musée nocturne de chefs-d’œuvre soudains, dont l’invraisemblance porte sur l'affabulation mais non sur la solidité des masses ou sur la justesse des tons.
Les problèmes posés par l’interprétation de l’oeuvre d’art se présentent sous l’aspect de contradictions presque obsédantes. L’oeuvre d’art est une tentative vers l’unique, elle s’affirme comme un tout, comme un absolu, et, en même temps, elle appartient à un système de relations complexes. Elle résulte d’une activité indépendante, elle traduit une rêverie supérieure et libre, mais on voit aussi converger en elle les énergies des civilisations.
>Ontologie>Propriétés de l'être>Beauté (35)
autres livres classés : philosophieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Henri Focillon (33)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
445 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre445 lecteurs ont répondu