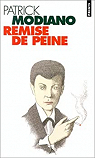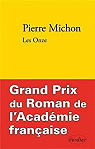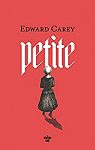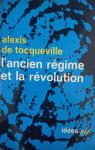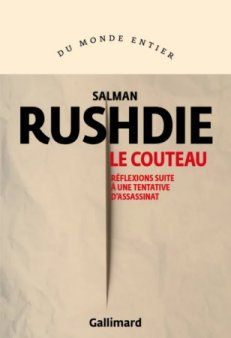La Commune de Paris : Analyse spectrale de l’Occident (1965 / France Culture). Diffusion sur France Culture le 12 juin 1965. Illustration : Une photo de la Barricade de la Chaussée Ménilmontant, Paris, 18 mars 1871 © Getty / Bettmann / Contributeur. Pierre Sipriot s'entretient avec Henri Guillemin (critique littéraire, historien, conférencier, polémiste, homme de radio et de télévision), Emmanuel Berl (journaliste, historien, essayiste), Adrien Dansette (historien, juriste), Pierre Descaves (écrivain, chroniqueur, homme de radio), Jacques Rougerie (historien spécialiste de la Commune de Paris), Philippe Vigier (historien contemporanéiste spécialiste de la Deuxième République), Henri Lefebvre (philosophe), et Georges Lefranc (historien spécialiste du socialisme et du syndicalisme). Dans les années 60, la Commune de Paris était encore "un objet chaud" qui divisait profondément les historiens. Comme en atteste ce débat diffusé pour la première fois sur les ondes de France Culture en juin 1965 et qui réunissait sept historiens, journalistes ou philosophes spécialistes du XIXe siècle. Textes d'Élémir Bourges, Jules Claretie, Lucien Descaves, Paul et Victor Margueritte, Jules Vallès et Émile Zola lus par Jean-Paul Moulinot, Robert Party et François Périer.
« La Commune, objet chaud, a longtemps divisé les historiens. Elle a eu sa légende noire, sitôt après l’événement : celle de la révolte sauvage des barbares et bandits. Elle a eu sa légende rouge : toutes les révolutions, les insurrections socialistes du XXe siècle se sont voulues filles de l’insurrection parisienne de 1871 ; et c’était à tout prendre, politiquement, leur droit. Historiquement, cette légende a pu se révéler redoutablement déformante. L’historiographie socialiste s’assignait pour tâche de démontrer "scientifiquement" que l’onde révolutionnaire qui parcourt le premier XXe siècle trouvait sa source vive dans une Commune dont elle se déclarait légitime héritière. On quêtait, par une analyse anachroniquement rétrospective, les preuves de cette filiation, oubliant le beau précepte que Lissagaray, communard, historien « immédiat » de l’événement avait placé en 1876 en exergue à son Histoire de la Commune. "Celui qui fait au peuple de fausses légendes révolutionnaires, celui qui l’amuse d’histoires chantantes est aussi criminel que le géographe qui dresserait des cartes menteuses pour les navigateurs." »
Jacques Rougerie (in "La Commune, 1871", PUF, 1988)
Source : France Culture

Emmanuel Berl
EAN : 978B003WPZDW0
Hachette (01/01/1965)
/5
1 notes
Hachette (01/01/1965)
Résumé :
ASIN : B0000DL71Z
Éditeur : Hachette. (1 janvier 1965)
Éditeur : Hachette. (1 janvier 1965)
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le 9 thermidorVoir plus
Citations et extraits (2)
Ajouter une citation
[D]ans son ensemble, la Montagne était plus rousseauiste et croyait réellement à cette “volonté générale" que sans cesse elle invoquait. Dans ce système, on ne peut admettre les divergences, puisqu’on ne peut contrarier la volonté générale sans, par là même, devenir traître à la nation. Un citoyen, à plus forte raison un député, un membre du gouvernement, s’il est en désaccord avec la politique pratiquée, ne peut être que corrompu. Car seule la corruption explique que sa volonté particulière ne concorde pas totalement avec la volonté générale. Le seul fait que des députés se concertent entre eux, à l’insu de leurs collègues, est déjà une forfaiture : c’est tenter de “se faire un parti", de “former une faction" - ce qui contitue un crime - puisque cela signifie qu’on cherche à s’opposer à la volonté générale. D’où l’effarante propensions des conventionnels à se soupçonner les uns les autres de menées contre-révolutionnaires et même d’intelligences avec l’ennemi. Il paraît incroyable, mais il est probable, que deux hommes aussi purs que Robespierre et Carnot ont été persuadés chacun que l’autre songeait à livrer la France soit aux Anglais, soit aux Autrichiens. Le “complot de l’étranger", la “lutte contre les factions" avaient beaucoup surexcité, dans la Montagne, cette tendance maladive, mais elle tenait à la nature même des choses et de la doctrine.
Sans doute, Robespierre surplombait ses collègues par l’immense prestige qu’il avait acquis à la Convention, aux Jacobins, sur l’opinion, en France et hors de France : prestige que méritaient la puissance de son esprit, un talent oratoire qui n’avait cessé de grandir, le rôle décisif qu’il avait joué dans la révolution du 31 mai, une réputation de vertu sur laquelle n’a pu mordre la critique la plus malveillante. Sa gloire, qui a grandi avec le temps, ne doit quand même pas faire oublier que, pour ses collègues, il restait un membre du Comité parmi les autres, le plus chevronné d’entre eux, le plus illustre, qui a beaucoup servi de porte-respect au gouvernement. De ce gouvernement, néanmoins, il n’était ni le chef ni le maître. Et sa position, si forte qu’elle parût, était d’autant plus ambiguë et irritante pour lui, que le rayonnement de sa personnalité lui faisait porter toute la responsabilité là où il ne détenait pas tout le pouvoir.
Videos de Emmanuel Berl (8)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : révolution françaiseVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Emmanuel Berl (20)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3260 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3260 lecteurs ont répondu