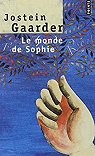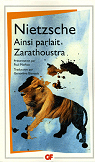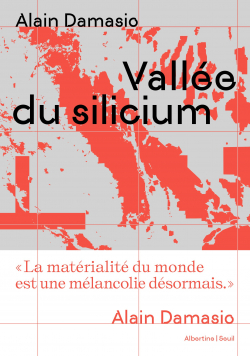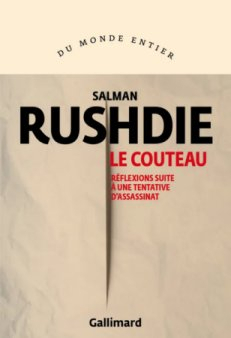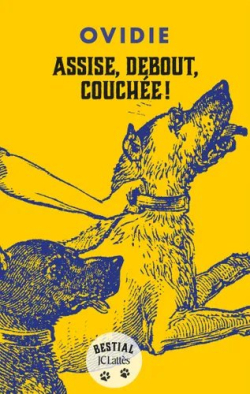CONVERSATION
Présentée par Raphael Zagury-Orly
Avec
Vincent Delecroix, philosophe
Camille Riquier, philosophe
Corine Pelluchon, philosophe
Ce n'est jamais l'espoir qui fait vivre: ce sont les aléas de la vie qui donnent à l'espoir ses ailes ou, au contraire, les lui coupent. On le sait bien d'ailleurs: l'espoir, on le «nourrit», on le «caresse», on le «fait naître», on le «soulève», on le «suscite» - comme si, en lui-même, il n'était qu'immobile attente, tantôt confiante, tantôt naïve, de l'avènement d'un Bien, d'un événement favorable, gratifiant, bénéfique. D'ailleurs, une langue telle que l'espagnol, n'a qu'un seul verbe pour dire attendre et espérer. Aussi une vie qui ne se s'alimenterait que d'espoirs serait-elle aussi anémique qu'un amour qui ne vivrait que d'eau fraîche - car bien tenue est la limite qui les sépare des illusions, des douces tromperies (ameni inganni) dont parlait Leopardi. Certes, dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même est nommé Espoir ou Confiance, les Pères de l'Eglise en ont fait une vertu théologale, et du «principe espérance» de Ernst Bloch la philosophie contemporaine s'est nourrie. Mais lorsqu'on dit que l'espoir fait vivre - ou que l'espoir est toujours le dernier à mourir - il faudrait entendre que pour faire vivre l'espoir, il faut d'abord commencer soi-même, autrement dit «faire le premier pas» de l'action, le mettre en mouvement en faisant «un pas en avant», en s'engageant, en allant si l'on veut vers Dieu, par la foi, en allant vers l'autre, par l'amour et l'amitié, en allant vers autrui, par la bienveillance, l'hospitalité, la solidarité.

Camille Riquier/5
6 notes
Résumé :
Quoi que nous nous efforcions de penser, nous continuons d'appartenir à notre siècle par les croyances les plus communes et, quand cela a lieu, par le fait tout aussi commun de ne plus croire – ou de ne pas donner notre confiance au monde. Nos pères se sont tant méfiés, ou ils ont été à ce point cyniques, que cette foi, entendue dans son sens large, semble nous être aujourd'hui interdite. À nous qui avons hérité de cette perte sans l'avoir consommée, ne restent que ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Nous ne savons plus croireVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
« Nous ne savons plus croire » (2020, Desclée de Brouwer, 244 p.) est un essai de Camille Riquier, recteur à « l'Institut Catholique de Paris » (La Catho), et professeur en philosophie. Un essai en sept chapitres, avec une introduction et une conclusion, qui va de Montaigne à Sartre, en passant surtout par Descartes, et un peu Nietzsche et les agnostiques.
« Dans une époque désorientée, nous ne pourrons peut-être sauver que le désir de croire : rien ne nous dit que nous retrouverons la croyance. Cette impuissance annonce un temps de dangereuse crédulité. Il nous faut donc tout réapprendre ». Et de conclure ce quatrième de couverture : « la traversée du nihilisme est possible ».
Une époque désorientée. On le serait à moins, comment comprendre que l'on puise croire que la terre est plate, ou que l'on va vous injecter des nanoparticles qui vont s'activer sur un ordre venu d'on ne sait où. Il est vrai que cela a déjà été le cas, lors d'un test, le 4 octobre 2023, sur les alarmes à déclencher en cas de risque majeur et activation des téléphones. Et que la transformation des peuples en zombies n'a pas eu lieu. Mais c'était vrai, je l'ai lu sur les réseaux sociaux ? Avant, c'était « vu à la télévision », là c'est lu sur mon téléphone. Avant, cela touchait « la ménagère de 50 ans », maintenant ce sont tous les gogos.
« Nous ne savons plus croire », nous avons perdu la foi. Et il ne s'agit pas que de la croyance religieuse. Et dans cette époque désorientée, nous pourrons, peut-être, ne sauver que ce désir de croire, mais nous aurons perdu la croyance. C'est ce message que Camille Riquier essaie de faire passer.
Après une brève introduction en mémoire à un ami disparu qui avait tenté de confier ses doutes, et s'y était résigné, voyant que « l'impuissance à croire était l'objet du constat ». Doutes manifestement partagés par ses amis. « À nous, aussi, il s'était déposé « comme un boeuf sur la langue2 » chaque fois qu'à table et en société nous nous mettions à parler « religion » ». Très belle introduction qui fixe d'emblée les règles qui nous régissent et les autocensures qu'elles induisent. « Au milieu des athées, nous ignorions par où commencer ; au milieu des croyants, c'est nous qui ne nous y retrouvions plus. La bouche s'entrouvrait, hésitait, balbutiait ; le dépit la refermait ».
D'où la conclusion factuelle. « Reconnaissons que nous ne savons plus croire », et cet aveu « Il a toujours été difficile de croire ».
D'après Camille Riquier, il faut remonter à l'enfance. « L'enfant que nous fûmes se souvient également que croire lui était spontané, simple et naturel comme la vie qui lui avait été donnée ». Plus tard « la jeunesse est imprudente, et la vieillesse s'en chagrine ». « Parce qu'il fut enfant d'abord, l'homme a ainsi toujours cru, sans attendre de savoir pourquoi, ni comment, ni même ce qu'il devait précisément croire ».
Alors, tout est fixé à l'avance et « l'enfant que nous fûmes » est il condamné à ne plus croire, lui qui par définition sait peu et enregistre presque tout. « L'enfant, avant que d'être un homme athée ou croyant, est d'abord un être crédule ». Cela n'est pas aussi simple.
Riquier part de plus loin, avec Montaigne et l'étude du XVIe siècle avec comme hypothèse que notre XXIe siècle en est très proche. Au temps de Montaigne, le doute s'installe de partout. Avec les guerres de religion, nées de la découverte de l'imprimerie. Les Bibles se répandent, encore faut-il pouvoir les lire. Mais les traductions en langues vernaculaires suivent, avec leur lot d'interprétations, de commentaires, quelquefois divergents. Les pays deviennent des royaumes de croyances disparates, dans lesquels la rationalité du savoir et surtout du doute se relâchent. L'enfant oublie son enfance et sa crédulité. L'humain replace sa foi dans un doute qui interroge en retour la vérité de sa croyance religieuse. Pour Camille Riquier, l'incrédulité progressive et historique de l'Occident : « c'est la perte de foi qu'il faut expliquer et non pas son acquisition ». se référant à Montaigne, il montre qu'à cette époque, « l'athéisme n'était pas une option envisageable ». Il introduit alors ma notion d'une foi faible (fondée sur la créance) à un doute faible.
Il va ensuite décliner ces notions de foi et de doute, forts ou faibles au cours des siècles. Postulant qu'il y a deux sortes très différentes de savoir, alors que la modernité n'en connaît qu'une seule.
Ainsi à l'époque d'Érasme et de Rabelais, l'imagination régnait sur des âmes simples et peu éduquées, faisait preuve d'une « grande crédulité et [d']un savoir qui [était] hors de la portée des hommes ».
Suivant ce siècle de l'imagination, voilà Descartes, pour lequel Riquier a une inclination certaine. C'est l'enfant terrible de la philosophie. « Descartes n'a tant douté que parce qu'il a cru si sagement en ses maître […] pensée, selon laquelle la raison se soutient d'une foi primordiale en un Dieu vérace, tandis que la foi en Dieu ne se départit pas d'une argumentation ». Descartes a finalement révélé la rationalité qu'autorise la foi. « La raison […] ne mérite pas la foi exclusive que les athées lui vouent, aussi longtemps qu'ils ignorent qu'il y a un Dieu et qu'il n'est pas trompeur ». Il développe alors ses bases de ses certitudes en puisant dans le roc de la raison. C'est ainsi qu'il fonde les bases de la physique et de la pensée moderne. Il le fait en « gard[ant] la foi dans sa propre raison » et en postulant que la foi et la raison ne peuvent se séparer l'une de l'autre sans préjudice notable.
Pour cette époque du XVIIe siècle, il propose une foi forte et un doute radical, suivant ainsi la pensée de Descartes. Ce dernier est parvenu à maintenir en équilibre le croire et la raison en utilisant la raison pour éclairer la foi.
Par la suite, Dieu est désormais absent, devenant un « soleil noir », cher aux surréalistes et autres existentialistes.
Mais pour Riquier, l'indifférence doit se confronter à l'athéisme. Sachant que ce dernier cas, qui vit par Dieu en le niant, offre une posture plus inconfortable que le nietzschéisme dont l'athéisme réclame la volonté de vivre sans l'horizon d'un sens ultime. « le croyant face à l'incroyant, et l'incroyant face au croyant, finiront peut-être par se rendre compte qu'ils sont pareils, et comme deux reflets de la même époque ». Mais derrière cette ambivalence, il y a une époque si persuadée que Dieu est hors de portée qu'elle en aurait perdu la question elle-même ».
Il interpelle Nietzsche pour explorer la « foi épuisée » de ce siècle qui a vu grandir l'athéisme comme jamais auparavant. C'est le fameux « Gott ist tot » (Dieu est mort) ou l'inexistence de Dieu qui se présente comme un croire détourné, sur fond d'un nihilisme à la Schopenhauer. La folie n'est plus de ne pas croire, mais bien de croire en ce Dieu absent. Cet aspect de travail de l'athéisme, Riquier le présente comme une inscription historique qui a redéfini le rapport à la religion. La religion devient une mystification « coupable d'avoir coupé l'homme de lui-même en logeant sa liberté dans la volonté d'un Autre » (p. 157). La « foi » et la « bonne foi » deviennent antithétiques. Croire en Dieu relève d'une absurdité.
Les deux chapitres suivants s'intéressent à la situation contemporaine du croire, une époque de foi et de doute faibles. Riquier passe ensuite aux agnostiques. Il reprend pour ce faire une étude antérieure sur la foi dans nos sociétés occidentales. « Figure actuelle de l'agnostique. le croyant tiède » parue plus tôt (2017, Études, # 424). Etude qui fournit, après une « Petite histoire de l'agnosticisme », deux textes sur Emmanuel Carrère (1957- ) et Gianni Vattimo (1936-2023) deux agnostiques, l'un athée, le second chrétien. du premier on peut retenir « le Royaume » (2014, P.O.L., 640 p.) « A un moment de ma vie, j'ai été chrétien. Cela a duré trois ans, c'est passé ». du second, plus ardu, « La fin de la modernité » (1987, Seuil, 184 p.) sous-titré « Nihilisme et herméneutisme dans la culture post-moderne » C'est « un miroir à notre temps. Une lecture de Heidegger par Nietzsche ».
C'est alors une foi faible accompagnée d'un doute faible. Camille Riquier précise sa pensée « Croire ce n'est pas moins que savoir. Ce n'est pas un savoir diminué ou affaibli. Au contraire, il y a plus dans l'acte de croire que dans l'acte de savoir, car croire engage toute la personne : coeur, intellect, volonté, affects… Et croire amène à l'action, alors que l'on peut savoir de manière détachée, en restant spectateur ». Car si nous ne savons plus croire, « pas davantage ne savons-nous douter vraiment et redescendre jusqu'aux raisons critiques qui avaient su nous armer contre une religion jadis intrusive ».
Selon son modèle historique, Riquier suggère que la situation actuelle du croire est comparable à celle du XVIe siècle, « déçu par trois siècles de rationalisme auquel nous avions trop demandé, notre siècle n'est à nouveau plus si sûr de ce qu'il croit ni de ce qu'il sait ».
D'où la tendance à la crédulité qui se manifeste dans les sociétés contemporaines, où d'aucuns veulent bien croire autant aux théories du complot, qu'au transhumanisme ou à d'autres promesses proposées par une pseudo-science magique qui charme les esprits au sens critique désabusé. L'humain redevient l'enfant crédule à l'aube d'une humanité forcée à se réinventer.
Il passe rapidement à ce qu'on appelle aujourd'hui le «multiculturalisme». Il offre une situation assez similaire, dans la mesure où l'individu y circule de plus en plus avec son caddie en choisissant son propre credo. Nous sommes dans une période de foi faible et de doute faible, qui a des similitudes avec le XVIe siècle français, celui de Montaigne
Mais comment, en notre « XXIe siècle aux accents crépusculaires », retrouver la puissance tranquille du cartésianisme face aux cohortes d'absurdités charriées par les médias. Donc, une période de foi faible et de doute faible. Surtout pas en réaffirmant une foi identitaire et réactionnaire. Mais, a contrario, par un « doute fort », c'est-à-dire une remise en question radicale de tout, y compris de la foi elle-même. « Si elle meurt, c'est qu'elle n'en valait pas la peine » assène Riquier. Chez lui, la croyance et le doute ne s'excluent pas, c'est même tout le contraire : « Doutons violemment si nous voulons pouvoir accueillir la foi dans la force de son paradoxe. »
« Dans une époque désorientée, nous ne pourrons peut-être sauver que le désir de croire : rien ne nous dit que nous retrouverons la croyance. Cette impuissance annonce un temps de dangereuse crédulité. Il nous faut donc tout réapprendre ». Et de conclure ce quatrième de couverture : « la traversée du nihilisme est possible ».
Une époque désorientée. On le serait à moins, comment comprendre que l'on puise croire que la terre est plate, ou que l'on va vous injecter des nanoparticles qui vont s'activer sur un ordre venu d'on ne sait où. Il est vrai que cela a déjà été le cas, lors d'un test, le 4 octobre 2023, sur les alarmes à déclencher en cas de risque majeur et activation des téléphones. Et que la transformation des peuples en zombies n'a pas eu lieu. Mais c'était vrai, je l'ai lu sur les réseaux sociaux ? Avant, c'était « vu à la télévision », là c'est lu sur mon téléphone. Avant, cela touchait « la ménagère de 50 ans », maintenant ce sont tous les gogos.
« Nous ne savons plus croire », nous avons perdu la foi. Et il ne s'agit pas que de la croyance religieuse. Et dans cette époque désorientée, nous pourrons, peut-être, ne sauver que ce désir de croire, mais nous aurons perdu la croyance. C'est ce message que Camille Riquier essaie de faire passer.
Après une brève introduction en mémoire à un ami disparu qui avait tenté de confier ses doutes, et s'y était résigné, voyant que « l'impuissance à croire était l'objet du constat ». Doutes manifestement partagés par ses amis. « À nous, aussi, il s'était déposé « comme un boeuf sur la langue2 » chaque fois qu'à table et en société nous nous mettions à parler « religion » ». Très belle introduction qui fixe d'emblée les règles qui nous régissent et les autocensures qu'elles induisent. « Au milieu des athées, nous ignorions par où commencer ; au milieu des croyants, c'est nous qui ne nous y retrouvions plus. La bouche s'entrouvrait, hésitait, balbutiait ; le dépit la refermait ».
D'où la conclusion factuelle. « Reconnaissons que nous ne savons plus croire », et cet aveu « Il a toujours été difficile de croire ».
D'après Camille Riquier, il faut remonter à l'enfance. « L'enfant que nous fûmes se souvient également que croire lui était spontané, simple et naturel comme la vie qui lui avait été donnée ». Plus tard « la jeunesse est imprudente, et la vieillesse s'en chagrine ». « Parce qu'il fut enfant d'abord, l'homme a ainsi toujours cru, sans attendre de savoir pourquoi, ni comment, ni même ce qu'il devait précisément croire ».
Alors, tout est fixé à l'avance et « l'enfant que nous fûmes » est il condamné à ne plus croire, lui qui par définition sait peu et enregistre presque tout. « L'enfant, avant que d'être un homme athée ou croyant, est d'abord un être crédule ». Cela n'est pas aussi simple.
Riquier part de plus loin, avec Montaigne et l'étude du XVIe siècle avec comme hypothèse que notre XXIe siècle en est très proche. Au temps de Montaigne, le doute s'installe de partout. Avec les guerres de religion, nées de la découverte de l'imprimerie. Les Bibles se répandent, encore faut-il pouvoir les lire. Mais les traductions en langues vernaculaires suivent, avec leur lot d'interprétations, de commentaires, quelquefois divergents. Les pays deviennent des royaumes de croyances disparates, dans lesquels la rationalité du savoir et surtout du doute se relâchent. L'enfant oublie son enfance et sa crédulité. L'humain replace sa foi dans un doute qui interroge en retour la vérité de sa croyance religieuse. Pour Camille Riquier, l'incrédulité progressive et historique de l'Occident : « c'est la perte de foi qu'il faut expliquer et non pas son acquisition ». se référant à Montaigne, il montre qu'à cette époque, « l'athéisme n'était pas une option envisageable ». Il introduit alors ma notion d'une foi faible (fondée sur la créance) à un doute faible.
Il va ensuite décliner ces notions de foi et de doute, forts ou faibles au cours des siècles. Postulant qu'il y a deux sortes très différentes de savoir, alors que la modernité n'en connaît qu'une seule.
Ainsi à l'époque d'Érasme et de Rabelais, l'imagination régnait sur des âmes simples et peu éduquées, faisait preuve d'une « grande crédulité et [d']un savoir qui [était] hors de la portée des hommes ».
Suivant ce siècle de l'imagination, voilà Descartes, pour lequel Riquier a une inclination certaine. C'est l'enfant terrible de la philosophie. « Descartes n'a tant douté que parce qu'il a cru si sagement en ses maître […] pensée, selon laquelle la raison se soutient d'une foi primordiale en un Dieu vérace, tandis que la foi en Dieu ne se départit pas d'une argumentation ». Descartes a finalement révélé la rationalité qu'autorise la foi. « La raison […] ne mérite pas la foi exclusive que les athées lui vouent, aussi longtemps qu'ils ignorent qu'il y a un Dieu et qu'il n'est pas trompeur ». Il développe alors ses bases de ses certitudes en puisant dans le roc de la raison. C'est ainsi qu'il fonde les bases de la physique et de la pensée moderne. Il le fait en « gard[ant] la foi dans sa propre raison » et en postulant que la foi et la raison ne peuvent se séparer l'une de l'autre sans préjudice notable.
Pour cette époque du XVIIe siècle, il propose une foi forte et un doute radical, suivant ainsi la pensée de Descartes. Ce dernier est parvenu à maintenir en équilibre le croire et la raison en utilisant la raison pour éclairer la foi.
Par la suite, Dieu est désormais absent, devenant un « soleil noir », cher aux surréalistes et autres existentialistes.
Mais pour Riquier, l'indifférence doit se confronter à l'athéisme. Sachant que ce dernier cas, qui vit par Dieu en le niant, offre une posture plus inconfortable que le nietzschéisme dont l'athéisme réclame la volonté de vivre sans l'horizon d'un sens ultime. « le croyant face à l'incroyant, et l'incroyant face au croyant, finiront peut-être par se rendre compte qu'ils sont pareils, et comme deux reflets de la même époque ». Mais derrière cette ambivalence, il y a une époque si persuadée que Dieu est hors de portée qu'elle en aurait perdu la question elle-même ».
Il interpelle Nietzsche pour explorer la « foi épuisée » de ce siècle qui a vu grandir l'athéisme comme jamais auparavant. C'est le fameux « Gott ist tot » (Dieu est mort) ou l'inexistence de Dieu qui se présente comme un croire détourné, sur fond d'un nihilisme à la Schopenhauer. La folie n'est plus de ne pas croire, mais bien de croire en ce Dieu absent. Cet aspect de travail de l'athéisme, Riquier le présente comme une inscription historique qui a redéfini le rapport à la religion. La religion devient une mystification « coupable d'avoir coupé l'homme de lui-même en logeant sa liberté dans la volonté d'un Autre » (p. 157). La « foi » et la « bonne foi » deviennent antithétiques. Croire en Dieu relève d'une absurdité.
Les deux chapitres suivants s'intéressent à la situation contemporaine du croire, une époque de foi et de doute faibles. Riquier passe ensuite aux agnostiques. Il reprend pour ce faire une étude antérieure sur la foi dans nos sociétés occidentales. « Figure actuelle de l'agnostique. le croyant tiède » parue plus tôt (2017, Études, # 424). Etude qui fournit, après une « Petite histoire de l'agnosticisme », deux textes sur Emmanuel Carrère (1957- ) et Gianni Vattimo (1936-2023) deux agnostiques, l'un athée, le second chrétien. du premier on peut retenir « le Royaume » (2014, P.O.L., 640 p.) « A un moment de ma vie, j'ai été chrétien. Cela a duré trois ans, c'est passé ». du second, plus ardu, « La fin de la modernité » (1987, Seuil, 184 p.) sous-titré « Nihilisme et herméneutisme dans la culture post-moderne » C'est « un miroir à notre temps. Une lecture de Heidegger par Nietzsche ».
C'est alors une foi faible accompagnée d'un doute faible. Camille Riquier précise sa pensée « Croire ce n'est pas moins que savoir. Ce n'est pas un savoir diminué ou affaibli. Au contraire, il y a plus dans l'acte de croire que dans l'acte de savoir, car croire engage toute la personne : coeur, intellect, volonté, affects… Et croire amène à l'action, alors que l'on peut savoir de manière détachée, en restant spectateur ». Car si nous ne savons plus croire, « pas davantage ne savons-nous douter vraiment et redescendre jusqu'aux raisons critiques qui avaient su nous armer contre une religion jadis intrusive ».
Selon son modèle historique, Riquier suggère que la situation actuelle du croire est comparable à celle du XVIe siècle, « déçu par trois siècles de rationalisme auquel nous avions trop demandé, notre siècle n'est à nouveau plus si sûr de ce qu'il croit ni de ce qu'il sait ».
D'où la tendance à la crédulité qui se manifeste dans les sociétés contemporaines, où d'aucuns veulent bien croire autant aux théories du complot, qu'au transhumanisme ou à d'autres promesses proposées par une pseudo-science magique qui charme les esprits au sens critique désabusé. L'humain redevient l'enfant crédule à l'aube d'une humanité forcée à se réinventer.
Il passe rapidement à ce qu'on appelle aujourd'hui le «multiculturalisme». Il offre une situation assez similaire, dans la mesure où l'individu y circule de plus en plus avec son caddie en choisissant son propre credo. Nous sommes dans une période de foi faible et de doute faible, qui a des similitudes avec le XVIe siècle français, celui de Montaigne
Mais comment, en notre « XXIe siècle aux accents crépusculaires », retrouver la puissance tranquille du cartésianisme face aux cohortes d'absurdités charriées par les médias. Donc, une période de foi faible et de doute faible. Surtout pas en réaffirmant une foi identitaire et réactionnaire. Mais, a contrario, par un « doute fort », c'est-à-dire une remise en question radicale de tout, y compris de la foi elle-même. « Si elle meurt, c'est qu'elle n'en valait pas la peine » assène Riquier. Chez lui, la croyance et le doute ne s'excluent pas, c'est même tout le contraire : « Doutons violemment si nous voulons pouvoir accueillir la foi dans la force de son paradoxe. »
Stop ! Je suis à la page 52 de ce livre. Il en reste 190. J'abandonne !!
Le sujet du livre est intéressant, passionnant même. La rédaction très compréhensible de la quatrième de couverture m'avait donné l'envie de me plonger dans cet essai. Mais comme je l'ai souvent constaté, le texte de cette quatrième de couverture n'a pas été rédigé par l'auteur. Trop simple, trop accessible !
Dès les premières pages du livre, le style lourd, complexe, ampoulé du texte m'a paru rebutant, décourageant. Chaque paragraphe nécessite une seconde, voire une troisième lecture pour essayer de comprendre l'idée développée.
Pourquoi diable, certains universitaires prennent-ils plaisir à écrire de manière si embrouillée, si obscure ? A qui s'adressent-ils ? A d'autres universitaires ? A un petit monde d'intellectuels restreints ?
Le rôle d'un intellectuel est de vulgariser les idées qu'il souhaite développer. Vulgariser c'est-à-dire mettre à la portée des non-spécialistes des notions, des théories, des réflexions. C'est rendre accessible à tous sa pensée, son intelligence
Bref, quel dommage !
Le sujet du livre est intéressant, passionnant même. La rédaction très compréhensible de la quatrième de couverture m'avait donné l'envie de me plonger dans cet essai. Mais comme je l'ai souvent constaté, le texte de cette quatrième de couverture n'a pas été rédigé par l'auteur. Trop simple, trop accessible !
Dès les premières pages du livre, le style lourd, complexe, ampoulé du texte m'a paru rebutant, décourageant. Chaque paragraphe nécessite une seconde, voire une troisième lecture pour essayer de comprendre l'idée développée.
Pourquoi diable, certains universitaires prennent-ils plaisir à écrire de manière si embrouillée, si obscure ? A qui s'adressent-ils ? A d'autres universitaires ? A un petit monde d'intellectuels restreints ?
Le rôle d'un intellectuel est de vulgariser les idées qu'il souhaite développer. Vulgariser c'est-à-dire mettre à la portée des non-spécialistes des notions, des théories, des réflexions. C'est rendre accessible à tous sa pensée, son intelligence
Bref, quel dommage !
J'ai lu jusqu'au bout, j'ai peu compris.
L'évolution des structures de la foi et du doute est analysée du 16ème au 21ème siècle (impasse sur le 18ème, pourquoi ?) au travers d'un penseur célèbre pour chaque siècle.
Montaigne : j'ai accroché ma ceinture pour le décollage qui s'est relativement bien passé.
Descartes : j'ai commencé avoir quelques nausées dans les turbulences
Nietzsche : j'ai décroché.
Sartre : je suis parti en vrille.
Thème et quatrième de couverture alléchants, mais lecture réservée aux initiés (connaître les pensées des auteurs ci-dessus), et aux habitués du style universitaire.
Je retiendrai peu de cette lecture, offerte en cadeau d'anniversaire.
Dommage.
L'évolution des structures de la foi et du doute est analysée du 16ème au 21ème siècle (impasse sur le 18ème, pourquoi ?) au travers d'un penseur célèbre pour chaque siècle.
Montaigne : j'ai accroché ma ceinture pour le décollage qui s'est relativement bien passé.
Descartes : j'ai commencé avoir quelques nausées dans les turbulences
Nietzsche : j'ai décroché.
Sartre : je suis parti en vrille.
Thème et quatrième de couverture alléchants, mais lecture réservée aux initiés (connaître les pensées des auteurs ci-dessus), et aux habitués du style universitaire.
Je retiendrai peu de cette lecture, offerte en cadeau d'anniversaire.
Dommage.
critiques presse (1)
L’ouvrage [...] est d’abord un appel à renouer avec une « foi » qui pourrait être parfaitement athée.
Lire la critique sur le site : Bibliobs
Citations et extraits (2)
Ajouter une citation
L'homme postmoderne a beau être incroyant, rien ne peut l'empêcher de croire n'importe quoi.
Au milieu, à l'endroit où athées et croyants se rejoignent, la figure de l'agnostique, jadis isolée, a fini par prendre la plus grande part, jusqu'à estomper quelque peu la frontière qui séparait les uns des autres.
Videos de Camille Riquier (27)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : philosophieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Camille Riquier (4)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
441 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre441 lecteurs ont répondu