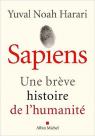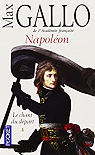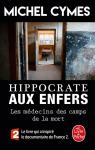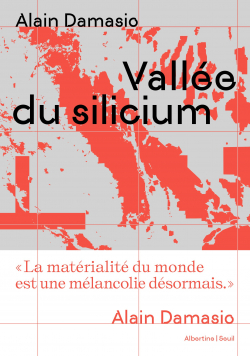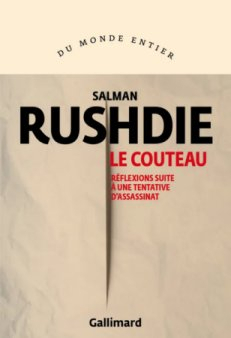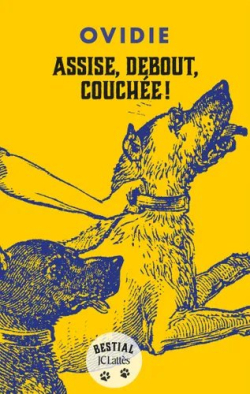Isabelle Mity/5
10 notes
Résumé :
Le portrait de dix actrices au cœur du star system nazi.
Nous le savons, la production cinématographique a été intense en Allemagne sous le IIIe Reich. Mais si l’on connaît les films de propagande exaltant l’esprit guerrier (tels Stukas ou Kolberg) ainsi que les incontournables documentaires de Leni Riefenstahl (notamment celui sur les Jeux olympiques de 1936), le cinéma de divertissement est souvent mis de côté, voire totalement ignoré.
C’est ... >Voir plus
Nous le savons, la production cinématographique a été intense en Allemagne sous le IIIe Reich. Mais si l’on connaît les films de propagande exaltant l’esprit guerrier (tels Stukas ou Kolberg) ainsi que les incontournables documentaires de Leni Riefenstahl (notamment celui sur les Jeux olympiques de 1936), le cinéma de divertissement est souvent mis de côté, voire totalement ignoré.
C’est ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les actrices du IIIe ReichVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (6)
Voir plus
Ajouter une critique
On connaissait Hollywood, Bollywood, Nollywood, et grâce à Isabelle Mity nous saurons tout sur « Reichllywood » avec cet ouvrage passionnant qui se lit comme un roman. Avant d'évoquer ces actrices du IIIe Reich, icônes du régime, dont il est question dans le titre, l'auteure nous offre dans les deux premières parties, un état des lieux du cinéma allemand entre 1933 et 1945. Si Hitler aimait le cinéma américain (westerns, Clark Gable et Blanche Neige…), Goebbels, son ministre de la Propagande et de l'Éducation du peuple, aimait surtout les actrices, de préférence brunes et piquantes. Mais les deux hommes avaient en commun leur détestation des juifs, des homosexuels et des démocrates, ce qui provoqua une véritable hémorragie de talents, réalisateurs, scénaristes, acteurs et techniciens, suite à l' aryanisation du cinéma allemand. Les moins clairvoyants -« Les pessimistes finirent à Hollywood et les optimistes à Auschwitz. », pour rappeler la phrase de Billy Wilder exilé aux Etats-Unis- se suicidèrent, ou furent assassinés.
Pendant qu'un Hitler boulimique impose à ses invités des soirées-marathon de visionnages de films, Goebbels se transforme en tycoon, et prend les choses en main. Comme Hitler, il choisit les sujets, les acteurs, ou censure. Mais il est surtout conscient du formidable pouvoir des images, non seulement comme outil de propagande mais aussi comme acteur majeur dans le divertissement des soldats et des civils. L'image que l'on pouvait avoir d'une production cinématographique essentiellement axée sur les films de propagande ( antisémitisme, anglophobie, euthanasie…) était galvaudée, puisque les histoires d'amour, les mélos, les comédies musicales et les films historiques occupaient une large place dans la production voulue par Hitler et Goebbels, à condition bien sûr que la production soit au service de la "Grande Allemagne".
Pour satisfaire la demande et rivaliser avec Hollywood et les stars internationales auxquelles le public n'a plus accès, un véritable star-system se développe. Marlene Dietrich s'est exilée, Ingrid Bergman n'a tourné qu'un film en Allemagne en 1938 et ne reviendra plus. Les actrices sont choisies pour coller à des stéréotypes, comme Kirsten Heiberg, « la Rita Hayworth du Nord », ou Jenny Jugo, « la petite rigolote »… La starisation va de paire avec une proximité politique avec les dignitaires nazis affichée dans la presse, ainsi qu'une « proximité » plus prosaïque avec Goebbels qui raffole des actrices. Soirées, magazines, glamour et paillettes, tout est pensé pour servir d'écrin aux nouvelles déesses du grand écran. Les portraits de ces actrices, « vitrines » du régime, présentés par Isabelle Mity sont fascinants à parcourir, comme le sont leurs destins après la chute du Reich, entre dénazification, accusation d'espionnage et retournement de veste en zone américaine.
Les Actrices du IIIe Reich sont une facette du national-socialisme, que je ne connaissais pas. A part les noms de Lilian Harvey et de Magda Schneider, j'ignorais tout de ces icônes du cinéma, peut-être parce qu'en tant que Française, l'image du cinéma allemand sous l'Occupation est surtout liée à celle de la Continental Films, créée en 1940 par Joseph Goebbels et dirigée par Alfred Greven pour contrôler le cinéma français. Certains passages sur la coopération cinématographique Espagne franquiste/Allemagne nazie et sur les caprices de l'actrice Imperio Argentina m'ont rappelé l'excellent film La Fille de tes rêves (La niña de tus ojos) réalisé par Fernando Trueba sur une troupe d'acteurs espagnols venue en Allemagne pour un tournage organisé dans le cadre d'une collaboration entre franquistes et nazis, avec un Goebbels épris d'une des actrices (inspiré du tournage de Carmen, la de Triana et de Andalusische Nächte ). Instructif et édifiant, l'ouvrage ne peut que plaire aux lecteurs férus d'histoire et de cinéma.
Pendant qu'un Hitler boulimique impose à ses invités des soirées-marathon de visionnages de films, Goebbels se transforme en tycoon, et prend les choses en main. Comme Hitler, il choisit les sujets, les acteurs, ou censure. Mais il est surtout conscient du formidable pouvoir des images, non seulement comme outil de propagande mais aussi comme acteur majeur dans le divertissement des soldats et des civils. L'image que l'on pouvait avoir d'une production cinématographique essentiellement axée sur les films de propagande ( antisémitisme, anglophobie, euthanasie…) était galvaudée, puisque les histoires d'amour, les mélos, les comédies musicales et les films historiques occupaient une large place dans la production voulue par Hitler et Goebbels, à condition bien sûr que la production soit au service de la "Grande Allemagne".
Pour satisfaire la demande et rivaliser avec Hollywood et les stars internationales auxquelles le public n'a plus accès, un véritable star-system se développe. Marlene Dietrich s'est exilée, Ingrid Bergman n'a tourné qu'un film en Allemagne en 1938 et ne reviendra plus. Les actrices sont choisies pour coller à des stéréotypes, comme Kirsten Heiberg, « la Rita Hayworth du Nord », ou Jenny Jugo, « la petite rigolote »… La starisation va de paire avec une proximité politique avec les dignitaires nazis affichée dans la presse, ainsi qu'une « proximité » plus prosaïque avec Goebbels qui raffole des actrices. Soirées, magazines, glamour et paillettes, tout est pensé pour servir d'écrin aux nouvelles déesses du grand écran. Les portraits de ces actrices, « vitrines » du régime, présentés par Isabelle Mity sont fascinants à parcourir, comme le sont leurs destins après la chute du Reich, entre dénazification, accusation d'espionnage et retournement de veste en zone américaine.
Les Actrices du IIIe Reich sont une facette du national-socialisme, que je ne connaissais pas. A part les noms de Lilian Harvey et de Magda Schneider, j'ignorais tout de ces icônes du cinéma, peut-être parce qu'en tant que Française, l'image du cinéma allemand sous l'Occupation est surtout liée à celle de la Continental Films, créée en 1940 par Joseph Goebbels et dirigée par Alfred Greven pour contrôler le cinéma français. Certains passages sur la coopération cinématographique Espagne franquiste/Allemagne nazie et sur les caprices de l'actrice Imperio Argentina m'ont rappelé l'excellent film La Fille de tes rêves (La niña de tus ojos) réalisé par Fernando Trueba sur une troupe d'acteurs espagnols venue en Allemagne pour un tournage organisé dans le cadre d'une collaboration entre franquistes et nazis, avec un Goebbels épris d'une des actrices (inspiré du tournage de Carmen, la de Triana et de Andalusische Nächte ). Instructif et édifiant, l'ouvrage ne peut que plaire aux lecteurs férus d'histoire et de cinéma.
Voilà un ouvrage passionnant, écrit d'une plume alerte, qui ne laisse pas indifférent ! Pour tous les amoureux d'histoire et plus particulièrement de la période de la 2e Guerre mondiale, c'est un essai sur le cinéma qui, je crois, fera date.
Mme Mity nous décrit l'aryanisation du cinéma par Goebbels qui, dès 1933, élimine impitoyablement les acteurs et les réalisateurs ou scénaristes juifs. Ainsi, les réalisateurs Max Ophüls, les frères Siodmack ou Billy Wilder. Certains d'entre eux fuient le pays avant d'en être chassés, comme Fritz Lang. En 1937, Goebbels nationalise les sociétés de production et devient le grand maître de tout ce qui touche le cinéma allemand. Il intervient jusque dans l'écriture des scénarios qui ne lui plaisent pas, parfois au point que les scénaristes s'arrachent les cheveux.
On découvre un Goebbels, grand amateur d'actrices et un Hitler, fasciné par Hollywood, qui pouvait consommer jusqu'à trois films américains par jour. Il y a certes des films de propagande, comme ceux de Leni Riefenstahl, ou ce fameux film antisémite : le Juif Süss. Mais en général, le cinéma est là pour distraire le peuple de la guerre et faire rêver.
Isabelle Mity consacre une partie de son essai aux divas, comme Zarah Leander, une Suédoise, qui jouait aussi bien qu'elle chantait et dansait, et dont le succès durera longtemps après la guerre. On peut citer aussi Sybille Schmitz, Kirsten Heiberg, une Norvégienne, ou Magda Schneider (la mère de Romy) et tant d'autres qui, sans être toutes nazies, rêvaient de faire carrière en Allemagne.
Durant les années d'après-guerre, nombre d'entre elles étaient toujours adulées, et les films de la période nazie toujours regardés. Cela tient au fait que ce cinéma n'était pas imperméable aux influences extérieures ni à la période dont il se faisait le reflet.
Mme Mity nous décrit l'aryanisation du cinéma par Goebbels qui, dès 1933, élimine impitoyablement les acteurs et les réalisateurs ou scénaristes juifs. Ainsi, les réalisateurs Max Ophüls, les frères Siodmack ou Billy Wilder. Certains d'entre eux fuient le pays avant d'en être chassés, comme Fritz Lang. En 1937, Goebbels nationalise les sociétés de production et devient le grand maître de tout ce qui touche le cinéma allemand. Il intervient jusque dans l'écriture des scénarios qui ne lui plaisent pas, parfois au point que les scénaristes s'arrachent les cheveux.
On découvre un Goebbels, grand amateur d'actrices et un Hitler, fasciné par Hollywood, qui pouvait consommer jusqu'à trois films américains par jour. Il y a certes des films de propagande, comme ceux de Leni Riefenstahl, ou ce fameux film antisémite : le Juif Süss. Mais en général, le cinéma est là pour distraire le peuple de la guerre et faire rêver.
Isabelle Mity consacre une partie de son essai aux divas, comme Zarah Leander, une Suédoise, qui jouait aussi bien qu'elle chantait et dansait, et dont le succès durera longtemps après la guerre. On peut citer aussi Sybille Schmitz, Kirsten Heiberg, une Norvégienne, ou Magda Schneider (la mère de Romy) et tant d'autres qui, sans être toutes nazies, rêvaient de faire carrière en Allemagne.
Durant les années d'après-guerre, nombre d'entre elles étaient toujours adulées, et les films de la période nazie toujours regardés. Cela tient au fait que ce cinéma n'était pas imperméable aux influences extérieures ni à la période dont il se faisait le reflet.
sabelle Mity nous plonge dans les méandres de la propagande nazi, gérée et orchestrée par le visionnaire (dans tous les sens du terme possible) Goebbels, obnubilé par l'image, la distorsion de la réalité, la beauté (et les actrices !) et un Hitler fasciné par Hollywood.
Depuis l'invention de la photographie et du cinématographe, l'image a été la première récupération pour la propagande, pour influencer, pour dénoncer, pour montrer…
L'image, encore plus que le cinéma, a un impact énorme sur l'avis d'une personne.
Le parti national-socialiste a compris, avant le putsch de Munich, de la force d'une image ; Hitler posait pour des photographes officiels (déjà) pour créer une ambiance, une posture de chef ; il avait pris des cours de théâtre pour apprendre le positionnement, les gestes, etc.
Nul doute, donc, qu'à son ascension au pouvoir, et sous l'influence (néfaste mais bien pensée) de Goebbels de la mise en scène, et de la puissance du cinéma pour faire passer des messages, l'idée de la race aryenne, de la force de l'Allemagne, de la suprématie des idées nazies.
Dès 1933, certains cinéastes (Max Ophüls, les frères Siodmack ou Billy Wilder, par exemple… puis Fritz Lang plus tard…) et acteurs/actrices fuient le régime, refusant la mascarade ou l'opprobre (notamment les juifs). Certains autres restent (et pas que Lent Riefenstahl) et essaient de se frayer un chemin, sans trop copiner, mais la machinerie bien rodée va les englober pour créer une illusion. Goebbels nationalise la société des films allemands, et vogue la galère (oui, c'est facile, mais…)
Car là est le but : créer l'illusion d'un système, d'une population, d'une idéologie commune.
Les actrices allemandes (et des pays « aryénisés », tel la Norvège) vont en subir le prix fort, sous l'influence d'un Goebbels qui retouche les scénarios, choisit les actrices, les séduit (on se doute donc qu'elles avaient bien conscience du funeste destin qui les attendaient si elles se refusaient… compte-tenu du peu d'attrait du ministre de la Propagande… entre autres).
Que cela soit la star Zarah Leander, ou les autres (toutes aussi belles et bonnes), leurs destins vont être liées durablement au régime.
Autant la gloire sera au rendez-vous avec tous les avantages dus à leurs rangs, autant certains vont s'opposer, avec leurs moyens, et en subir les conséquences.
Cet ouvrage montre les arcanes de la propagande, les petits arrangements entre amis/ennemis, les luttes de pouvoir au sein du régime, de l'adoration malsaine de Goebbels, de l'arrivisme de certaines, du questionnement sur l'art et la dictature (ou comment lutter de l'intérieur aussi).
Reste que ces actrices ont un peu disparu après la guerre et malgré des carrières à la télévision ou en cabaret pour certaines, seuls les fans de cinéma connaissent encore leurs noms.
N'hésitez pas à aller sur une plateforme de vidéos ou sur l'INA, pour aller écouter, admirer les Zarah Leander, Marika Rökk, Sybille Schmitz, Kirsten Heiberg…
Bref, un ouvrage très intéressant pour les amateurs de cinéma et du régime.
Depuis l'invention de la photographie et du cinématographe, l'image a été la première récupération pour la propagande, pour influencer, pour dénoncer, pour montrer…
L'image, encore plus que le cinéma, a un impact énorme sur l'avis d'une personne.
Le parti national-socialiste a compris, avant le putsch de Munich, de la force d'une image ; Hitler posait pour des photographes officiels (déjà) pour créer une ambiance, une posture de chef ; il avait pris des cours de théâtre pour apprendre le positionnement, les gestes, etc.
Nul doute, donc, qu'à son ascension au pouvoir, et sous l'influence (néfaste mais bien pensée) de Goebbels de la mise en scène, et de la puissance du cinéma pour faire passer des messages, l'idée de la race aryenne, de la force de l'Allemagne, de la suprématie des idées nazies.
Dès 1933, certains cinéastes (Max Ophüls, les frères Siodmack ou Billy Wilder, par exemple… puis Fritz Lang plus tard…) et acteurs/actrices fuient le régime, refusant la mascarade ou l'opprobre (notamment les juifs). Certains autres restent (et pas que Lent Riefenstahl) et essaient de se frayer un chemin, sans trop copiner, mais la machinerie bien rodée va les englober pour créer une illusion. Goebbels nationalise la société des films allemands, et vogue la galère (oui, c'est facile, mais…)
Car là est le but : créer l'illusion d'un système, d'une population, d'une idéologie commune.
Les actrices allemandes (et des pays « aryénisés », tel la Norvège) vont en subir le prix fort, sous l'influence d'un Goebbels qui retouche les scénarios, choisit les actrices, les séduit (on se doute donc qu'elles avaient bien conscience du funeste destin qui les attendaient si elles se refusaient… compte-tenu du peu d'attrait du ministre de la Propagande… entre autres).
Que cela soit la star Zarah Leander, ou les autres (toutes aussi belles et bonnes), leurs destins vont être liées durablement au régime.
Autant la gloire sera au rendez-vous avec tous les avantages dus à leurs rangs, autant certains vont s'opposer, avec leurs moyens, et en subir les conséquences.
Cet ouvrage montre les arcanes de la propagande, les petits arrangements entre amis/ennemis, les luttes de pouvoir au sein du régime, de l'adoration malsaine de Goebbels, de l'arrivisme de certaines, du questionnement sur l'art et la dictature (ou comment lutter de l'intérieur aussi).
Reste que ces actrices ont un peu disparu après la guerre et malgré des carrières à la télévision ou en cabaret pour certaines, seuls les fans de cinéma connaissent encore leurs noms.
N'hésitez pas à aller sur une plateforme de vidéos ou sur l'INA, pour aller écouter, admirer les Zarah Leander, Marika Rökk, Sybille Schmitz, Kirsten Heiberg…
Bref, un ouvrage très intéressant pour les amateurs de cinéma et du régime.
Excellent ouvrage sur les actrices du IIIème Reich et au delà sur le cinéma nazi.
Isabelle Mitry a fortement documenté ses propos et ne se contente pas de décrire les splendeurs et décadences de ces vedettes des années 30/40.
Elle retrace derrière leurs vies, leurs films, toute la mise au pas du cinéma par les nazis.
Pour certaines, honneurs et les mondanités ont suffi à faire taire leurs éventuels scrupules, pour d'autres jouer primait sur tout, quelques unes ont fait preuve de naîveté, peu ont résisté. Aucune ne semble cependant avoir adhéré avec conviction au nazisme.
Cinéma de propagande, cinéma de distraction, mélant les codes du honni Hollywood et ceux de l'ordre nazi, le cinéma allemant de ces années là n'est pas vraiment sorti de son purgatoire même si ses vedettes ont pour nombre d'entre elles eu une carrière plus ou moins connues par la suite.
Isabelle Mitry a fortement documenté ses propos et ne se contente pas de décrire les splendeurs et décadences de ces vedettes des années 30/40.
Elle retrace derrière leurs vies, leurs films, toute la mise au pas du cinéma par les nazis.
Pour certaines, honneurs et les mondanités ont suffi à faire taire leurs éventuels scrupules, pour d'autres jouer primait sur tout, quelques unes ont fait preuve de naîveté, peu ont résisté. Aucune ne semble cependant avoir adhéré avec conviction au nazisme.
Cinéma de propagande, cinéma de distraction, mélant les codes du honni Hollywood et ceux de l'ordre nazi, le cinéma allemant de ces années là n'est pas vraiment sorti de son purgatoire même si ses vedettes ont pour nombre d'entre elles eu une carrière plus ou moins connues par la suite.
On ne peut qu'être impressionné par le travail effectué par Isabelle Mity qui livre un récit détaillé et documenté sur le sujet.
Evidemment mieux vaut être un cinéphile pur et dur pour totalement l'apprécier car la plupart des actrices et des films dont elle parle sont inconnus du grand public.
Les passages sur la mainmise du ministre de la propagande, le sinistre Joseph Goebbels , sur la production cinématographique Allemande de l'époque et sur ses rapports avec plusieurs actrices en vogue sont particulièrement intéressants.
Instructif!
Evidemment mieux vaut être un cinéphile pur et dur pour totalement l'apprécier car la plupart des actrices et des films dont elle parle sont inconnus du grand public.
Les passages sur la mainmise du ministre de la propagande, le sinistre Joseph Goebbels , sur la production cinématographique Allemande de l'époque et sur ses rapports avec plusieurs actrices en vogue sont particulièrement intéressants.
Instructif!
critiques presse (2)
Une étude très complète d’Isabelle Mity sur le cinéma allemand à l’heure nazie.
Lire la critique sur le site : LeFigaro
Entre le rêve pompeux d’un empire cinématographique et la réalité d’une chute brutale avec la défaite, il y a eu la magie d’une illusion, magistralement racontée par Isabelle Mity, qui enseigne la langue et la civilisation allemandes à l’université Paris-Dauphine.
Lire la critique sur le site : Bibliobs
Citations et extraits (7)
Voir plus
Ajouter une citation
Herbert Reinecker, le père d'Inspecteur Derrick, entre dans les Jeunesses hitlériennes en 1934, puis travaille au département de la propagande de la SS et fait partie de la division Totenkopf ("tête de mort") de la SS en 1942. En 1945, il est rédacteur au journal SS Das Schwarze Korps. Un an plus tôt, en 1944, il a écrit le scénario du film Jeunes Aigles (Junge Adler, 1944), destiné à la jeunesse, réalisé par Alfred Weidenmann. Ce dernier dirige la section cinéma dans l'organisation de jeunesse de Baldur von Schirach et tourna plus tard de nombreux épisodes de l'inspecteur Derrick. Les deux compères se retrouvent en 1954 sur le film Canaris, réalisé par Weidenmann, qui réhabilite l'amiral Canaris en mettant en avant les activités dans la résistance du chef de l'Abwehr.
Si les deux hommes n'ont jamais tenté de dissimuler leur passé, ce n'est pas le cas de Horst Tappert, l'acteur qui jouait Derrick. En 2013, cinq ans après sa mort, coup de tonnerre outre-Rhin: les archives révèlent qu'il a lui aussi fait partie de la fameuse division Totenkopf de la Waffen SS.
Si les deux hommes n'ont jamais tenté de dissimuler leur passé, ce n'est pas le cas de Horst Tappert, l'acteur qui jouait Derrick. En 2013, cinq ans après sa mort, coup de tonnerre outre-Rhin: les archives révèlent qu'il a lui aussi fait partie de la fameuse division Totenkopf de la Waffen SS.
Si Riefenstahl est la principale réalisatrice de documentaires sur demande express de Hitler, elle n'est pas la seule. Le Fürher fait réaliser Victimes du passé (Opter der Vergangenheit, 1937), de la propagande eugéniste sur la stérilisation des déficients mentaux et charge Karl Ritter, cinéaste émérite, de produire un film sur la légion Condor pendant la guerre d'Espagne. Cela donne Au combat contre l'ennemi mondial- les volontaires allemands en Espagne (Im Kampf gegen des Weltfeind, 1938), "l'ennemi mondial" désignant ici bien entendu les bolcheviques.
(A propos de Magda Schneider, "La reine des bluettes", mère de Romy)
Les films allemands de Romy Schneider sont d'ailleurs en grande partie des remakes de films du IIIe Reich. C'est le cas des Jeunes années d'une reine (1954), où elle reprend le rôle tenu en 1936 par Jenny Jugo, avec sa mère en gouvernante et préceptrice de Victoria, ou de Kitty à la conquête du monde (1956), reprise de Kitty und die Weltkonferenz (1939), de Helmut Käutner, avec Hannelore Schroth. Sans parler de Sissi, qui a déjà donné lieu à un Princesse Sissi en 1939, centré exclusivement sur l'enfance de la future impératrice.
Aussi longtemps que Romy tourne avec elle, Magda Schneider vole de succès en succès, presque par procuration, tant la gloire de sa fille dépasse rapidement la sienne. Lorsque Romy, lassée des rôles ineptes, répétitifs et commerciaux qu'on lui propose en Allemagne, et étouffée par la tutelle d'une mère chaperon et d'un beau-père pressant, décide de s'émanciper, c'en est fini de la deuxième carrière de Magda.
Les films allemands de Romy Schneider sont d'ailleurs en grande partie des remakes de films du IIIe Reich. C'est le cas des Jeunes années d'une reine (1954), où elle reprend le rôle tenu en 1936 par Jenny Jugo, avec sa mère en gouvernante et préceptrice de Victoria, ou de Kitty à la conquête du monde (1956), reprise de Kitty und die Weltkonferenz (1939), de Helmut Käutner, avec Hannelore Schroth. Sans parler de Sissi, qui a déjà donné lieu à un Princesse Sissi en 1939, centré exclusivement sur l'enfance de la future impératrice.
Aussi longtemps que Romy tourne avec elle, Magda Schneider vole de succès en succès, presque par procuration, tant la gloire de sa fille dépasse rapidement la sienne. Lorsque Romy, lassée des rôles ineptes, répétitifs et commerciaux qu'on lui propose en Allemagne, et étouffée par la tutelle d'une mère chaperon et d'un beau-père pressant, décide de s'émanciper, c'en est fini de la deuxième carrière de Magda.
Car le cinéma allemand sous les nazis, ce n'est pas seulement les productions antisémites, Le Juif Süss, Le Juif éternel, les films de propagande exaltant l'esprit guerrier ou de résistance comme Sukas ou Kolberg, ou les documentaires de Levi Riefenstahl sur le congrès de Nuremberg de 1934 ou les Jeux olympiques de 1936. C'est aussi, et surtout, une industrie de divertissement, une usine à rêves, bref, un second Hollywood. Comédies, mélodrames, films d'amour, policiers, de revue, musicaux forment le plus gros d'une production extrêmement abondante, estimée à 1094 films entre 1933 et 1945. Jamais les studios ne furent soumis à un tel régime, jamais il n'y eut autant de magazines consacré au cinéma et aux stars, jamais il n'y eut autant de vedettes. Un véritable âge d'Or, en somme, qui coïncide avec la page la plus sombre de l'histoire allemande.
En quelques semaines, des grands noms du cinéma expressionniste, de la Nouvelle-Objectivité - un mouvement artistique pluridisciplinaire, réaliste et humaniste, des années 1920 en Allemagne-, du film musical enlevé et plein d'humour, échappatoire à la crise, tournent le dos à cette Allemagne assimilant une partie de ses artistes à des corps étrangers corrupteurs. Envolés, les Curt et Robert Siodmak, Billy Wilder, Max Ophüls, Wilhem Thiele, Paul Czinner, E.A. Dupont, Hermann Kosterlitz (futur Henry Koster), Joe May, Richard Oswald, Robert Wiene, Leontine Sagan, Fritz Lang. Ils trouvent refuge en Russie, en France, en Angleterre, le plus souvent aux Etats-Unis. Une hémorragie de génies de la mise en scène, mais aussi de compositeurs de musique de films dont le cinéma allemand, amputé de ses principaux pourvoyeurs d'humour et de légèreté, ne se remettra jamais tout à fait.
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Isabelle Mity (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3240 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3240 lecteurs ont répondu