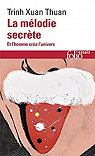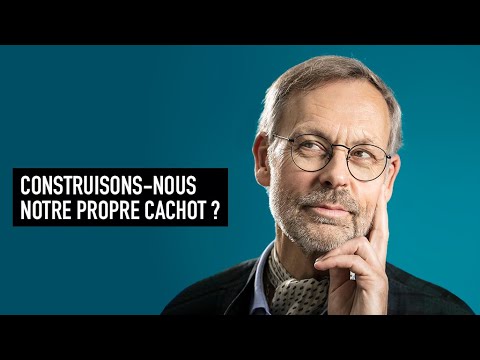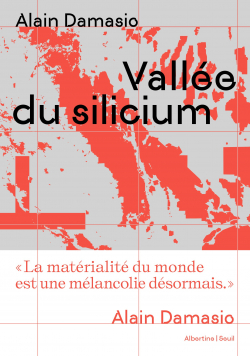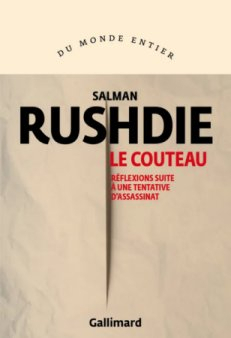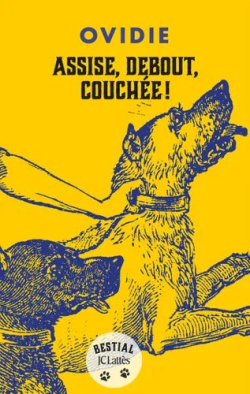Ingénieur agronome, docteur en histoire des sciences et docteur en théologie, Jacques Arnould s'intéresse aux relations entre sciences, cultures et religions, avec un intérêt particulier pour deux thèmes : celui du vivant et de son évolution et celui de l'espace et de sa conquête. Il a consacré plusieurs ouvrages et articles d'histoire ou de théologie au domaine du vivant. Suite à la poussée de fièvre créationniste en France, à partir de janvier 2007, il a été sollicité par différents milieux, scientifiques, pédagogiques ou religieux, pour informer les publics de l'existence des courants créationnistes, de leur histoire, des questions qu'ils posent à nos sociétés. L'année 2009, consacrée à Darwin, a montré comment les idées de ce savant et de ses successeurs continuent à interroger nos contemporains et les invitent à des interrogations plus philosophiques. Il est également expert éthique au Centre national d'études spatiales (CNES), un poste encore un peu unique dans le monde de l'astronautique. Pourtant, cela rejoint une vraie attente de la part du public, mais aussi des acteurs et des dirigeants, leurs motivations ne pouvant en effet plus être les mêmes qu'il y a quarante ou cinquante ans.
Conférence : Construisons-nous notre propre cachot ?
30 juin 2022, 16h - 16h45 — Amphi 34A
Paul Virilio était maître-verrier, mais il ne s'est pas contenté d'habiller de lumière le vide creusé dans nos édifices de pierre et de verre. Sa pensée, aussi élégante qu'une voûte gothique, aussi audacieuse qu'un voile de béton, a scruté, critiqué, analysé nos constructions techniques, sociales et politiques jusque dans leurs recoins les plus cachés, leurs fondations les plus fragiles, leurs zones les plus dangereuses. Il a rappelé la finitude de notre monde, ce cachot dont parlait Blaise Pascal ; il a dénoncé les dérives de la technologie, les excès de la vitesse ; il a annoncé les accidents, les catastrophes à venir. Il a aussi échafaudé des plans pour habiter le vide, pour construire le futur. Il avait pour devise : « Rien derrière, tout devant. »

Jacques Arnould/5
3 notes
Résumé :
Présentation de l'éditeur
« Je veux connaître la pensée de Dieu ; le reste n est que détails », dit un jour Albert Einstein à ses étudiants. Cette attitude prométhéenne tranchait avec des siècles d éloignement entre science moderne et métaphysique. Jusqu alors, il était entendu que chaque avancée dans la connaissance de la matière et du cosmos faisait reculer d un cran l idée de Dieu : celui-ci était devenu au mieux une hypothèse inutile, au pire un p... >Voir plus
« Je veux connaître la pensée de Dieu ; le reste n est que détails », dit un jour Albert Einstein à ses étudiants. Cette attitude prométhéenne tranchait avec des siècles d éloignement entre science moderne et métaphysique. Jusqu alors, il était entendu que chaque avancée dans la connaissance de la matière et du cosmos faisait reculer d un cran l idée de Dieu : celui-ci était devenu au mieux une hypothèse inutile, au pire un p... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Sous le voile du cosmos : Quand les scientifiques parlent de dieuVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Un livre passionnant qui a le mérite d'expliquer simplement l'évolution des théories scientifiques sur les origines de l'univers tout en montrant qu'on ne peut pas donner des preuves de l'existence ou de l'inexistence de Dieu.
C.Meaudre
C.Meaudre
Citations et extraits (7)
Voir plus
Ajouter une citation
Einstein l’a dit sans détour à son étudiante Esther Salaman : dans ses équations, il ne cherchait rien d’autre qu’à connaître la pensée de Dieu. Ses contemporains, pour leur part, manifestèrent en maintes occasions leur désir de connaître la pensée d’Einstein sur Dieu ; parmi elles, celle du 14 février 1927. Ce soir-là, à Berlin, avec Einstein, l’éditeur Samuel Fischer a invité à sa table l’écrivain Gerhart Hauptmann et le critique Alfred Kerr. La conversation tourne un instant autour de l’astrologie. Soudain, Kerr s’emballe : « Comment ? Ce n’est pas possible ! Je dois lui poser la question sans attendre. Professeur ! J’apprends que vous êtes supposé être profondément religieux ? » Avec calme et dignité, Einstein répond : « Oui, vous pouvez dire cela. Essayez de pénétrer, avec nos capacités limitées, les secrets de la nature et vous découvrirez que demeure, derrière les concaténations observables, quelque chose de subtil, d’intangible et d’inexplicable. Sentir que derrière tout ce que peut appréhender l’expérience, se trouve un quelque chose que notre esprit ne peut saisir et dont la beauté et le sublime ne nous touchent qu’indirectement sous la forme d’un faible reflet, c’est le religieux. Dans ce sens, je suis religieux. » Une confession, un credo parmi tant d’autres que prononça et écrivit Einstein qui souligne, non pas pour s’opposer à sa réponse à Esther Salaman mais plutôt pour la compléter, comment son attitude, qu’il qualifie de religieuse, trouve ses racines dans la démarche scientifique, dans la recherche des secrets de la nature.
(...)
La vision d’Einstein n’est donc pas dénuée de matérialisme, ni, nous l’avons vu, d’un profond déterminisme ; cependant, à l’école de Spinoza, proche aussi de Démocrite et d’Épicure, le savant reconnaît dans la structure même du monde l’empreinte d’une volonté supérieure et divine. Une empreinte si profonde qu’il ne reste pour seule issue à l’être humain que le renoncement à toute prétention à la liberté : « Je me refuse à croire en la liberté et en ce concept philosophique. Je ne suis pas libre, mais tantôt contraint par des pressions étrangères à moi ou tantôt par des convictions intimes. Jeune, j’ai été frappé par la maxime de Schopenhauer : “L’homme peut certes faire ce qu’il veut mais il ne peut pas vouloir ce qu’il veut” ; et aujourd’hui face au terrifiant spectacle des injustices humaines, cette morale m’apaise et m’éduque. » S’il existe une liberté, il s’agit de celle acquise vis-à-vis des désirs égoïstes ; s’il existe une libération, seule la reconnaissance d’un Être suprême permet de l’opérer et non l’adhésion à une religion.
(...)
La vision d’Einstein n’est donc pas dénuée de matérialisme, ni, nous l’avons vu, d’un profond déterminisme ; cependant, à l’école de Spinoza, proche aussi de Démocrite et d’Épicure, le savant reconnaît dans la structure même du monde l’empreinte d’une volonté supérieure et divine. Une empreinte si profonde qu’il ne reste pour seule issue à l’être humain que le renoncement à toute prétention à la liberté : « Je me refuse à croire en la liberté et en ce concept philosophique. Je ne suis pas libre, mais tantôt contraint par des pressions étrangères à moi ou tantôt par des convictions intimes. Jeune, j’ai été frappé par la maxime de Schopenhauer : “L’homme peut certes faire ce qu’il veut mais il ne peut pas vouloir ce qu’il veut” ; et aujourd’hui face au terrifiant spectacle des injustices humaines, cette morale m’apaise et m’éduque. » S’il existe une liberté, il s’agit de celle acquise vis-à-vis des désirs égoïstes ; s’il existe une libération, seule la reconnaissance d’un Être suprême permet de l’opérer et non l’adhésion à une religion.
René Descartes est donc l’un de ces premiers théologiens séculiers. En 1633, lorsqu’il apprend la condamnation de Galilée, il préfère différer la parution de l’ouvrage dont la rédaction l’a occupé durant les quatre années précédentes, son propre Traité du monde. Sa décision est sage : trente années plus tard et quinze après sa mort, le livre, enfin imprimé, est immédiatement mis à l’Index, autrement dit jugé et déclaré interdit aux catholiques. Si la perspective astronomique de Descartes est sans nul doute trop héliocentrique au goût du magistère romain, le vrai motif de cette condamnation est probablement plus théologique que scientifique : la physique de Descartes, résolument mathématique et hypothétique, n’a que faire des notions de cause finale et de but, elle expulse de l’univers les esprits en même temps que Dieu. Dès lors, il est impossible d’assimiler le Dieu de Descartes avec le Dieu des chrétiens : le premier ne peut être saisi que par l’âme humaine qui a recours à sa propre essence spirituelle, à sa propre intelligence ; le second invite les croyants à le chercher, à le dénicher, à le contempler dans ses reflets, dans ses vestiges que sont ses créatures, enfin dans sa Révélation historique. Le Dieu de Descartes est un Dieu pour les philosophes et non pour les croyants, un Dieu dont seule compte l’immutabilité à laquelle le savant français a recours pour fonder les lois d’inertie et de conservation du mouvement, et non un Dieu qui pourrait avoir un quelconque intérêt pour ses créatures.
Le Dieu de Descartes paraît trop fainéant pour Henry More qui reproche au philosophe français son athéisme.
(...)
Qu’ils paraissent étranges, ces théologiens séculiers : s’ils ne nient pas l’existence de Dieu et entretiennent à son égard une forme de respect, ils n’hésitent pas à le plier aux mesures des mondes qu’ils entreprennent de bâtir et de représenter. Au point de ne pas hésiter à recourir à ses divins pouvoirs pour combler les lacunes de leurs connaissances, pour franchir les murs contre lesquels butent leurs explications ; ainsi, le Dieu de Newton a-t-il toutes les allures d’un God-of-the gaps, d’un Dieu-bouche-trous qui offre une réponse à ce que le savant anglais ignore encore. Voilà une solution dangereuse, une pratique délicate, dénoncées par ceux qui craignent de voir cette méthode de colmatage apaiser trop facilement la soif de comprendre et rassasier à bas prix la faim de connaître dont aime à s’enorgueillir l’être humain.
Le Dieu de Descartes paraît trop fainéant pour Henry More qui reproche au philosophe français son athéisme.
(...)
Qu’ils paraissent étranges, ces théologiens séculiers : s’ils ne nient pas l’existence de Dieu et entretiennent à son égard une forme de respect, ils n’hésitent pas à le plier aux mesures des mondes qu’ils entreprennent de bâtir et de représenter. Au point de ne pas hésiter à recourir à ses divins pouvoirs pour combler les lacunes de leurs connaissances, pour franchir les murs contre lesquels butent leurs explications ; ainsi, le Dieu de Newton a-t-il toutes les allures d’un God-of-the gaps, d’un Dieu-bouche-trous qui offre une réponse à ce que le savant anglais ignore encore. Voilà une solution dangereuse, une pratique délicate, dénoncées par ceux qui craignent de voir cette méthode de colmatage apaiser trop facilement la soif de comprendre et rassasier à bas prix la faim de connaître dont aime à s’enorgueillir l’être humain.
Einstein répond : «...Essayez de pénétrer, avec nos capacités limitées, les secrets de la nature et vous découvrirez que demeure, derrière les concaténations observables, quelque chose de subtil, d’intangible et d’inexplicable. Sentir que derrière tout ce que peut appréhender l’expérience, se trouve un quelque chose que notre esprit ne peut saisir, et dont la beauté et le sublime ne nous touchent qu’indirectement sous la forme d’un faible reflet, c’est le religieux.
Dans ce sens, je suis religieux. »
Dans ce sens, je suis religieux. »
La recherche scientifique est un incroyable édifice, où les audaces d’hier servent d’échafaudage aux constructions d’aujourd’hui, avant que celles ci ne se trouvent partiellement détruites et enfouies pour servir de fondations aux avancées de demain.
Une énorme tuile, arrachée par le vent, tombe et assomme un passant. Nous dirons que c’est un hasard. Le dirions nous si la tuile s’etait brisée simplement sur le sol ?... Le hasard est donc le mécanisme se comportant comme s’il avait une intention.
Lire un extrait
Videos de Jacques Arnould (11)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jacques Arnould (43)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Pas de sciences sans savoir (quiz complètement loufoque)
Présent - 1ère personne du pluriel :
Nous savons.
Nous savonnons (surtout à Marseille).
10 questions
414 lecteurs ont répondu
Thèmes :
science
, savoir
, conjugaison
, humourCréer un quiz sur ce livre414 lecteurs ont répondu