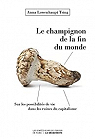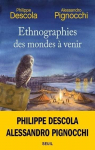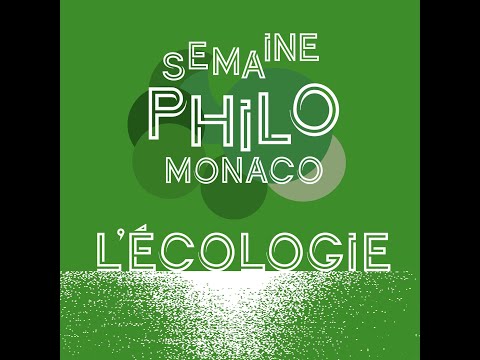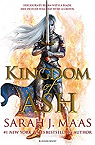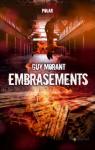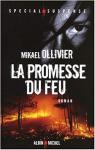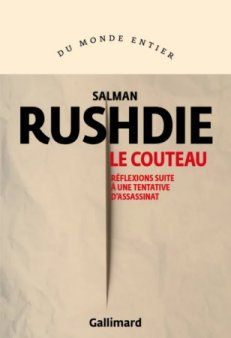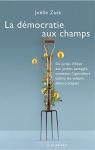Présenté par Raphael Zagury-Orly
Avec
Guillaume le Blanc, philosophe
Joëlle Zask, philosophe
Que la sobriété est difficile à percevoir, et à maintenir! Etymologiquement, elle renvoie à «sine ebrietas», absence d'ébriété. On est sobre si on n'est pas ivre (ebrius), soûl, aviné, et, par extension, grisé, exalté, excessif, immodéré, sans frein (bien qu'on puisse être tout cela en étant abstinent). Assez sereine et posée, elle ressemble peu à l'austérité, obligée, sévère, grise et ennuyeuse. Son amie la plus proche serait la tempérance, louée depuis l'Antiquité: ni trop ni trop peu, et encore moins pas assez – car la sobriété n'est pas la pauvreté. Elle suppose avoirs et biens, mais les gère et en jouit en évitant qu'ils excèdent ou s'hypertrophient. Mettant en acte la «juste mesure», elle se pose comme le contraire de cette pseudo-autonomie radicale par quoi on se permet tout, foulant aux pieds les besoins, les désirs, les aspirations, les droits et les libertés des autres. Certes, dans une société ivre de biens matériels, de plaisirs et de pouvoirs, où l'arc des inégalités sans cesse s'écarte, où la vocifération se substitue à la parole, l'invective au dialogue, le mépris au respect, le rejet à l'accueil, où seuls le buzz, l'outrance et le clash s'entendent, la place de la sobriété, comme vertu, semble bien exiguë. Aussi ne peut-elle revivre que par nécessité, sous forme du soin qu'exige la planète – et de la conscience que les excès et les gâchis sont nocifs non seulement du point de vue économique et écologique mais aussi de celui de la sécurité, de la santé et de la stabilité sociale. Elle sera alors vertu sociale et civique, style de vie partagé, changement d'habitudes, de principes et de croyances, et signifiera, non plus accumuler, gâcher, polluer, mais prendre soin, protéger, réutiliser, recycler, récupérer, réparer.

Joëlle Zask/5
15 notes
Résumé :
Comment comprendre ce phénomène écologique nouveau et extrêmement inquiétant que sont les mégafeux, ces feux gigantesques et incontrôlables, que les moyens techniques actuels ne permettent pas de contenir?
Incendies de Californie, de Grèce, du Portugal... Les feux de forêt, ce phénomène que l'on connaît depuis toujours, prennent désormais une ampleur telle qu'ils en viennent à changer de nature : nous avons désormais affaire, un peu partout dans le mo... >Voir plus
Incendies de Californie, de Grèce, du Portugal... Les feux de forêt, ce phénomène que l'on connaît depuis toujours, prennent désormais une ampleur telle qu'ils en viennent à changer de nature : nous avons désormais affaire, un peu partout dans le mo... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Quand la forêt brûleVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (5)
Ajouter une critique
Dans cet essai Joëlle Zask nous invite à approcher de plus près les mégafeux et nous les présentent comme la nouvelle catastrophe écologique.
Mais pas seulement et c'est ce qui est passionnant si on prend le temps de suivre son enseignement au fil des chapitres. Il faut être patient et attentif, mettre de côté parfois certains passages plus complexes pour mieux y revenir.
On se détourne par moment du feu pour écouter notre rapport à la nature, notre rapport au paysage.
On regarde en face les actions de l'homme, sa course à l'industrialisation, au rendement. L'homme domine, perturbe, déséquilibre, désapprend, s'enferme dans un cercle vicieux et destructeur. Il fait de la « malforestation » comme il fait de la malbouffe.
Puis il revient à la nature, il s'en rapproche, fabrique des cabanes dans la forêt par exemple, là où nos ancêtres savaient être plus prudents en créant des barrières. Il pense la nature réconfortante, apaisante. Il en prend soin parfois, il l'écoute, mais la nature est de plus en plus menaçante. Elle n'est pas le paysage que l'on maîtrise, elle est sauvage. Si on la bat, elle gronde.
J'ai particulièrement apprécié un passage qui évoque le roman de Jocelyne Saucier : Il pleuvait des oiseaux. Les mégafeux engendrent un naufrage moral, une blessure ouverte, un sentiment de perte.
Quelle est la part du feu ? Quelle est la part de l'homme ? Comment cette histoire entre l'homme et le feu pourrait-elle finir si l'homme ne repense pas sa place dans la nature, et oublie la culture ancestrale du feu ?
Je remercie la masse critique Babelio et les Éditions Premier Parallèle pour cet essai écrit par Joëlle Zask, enseignante en philosophie à l'université Aix-Marseille.
Mais pas seulement et c'est ce qui est passionnant si on prend le temps de suivre son enseignement au fil des chapitres. Il faut être patient et attentif, mettre de côté parfois certains passages plus complexes pour mieux y revenir.
On se détourne par moment du feu pour écouter notre rapport à la nature, notre rapport au paysage.
On regarde en face les actions de l'homme, sa course à l'industrialisation, au rendement. L'homme domine, perturbe, déséquilibre, désapprend, s'enferme dans un cercle vicieux et destructeur. Il fait de la « malforestation » comme il fait de la malbouffe.
Puis il revient à la nature, il s'en rapproche, fabrique des cabanes dans la forêt par exemple, là où nos ancêtres savaient être plus prudents en créant des barrières. Il pense la nature réconfortante, apaisante. Il en prend soin parfois, il l'écoute, mais la nature est de plus en plus menaçante. Elle n'est pas le paysage que l'on maîtrise, elle est sauvage. Si on la bat, elle gronde.
J'ai particulièrement apprécié un passage qui évoque le roman de Jocelyne Saucier : Il pleuvait des oiseaux. Les mégafeux engendrent un naufrage moral, une blessure ouverte, un sentiment de perte.
Quelle est la part du feu ? Quelle est la part de l'homme ? Comment cette histoire entre l'homme et le feu pourrait-elle finir si l'homme ne repense pas sa place dans la nature, et oublie la culture ancestrale du feu ?
Je remercie la masse critique Babelio et les Éditions Premier Parallèle pour cet essai écrit par Joëlle Zask, enseignante en philosophie à l'université Aix-Marseille.
Un ouvrage important d'une philosophe importante en France. J'éprouve une fierté certaine à avoir été son élève et l'avoir eu pour directrice de recherche.
Lire ce livre alors qu'il se passe ce qu'il se passe en Australie induit nécessairement une sorte d'urgence à s'informer et une certaine atmosphère lors de la lecture.
Je ne suis pas écologiste au sens où on l'entend politiquement, avec un militantisme revendicatif forcené. J'essaye de m'informe du mieux possible notamment sur l'agriculture, sur la biodiversité d'un point de vue scientifique et j'avoue ne jamais m'être posé de question sur le sujets des feux de forêts jusqu'à la connaissance des méga-feux.
J'ai donc lu cet ouvrage pour deux raisons. La première est parce qu'il provient d'une personne qui a beaucoup compté dans mes études en philosophie et la seconde est par rapport à mon implication politique.
J'avoue avoir été très intéressé par cet ouvrage.
Tout d'abord parce que le style de Joëlle Zask s'y prête. le propos est clair, le style est simple, sans fioriture et concis. Il n'y a pas de prétention ni de volonté de gloser, simplement de partager et d'avertir non dans un catastrophisme effréné mais avec la patience de la démonstration philosophique et des connaissances scientifiques.
Il ne sert à rien de s'attarder sur l'émotion sinon pour comprendre les causes de cette émotion et notre rapport singulier au feu constructeur et destructeurs d'environnements, d'espaces et de sociétés. Rappeler que le feu nous a permis de bâtir nos techniques et nos civilisations n'est pas une mince affaire à une époque où l'ultra préservationnisme et l'interventionnisme exagéré laissent peu de place à la nuance quant à notre rapport avec le monde et la Nature.
Nous rappeler à l'humilité également en remarquant que la technologie ne nous permet pas de lutter contre les méga feux et préciser aussi que la course à la vente de cette technologie au motif qu'il s'agit d'une guerre contre le feu (dont on peut également interroger la pertinence puisque le feu est le seul élément qui place notre relation dans le champ lexical de la guerre.) ne sert à rien contre les méga feux et que bien souvent les éléments naturels résolvent la situation.
Mentionner l'information selon laquelle nous nous servons du feu depuis des millénaires et depuis homo erectus pour aménager l'espace et que bien souvent cet aménagement lorsqu'il est équilibré renforce le développement des espaces naturels. Mais pour cela il convient d'être à nouveau capable d'interactions sociales avec la Nature afin d'en comprendre la temporalité. Et de prendre en compte le fait que la Nature vierge n'existe pas, qu'elle est déjà sujette depuis longtemps à nos volontés d'aménagement et aux évolutions successives.
Réaffirmer le rôle du réchauffement climatique et du cercle vicieux généré par les Méga feux producteurs immenses de CO2 et destructeur d'espaces végétaux producteurs eux d'oxygène.
Interroger notre culture du feu ainsi et notre rapport à lui, nos sentiments à son égard, le traumatisme vécu quand il est hors de contrôle, et réintroduire le concept de paysage comme point d'ancrage de notre relation à notre environnement.
C'est un retour aux sources social, politique, et finalement le principe premier de l'écologie que souhaite nous communiquer Joëlle Zask et ce à travers l'archétype du méga feu véritable révélateur des tensions qui se jouent entre nos sociétés et la Nature. Confirmer la nécessité d'un retour aux paysages et du coup à la paysannerie qui n'est pas seulement l'agriculture mais un mode de vie équilibré entre la vie social et la vie au sein d'espaces naturels. Car la vie sociale est aussi aux champs, elle l'a d'abord été.
Un livre indispensable pour tout citoyen et toute formation politique qui dépasse les idéologies en demeurant factuel et en essayant de répondre à des problématiques complexes mais nécessaires.
Lire ce livre alors qu'il se passe ce qu'il se passe en Australie induit nécessairement une sorte d'urgence à s'informer et une certaine atmosphère lors de la lecture.
Je ne suis pas écologiste au sens où on l'entend politiquement, avec un militantisme revendicatif forcené. J'essaye de m'informe du mieux possible notamment sur l'agriculture, sur la biodiversité d'un point de vue scientifique et j'avoue ne jamais m'être posé de question sur le sujets des feux de forêts jusqu'à la connaissance des méga-feux.
J'ai donc lu cet ouvrage pour deux raisons. La première est parce qu'il provient d'une personne qui a beaucoup compté dans mes études en philosophie et la seconde est par rapport à mon implication politique.
J'avoue avoir été très intéressé par cet ouvrage.
Tout d'abord parce que le style de Joëlle Zask s'y prête. le propos est clair, le style est simple, sans fioriture et concis. Il n'y a pas de prétention ni de volonté de gloser, simplement de partager et d'avertir non dans un catastrophisme effréné mais avec la patience de la démonstration philosophique et des connaissances scientifiques.
Il ne sert à rien de s'attarder sur l'émotion sinon pour comprendre les causes de cette émotion et notre rapport singulier au feu constructeur et destructeurs d'environnements, d'espaces et de sociétés. Rappeler que le feu nous a permis de bâtir nos techniques et nos civilisations n'est pas une mince affaire à une époque où l'ultra préservationnisme et l'interventionnisme exagéré laissent peu de place à la nuance quant à notre rapport avec le monde et la Nature.
Nous rappeler à l'humilité également en remarquant que la technologie ne nous permet pas de lutter contre les méga feux et préciser aussi que la course à la vente de cette technologie au motif qu'il s'agit d'une guerre contre le feu (dont on peut également interroger la pertinence puisque le feu est le seul élément qui place notre relation dans le champ lexical de la guerre.) ne sert à rien contre les méga feux et que bien souvent les éléments naturels résolvent la situation.
Mentionner l'information selon laquelle nous nous servons du feu depuis des millénaires et depuis homo erectus pour aménager l'espace et que bien souvent cet aménagement lorsqu'il est équilibré renforce le développement des espaces naturels. Mais pour cela il convient d'être à nouveau capable d'interactions sociales avec la Nature afin d'en comprendre la temporalité. Et de prendre en compte le fait que la Nature vierge n'existe pas, qu'elle est déjà sujette depuis longtemps à nos volontés d'aménagement et aux évolutions successives.
Réaffirmer le rôle du réchauffement climatique et du cercle vicieux généré par les Méga feux producteurs immenses de CO2 et destructeur d'espaces végétaux producteurs eux d'oxygène.
Interroger notre culture du feu ainsi et notre rapport à lui, nos sentiments à son égard, le traumatisme vécu quand il est hors de contrôle, et réintroduire le concept de paysage comme point d'ancrage de notre relation à notre environnement.
C'est un retour aux sources social, politique, et finalement le principe premier de l'écologie que souhaite nous communiquer Joëlle Zask et ce à travers l'archétype du méga feu véritable révélateur des tensions qui se jouent entre nos sociétés et la Nature. Confirmer la nécessité d'un retour aux paysages et du coup à la paysannerie qui n'est pas seulement l'agriculture mais un mode de vie équilibré entre la vie social et la vie au sein d'espaces naturels. Car la vie sociale est aussi aux champs, elle l'a d'abord été.
Un livre indispensable pour tout citoyen et toute formation politique qui dépasse les idéologies en demeurant factuel et en essayant de répondre à des problématiques complexes mais nécessaires.
Un livre...de saison.
Utile, rigoureux et documenté qui énonce dans un langage clair les principaux mécanismes, du façonnage fait par l'homme à l'émergence d'espèces végétales "pyrofiles". Un souci de traiter la question avec un esprit philosophique précis;
Qui en fait une introduction intéressante à cette grande problématique et enjeu de notre époque...difficile.
Une bibliographie est fournie.
Utile, rigoureux et documenté qui énonce dans un langage clair les principaux mécanismes, du façonnage fait par l'homme à l'émergence d'espèces végétales "pyrofiles". Un souci de traiter la question avec un esprit philosophique précis;
Qui en fait une introduction intéressante à cette grande problématique et enjeu de notre époque...difficile.
Une bibliographie est fournie.
Idée de départ / Accroche du début de livre : 9/10
Développement du livre : 3/10
Style de l'écriture : 7/10
Rendu des propos : 3/10
Total 21/40 Babelio 2,5/5
D'abord merci à Babelio pour m'avoir tiré au sort pour ce livre. C'est d'ailleurs la première fois qu'un livre met autant de temps à me parvenir, pendant un moment j'ai cru qu'il s'était égaré.
Pour tout dire ce livre m'a quelque peu déçu, moi qui m'attendais à un livre coup de poing dénonçant la stupidité de l'homme de nos jours par rapport à son environnement qu'il ne respecte plus, j'ai eu droit à un livre trop scolaire à mon gout.
Il faut bien l'avouer le premier quart du livre est vaguement intéressant. J'ai d'ailleurs pu découvrir certaines choses. Mais après le vivre quitte son côté écolo pour s'intéresser à diverses choses tournant autour du feu. Pompiers jugés responsables, victimes dépressives, terroristes pyromanes. Je pense qu'il avait mieux à faire avec un telle ouvrage.
Il est clair que de nos jours les hommes courent à leur propre perte. Par exemple le fait de vouloir changé les habitudes rouler à l'électrique alors que toute production industriel de ce type pollue quoi qu'il arrive. Tout ce que l'homme arrivera à faire c'est ralentir les conséquences, mais rien n'empêchera la chute de notre environnement.
Sur cet aspect l'auteur aurait pu accentué ses arguments sur le réchauffement climatique et vers quoi l'homme expose ses forêt et son monde. Au lieu de cela on a droit à une sorte de thèse basé sur des recherches faites par d'autres. Donc pas une réelle approche du terrain à mon sens. Grand déception pour moi que ce livre trop timide et sans réelle envergure dans son approche.
Développement du livre : 3/10
Style de l'écriture : 7/10
Rendu des propos : 3/10
Total 21/40 Babelio 2,5/5
D'abord merci à Babelio pour m'avoir tiré au sort pour ce livre. C'est d'ailleurs la première fois qu'un livre met autant de temps à me parvenir, pendant un moment j'ai cru qu'il s'était égaré.
Pour tout dire ce livre m'a quelque peu déçu, moi qui m'attendais à un livre coup de poing dénonçant la stupidité de l'homme de nos jours par rapport à son environnement qu'il ne respecte plus, j'ai eu droit à un livre trop scolaire à mon gout.
Il faut bien l'avouer le premier quart du livre est vaguement intéressant. J'ai d'ailleurs pu découvrir certaines choses. Mais après le vivre quitte son côté écolo pour s'intéresser à diverses choses tournant autour du feu. Pompiers jugés responsables, victimes dépressives, terroristes pyromanes. Je pense qu'il avait mieux à faire avec un telle ouvrage.
Il est clair que de nos jours les hommes courent à leur propre perte. Par exemple le fait de vouloir changé les habitudes rouler à l'électrique alors que toute production industriel de ce type pollue quoi qu'il arrive. Tout ce que l'homme arrivera à faire c'est ralentir les conséquences, mais rien n'empêchera la chute de notre environnement.
Sur cet aspect l'auteur aurait pu accentué ses arguments sur le réchauffement climatique et vers quoi l'homme expose ses forêt et son monde. Au lieu de cela on a droit à une sorte de thèse basé sur des recherches faites par d'autres. Donc pas une réelle approche du terrain à mon sens. Grand déception pour moi que ce livre trop timide et sans réelle envergure dans son approche.
Ce livre est éclairant sur la question des incendies qui se déclarent à travers le monde et plus particulièrement sur ce que l'on appelle les « mégafeux ». Des incendies dévastateurs que l'on peut difficilement circonscrirent et qui détruisent tout sur leurs passages. Joëlle Zask, enseignante en philosophie, est passionnante dans cet essai et convoque plusieurs disciplines pour questionner ce phénomène. L'autrice nous montre ce que le phénomène nous donne à voir de nos sociétés, sans jamais tomber dans le dogmatisme. Elle ne valorise pas plus un point de vue où les écologistes souhaiteraient laisser faire la nature (et donc les incendies) par rapport à un autre point de vue où les autorités souhaiteraient lutter à tout prix contre toutes formes d'incendies (vous verrez que ce n'est pas non plus si malin).
Il existe tout au long du livre un questionnement sous-jacent qui concerne l'écologie dans un sens plus général. le rapport de l'homme à la nature, aux forêts, aux paysages environnants. C'est riche et l'on ressort de cette lecture avec l'envie d'approfondir des passages.
Lien : https://lesmafieuses.wordpre..
Il existe tout au long du livre un questionnement sous-jacent qui concerne l'écologie dans un sens plus général. le rapport de l'homme à la nature, aux forêts, aux paysages environnants. C'est riche et l'on ressort de cette lecture avec l'envie d'approfondir des passages.
Lien : https://lesmafieuses.wordpre..
Citations et extraits (16)
Voir plus
Ajouter une citation
D'une manière générale, des simulations informatiques laissent penser que les feux peuvent engendrer en quelques mois plus de CO2 que les voitures de la même région. Les forêts boréales en feu en produisent plus qu'elles ne parviennent à en absorber. En s'asséchant sous l'effet combiné de l'exploitation forestière, du réchauffement climatique et des périodes de sécheresse, les tourbières, qui brûlent à raison de milliers d'hectares en Russie ou dans les forêts de Sumatra ou de Bornéo, émettent des quantités considérables de gaz à effet de serre. Dans les zones froides comme l'Alaska ou la Sibérie, le carbone et le méthane qui étaient emprisonnés dans le permafrost sont massivement libérés dans l'atmosphère. Autre désastre, la suie emportée par la mer jusqu'au Groenland absorbe la chaleur du soleil et contribue ainsi à la fonte des glaces. À quoi s'ajoute, analyse Struzik, le fait que les feux brassent les restes des activités minières (arsenic, uranium, amiante), les font remonter à la surface et les dispersent, y compris bien sûr dans les villes éloignées où personne ne se rend compte du danger.
p.73
p.73
Le fait de choisir la localisation des habitations de manière à les protéger des passages des feux existent pourtant depuis des temps immémoriaux. Par exemple, en Mésopotamie et dans les régions moyen-orientales, les villages antiques étaient construits de telle sorte que les habitants, leurs cultures et leurs maisons restaient à l'abri des flammes. Les constructions, groupées au milieu d'un espace aménagé selon un plan concentrique, étaient protégées des feux par plusieurs remparts. La première zone qui ceinturait le village était formée des jardins potagers et d'ornement, la deuxième des zones agricoles et la troisième des zones pâturées communes, qui étaient régulièrement débroussaillées grâce aux brûlis et aux bêtes qui y paissaient. Au-delà s'étendait la forêt que les villageois soumettaient à un aménagement perpétuel en s'y approvisionnant, par exemple, en bois de chauffe, en tourbe ou en glands pour l'alimentation des cochons. Puis arrivait enfin la forêt sauvage. Les risques étaient donc traditionnellement identifiées et la prévention, assurée.
En outre se met en place un cercle vicieux : les grands feux détruisent des millions d'arbres, qui sont les poumons de la planète, tout en relâchant des tonnes de CO2 qu'ils ont stockées. Ils contribuent donc au réchauffement climatique, qui lui-même favorise leur déclenchement. Leur augmentation en fréquence et en intensité est donc une perspective réellement redoutable. Selon la NASA, ils seraient responsables de 30% des émissions de dioxyde de carbone mondiales. En septembre et octobre 2015, les mégafeux dans les forêts tropicales d'Indonésie, dont des dizaines de milliers ont été déclenchés volontairement par des producteurs d'huile de palme et de pâte à papier, ont généré chaque jour plus de gaz à effet de serre que l'ensemble de l'activité américaine annuelle et provoqué la mort prématurée d'environ 100 000 personnes.
p.72
p.72
La neige fond plus tôt, les températures sont plus douces, ce qui favorise la prolifération d'insectes ravageurs qui détruisent et fragilisent les arbres et donc augmente la masse de matière sèche hautement inflammable. À l'heure actuelle, la Californie compte plus de 100 millions d'arbres morts sous l'effet de plusieurs années de sècheresse et d'infestations d'insectes, en particulier de dendroctrones du pin qui sont particulièrement nuisibles. Ces arbres, comparés à des "allumettes géantes" ou à des "fantômes", n'ont aucune valeur pour les entreprises forestières et les scieries. Ils sont trop nombreux pour qu'il soit possible de les dégager. Quant au budget qui serait nécessaire pour remettre la forêt en état de recevoir des feux écologiquement utiles, il est abyssal.
Bien que la plupart d'entre nous restent inconscients des dangers auxquels expose le phénomène planétaire des mégafeux, l'idée que ces derniers sont d'origine humaine a fait progressivement son chemin. En dépit des arguments contradictoires avancés respectivement par les climatosceptiques et certains écologistes intégristes, le lien entre l'altération du climat et le développement de feux hors normes est de mieux en mieux identifié.
Videos de Joëlle Zask (7)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Joëlle Zask (15)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'écologiste mystère
Quel mot concerne à la fois le métro, le papier, les arbres et les galères ?
voile
branche
rame
bois
11 questions
266 lecteurs ont répondu
Thèmes :
écologie
, developpement durable
, Consommation durable
, protection de la nature
, protection animale
, protection de l'environnement
, pédagogie
, mers et océansCréer un quiz sur ce livre266 lecteurs ont répondu