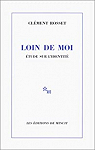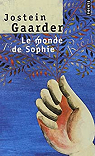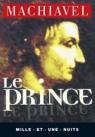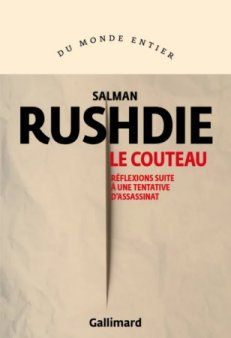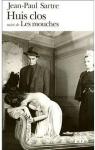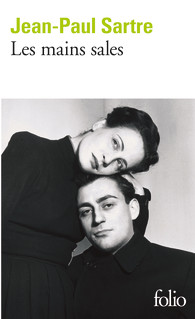Jean-Paul Sartre
Sylvie Le Bon de Beauvoir (Éditeur scientifique)/5 8 notes
Sylvie Le Bon de Beauvoir (Éditeur scientifique)/5 8 notes
Résumé :
"...entre la conscience et le psychique il établissait
une distinction qu'il devait toujours maintenir ; alors que la conscience est une immédiate et évidente
présence à soi, le psychique est un ensemble
d'objets qui ne se saisissent que par une opération réflexive et qui, comme les objets de la perception,
ne se donnent que par profils [...] il y a une autonomie de la conscience irréfléchie; le rapport
au Moi, selon La... >Voir plus
une distinction qu'il devait toujours maintenir ; alors que la conscience est une immédiate et évidente
présence à soi, le psychique est un ensemble
d'objets qui ne se saisissent que par une opération réflexive et qui, comme les objets de la perception,
ne se donnent que par profils [...] il y a une autonomie de la conscience irréfléchie; le rapport
au Moi, selon La... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La Transcendance de l'égoVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
« Nous voudrions montrer que l'Ego n'est ni formellement ni matériellement dans la conscience ; il est dehors dans le monde ; c'est un être du monde, comme l'Ego d'autrui. »
« J'étais absorbé tout à l'heure dans ma lecture…Tandis que je lisais, il y avait conscience du livre, des héros du roman, mais le Je n'habitais pas cette conscience... ».
Cette affirmation qu'on peut juger incertaine, Sartre la complète par des considérations théoriques, faisant intervenir plusieurs degrés de conscience : une conscience irréfléchie d'où le « Je » est absent, et un deuxième degré réfléchi où naît le « Je » dans le « Je pense ».
Ce qui fait dire à Sartre : « la conscience qui dit « Je pense » n'est précisément pas celle qui pense. ».
Il parle alors d'une conscience réfléchie et d'une conscience réfléchissante, conscience d'elle-même, non-positionnelle, non-thétique. C'est le genre de vocabulaire technique et de difficultés qu'on retrouve dans l'Etre et le Néant. Certes, il ne manque pas d'illustrations tirées d'expériences concrètes, mais elles sont traitées d'une manière phénoménologique qui exige une certaine discipline, en quête de pureté.
Ce livre revient à la source de cette discipline avec Husserl, en examinant le moment où, précisément, ce dernier semble renoncer à l'objectif initial, dans un tournant dit « subjectiviste ».
La phénoménologie invite à clarifier son « attitude naturelle », or ce « Je » qui se manifeste comme la source de la conscience, apparaît voilé, « mal distinct à travers la conscience comme un caillou au fond de l'eau ». En regardant cette chaise où je suis assis, je devrais dire de façon impersonnelle, « il y a conscience de cette chaise », rien de plus.
De même, face à Pierre-devant-être-secouru, il y a une conscience qui n'a pas besoin d'un « d'amour propre » dissimulé, pour s'engager à secourir Pierre. Mais je peux toujours croire que derrière l'action de le secourir, il n'y a que le désir inconscient de faire cesser l'état désagréable où m'a mis la vue de ces souffrances.
Sartre maintient que « l'état apparaît à la conscience réflexive » et que cette action se place sur un plan réfléchi comme toute action égoïste, alors que sur un plan irréfléchi se place la vie impersonnelle.
Si maintenant je suis dans un état de haine envers Pierre, je l'éprouve réellement et je le manifeste à l'occasion. Mais il peut alors m'arriver de penser après coup, que j'étais juste sous le coup de la colère. Dans ces moments-là, il n'est pas douteux que j'éprouve un sentiment de répulsion, mais comme émanant par magie de l'état inerte de haine.
De la sorte, en tous les cas, je n'engagerai pas l'avenir, « mais précisément par ce refus d'engager l'avenir, je cesserai de haïr. »
“Moi, j'ai pu faire ça !”, “Moi, je puis haïr mon père !”
L'état de haine procède d'une spontanéité inintelligible. C'est une production poétique de l'Ego, à ne pas confondre avec la liberté. En effet, si on se souvient que les consciences sont premières, l'Ego se présente comme un objet passif constitué comme la synthèse des états et des actions constitués eux-mêmes à travers les consciences.
De là, cette irrationalité profonde, cette pseudo-spontanéité qui n'est qu'une projection de la conscience. Sartre veut entraîner le lecteur à distinguer l'Ego, comme synthèse du psychique, de la conscience qui le constitue. « Nous sommes des sorciers pour nous-mêmes chaque fois que nous considérons notre Moi ».
On retrouve les thèmes récurrents de ce livre : la spontanéité pure est impersonnelle. L'Ego est opaque à la conscience.
La liberté, dans ce livre, n'est pas celle que Bergson trouve dans son « essai sur les données immédiates de la conscience ». L'opacité de l'Ego saisie comme indistinction, comme « l'intériorité vue du dehors », « c'est ce qu'on trouve chez le Dieu de nombreux mystiques ». Bergson est encore visé, et à travers cette critique, c'est l'athéisme de Sartre qui tranche précisément.
Après plusieurs tentatives pour aborder L'Etre et le Néant, j'ai trouvé ce livre antérieur, qui reste difficile, mais qui donne une nouvelle chance pour tenter de suivre la pensée de Sartre. le thème passionnant de la mauvaise foi, qu'il étudiera, trouve ici quelques racines.
« le Champ transcendantal, purifié de toute structure égologique, recouvre sa limpidité première. En un sens c'est un rien puisque tous les objets physiques, psycho-physiques et psychiques, toutes les vérités, toutes les valeurs sont hors de lui, puisque mon Moi a cessé, lui-même d'en faire partie. Mais ce rien est tout puisqu'il est conscience de tous ces objets ».
Ce qui m'intéresse dans les bons livres, c'est d'aborder par surprise des situations concrètes, familières ou singulières. Ce livre très court et très dense ouvre des horizons. Je terminerai donc ce commentaire, par une situation singulière d'abord décrite par Janet dans son livre « Les névroses », où Sartre trouve l'illustration d'une liberté vertigineuse. Il est particulièrement piquant de tenter de rapporter ce sens de la liberté à une autre citation célèbre : « Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande ».
« Une jeune mariée avait la terreur, quand son mari la laissait seule, de se mettre à la fenêtre et d'interpeller les passants à la façon des prostituées. Rien dans son éducation, dans son passé, ni dans son caractère ne peut servir d'explication à une crainte semblable. Il nous parait simplement qu'une circonstance sans importance (lecture, conversation, etc.) avait déterminé chez elle ce qu'on pourrait appeler un vertige de la possibilité. Elle se trouvait monstrueusement libre et cette liberté vertigineuse lui paraissait à l'occasion de ce geste qu'elle avait peur de faire. Mais ce vertige n'est compréhensible que si la conscience s'apparait soudain à elle-même comme débordant infiniment dans ses possibilités le « Je » qui lui sert d'unité à l'ordinaire. »
« J'étais absorbé tout à l'heure dans ma lecture…Tandis que je lisais, il y avait conscience du livre, des héros du roman, mais le Je n'habitais pas cette conscience... ».
Cette affirmation qu'on peut juger incertaine, Sartre la complète par des considérations théoriques, faisant intervenir plusieurs degrés de conscience : une conscience irréfléchie d'où le « Je » est absent, et un deuxième degré réfléchi où naît le « Je » dans le « Je pense ».
Ce qui fait dire à Sartre : « la conscience qui dit « Je pense » n'est précisément pas celle qui pense. ».
Il parle alors d'une conscience réfléchie et d'une conscience réfléchissante, conscience d'elle-même, non-positionnelle, non-thétique. C'est le genre de vocabulaire technique et de difficultés qu'on retrouve dans l'Etre et le Néant. Certes, il ne manque pas d'illustrations tirées d'expériences concrètes, mais elles sont traitées d'une manière phénoménologique qui exige une certaine discipline, en quête de pureté.
Ce livre revient à la source de cette discipline avec Husserl, en examinant le moment où, précisément, ce dernier semble renoncer à l'objectif initial, dans un tournant dit « subjectiviste ».
La phénoménologie invite à clarifier son « attitude naturelle », or ce « Je » qui se manifeste comme la source de la conscience, apparaît voilé, « mal distinct à travers la conscience comme un caillou au fond de l'eau ». En regardant cette chaise où je suis assis, je devrais dire de façon impersonnelle, « il y a conscience de cette chaise », rien de plus.
De même, face à Pierre-devant-être-secouru, il y a une conscience qui n'a pas besoin d'un « d'amour propre » dissimulé, pour s'engager à secourir Pierre. Mais je peux toujours croire que derrière l'action de le secourir, il n'y a que le désir inconscient de faire cesser l'état désagréable où m'a mis la vue de ces souffrances.
Sartre maintient que « l'état apparaît à la conscience réflexive » et que cette action se place sur un plan réfléchi comme toute action égoïste, alors que sur un plan irréfléchi se place la vie impersonnelle.
Si maintenant je suis dans un état de haine envers Pierre, je l'éprouve réellement et je le manifeste à l'occasion. Mais il peut alors m'arriver de penser après coup, que j'étais juste sous le coup de la colère. Dans ces moments-là, il n'est pas douteux que j'éprouve un sentiment de répulsion, mais comme émanant par magie de l'état inerte de haine.
De la sorte, en tous les cas, je n'engagerai pas l'avenir, « mais précisément par ce refus d'engager l'avenir, je cesserai de haïr. »
“Moi, j'ai pu faire ça !”, “Moi, je puis haïr mon père !”
L'état de haine procède d'une spontanéité inintelligible. C'est une production poétique de l'Ego, à ne pas confondre avec la liberté. En effet, si on se souvient que les consciences sont premières, l'Ego se présente comme un objet passif constitué comme la synthèse des états et des actions constitués eux-mêmes à travers les consciences.
De là, cette irrationalité profonde, cette pseudo-spontanéité qui n'est qu'une projection de la conscience. Sartre veut entraîner le lecteur à distinguer l'Ego, comme synthèse du psychique, de la conscience qui le constitue. « Nous sommes des sorciers pour nous-mêmes chaque fois que nous considérons notre Moi ».
On retrouve les thèmes récurrents de ce livre : la spontanéité pure est impersonnelle. L'Ego est opaque à la conscience.
La liberté, dans ce livre, n'est pas celle que Bergson trouve dans son « essai sur les données immédiates de la conscience ». L'opacité de l'Ego saisie comme indistinction, comme « l'intériorité vue du dehors », « c'est ce qu'on trouve chez le Dieu de nombreux mystiques ». Bergson est encore visé, et à travers cette critique, c'est l'athéisme de Sartre qui tranche précisément.
Après plusieurs tentatives pour aborder L'Etre et le Néant, j'ai trouvé ce livre antérieur, qui reste difficile, mais qui donne une nouvelle chance pour tenter de suivre la pensée de Sartre. le thème passionnant de la mauvaise foi, qu'il étudiera, trouve ici quelques racines.
« le Champ transcendantal, purifié de toute structure égologique, recouvre sa limpidité première. En un sens c'est un rien puisque tous les objets physiques, psycho-physiques et psychiques, toutes les vérités, toutes les valeurs sont hors de lui, puisque mon Moi a cessé, lui-même d'en faire partie. Mais ce rien est tout puisqu'il est conscience de tous ces objets ».
Ce qui m'intéresse dans les bons livres, c'est d'aborder par surprise des situations concrètes, familières ou singulières. Ce livre très court et très dense ouvre des horizons. Je terminerai donc ce commentaire, par une situation singulière d'abord décrite par Janet dans son livre « Les névroses », où Sartre trouve l'illustration d'une liberté vertigineuse. Il est particulièrement piquant de tenter de rapporter ce sens de la liberté à une autre citation célèbre : « Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande ».
« Une jeune mariée avait la terreur, quand son mari la laissait seule, de se mettre à la fenêtre et d'interpeller les passants à la façon des prostituées. Rien dans son éducation, dans son passé, ni dans son caractère ne peut servir d'explication à une crainte semblable. Il nous parait simplement qu'une circonstance sans importance (lecture, conversation, etc.) avait déterminé chez elle ce qu'on pourrait appeler un vertige de la possibilité. Elle se trouvait monstrueusement libre et cette liberté vertigineuse lui paraissait à l'occasion de ce geste qu'elle avait peur de faire. Mais ce vertige n'est compréhensible que si la conscience s'apparait soudain à elle-même comme débordant infiniment dans ses possibilités le « Je » qui lui sert d'unité à l'ordinaire. »
Le commentaire introductif de Vincent de Coorebyter est particulièrement riche et véridique. Cependant, la rupture entre le premier et le second Sartre me semble légèrement exagérée. On note que les noeuds de la réflexion sartrienne sont bien saisis.
L'article « Une idée fondamentale de la phénoménologie » paraît davantage comme idéologique que comme philosophique, et est très littéraire. La formule de « philosophie alimentaire » a au moins le mérite d'être parlante, mais il n'y a pas d'argumentation.
La Transcendance de l'Ego reste le texte le plus complet. Il insiste sur la distinction entre la conscience réflexive et le Je : ce dernier n'est pas la conscience réflexive, il s'en distingue ou s'en sépare nécessairement (de telle sorte qu'il n'y a pas, contrairement à ce pensent les kantiens et même Husserl, de Je transcendantal, seule la conscience réflexive – absolue en tant que telle – est transcendantale – le Je est transcendant au sens phénoménologique du terme), puisque le Je se prend comme objet-pour-la-conscience, en tant qu'il est au-monde. L'influence heidegerienne est présente, mais n'est cependant pas à exagérer, un tel texte étant assez idiosyncratique.
« Conscience de soi et connaissance de soi » ne change pas autant la doctrine sartrienne. La principale différence réside dans la doctrine de la spontanéité, puisque le cogito est cette fois-ci perçu dans son rôle temporel.
Globalement, malgré les retournements idéologiques de Sartre, on aperçoit, dès la Transcendance, une doctrine de l'objectivation de l'Ego par ma propre conscience, le triptyque pour-soi, pour-autrui, en-soi. On aperçoit surtout, et par là-même, une doctrine de la liberté, doctrine inextricable, chez Sarte, de la distanciation à soi, sorte « d'angoisse » et de « dépersonnalisation » en version sartrienne.
L'article « Une idée fondamentale de la phénoménologie » paraît davantage comme idéologique que comme philosophique, et est très littéraire. La formule de « philosophie alimentaire » a au moins le mérite d'être parlante, mais il n'y a pas d'argumentation.
La Transcendance de l'Ego reste le texte le plus complet. Il insiste sur la distinction entre la conscience réflexive et le Je : ce dernier n'est pas la conscience réflexive, il s'en distingue ou s'en sépare nécessairement (de telle sorte qu'il n'y a pas, contrairement à ce pensent les kantiens et même Husserl, de Je transcendantal, seule la conscience réflexive – absolue en tant que telle – est transcendantale – le Je est transcendant au sens phénoménologique du terme), puisque le Je se prend comme objet-pour-la-conscience, en tant qu'il est au-monde. L'influence heidegerienne est présente, mais n'est cependant pas à exagérer, un tel texte étant assez idiosyncratique.
« Conscience de soi et connaissance de soi » ne change pas autant la doctrine sartrienne. La principale différence réside dans la doctrine de la spontanéité, puisque le cogito est cette fois-ci perçu dans son rôle temporel.
Globalement, malgré les retournements idéologiques de Sartre, on aperçoit, dès la Transcendance, une doctrine de l'objectivation de l'Ego par ma propre conscience, le triptyque pour-soi, pour-autrui, en-soi. On aperçoit surtout, et par là-même, une doctrine de la liberté, doctrine inextricable, chez Sarte, de la distanciation à soi, sorte « d'angoisse » et de « dépersonnalisation » en version sartrienne.
Citations et extraits (4)
Ajouter une citation
L’Ego n’est ni formellement ni matériellement dans la conscience : il est dehors, dans le monde, c’est un être du monde, comme l’Ego d’autrui.
p93
p93
Nous sommes des sorciers pour nous-mêmes chaque fois que nous considérons notre Moi.
Nous sommes persuadés, comme lui [Husserl], que notre moi psychique et psycho-physique est un objet transcendant.
p96
p96
Le Je transcendantal, c’est la mort de la conscience.
p98
p98
Videos de Jean-Paul Sartre (209)
Voir plusAjouter une vidéo
S'agissant par exemple du marxisme, de l'existentialisme, du bouddhisme, du nominalisme, de l'immanentisme, du keynésianisme, du personnalisme ou autres, il ne viendrait à l'esprit de personne de se demander si, pour adhérer à ces doctrines, ces conceptions du monde ou ces écoles de pensée, il faut être une femme ou un homme (même si, dans la plupart des cas, elles ont été forgées par des hommes !). Il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit du féminisme : une « femme féministe » ressemble à un pléonasme, un « homme féministe » à un oxymore. Pourquoi ? Peut-être parce que le marxisme ne tient pas à ce qu'était Karl Marx ni à qui il était, pas plus que le keynésianisme ne s'explique par ce qu'était John Maynard Keynes, alors que le féminisme, tout en étant une philosophie, une conception du monde, une pratique, une gamme de mouvements sociaux et politiques, est ancré dans le « devenir-femme », élaboré depuis la subordination et les systèmes d'exploitation politique, économique, sociale, sexuel, familial dans lesquels les hommes, façonnés, eux, par le système patriarcal, ont enfermé les femmes. Autrement dit, les femmes sont les sujets du féminisme, les protagonistes qui l'ont initié, formulé, partagé, diffusé et transformé en force des femmes, alors que les hommes sont les objets de l'analyse, les agents et les hérauts de la structure qu'il faut modifier et faire tomber, les représentants et les vecteurs des modalités patriarcales. Certainement, Simone de Beauvoir eût pu écrire l'Être et le néant, mais à Jean-Paul Sartre il aurait été impossible d'écrire le Deuxième sexe, et si, par son ingéniosité, il avait quand même réussi à le faire, l'ouvrage serait resté un « point de vue » sur les femmes, et jamais devenu la matrice et la puissance du féminisme moderne. Est-ce à dire que les hommes, quand ils ne s'accrochent pas au vieux virilisme comme à une bouée, sont condamnés à demeurer des « compagnons de route » du féminisme et qu'ils partagent, collaborent, participent aux luttes des femmes ? Probablement pas. À ceci près que le féminisme exige peut-être cette « écriture féminine » dont parlait Hélène Cixous, qui exalte ce qui a été ignoré et méprisé par le discours des hommes, crée sans cesse des structures syntaxiques et stylistiques nouvelles irréductibles aux codifications fixées par les hommes, et qui s'avère capable de refuser et réfuter la logique de l'« écriture masculine », fondée, elle, sur ces oppositions (homme/femme, père/mère, actif/passif, culture/nature, coeur/raison…) qui ont nourri la pensée occidentale et, par là même, conforté le patriarcat. Dans ce cas, on pourrait dire que l'« homme féministe » est celui qui se révélerait apte à assurer, assumer et faire sienne une telle « écriture féminine ».
+ Lire la suite
autres livres classés : philosophieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean-Paul Sartre (104)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'oeuvre littéraire et théâtrale de Jean-Paul Sartre
Dans Huis Clos, l'enfer c'est...
Les oeufs
Les autres
La guerre
Les voisins
8 questions
351 lecteurs ont répondu
Thème :
Jean-Paul SartreCréer un quiz sur ce livre351 lecteurs ont répondu