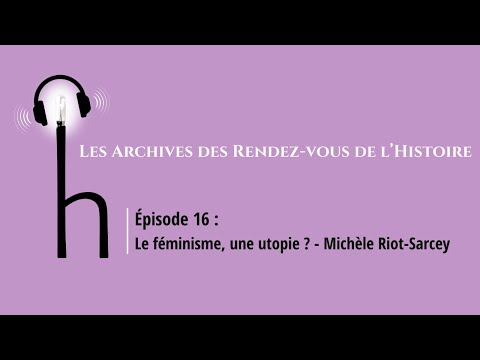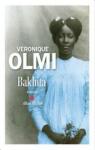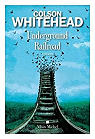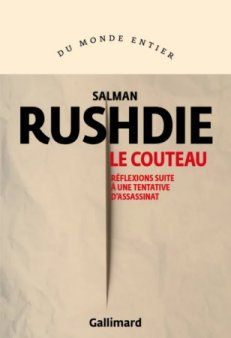Michèle Riot-Sarcey restitue l'histoire du féminisme entendu comme utopie politique et décrit la mise à l'écart des femmes vis-à-vis du pouvoir, de la Révolution française jusqu'au XXème siècle, à travers le développement de discours différentialistes et l'établissement de lois excluantes.
Retrouvez l'épisode sur toutes les plateformes de podcast : https://urlz.fr/pOOw
Conférence issue de l'édition 2000 des Rendez-vous de l'histoire sur le thème "Les utopies, moteurs de l'histoire ?".
© Michèle Riot-Sarcey, 2000.
Voix du générique : Michel Hagnerelle (2006), Michaelle Jean (2016), Michelle Perrot (2002)
https://rdv-histoire.com/

Michèle Riot-Sarcey/5
1 notes
Résumé :
Une catastrophe, un penseur et quelques pages de récit et d’analyse à
hauteur d’homme, pour se remémorer l’impact de ces basculements inouïs et en nourrir notre rapport au monde, alors que nous nous sentons impuissants face à des drames dont nous sommes souvent les moteurs.
Livre pessimiste ? En apparence seulement. De la Catastrophe rassemble un concentré synthétique des événements inouïs qu’ont dû vivre et subir les contemporains, du mythe du... >Voir plus
hauteur d’homme, pour se remémorer l’impact de ces basculements inouïs et en nourrir notre rapport au monde, alors que nous nous sentons impuissants face à des drames dont nous sommes souvent les moteurs.
Livre pessimiste ? En apparence seulement. De la Catastrophe rassemble un concentré synthétique des événements inouïs qu’ont dû vivre et subir les contemporains, du mythe du... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après De la catastrophe : L'homme en question du Déluge à FukushimaVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
La part humaine dans des événements inouïs
Dans son introduction, Michèle Riot-Sarcey parle, entre autres, des fragments, des moments historiques restés en mémoire, « nous abordons ces événements d'exception, ou pensé tels, à travers le regard des hommes qui l'interprètent en termes de catastrophe », de la multiplicité des regards et des analyses caractérisant ce livre, de Walter Benjamin et de Günther Anders…
« Toujours, le point de vue des contemporains est toujours privilégié afin de restituer au mieux la réception d'une catastrophe en prenant en compte l'initiative et la responsabilité humaine – une responsabilité qui peut-être collective, mais qui souvent, particulièrement dans les temps contemporains, incombe à des hommes de pouvoir – économique ou politique. Il nous a semblé nécessaire de faire face à la réalité d'une déshumanisation qui menace la planète et les populations dont la lutte pour la survie peut désespérer le reste d'une humanité qui s'estimeimpuissante face à l'énormité des défis actuels ».
Sommaire :
Michèle Riot-Sarcey : Introduction
Pierre-Antoine Fabre : le Déluge
Michel Kaplan : 1204, la prise et le sac de Constantinople
Marilyn Nicoud : La Grande Peste de 1347
Gwladys le Cuff et Karen Dutrech : Signes apocalyptiques, Florence 1500 et Naples 1631
Alejandro Madrid Zan : La conquête de l'Amérique, utopie et catastrophe
Paola Giacomoni : Lisbonne, 1755, les philosophes et la catastrophe,
Djiguatte Amédé Bassène : Traite et esclavage en Sénégambie, le marché d'esclaves de Marsassoum
Ibrahima Thioub : Stigmates et mémoires de l'esclavage en Afrique de l'Ouest
Jay Winter : La Grande Guerre ou la révolution de la violence
Christophe David : La requalification du progrès en catastrophe
Eva Weil : Traces psychiques, mémoires cryptées et catastrophes historiques
Paul Guillibert : L'effondrement, la catastrophe et la rédemption, réflexion sur la crise écologique
Jean-Paul Deléage : Fukushima ou la banalisation de la catastrophe nucléaire
Michèle Riot-Sarcey : Conclusion
Je ne vais pas aborder l'ensemble des articles. Je choisis quelques uns des thèmes traités. La notion même de « catastrophe » souligne la charge politique du regard et de la réflexion.
La prise et la mise sac de la plus importante ville de la chrétienté par des soldats chrétiens, 1204, Constantinople. Michel Kaplan revient sur la richesse de cette ville, son rôle, la place des vénitiens, les croisades… Constantinople prise et mise à sac par les croisés, une catastrophe matérielle et humaine pour les Byzantin·es, une transformation géopolitique (l'extension d'un nouvel empire, celui des Turcs ottomans), une catastrophe à l'échelle de la chrétienté (« les soldats du Christ prennent et pillent la plus grande ville de la chrétienté, y violent et massacres leurs soeurset leurs frères »). La chrétienté certes, mais comme le souligne l'auteur, cette catastrophe « est le fruit d'une logique économique implacable, celle de l'expansion de l'Occident et tout particulièrement de Venise » et le rôle de la religion dans le déclenchement de cette catastrophe est « infime, sinon nulle »…
Marylin Nicod aborde le milieu du XIVe siècle en Europe, la peste, la mort de plus d'un tiers de la population, un événement et « sa construction sociale et culturelle », les grilles de lecture, la longue conjoncture de crises, la recherche d'explications rationnelles, les discours médicaux et les réflexions sur la maladie (le bacille ne fut identifié qu'à la fin du XIXème siècle)…
Alejandro Madrid Zan analyse la conquête de l'Amérique, les rapports entre utopie et catastrophe ou entre rencontre et génocide (pour utiliser un terme actuel), les (non)-lieux d'énonciation, la domination en acte et l'invention d'un nouveau « discours de vérité », ce qui se cache derrière le terme « nouveau monde », l'espace abstrait de la mondialisation et les formes de déterritorialisation, la dénégation de la totale humanité à certain·es êtres humains, la singularité… « Repenser la colonialité dans ses effets ante- et postcoloniaux, permettrait de penser autrement l'histoire des vaincus, qui fut inaugurée par une des grandes catastrophes du monde – celle de la conquête dudit Nouveau Monde ».
Paola Giacomoni discute des philosophes et de la catastrophe, de la désintégration d'un élément porteur de sens, de désagrégation du monde, du tremblement de terre à Lisbonne en 1755, de caractères discontinus et irréversibles, du meilleur des mondes espéré, de regard universel et cosmopolite, du désordre, de scepticisme, « La catastrophe n'est pas un destin », du possible et non de l'inéluctable… « La catastrophe est avant tout un élément dynamique, transformateur, malgré sa dimension inquiétante de discontinuité destructive ».
Djiguatte Amédé Bassène revient sur la traite esclavagiste « une catastrophe globale » et plus particulièrement sur Marsassoum, « le rendez-vous des marchands du cheptel humain », la revivification et la portée à un stade jusque-là jamais atteint de la pratique servile par les puissances européennes et les autorités locales africaines… « La barbarie, l'horreur de la traite et de l'esclavage ont semé en Afrique, et notamment en Sénégambie, les germes du chaos, de la souffrance et du désordre, tant au niveau des communautés familiales, locales qu'au niveau politique des Etats, provoquant des expropriations, des famines et l'effondrement moral des populations touchées ». L'auteur souligne qu'un siècle plus tard, aujourd'hui, « l'idéologie de l'esclavage est toujours prégnante dans les sociétés sénégambiennes ».
Le travail de mémoire autour des catastrophes est politiquement important. Il reste insuffisant face aux inscriptions au présent des effets des catastrophes passées. Il convient d'interroger l'ensemble des constructions, des relations, des acteurs dans leur complexité.
J'ai particulièrement été intéressé par l'article d'Ibrahima Thioub sur les « Stigmates et mémoires de l'esclavage en Afrique de l'Ouest ». L'auteur souligne que l'esclavage n'est pas une simple privation de liberté, mais vise « intentionnellement à dépersonnaliser, désocialiser et déshumaniser la victime pour en faire d'abord une marchandise ». Une institution sociale, une construction d'une altérité identitaire radicale des victimes, une fabrication de marqueurs identitaires comme la couleur de la peau ou le sang. Il ajoute que les mémoires dominantes de la traite et de l'esclavage ont réussi à rendre inaudible les voix des victimes d'hier ainsi que celles de leurs descendant·es aujourd'hui, que les sociétés bénéficiaires des traites exportatrices africaines ont construit une « politique du silence ». L'auteur aborde, entre autres, les légitimations européennes de la colonisation, le mode de production esclavagiste, la prégnance contemporaine des pratiques esclavagistes dans « le monde arabe », la difficulté à étudier l'esclavage interne aux sociétés africaines, la persistance de l'esclavage actif ou passif dans beaucoup de sociétés africaines, la naturalisation des processus esclavagistes dans les écritures de l'histoire par les « vainqueurs » et le refus de penser l'historicité de ces processus. Il traite particulièrement de l'ambiguïté des politiques abolitionnistes de l'ère coloniale à l'Afrique contemporaine, de l'institution servile et des enjeux économiques, de l'« esclavage de case », des pratiques esclavagistes inscrites dans la durée, du déni de l'esclavage domestique, des régions où sévit l'esclavage actif, de la transmission « par voie d'hérédité biologique » du statut servile, de la « place » des descendant·es d'esclaves et de leur stigmatisation, de l'efficacité des bases idéologiques de l'esclavage, de la notion de « pureté de sang », du poids de la généalogie, des discours négationnistes, de la réduction de l'esclavage à la traite atlantique, des mutations induites par la domination coloniale, des trafics d'enfants, de la « production de mémoires victimaires ciblant les traites exportatrices qui ont servi à mettre un voile efficace sur les réalités contemporaines »…
La Grande Guerre. Comment ne pas interroger l'image persistante de l'Angelus Novus de Paul Klee, l'ange de l'histoire de Walter Benjamin. Jay Winter parle de la « révolution de la violence », la submersion des digues cantonnant l'exercice de la violence militaire, l'artillerie et les meurtres de masse, l'atteinte mortifère des populations civiles, « la fin de la distinction entre cibles militaires et cibles civiles », la guerre comme instrument de disparition, le front comme « lieu de tuerie, mais aussi de disparition », les effets de l'industrialisation de la violence, l'épidémie de « grippe espagnole », les millions de morts dans l'oubli, le vocabulaire nouveau de la criminalité d'Etat (je m'interroge toujours sur la glorification de ces généraux, criminels en chef, responsables des tueries, sans oublier les milliers de fusillés pour l'exemple et les bombardements de « leurs » propres lignes de front – de « leurs » tranchées » pour obliger les soldats à mourir), les déplacements massifs de population et la recherche de la « cinquième colonne » ou de l'ennemi intérieur (dont la version « turque » se traduisit par le génocide des populations arméniennes), la naissance de la guerre chimique, la boucherie humaine à Verdun. L'auteur analyse aussi les liens entre la guerre, la révolution et la violence, l'irruption des civil·es, le continuum entre guerre et guerre civile, les politiques d'anéantissement, la violence contre la révolution, les paroles des foules… Il termine sur les sites commémoratifs, les cimetières, les sites de bataille, les musées de la guerre, la sélectivité et la censure des musées mémoriaux, la non-neutralité de la mémoire construite par les institutions…
Pause, relire Walter Benjamin. Thèse IX
« Il existe un tableau de Klee qui s'intitule «Angelus Novus ». Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe de son regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'Ange de l'Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel.Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. »
Réfléchir sur le « progrès » et la catastrophe, l'horizon limité de chaque époque, les effets de la révolution industrielle, Hiroshima, « L'étranger ne peut rien voir à Hiroshima parce que, justement, il n'y a rien à voir à Hiroshima », ce qui lie les catastrophes entre elles, la destruction industrielle des populations juives en Europe et la destruction atomique de populations japonaises, les sites industriels capables de produire des cadavres par millions, « nous ne sommes pas aujourd'hui d'abord des êtres mortels », mais des êtres « tuables » » (Günther Anders).
Des mort·es et des survivant·es, des « descendant·es » de survivant·es des catastrophes, des individu·es et les dimensions collectives, les débats et les intrications des traces, le refoulement et les traumatismes, les générations amputées, les généalogies à trous, « ressaisir la place de l'Histoire dans sa filiation brisée pour les survivants et leurs descendants »…
La dépolitisation par la notion d'« effondrement », la survalorisation de choix techniques, les conceptions téléologiques de l'histoire, celles et ceux qui s'arrogent le droit de « juger des pratiques sociales » d'un point de vue non situé – comme hors de l'histoire, les nostalgies réactionnaires d'un passé, magnifié, la « nature » naturalisée et le refus de la dispute politique, la prégnance apocalyptique jusqu'au coeurde la sécularisation…
Jean-Paul Deléage revient sur Fukushima et la banalisation de la catastrophe nucléaire, les mensonges atomiques, la construction industrielle de la privatisation énergétique, les recours aux chaines de sous-traitance, les campagnes de désinformation, les migrations forcées de population, « nous sommes tenus à un travail de vérité car il en va de notre survie et de notre dignité d'êtres humains »…
En conclusion, Michèle Riot-Sarcey parle, entre autres, de l'actualité de la catastrophe, de l'insaisissable temps pourtant si proche des survivant·es des camps de la mort, de relectures du passé, de l'ère des techniques et du progrès pensés hors de la politique, de l'enfouissement de l'idée d'émancipation, des autres voies possibles, du retour du commun, « S'efforcer de retrouver le goût de la liberté de tous et de l'action critique publique, à condition toutefois de puiser dans les expériences en cours, dont le renouveau est riche d'un potentiel concret, la substance d'une élaboration théorique vers la construction d'un autre monde en devenir ».
Les catastrophes sont inscrites dans l'histoire, leurs effets sociaux peuvent être analysés, aussi inouïs paraissent-ils. La sidération ne saurait justifier le désarmement de la pensée. L'industrialisation de la guerre – la catastrophe écologique aussi – a bien quelque chose à voir avec l'accumulation du capital ; la notion de « pureté de sang » avec la biologisation des relations sociales ; les « dérèglements naturels » ou les « punitions divines » avec le refus de s'affronter aux constructions sociales et aux dominations. Reste aussi à interroger le « sexe » de la catastrophe ou, pour le dire autrement, sur ses effets genrés.
Lien : https://entreleslignesentrel..
Dans son introduction, Michèle Riot-Sarcey parle, entre autres, des fragments, des moments historiques restés en mémoire, « nous abordons ces événements d'exception, ou pensé tels, à travers le regard des hommes qui l'interprètent en termes de catastrophe », de la multiplicité des regards et des analyses caractérisant ce livre, de Walter Benjamin et de Günther Anders…
« Toujours, le point de vue des contemporains est toujours privilégié afin de restituer au mieux la réception d'une catastrophe en prenant en compte l'initiative et la responsabilité humaine – une responsabilité qui peut-être collective, mais qui souvent, particulièrement dans les temps contemporains, incombe à des hommes de pouvoir – économique ou politique. Il nous a semblé nécessaire de faire face à la réalité d'une déshumanisation qui menace la planète et les populations dont la lutte pour la survie peut désespérer le reste d'une humanité qui s'estimeimpuissante face à l'énormité des défis actuels ».
Sommaire :
Michèle Riot-Sarcey : Introduction
Pierre-Antoine Fabre : le Déluge
Michel Kaplan : 1204, la prise et le sac de Constantinople
Marilyn Nicoud : La Grande Peste de 1347
Gwladys le Cuff et Karen Dutrech : Signes apocalyptiques, Florence 1500 et Naples 1631
Alejandro Madrid Zan : La conquête de l'Amérique, utopie et catastrophe
Paola Giacomoni : Lisbonne, 1755, les philosophes et la catastrophe,
Djiguatte Amédé Bassène : Traite et esclavage en Sénégambie, le marché d'esclaves de Marsassoum
Ibrahima Thioub : Stigmates et mémoires de l'esclavage en Afrique de l'Ouest
Jay Winter : La Grande Guerre ou la révolution de la violence
Christophe David : La requalification du progrès en catastrophe
Eva Weil : Traces psychiques, mémoires cryptées et catastrophes historiques
Paul Guillibert : L'effondrement, la catastrophe et la rédemption, réflexion sur la crise écologique
Jean-Paul Deléage : Fukushima ou la banalisation de la catastrophe nucléaire
Michèle Riot-Sarcey : Conclusion
Je ne vais pas aborder l'ensemble des articles. Je choisis quelques uns des thèmes traités. La notion même de « catastrophe » souligne la charge politique du regard et de la réflexion.
La prise et la mise sac de la plus importante ville de la chrétienté par des soldats chrétiens, 1204, Constantinople. Michel Kaplan revient sur la richesse de cette ville, son rôle, la place des vénitiens, les croisades… Constantinople prise et mise à sac par les croisés, une catastrophe matérielle et humaine pour les Byzantin·es, une transformation géopolitique (l'extension d'un nouvel empire, celui des Turcs ottomans), une catastrophe à l'échelle de la chrétienté (« les soldats du Christ prennent et pillent la plus grande ville de la chrétienté, y violent et massacres leurs soeurset leurs frères »). La chrétienté certes, mais comme le souligne l'auteur, cette catastrophe « est le fruit d'une logique économique implacable, celle de l'expansion de l'Occident et tout particulièrement de Venise » et le rôle de la religion dans le déclenchement de cette catastrophe est « infime, sinon nulle »…
Marylin Nicod aborde le milieu du XIVe siècle en Europe, la peste, la mort de plus d'un tiers de la population, un événement et « sa construction sociale et culturelle », les grilles de lecture, la longue conjoncture de crises, la recherche d'explications rationnelles, les discours médicaux et les réflexions sur la maladie (le bacille ne fut identifié qu'à la fin du XIXème siècle)…
Alejandro Madrid Zan analyse la conquête de l'Amérique, les rapports entre utopie et catastrophe ou entre rencontre et génocide (pour utiliser un terme actuel), les (non)-lieux d'énonciation, la domination en acte et l'invention d'un nouveau « discours de vérité », ce qui se cache derrière le terme « nouveau monde », l'espace abstrait de la mondialisation et les formes de déterritorialisation, la dénégation de la totale humanité à certain·es êtres humains, la singularité… « Repenser la colonialité dans ses effets ante- et postcoloniaux, permettrait de penser autrement l'histoire des vaincus, qui fut inaugurée par une des grandes catastrophes du monde – celle de la conquête dudit Nouveau Monde ».
Paola Giacomoni discute des philosophes et de la catastrophe, de la désintégration d'un élément porteur de sens, de désagrégation du monde, du tremblement de terre à Lisbonne en 1755, de caractères discontinus et irréversibles, du meilleur des mondes espéré, de regard universel et cosmopolite, du désordre, de scepticisme, « La catastrophe n'est pas un destin », du possible et non de l'inéluctable… « La catastrophe est avant tout un élément dynamique, transformateur, malgré sa dimension inquiétante de discontinuité destructive ».
Djiguatte Amédé Bassène revient sur la traite esclavagiste « une catastrophe globale » et plus particulièrement sur Marsassoum, « le rendez-vous des marchands du cheptel humain », la revivification et la portée à un stade jusque-là jamais atteint de la pratique servile par les puissances européennes et les autorités locales africaines… « La barbarie, l'horreur de la traite et de l'esclavage ont semé en Afrique, et notamment en Sénégambie, les germes du chaos, de la souffrance et du désordre, tant au niveau des communautés familiales, locales qu'au niveau politique des Etats, provoquant des expropriations, des famines et l'effondrement moral des populations touchées ». L'auteur souligne qu'un siècle plus tard, aujourd'hui, « l'idéologie de l'esclavage est toujours prégnante dans les sociétés sénégambiennes ».
Le travail de mémoire autour des catastrophes est politiquement important. Il reste insuffisant face aux inscriptions au présent des effets des catastrophes passées. Il convient d'interroger l'ensemble des constructions, des relations, des acteurs dans leur complexité.
J'ai particulièrement été intéressé par l'article d'Ibrahima Thioub sur les « Stigmates et mémoires de l'esclavage en Afrique de l'Ouest ». L'auteur souligne que l'esclavage n'est pas une simple privation de liberté, mais vise « intentionnellement à dépersonnaliser, désocialiser et déshumaniser la victime pour en faire d'abord une marchandise ». Une institution sociale, une construction d'une altérité identitaire radicale des victimes, une fabrication de marqueurs identitaires comme la couleur de la peau ou le sang. Il ajoute que les mémoires dominantes de la traite et de l'esclavage ont réussi à rendre inaudible les voix des victimes d'hier ainsi que celles de leurs descendant·es aujourd'hui, que les sociétés bénéficiaires des traites exportatrices africaines ont construit une « politique du silence ». L'auteur aborde, entre autres, les légitimations européennes de la colonisation, le mode de production esclavagiste, la prégnance contemporaine des pratiques esclavagistes dans « le monde arabe », la difficulté à étudier l'esclavage interne aux sociétés africaines, la persistance de l'esclavage actif ou passif dans beaucoup de sociétés africaines, la naturalisation des processus esclavagistes dans les écritures de l'histoire par les « vainqueurs » et le refus de penser l'historicité de ces processus. Il traite particulièrement de l'ambiguïté des politiques abolitionnistes de l'ère coloniale à l'Afrique contemporaine, de l'institution servile et des enjeux économiques, de l'« esclavage de case », des pratiques esclavagistes inscrites dans la durée, du déni de l'esclavage domestique, des régions où sévit l'esclavage actif, de la transmission « par voie d'hérédité biologique » du statut servile, de la « place » des descendant·es d'esclaves et de leur stigmatisation, de l'efficacité des bases idéologiques de l'esclavage, de la notion de « pureté de sang », du poids de la généalogie, des discours négationnistes, de la réduction de l'esclavage à la traite atlantique, des mutations induites par la domination coloniale, des trafics d'enfants, de la « production de mémoires victimaires ciblant les traites exportatrices qui ont servi à mettre un voile efficace sur les réalités contemporaines »…
La Grande Guerre. Comment ne pas interroger l'image persistante de l'Angelus Novus de Paul Klee, l'ange de l'histoire de Walter Benjamin. Jay Winter parle de la « révolution de la violence », la submersion des digues cantonnant l'exercice de la violence militaire, l'artillerie et les meurtres de masse, l'atteinte mortifère des populations civiles, « la fin de la distinction entre cibles militaires et cibles civiles », la guerre comme instrument de disparition, le front comme « lieu de tuerie, mais aussi de disparition », les effets de l'industrialisation de la violence, l'épidémie de « grippe espagnole », les millions de morts dans l'oubli, le vocabulaire nouveau de la criminalité d'Etat (je m'interroge toujours sur la glorification de ces généraux, criminels en chef, responsables des tueries, sans oublier les milliers de fusillés pour l'exemple et les bombardements de « leurs » propres lignes de front – de « leurs » tranchées » pour obliger les soldats à mourir), les déplacements massifs de population et la recherche de la « cinquième colonne » ou de l'ennemi intérieur (dont la version « turque » se traduisit par le génocide des populations arméniennes), la naissance de la guerre chimique, la boucherie humaine à Verdun. L'auteur analyse aussi les liens entre la guerre, la révolution et la violence, l'irruption des civil·es, le continuum entre guerre et guerre civile, les politiques d'anéantissement, la violence contre la révolution, les paroles des foules… Il termine sur les sites commémoratifs, les cimetières, les sites de bataille, les musées de la guerre, la sélectivité et la censure des musées mémoriaux, la non-neutralité de la mémoire construite par les institutions…
Pause, relire Walter Benjamin. Thèse IX
« Il existe un tableau de Klee qui s'intitule «Angelus Novus ». Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe de son regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'Ange de l'Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel.Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. »
Réfléchir sur le « progrès » et la catastrophe, l'horizon limité de chaque époque, les effets de la révolution industrielle, Hiroshima, « L'étranger ne peut rien voir à Hiroshima parce que, justement, il n'y a rien à voir à Hiroshima », ce qui lie les catastrophes entre elles, la destruction industrielle des populations juives en Europe et la destruction atomique de populations japonaises, les sites industriels capables de produire des cadavres par millions, « nous ne sommes pas aujourd'hui d'abord des êtres mortels », mais des êtres « tuables » » (Günther Anders).
Des mort·es et des survivant·es, des « descendant·es » de survivant·es des catastrophes, des individu·es et les dimensions collectives, les débats et les intrications des traces, le refoulement et les traumatismes, les générations amputées, les généalogies à trous, « ressaisir la place de l'Histoire dans sa filiation brisée pour les survivants et leurs descendants »…
La dépolitisation par la notion d'« effondrement », la survalorisation de choix techniques, les conceptions téléologiques de l'histoire, celles et ceux qui s'arrogent le droit de « juger des pratiques sociales » d'un point de vue non situé – comme hors de l'histoire, les nostalgies réactionnaires d'un passé, magnifié, la « nature » naturalisée et le refus de la dispute politique, la prégnance apocalyptique jusqu'au coeurde la sécularisation…
Jean-Paul Deléage revient sur Fukushima et la banalisation de la catastrophe nucléaire, les mensonges atomiques, la construction industrielle de la privatisation énergétique, les recours aux chaines de sous-traitance, les campagnes de désinformation, les migrations forcées de population, « nous sommes tenus à un travail de vérité car il en va de notre survie et de notre dignité d'êtres humains »…
En conclusion, Michèle Riot-Sarcey parle, entre autres, de l'actualité de la catastrophe, de l'insaisissable temps pourtant si proche des survivant·es des camps de la mort, de relectures du passé, de l'ère des techniques et du progrès pensés hors de la politique, de l'enfouissement de l'idée d'émancipation, des autres voies possibles, du retour du commun, « S'efforcer de retrouver le goût de la liberté de tous et de l'action critique publique, à condition toutefois de puiser dans les expériences en cours, dont le renouveau est riche d'un potentiel concret, la substance d'une élaboration théorique vers la construction d'un autre monde en devenir ».
Les catastrophes sont inscrites dans l'histoire, leurs effets sociaux peuvent être analysés, aussi inouïs paraissent-ils. La sidération ne saurait justifier le désarmement de la pensée. L'industrialisation de la guerre – la catastrophe écologique aussi – a bien quelque chose à voir avec l'accumulation du capital ; la notion de « pureté de sang » avec la biologisation des relations sociales ; les « dérèglements naturels » ou les « punitions divines » avec le refus de s'affronter aux constructions sociales et aux dominations. Reste aussi à interroger le « sexe » de la catastrophe ou, pour le dire autrement, sur ses effets genrés.
Lien : https://entreleslignesentrel..
L'autrice a rassemblé chronologiquement les essais de différents historiens et philosophes au sujet des réactions humaines face aux catastrophes, que celles-ci soient provoquées (guerres) ou pas (séismes, épidémies).
Bien entendu, ces réflexions m'ont parues inégales de par leur compréhension par le grand public.
Bien entendu, ces réflexions m'ont parues inégales de par leur compréhension par le grand public.
Citations et extraits (7)
Voir plus
Ajouter une citation
Toujours, le point de vue des contemporains est toujours privilégié afin de restituer au mieux la réception d’une catastrophe en prenant en compte l’initiative et la responsabilité humaine – une responsabilité qui peut-être collective, mais qui souvent, particulièrement dans les temps contemporains, incombe à des hommes de pouvoir – économique ou politique. Il nous a semblé nécessaire de faire face à la réalité d’une déshumanisation qui menace la planète et les populations dont la lutte pour la survie peut désespérer le reste d’une humanité qui s’estimeimpuissante face à l’énormité des défis actuels
Repenser la colonialité dans ses effets ante- et postcoloniaux, permettrait de penser autrement l’histoire des vaincus, qui fut inaugurée par une des grandes catastrophes du monde – celle de la conquête dudit Nouveau Monde
La barbarie, l’horreur de la traite et de l’esclavage ont semé en Afrique, et notamment en Sénégambie, les germes du chaos, de la souffrance et du désordre, tant au niveau des communautés familiales, locales qu’au niveau politique des Etats, provoquant des expropriations, des famines et l’effondrement moral des populations touchées
S’efforcer de retrouver le goût de la liberté de tous et de l’action critique publique, à condition toutefois de puiser dans les expériences en cours, dont le renouveau est riche d’un potentiel concret, la substance d’une élaboration théorique vers la construction d’un autre monde en devenir
nous abordons ces événements d’exception, ou pensé tels, à travers le regard des hommes qui l’interprètent en termes de catastrophe
Videos de Michèle Riot-Sarcey (4)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Michèle Riot-Sarcey (9)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3260 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3260 lecteurs ont répondu