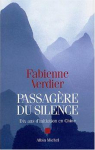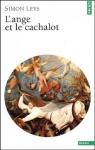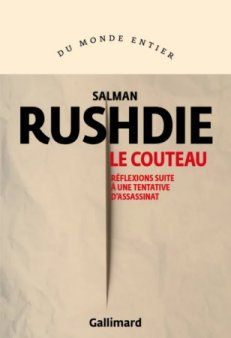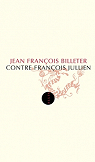Jean-François Billeter/5
5 notes
Ouvrage de référence sur la calligraphie chinoise, s'adressant aussi bien aux amoureux ou curieux de la culture chinoise qu'aux sinologues et historiens. Il fournit les bases pour comprendre l'écriture chinoise dans sa structure et dans ses formes et montre à quelles exigences formelles il faut répondre pour l'écrire lisiblement.
Dans cet ouvrage, l'auteur décrit de manière précise et la technique du pinceau et l'expérience de la calligraphie - art e... >Voir plus
Résumé :
Ouvrage de référence sur la calligraphie chinoise, s'adressant aussi bien aux amoureux ou curieux de la culture chinoise qu'aux sinologues et historiens. Il fournit les bases pour comprendre l'écriture chinoise dans sa structure et dans ses formes et montre à quelles exigences formelles il faut répondre pour l'écrire lisiblement.
Dans cet ouvrage, l'auteur décrit de manière précise et la technique du pinceau et l'expérience de la calligraphie - art e... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Essai sur l'art chinois de l'écriture et ses fondementsVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
Les éditions Allia m'ont habitué à de petits fascicules, courts textes élégamment imprimés sur un beau papier. L'"Essai sur l'art chinois de l'écriture et ses fondements" de Jean-François Billeter est un fort volume de quatre cents pages, qui fait le tour de la calligraphie et de l'écriture chinoises des origines à nos jours. Non seulement la masse d'informations contenues dans ce volume est grande, mais la réflexion de l'auteur rattache les oeuvres aux diverses époques de la civilisation chinoise et aux personnalités d'artistes. Jusque-là, il n'y a rien qui doive attirer un lecteur qui ne s'intéresse pas à la Chine, et ce livre ne semble être qu'un ouvrage spécialisé de plus. On ajoutera ceci : les analyses de Jean-François Billeter sur l'activité propre de l'artiste et sur l'amateur d'art qui contemple ou écoute ses oeuvres, ses pages sur le "corps propre" et sur la psychologie de la création, concernent tout art, musical, littéraire ou graphique, toutes les époques et tous les lieux. Cet essai n'est donc pas seulement un voyage intelligent en Chine, ce qui serait déjà beaucoup, mais aussi un enrichissement considérable proposé au lecteur qui aime l'art. Cela se sent à chaque page : d'abord on jette sur les illustrations de calligraphies reproduites un regard indifférent et vague, puis, à la lecture du commentaire qu'en fait l'auteur, les caractères chinois prennent vie, la page s'anime et l'on sent, si peu que ce soit, la magie calligraphique à l'oeuvre dans la reproduction. De même, dans les passages plus abstraits, l'auteur éveille l'esprit, donne à penser et à méditer, et nous aide à mettre en relation des impressions d'art ou des pensées éparses dans notre mémoire. C'est dire qu'il ne s'agit pas ici d'un page-turner ni d'un feel-good, comme on dit : ce livre nous invite à un dépassement de nous-même et à une aventure au-delà de nos limites personnelles. C'est exigeant, mais la joie que l'on éprouve à lire pareil ouvrage est intense, et invite à de nombreuses relectures. Livre admirable.
Si l'Ecriture chinoise de Viviane Alleton était d'abord facile, et permettait à tout lecteur de s'intéresser à l'écriture du pays du milieu, ici il s'agit d'autre chose ! Un traité très complet sur l'écriture chinoise, un essai qui vous guidera pour savoir dans quel esprit vous devez travailler l'écriture chinoise. Bien qu'il ne s'agit pas d''un cours de Calligraphie,, le spécialiste de la Chine François Billeter nous expose un essai très complet sur comment on doit appréhender l'écriture chinoise, pour comprendre les symboles (quelques pistes pour comprendre les différentes façons d'associés les caractères, l'utilisation des carrés pour apprendre à les tracer, comment rendre l'écriture fluide, par de petites imperfections qui en fait n'en sont pas, car elles sont voulues).
Régulièrement, nous avons des comparaisons entre Orient et Occident, car écrire des caractères bien individualisé, dont le sens est compris dans le symbole, ne demande pas du tout la même démarche que les lettres d'un alphabet, liées lorsque dans un même mot qui reposent sur une ligne imaginaire ou réelle. On retrouve un peu ce phénomène dans l'Alphabet tibétains qui, bien qu'alphabet, n'agence pas les mots non plus comme en occident même si le phénomène est beaucoup moins prononcé....
Il s'agit donc d'un livre pour comprendre l'écriture Chinoise dans ses moindres détails, à proscrire si l'on veux juste survoler le problème, mais tellement passionnant si l'on veux étudier le sujet en profondeur....
Régulièrement, nous avons des comparaisons entre Orient et Occident, car écrire des caractères bien individualisé, dont le sens est compris dans le symbole, ne demande pas du tout la même démarche que les lettres d'un alphabet, liées lorsque dans un même mot qui reposent sur une ligne imaginaire ou réelle. On retrouve un peu ce phénomène dans l'Alphabet tibétains qui, bien qu'alphabet, n'agence pas les mots non plus comme en occident même si le phénomène est beaucoup moins prononcé....
Il s'agit donc d'un livre pour comprendre l'écriture Chinoise dans ses moindres détails, à proscrire si l'on veux juste survoler le problème, mais tellement passionnant si l'on veux étudier le sujet en profondeur....
Citations et extraits (21)
Voir plus
Ajouter une citation
Les caractères chinois s'écrivent chacun selon un ordre des traits immuable. Apprendre à écrire un caractère, c'est apprendre à en tracer les éléments dans un ordre prescrit, qui découle d'un certain nombre de règles. Avec le temps, la main se fait à la séquence et l'exécute sans plus d'hésitation, la transformant en un geste unique. Un caractère appris est un geste disponible qui, comme tout geste, répond immédiatement à une intention et l'exprime.
Pour concevoir comment il est possible de retenir des centaines ou des milliers de caractères, il faut avoir compris que ce sont des gestes que l'on apprend plus que des images, que c'est à la mémoire motrice que l'on fait appel plus qu'à la mémoire visuelle. Or les ressources de la mémoire motrice sont plus riches que celles de la mémoire visuelle. Sa fiabilité est bien supérieure.
Cette supériorité s'explique. Notre mémoire travaille d'autant mieux que nous sommes plus engagés dans notre activité. Quand nous nous mettons tout entiers dans chaque geste, en écrivant, la mémoire retient les caractères sans qu'il faille la solliciter pour cela. Elle travaille moins bien dès que notre activité diminue, que notre corps se démobilise. Les pédagogues chinois ont toujours su qu'au commencement de l'écriture était le geste. Aussi les enfants chinois commencent-ils traditionnellement leur apprentissage en exécutant les caractères en l'air, à grands gestes et en cadence. Ils nomment un à un les éléments qu'ils tracent (une barre, une jambe, un point ...) et donnent à la fin la prononciation du caractère. Quand ce geste est appris vient l'exécution écrite, qui se fait d'abord en grand, en cadence et en choeur. Le souci de la forme, c'est-à-dire de la conformité avec un modèle, ne vient qu'après, lorsque le geste est devenu assez sûr pour ne plus requérir l'attention. Le passage à une exécution plus rapide et plus petite se fait ensuite de manière naturelle.
p. 111
Pour concevoir comment il est possible de retenir des centaines ou des milliers de caractères, il faut avoir compris que ce sont des gestes que l'on apprend plus que des images, que c'est à la mémoire motrice que l'on fait appel plus qu'à la mémoire visuelle. Or les ressources de la mémoire motrice sont plus riches que celles de la mémoire visuelle. Sa fiabilité est bien supérieure.
Cette supériorité s'explique. Notre mémoire travaille d'autant mieux que nous sommes plus engagés dans notre activité. Quand nous nous mettons tout entiers dans chaque geste, en écrivant, la mémoire retient les caractères sans qu'il faille la solliciter pour cela. Elle travaille moins bien dès que notre activité diminue, que notre corps se démobilise. Les pédagogues chinois ont toujours su qu'au commencement de l'écriture était le geste. Aussi les enfants chinois commencent-ils traditionnellement leur apprentissage en exécutant les caractères en l'air, à grands gestes et en cadence. Ils nomment un à un les éléments qu'ils tracent (une barre, une jambe, un point ...) et donnent à la fin la prononciation du caractère. Quand ce geste est appris vient l'exécution écrite, qui se fait d'abord en grand, en cadence et en choeur. Le souci de la forme, c'est-à-dire de la conformité avec un modèle, ne vient qu'après, lorsque le geste est devenu assez sûr pour ne plus requérir l'attention. Le passage à une exécution plus rapide et plus petite se fait ensuite de manière naturelle.
p. 111
Il importe aussi que l'encre ne soit ni trop épaisse, pour ne pas engourdir la pointe du pinceau, ni trop liquide, pour qu'elle ne s'écoule pas toute seule. Le calligraphe règle son degré de fluidité de telle sorte qu'elle ne diminue en rien la mobilité du pinceau et ne quitte cependant jamais le pinceau sans qu'il l'ait voulu. Jusque dans un passé récent, l'encre se présentait toujours sous la forme de bâtons faits de suie fine, recueillie après combustion de certaines essences de bois ou d'huiles végétales et mélangée à de la résine, puis moulée, séchée et décorée à la main, souvent de motifs argentés ou dorés. Pour produire de l'encre liquide, on tenait le bâton verticalement entre trois doigts et on le frottait d'un mouvement circulaire, lent et régulier, en exerçant une pression légère sur la surface d'une pierre où l'on avait préalablement déposé un peu d'eau. Cette technique permet de donner à l'encre le degré de fluidité voulu. (...) Le prix d'un bâton d'encre peut varier dans une proportion d'un à dix au moins. Les bâtons bon marché ne se diluent pas toujours d'une manière régulière, cassent facilement et produisent un noir tirant sur le gris. Les bâtons de bonne qualité ont un grain fin, régulier, ils se défont de manière douce et rapide et donnent des beaux noirs profonds. Ces noirs dépendent des substances qui sont entrées dans leur fabrication. Le prix peut varier du simple au centuple lorsqu'il s'agit d'encres anciennes, qui sont parfois d'une qualité inégalée, mais sont aussi collectionnées comme objets d'art, à cause de la finition extérieure du bâton.
pp. 71-73
pp. 71-73
Le premier des grands genres [calligraphiques] est la sigillaire, ainsi nommée en français parce qu'après avoir été remplacée par d'autres genres d'écriture à l'époque des Han, elle est restée en usage, jusqu'à aujourd'hui, dans la gravure des sceaux ; elle est appelée zhuanshu (tchouan-chou) en chinois. Elle n'est pas la forme la plus ancienne de l'écriture chinoise, mais la plus ancienne de celles qui sont encore communément pratiquées par les calligraphes aujourd'hui. Elle s'est développée sous la dynastie des Zhou, fondée au XI° s avant notre ère, et en est devenue l'écriture officielle vers l'an - 800. La plupart des exemples qu'on en a sont des inscriptions placées dans le creux des vases cultuels en bronze : après avoir été gravées dans le moule, elles étaient fondues dans le fond du récipient pour être portées à la connaissance des ancêtres ou des dieux qui étaient censés venir consommer les offrandes. Le Vase de l'envoyé Song, reproduit à la p. 341, en est un bel exemple. Les formes de la sigillaire sont arrondies, ramassées, souvent symétriques, leur ordonnance est relativement libre. Certains caractères sont encore immédiatement reconnaissables aujourd'hui, d'autres ne sont plus guère identifiés que par les historiens de l'écriture, les épigraphistes et les calligraphes. (...)
Après être progressivement tombée en désuétude sous les Han (-206 à +220) et n'avoir plus servi que dans la gravure des sceaux et quelques autres fonctions ornementales, la sigillaire est redevenue un genre calligraphique au VIII°s, sous les Tang. Pratiquée épisodiquement par certains calligraphes à partir de ce moment-là, elle a été élevée au rang d'un genre majeur par les calligraphes de l'époque mandchoue, aux XVIII° et XIX°s. Les oeuvres de Wu Changshuo (1844-1927), reproduites aux pages 239 et 356, les caractères de Deng Shiru (1743-1805) qui figurent à la page 354, sont de magnifiques exemples de cette sigillaire moderne.
pp. 96-98
Après être progressivement tombée en désuétude sous les Han (-206 à +220) et n'avoir plus servi que dans la gravure des sceaux et quelques autres fonctions ornementales, la sigillaire est redevenue un genre calligraphique au VIII°s, sous les Tang. Pratiquée épisodiquement par certains calligraphes à partir de ce moment-là, elle a été élevée au rang d'un genre majeur par les calligraphes de l'époque mandchoue, aux XVIII° et XIX°s. Les oeuvres de Wu Changshuo (1844-1927), reproduites aux pages 239 et 356, les caractères de Deng Shiru (1743-1805) qui figurent à la page 354, sont de magnifiques exemples de cette sigillaire moderne.
pp. 96-98
Puisqu'il y a autant de caractères dans l'écriture que d'idées simples dans la langue, les caractères semblent révéler la réalité dans toute sa diversité. Les écritures alphabétiques, qui réduisent les mots à leur plus petit dénominateur commun, sons et lettres, occultent au contraire la diversité du réel. Comme la monnaie, qui réduit tous les produits de la nature et de l'industrie humaine au dénominateur commun de la valeur d'échange, l'alphabet ramène la richesse infinie de la réalité sensible aux combinaisons de quelques signes dénués de valeur propre. On devine les incidences de ces deux systèmes sur les formes de pensée : parce qu'elle dissocie le signe de la chose pensée, l'écriture alphabétique suggère qu'il existe au-delà des signes visibles un domaine des idées, un monde d'identités abstraites que nos sens ne peuvent atteindre, mais que notre esprit peut concevoir. Elle invite à se représenter comme une ascension vers la vérité le passage des sons aux mots, des mots aux pensées, des pensées aux idées en soi. Associant au contraire étroitement le signe et la chose pensée, l'écriture chinoise fait plutôt concevoir le signe comme une pensée et la pensée comme un signe, ou le signe comme une chose perçue, et la chose perçue comme un signe. Elle incite moins à chercher derrière les signes visibles des réalités abstraites qu'à étudier les relations, les configurations, les récurrences de phénomènes qui sont des signes et de signes qui sont des phénomènes, à s'interroger sur la dynamique de leurs apparitions et de leurs disparitions. Elle engage la réflexion dans des voies différentes des nôtres ...
p. 20
p. 20
Quand le musicien joue, il a le sentiment de d'enchaîner les motifs de façon continue et de se déplacer donc dans le temps de manière suivie tandis que le calligraphe organise chaque caractère autour d'un centre immobile : il l'achève entièrement avant de passer outre pour se fixer sur un nouveau point immobile et former autour de lui le caractère suivant. Tant que le premier n'est pas terminé, il n'est pas question qu'il se hâte déjà vers celui d'après. A la différence de notre écriture, qui fait courir la main, l'écriture chinoise naît d'une suite d'opérations indépendantes, centrées chacune sur un point fixe et demandant chacune à son tour l'attention exclusive de celui qui écrit. Georges Rodin voit juste lorsqu'il note : "Les idéogrammes chinois, où tout est particulier, où rien n'est interchangeable, pourraient être moins favorables que notre écriture alphabétique à l'acquisition d'une mentalité expéditive." (L'esprit de perfection, Stock, 1975). Un caractère naît à un certain endroit, puis un autre naît à l'endroit suivant. la temporalité de l'écriture chinoise est une temporalité compartimentée, faite de moments complets qui se succèdent. (...) Les caractères apparaissent ainsi comme des efflorescences se succédant sans solution de continuité, délaissées dès qu'achevées, remplacées chacune par celle qui était en gestation derrière elle. Alors que notre écriture suggère un temps qui nous emporte dans sa fuite ou défile devant nous, l'écriture chinoise évoque l'idée d'un temps surgissant d'une source situe face à nous et se manifestant par une succession ininterrompue de figures émergeant et dépérissant aussitôt sous nos yeux.
(...) Pour donner plus de force à certains moments dramatiques, les acteurs d'opéra arrêtent l'enchaînement de leurs gestes en prenant des poses qui ont valeur de signe. Dans l'entraînement aux arts martiaux, le lutteur fait aboutir chaque enchaînement de mouvements à une posture dans laquelle il s'immobilise un bref instant avant de poursuivre ; chacune de ces postures porte un nom distinct. (...)
p. 142-143
(...) Pour donner plus de force à certains moments dramatiques, les acteurs d'opéra arrêtent l'enchaînement de leurs gestes en prenant des poses qui ont valeur de signe. Dans l'entraînement aux arts martiaux, le lutteur fait aboutir chaque enchaînement de mouvements à une posture dans laquelle il s'immobilise un bref instant avant de poursuivre ; chacune de ces postures porte un nom distinct. (...)
p. 142-143
Videos de Jean-François Billeter (24)
Voir plusAjouter une vidéo
Chronique "Un livre, un jour" sur Radio Zinzine le 29 janvier 2022 autour des deux nouveaux ouvrages de Jean François: Héraclite, le sujet et le Court Traité du langage et des choses
autres livres classés : calligraphie chinoiseVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean-François Billeter (28)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Année du Dragon
Ce samedi 10 février 2024, l'année du lapin d'eau laisse sa place à celle du dragon de bois dans le calendrier:
grégorien
chinois
hébraïque
8 questions
135 lecteurs ont répondu
Thèmes :
dragon
, Astrologie chinoise
, signes
, signes du zodiaques
, chine
, culture générale
, littérature
, cinemaCréer un quiz sur ce livre135 lecteurs ont répondu