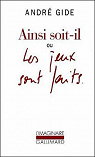Critiques de André Gide (714)
Petit ouvrage trouvé durant les vacances de l'été dernier et que je n'ouvre qu'aujourd'hui !!!
C'est le genre de petit livre toujours utile et agréable...
Chacun y prendra la mesure de ce dont il a besoin, de ce qui lui fait écho dans sa propre vie.
Une kyrielle de ''perles'' égrenées tout au long de ces pages par des auteurs cités tels : Andersen, Giono, Hugo, Voltaire, Gide, Alain, Saint Matthieu, Le Clézio, Tolstoï, Pirandello...
Alors : à vos marques, prêts, partez... pour le bonheur !!!
C'est le genre de petit livre toujours utile et agréable...
Chacun y prendra la mesure de ce dont il a besoin, de ce qui lui fait écho dans sa propre vie.
Une kyrielle de ''perles'' égrenées tout au long de ces pages par des auteurs cités tels : Andersen, Giono, Hugo, Voltaire, Gide, Alain, Saint Matthieu, Le Clézio, Tolstoï, Pirandello...
Alors : à vos marques, prêts, partez... pour le bonheur !!!
Ce petit livre est un recueil de nouvelle autour de la quête du bonheur. C'est un plaisir à lire. Il se mange en une bouchée. Il nourrit une réflexion sur un sujet qui fait rêver, réfléchir... ça inspire et c'est une lecture qui fait du bien.
En bref, je vous le conseille vivement.
En bref, je vous le conseille vivement.
Un petit (c'est presque un regret...) recueil de textes sur le bonheur ou plutôt illustrant le bonheur.
Certains textes, m'on peu enthousiasmé, mais finalement j'en retiens surtout quelques "perles", qui, en fermant le livre, laissent un sentiment diffus de plaisir: peut être un début de bonheur?
Parmi celles ci je ne peux que partager avec vous, lecteurs babéliens" celle trouvée dans Tolstoï:
" les livres qu'autrefois je lisais uniquement pour tuer mon ennui devinrent soudain pour moi un des plus grands plaisirs de la vie, et cela uniquement parce que j'avais parlé de livres avec lui, parce que nous avions lu ensemble."
Je vous en propose une seconde, signée Giono cette fois: " le sage cultive ses sentiments et ses sensations, connait sur le bout du doigt le catalogue exact de leurs possibilités, et s'applique avec elles à utiliser les ressources du monde sensible".
Certains textes, m'on peu enthousiasmé, mais finalement j'en retiens surtout quelques "perles", qui, en fermant le livre, laissent un sentiment diffus de plaisir: peut être un début de bonheur?
Parmi celles ci je ne peux que partager avec vous, lecteurs babéliens" celle trouvée dans Tolstoï:
" les livres qu'autrefois je lisais uniquement pour tuer mon ennui devinrent soudain pour moi un des plus grands plaisirs de la vie, et cela uniquement parce que j'avais parlé de livres avec lui, parce que nous avions lu ensemble."
Je vous en propose une seconde, signée Giono cette fois: " le sage cultive ses sentiments et ses sensations, connait sur le bout du doigt le catalogue exact de leurs possibilités, et s'applique avec elles à utiliser les ressources du monde sensible".
Tous les textes ne m’ont pas plu.
Si j’ai apprécié Alain, certains textes plus que d’autres, St Matthieu, beaucoup Tolstoï, Oscar Wilde, Maupassant et Pirandello. Voltaire et Anderson assez, peu Hugo, Gide et Le Clézio que d’habitude j’apprécie, Madame du Châtelet m’a ennuyée et je n’ai pas du tout aimé Giono.
Vu le titre je suis un peu déçue mais moins de 120 pages, ça passe.
Voilà un petit recueil de nouvelle que j'ai trouvé lumineux, exception faite de la nouvelle de Tolstoï que je n'ai pas accrochée, De "La pomme tomba et il trouva son bonheur" à "Nous avons rêvé des jours de bonheur" en passant par "j'ai besoin du bonheur de tous pour être heureux" c'est une recueil de nouvelles touchantes et de petites réflexions philosophiques aussi sur cette notion après laquelle chacun de nous court mais qui a trop tendance à nous échapper... Andersen, Voltaire, André Gide, Maupassant, Mme du Châtelet, Alain... ils sont tous réunis ici pour nous, dans des genres très différents pour nous faire réfléchir, chacun à leur manière et nous inviter à une réflexion sur l'art de trouver le bonheur et sur ce qu'il représente ; sur l'effort aussi que tout un chacun se doit de faire pour le trouver, car au fond qu'est-ce que la vie sinon vouloir être heureux ? Un petit livre à mettre entre toutes les mains.
Critique de Maxime Rovere pour le Magazine Littéraire
La Chronique dite de Jean de Venette est presque sans exemple: à une époque où l’Histoire transcrit le plus souvent les faits et gestes des Grands à l’attention de la postérité, voici qu’un homme du peuple prend la plume pour faire mémoire des fléaux de son temps : « Moi qui ne suis qu’un simple frère vivant à Paris, j’ai résumé dans ces pages tout ce que j’y ai vu et entendu »… La déferlante de maux auxquels la France est alors en butte ne peut manquer d’impressionner : « Ce siècle troublé par les guerres et les tribulations » n’est pas seulement celui de la guerre de Cent Ans (1337-1453) : peste, révoltes et répressions, épidémies, famines, dévaluations, pillages, accablent le pauvre peuple. Année après année, l’anonyme qu’on a longtemps identifié comme Jean de Venette consigne les événements, en tâchant de décrire le mieux possible la vie des humbles gens, prisonniers d’une histoire qui leur échappe. Passé des prophéties au charme étrange (« Le lys régnant dans la meilleure partie du monde s’ébranlera contre la semence du lion : il séjournera sur les champs parmi les épines. […] La tête du monde fléchira vers la terre »), le texte joue sur plusieurs registres : les mariages de rois alternent avec les batailles et les passages de comètes, et l’actualité de comptoir (« Personne n’osait s’opposer aux mouvements des Anglais, et le roi de France Philippe ne faisait qu’attendre, sans rien faire, qu’ils s’en aillent ») laisse filtrer de fines observations sur le monde rural ou sur les habitudes militaires. Même si cette Chronique n’a pas réellement d’ambition littéraire, et ne propose presque jamais d’analyse historique, elle est touchante en ceci qu’on y voit la main d’un homme obscur y imprimer les traces d’une misère poignante. La densité du bas-latin, bien rendue par Colette Beaune, donne lieu à de saisissantes descriptions de la peste, non seulement de « l’horreur de la maladie », mais aussi de l’effroi lié à son apparition foudroyante : « Qui aujourd’hui était en bonne santé demain était mort et porté en terre. » On voit les paysans, mis en danger par l’invasion anglaise, improviser des formes anciennes de résistance. C’est ainsi que le Grand Ferré, valet de ferme qui défendit vaillamment le village de Longueuil, apparaît comme l’un des premiers héros populaires d’un « roman national » qui commence à peine à s’écrire…
En partenariat avec
La Chronique dite de Jean de Venette est presque sans exemple: à une époque où l’Histoire transcrit le plus souvent les faits et gestes des Grands à l’attention de la postérité, voici qu’un homme du peuple prend la plume pour faire mémoire des fléaux de son temps : « Moi qui ne suis qu’un simple frère vivant à Paris, j’ai résumé dans ces pages tout ce que j’y ai vu et entendu »… La déferlante de maux auxquels la France est alors en butte ne peut manquer d’impressionner : « Ce siècle troublé par les guerres et les tribulations » n’est pas seulement celui de la guerre de Cent Ans (1337-1453) : peste, révoltes et répressions, épidémies, famines, dévaluations, pillages, accablent le pauvre peuple. Année après année, l’anonyme qu’on a longtemps identifié comme Jean de Venette consigne les événements, en tâchant de décrire le mieux possible la vie des humbles gens, prisonniers d’une histoire qui leur échappe. Passé des prophéties au charme étrange (« Le lys régnant dans la meilleure partie du monde s’ébranlera contre la semence du lion : il séjournera sur les champs parmi les épines. […] La tête du monde fléchira vers la terre »), le texte joue sur plusieurs registres : les mariages de rois alternent avec les batailles et les passages de comètes, et l’actualité de comptoir (« Personne n’osait s’opposer aux mouvements des Anglais, et le roi de France Philippe ne faisait qu’attendre, sans rien faire, qu’ils s’en aillent ») laisse filtrer de fines observations sur le monde rural ou sur les habitudes militaires. Même si cette Chronique n’a pas réellement d’ambition littéraire, et ne propose presque jamais d’analyse historique, elle est touchante en ceci qu’on y voit la main d’un homme obscur y imprimer les traces d’une misère poignante. La densité du bas-latin, bien rendue par Colette Beaune, donne lieu à de saisissantes descriptions de la peste, non seulement de « l’horreur de la maladie », mais aussi de l’effroi lié à son apparition foudroyante : « Qui aujourd’hui était en bonne santé demain était mort et porté en terre. » On voit les paysans, mis en danger par l’invasion anglaise, improviser des formes anciennes de résistance. C’est ainsi que le Grand Ferré, valet de ferme qui défendit vaillamment le village de Longueuil, apparaît comme l’un des premiers héros populaires d’un « roman national » qui commence à peine à s’écrire…
En partenariat avec
Critique de Alexis Brocas pour le Magazine Littéraire
Narration picaresque relevée de mauvais esprit, le récit de la vie de Louis Mandrin vaut son pesant d’écus : ce personnage entre dans la carrière de malfrat en fabriquant, avec son cadet, de l’or « frappé au coin du roi ». Son frère y laissera « la tête et le reste de son corps » quand Mandrin (après s’être retrouvé impliqué dans « un cas fortuit qu’un arrêté du Parlement vint à taxer d’assassinat ») prendra celle des contrebandiers sévissant entre France, Suisse et États de Savoie. Quand il offre de quoi se panser aux blessés qu’il laisse sur le carreau, il s’écrie « J’ai l’âme noble »... puis troue d’une balle, quelques pages plus loin, l’exécuteur de son frère et son petit garçon. « Vous méritez bien d’être pendus », lance-t-il aux voleurs dans la prison qu’il vient de conquérir. Nourrie de telles répliques, la trame historique prend l’allure d’une cavalcade menée grand train. Elle s’augmente ensuite de deux récits d’intérêt opposé. L’un, édifiant, conte la conversion du bandit par un jésuite dépêché spécialement pour son salut. L’autre décrit la fabrication d’un mythe. Déjà très populaire à sa capture, Mandrin devient, en prison, une vedette que visitent des foules curieuses venues de tout le royaume. Sa façon de défendre, lors de son procès, non sa personne mais son personnage de bandit au grand coeur, en fait l’ancêtre des délinquants médiatiques d’aujourd’hui.
En partenariat avec
Narration picaresque relevée de mauvais esprit, le récit de la vie de Louis Mandrin vaut son pesant d’écus : ce personnage entre dans la carrière de malfrat en fabriquant, avec son cadet, de l’or « frappé au coin du roi ». Son frère y laissera « la tête et le reste de son corps » quand Mandrin (après s’être retrouvé impliqué dans « un cas fortuit qu’un arrêté du Parlement vint à taxer d’assassinat ») prendra celle des contrebandiers sévissant entre France, Suisse et États de Savoie. Quand il offre de quoi se panser aux blessés qu’il laisse sur le carreau, il s’écrie « J’ai l’âme noble »... puis troue d’une balle, quelques pages plus loin, l’exécuteur de son frère et son petit garçon. « Vous méritez bien d’être pendus », lance-t-il aux voleurs dans la prison qu’il vient de conquérir. Nourrie de telles répliques, la trame historique prend l’allure d’une cavalcade menée grand train. Elle s’augmente ensuite de deux récits d’intérêt opposé. L’un, édifiant, conte la conversion du bandit par un jésuite dépêché spécialement pour son salut. L’autre décrit la fabrication d’un mythe. Déjà très populaire à sa capture, Mandrin devient, en prison, une vedette que visitent des foules curieuses venues de tout le royaume. Sa façon de défendre, lors de son procès, non sa personne mais son personnage de bandit au grand coeur, en fait l’ancêtre des délinquants médiatiques d’aujourd’hui.
En partenariat avec
Gide n'a jamais muieux écrit. Une expérience à faire : le lire à haute voix. Un régal.
Critique de pour le Magazine Littéraire
La bourgeoisie de gauche, les trentenaires, les roitelets du show business et la classe moyenne blanche : d'un livre à l'autre, Nicolas Fargues ausculte ces catégories et leur époque, avec une bonne dose d'autodérision. Dans Le Roman de l'été, il ob [...]
La bourgeoisie de gauche, les trentenaires, les roitelets du show business et la classe moyenne blanche : d'un livre à l'autre, Nicolas Fargues ausculte ces catégories et leur époque, avec une bonne dose d'autodérision. Dans Le Roman de l'été, il ob [...]
Critique de Aliette Armel pour le Magazine Littéraire
Paul Nizon livre des extraits du journal qu'il tient tous les jours. Ces pages, postérieures à 1990, sont marquées par la solitude, la disparition d'amis proches, la monotonie de l'existence. Un leitmotiv : «Qu'est-ce que la vie ?» Dans son appartement parisien, Paul Nizon poursuit une oeuvre à deux faces : des romans et un journal, dont il tape chaque jour une ou plusieurs pages sur une machine à écrire mécanique. Il en livre des extraits à ses lecteurs depuis les années 1990, celles que comprend le quatrième tome, Les Carnets du coursier, accompagné d’une postface du critique allemand Wend Kässens intitulée «Sur la genèse des Journaux, radiographie des processus créateurs de Paul Nizon». Selon leur auteur, ces carnets sont des notes «prises en continu sur [son] quotidien d’écrivain et tout ce qui va avec, Sex & Crime, beaucoup de sexe, drames conjugaux, flâneries urbaines, cogitations accompagnées de soupirs, de panique mais aussi d’exaltation pendant l’écriture de [ses] livres». Corpus delicti, en somme. L’auteur désigne par cette expression latine à consonance pénale ce bloc imposant qui comportait, en 1993 déjà, soixante classeurs de trois cents pages chacun, tapés au fil de la pensée. Paul Nizon a opéré des choix, a séparé la partie publiable de celle qui restera enfouie après avoir rempli sa fonction de «Mur des Lamentations intérieures» mais aussi de matériau de la vie et de l’oeuvre, indissociables chez l’écrivain. «Qu’est-ce que la vie ? s’interroge-t-il constamment. La vie se conquiert ou elle se perd.» Elle se gagne en cultivant la «prédisposition poétique», à l’écart de tout compromis avec la normalité bourgeoise. Dans les années 1990, l’écrivain se confronte à son incapacité à partager avec sa femme et son fils, Odile et Igor, de simples vacances dans la maison familiale bretonne ou aux sports d’hiver. «Je n’aime pas tellement ces régions monotones à scintillements métaphysiques que sont la mer et les cimes», avoue-t-il. Il arpente les trottoirs de la grande ville, terrain propice pour que «l’inouï [surgisse] de l’absence d’événements» et se mette à exister par l’intermédiaire du langage dans «un livre-monde, un livre sur la possession du monde, un composé de tendresse, de frénésie, de durée, de lyrisme, de noirceur et de haine». Les années 1990 sont celles de la difficile écriture de Chien, où l’auteur «dédouble le personnage de l’artiste en un clochard et un "écrivain" qui croise régulièrement ce dernier dans la rue», et où il accorde une grande importance à l’animal, représentation de «l’homme livré aux instincts». Sa vie personnelle est marquée par les turbulences de l’éloignement avec Odile, à l’âge où la mort commence à frapper à la porte avec la disparition d’amis proches. De tome en tome, le journal de Paul Nizon s’affirme ainsi comme une part indispensable de l’oeuvre. Le caractère impitoyable du regard qu’il porte sur lui-même lui confère une densité rare, renforcée par l’affirmation de son inéluctable solitude face à cette permanente «lutte - avec le sujet, avec le monde, avec l’obscurité du réel, avec les ténèbres, avec le moi (le [s]ien et celui des autres)».
Paul Nizon livre des extraits du journal qu'il tient tous les jours. Ces pages, postérieures à 1990, sont marquées par la solitude, la disparition d'amis proches, la monotonie de l'existence. Un leitmotiv : «Qu'est-ce que la vie ?» Dans son appartement parisien, Paul Nizon poursuit une oeuvre à deux faces : des romans et un journal, dont il tape chaque jour une ou plusieurs pages sur une machine à écrire mécanique. Il en livre des extraits à ses lecteurs depuis les années 1990, celles que comprend le quatrième tome, Les Carnets du coursier, accompagné d’une postface du critique allemand Wend Kässens intitulée «Sur la genèse des Journaux, radiographie des processus créateurs de Paul Nizon». Selon leur auteur, ces carnets sont des notes «prises en continu sur [son] quotidien d’écrivain et tout ce qui va avec, Sex & Crime, beaucoup de sexe, drames conjugaux, flâneries urbaines, cogitations accompagnées de soupirs, de panique mais aussi d’exaltation pendant l’écriture de [ses] livres». Corpus delicti, en somme. L’auteur désigne par cette expression latine à consonance pénale ce bloc imposant qui comportait, en 1993 déjà, soixante classeurs de trois cents pages chacun, tapés au fil de la pensée. Paul Nizon a opéré des choix, a séparé la partie publiable de celle qui restera enfouie après avoir rempli sa fonction de «Mur des Lamentations intérieures» mais aussi de matériau de la vie et de l’oeuvre, indissociables chez l’écrivain. «Qu’est-ce que la vie ? s’interroge-t-il constamment. La vie se conquiert ou elle se perd.» Elle se gagne en cultivant la «prédisposition poétique», à l’écart de tout compromis avec la normalité bourgeoise. Dans les années 1990, l’écrivain se confronte à son incapacité à partager avec sa femme et son fils, Odile et Igor, de simples vacances dans la maison familiale bretonne ou aux sports d’hiver. «Je n’aime pas tellement ces régions monotones à scintillements métaphysiques que sont la mer et les cimes», avoue-t-il. Il arpente les trottoirs de la grande ville, terrain propice pour que «l’inouï [surgisse] de l’absence d’événements» et se mette à exister par l’intermédiaire du langage dans «un livre-monde, un livre sur la possession du monde, un composé de tendresse, de frénésie, de durée, de lyrisme, de noirceur et de haine». Les années 1990 sont celles de la difficile écriture de Chien, où l’auteur «dédouble le personnage de l’artiste en un clochard et un "écrivain" qui croise régulièrement ce dernier dans la rue», et où il accorde une grande importance à l’animal, représentation de «l’homme livré aux instincts». Sa vie personnelle est marquée par les turbulences de l’éloignement avec Odile, à l’âge où la mort commence à frapper à la porte avec la disparition d’amis proches. De tome en tome, le journal de Paul Nizon s’affirme ainsi comme une part indispensable de l’oeuvre. Le caractère impitoyable du regard qu’il porte sur lui-même lui confère une densité rare, renforcée par l’affirmation de son inéluctable solitude face à cette permanente «lutte - avec le sujet, avec le monde, avec l’obscurité du réel, avec les ténèbres, avec le moi (le [s]ien et celui des autres)».
Critique de Jean-Yves Masson pour le Magazine Littéraire
Antonio Gamoneda, qui publie Clarté sans repos chez Arfuyen, sera présent à Sète à l'occasion du festival "Voix vives" qui se tiendra du 22 au 30 juillet prochain. Critique de ce recueil à l'austère splendeur. La venue à Sète d’Antonio Gamoneda constitue un événement : né en 1931 dans les Asturies, il est aujourd’hui le plus grand poète espagnol vivant. Sa poésie fut d’abord une sourde protestation contre la chape de plomb du franquisme. Cette première période culmina en 1977 avec Description du mensonge (trad. chez José Corti), recueil composé dans l’effervescence qui suivit la fin du régime de Franco. Les souvenirs de la guerre civile, mêlés aux souffrances d’une enfance marquée par la mort du père, forment la toile de fond de grands livres tragiques comme Clarté sans repos (éd. Arfuyen), traduit à l’occasion de l’attribution au poète du prix européen de littérature à Strasbourg, en 2006. Il y a beaucoup de violence passionnée et de solitude dans la poésie de Gamoneda, et pourtant, aussi, une compassion pour la souffrance qui fonde une éthique autant qu’une poétique. Pour celui qui peut écrire : « J’ai connu le froid », et qui se souvient de « l’âge du fer dans la gorge », la flamme vive du poème n’est pas une vaine métaphore. Nul hasard si le Livre du froid , publié en 1992 et révisé en 2003 (éd. Antoine Soriano, 1996, trad. revue en 2005 d’après la version définitive), est l’un des maîtres livres de notre temps par son mélange unique d’austérité et de splendeur verbale. Gamoneda est aussi l’auteur d’un fascinant Livre des poisons où il s’empare d’un traité de botanique grec du Ier siècle de notre ère, celui de Dioscoride, pour le moderniser et le peupler de créations imaginaires - car nul poison de l’âme humaine ne lui est étranger.Antonio Gamoneda sera présent à Sète en même temps que son principal traducteur, Jacques Ancet, poète de haute tenue dont je recommande la lecture, et qui vient de publier aux éditions Lettres vives Chronique d’un égarement.
Antonio Gamoneda, qui publie Clarté sans repos chez Arfuyen, sera présent à Sète à l'occasion du festival "Voix vives" qui se tiendra du 22 au 30 juillet prochain. Critique de ce recueil à l'austère splendeur. La venue à Sète d’Antonio Gamoneda constitue un événement : né en 1931 dans les Asturies, il est aujourd’hui le plus grand poète espagnol vivant. Sa poésie fut d’abord une sourde protestation contre la chape de plomb du franquisme. Cette première période culmina en 1977 avec Description du mensonge (trad. chez José Corti), recueil composé dans l’effervescence qui suivit la fin du régime de Franco. Les souvenirs de la guerre civile, mêlés aux souffrances d’une enfance marquée par la mort du père, forment la toile de fond de grands livres tragiques comme Clarté sans repos (éd. Arfuyen), traduit à l’occasion de l’attribution au poète du prix européen de littérature à Strasbourg, en 2006. Il y a beaucoup de violence passionnée et de solitude dans la poésie de Gamoneda, et pourtant, aussi, une compassion pour la souffrance qui fonde une éthique autant qu’une poétique. Pour celui qui peut écrire : « J’ai connu le froid », et qui se souvient de « l’âge du fer dans la gorge », la flamme vive du poème n’est pas une vaine métaphore. Nul hasard si le Livre du froid , publié en 1992 et révisé en 2003 (éd. Antoine Soriano, 1996, trad. revue en 2005 d’après la version définitive), est l’un des maîtres livres de notre temps par son mélange unique d’austérité et de splendeur verbale. Gamoneda est aussi l’auteur d’un fascinant Livre des poisons où il s’empare d’un traité de botanique grec du Ier siècle de notre ère, celui de Dioscoride, pour le moderniser et le peupler de créations imaginaires - car nul poison de l’âme humaine ne lui est étranger.Antonio Gamoneda sera présent à Sète en même temps que son principal traducteur, Jacques Ancet, poète de haute tenue dont je recommande la lecture, et qui vient de publier aux éditions Lettres vives Chronique d’un égarement.
Critique de Evelyne Bloch-Dano pour le Magazine Littéraire
C'est Nabokov et sa Lolita qui inspirent à Sara Stridsberg ces variations. L'auteur fait naître des figures troublantes, fantomatiques, difformes parfois. Une vision désespérée sur la maternité, malédiction de la femme. Inspirée dans son premier livre, La Faculté des rêves , par la sulfureuse Valerie Solanas, la jeune Suédoise Sara Stridsberg s’empare du personnage mythique de Lolita dans un Darling River sous-titré «Les variations Dolores». Elle y reprend, interprète, imagine, prolonge, orchestre des thématiques, des formes, des silhouettes issues de l’oeuvre de Nabokov. Quatre personnages forment des motifs qui alternent et constituent les parties de cette composition assez savante : le destin, le temps, le miroir, la maladie, la solitude. Dolores Haze, l’héroïne de Nabokov, est conduite à sa fin, évoquée dans l’avant-propos de Lolita : «Mme Richard F. Schiller est morte en couches le jour de Noël 1952 à Gray Star, un village aux confins du Nord-Ouest, en mettant au monde une fille mort-née.» Une moderne Lo de 13 ans accompagne son père dans une vieille Jaguar à travers des forêts en feu. Une femelle chimpanzé, dont Nabokov prétendait qu’elle était à l’origine de son personnage, apprend à dessiner au Jardin des Plantes. Enfin, une mère mystérieuse parcourt le monde avec son appareil photographique. Il faut avouer que ces personnages ne suscitent pas tous le même intérêt. À la clarté ironique, à l’intelligence au laser, à la perversité troublante, à la sobriété de Nabokov, à son lyrisme sans pathos, à son usage diabolique de la langue anglaise se substituent les abîmes d’une sensibilité postmoderne un peu erratique. Le monde de Sara Stridsberg est peuplé de créatures informes ou difformes, d’ombres inquiétantes, il est taché de sang, de crasse, de terre noire, de pus, d’eau boueuse. Paysage calciné et plaines incertaines entourent des êtres (les deux Lo, la mère, et même la chimpanzé) dont la dégradation physique fait peu à peu des monstres et engendre la répulsion. Son imaginaire donne naissance à des pages poétiques très fortes dans lesquelles les rêves, répétitifs et fascinants, forment un contrepoint à la réalité repoussante. Entre romantisme morbide et naturalisme sordide, la poétique de Sara Stridsberg repose sur une inspiration puissante : «Je ne mens pas, déclare Lo, c’est juste que je ne vois pas ce que les autres voient.» Reste à faire partager au lecteur cette vision désespérée de la «croûte extérieure d’une planète stérile»... La maternité est au coeur de cette errance. Dolores ou douleurs. Maternité haïe, qui crache dans la puanteur des foetus monstrueux ou mort-nés au milieu du sang et des glaires, maternité qui tue, malédiction de la femme. Le dégoût de la féminité n’a d’égal que le mépris pour l’homme. Mères absentes, mortes ou fantomatiques, pères incestueux, pervers, meurtriers : l’univers de Sara Stridsberg, dans la droite ligne d’une tradition scandinave tragique, est peuplé d’humanoïdes enfermés dans leur condition, qu’il s’agisse de la Jaguar déglinguée du père de Lo ou de la cage de la chimpanzé. «Les enfants sont les miroirs de la mort», et l’impossible enjeu de la littérature est de tenter de «décrire sans détruire».
C'est Nabokov et sa Lolita qui inspirent à Sara Stridsberg ces variations. L'auteur fait naître des figures troublantes, fantomatiques, difformes parfois. Une vision désespérée sur la maternité, malédiction de la femme. Inspirée dans son premier livre, La Faculté des rêves , par la sulfureuse Valerie Solanas, la jeune Suédoise Sara Stridsberg s’empare du personnage mythique de Lolita dans un Darling River sous-titré «Les variations Dolores». Elle y reprend, interprète, imagine, prolonge, orchestre des thématiques, des formes, des silhouettes issues de l’oeuvre de Nabokov. Quatre personnages forment des motifs qui alternent et constituent les parties de cette composition assez savante : le destin, le temps, le miroir, la maladie, la solitude. Dolores Haze, l’héroïne de Nabokov, est conduite à sa fin, évoquée dans l’avant-propos de Lolita : «Mme Richard F. Schiller est morte en couches le jour de Noël 1952 à Gray Star, un village aux confins du Nord-Ouest, en mettant au monde une fille mort-née.» Une moderne Lo de 13 ans accompagne son père dans une vieille Jaguar à travers des forêts en feu. Une femelle chimpanzé, dont Nabokov prétendait qu’elle était à l’origine de son personnage, apprend à dessiner au Jardin des Plantes. Enfin, une mère mystérieuse parcourt le monde avec son appareil photographique. Il faut avouer que ces personnages ne suscitent pas tous le même intérêt. À la clarté ironique, à l’intelligence au laser, à la perversité troublante, à la sobriété de Nabokov, à son lyrisme sans pathos, à son usage diabolique de la langue anglaise se substituent les abîmes d’une sensibilité postmoderne un peu erratique. Le monde de Sara Stridsberg est peuplé de créatures informes ou difformes, d’ombres inquiétantes, il est taché de sang, de crasse, de terre noire, de pus, d’eau boueuse. Paysage calciné et plaines incertaines entourent des êtres (les deux Lo, la mère, et même la chimpanzé) dont la dégradation physique fait peu à peu des monstres et engendre la répulsion. Son imaginaire donne naissance à des pages poétiques très fortes dans lesquelles les rêves, répétitifs et fascinants, forment un contrepoint à la réalité repoussante. Entre romantisme morbide et naturalisme sordide, la poétique de Sara Stridsberg repose sur une inspiration puissante : «Je ne mens pas, déclare Lo, c’est juste que je ne vois pas ce que les autres voient.» Reste à faire partager au lecteur cette vision désespérée de la «croûte extérieure d’une planète stérile»... La maternité est au coeur de cette errance. Dolores ou douleurs. Maternité haïe, qui crache dans la puanteur des foetus monstrueux ou mort-nés au milieu du sang et des glaires, maternité qui tue, malédiction de la femme. Le dégoût de la féminité n’a d’égal que le mépris pour l’homme. Mères absentes, mortes ou fantomatiques, pères incestueux, pervers, meurtriers : l’univers de Sara Stridsberg, dans la droite ligne d’une tradition scandinave tragique, est peuplé d’humanoïdes enfermés dans leur condition, qu’il s’agisse de la Jaguar déglinguée du père de Lo ou de la cage de la chimpanzé. «Les enfants sont les miroirs de la mort», et l’impossible enjeu de la littérature est de tenter de «décrire sans détruire».
Des illustrations de mauvaise qualité, très souvent floues, mal mises en pages.
Malheureusement le texte ne rattrape pas les illustrations.
Maurice Nadeau, visiblement non inspiré par Gide, signe une biographie sans épaisseur, terne et ennuyeuse.
Un comble pour un album !
Lien : https://www.babelio.com/livr..
Malheureusement le texte ne rattrape pas les illustrations.
Maurice Nadeau, visiblement non inspiré par Gide, signe une biographie sans épaisseur, terne et ennuyeuse.
Un comble pour un album !
Lien : https://www.babelio.com/livr..
Cet album Gide, magnifiquement rédigé par Maurice Nadeau, présente une belle iconographie de Gide et permet de resituer Gide dans son époque et son parcours.
La biographie de Gide reste hélas assez courte et nous laisse un peu sur notre fin, en particulier en ce qui concerne ses rapports avec les autres écrivains durant l'entre-deux-guerres et sur son attitude pendant les deux guerres (rôle au sein de la NRF). Il y a comme une volonté d'éviter les sujets trop polémiques (pédophilie notamment), peut-être pour laisser plus de place à l'œuvre.
La biographie de Gide reste hélas assez courte et nous laisse un peu sur notre fin, en particulier en ce qui concerne ses rapports avec les autres écrivains durant l'entre-deux-guerres et sur son attitude pendant les deux guerres (rôle au sein de la NRF). Il y a comme une volonté d'éviter les sujets trop polémiques (pédophilie notamment), peut-être pour laisser plus de place à l'œuvre.
Extraits de carnet de voyage d'André Gide...
Intéressant...
Intéressant...
Très agréables courts récits du Maghreb, entre Algérie et désert; on se passionne et l'on s'émerveille au fil des anecdotes amusantes racontées par Gide, dont la plume me transporte toujours.
Je suis comme un boxeur en plein désarroi : jet de l'éponge à la troisième reprise.
En termes diplomatiques je pourrai dire que j'ai renoncé, pour ne pas avouer que j'ai lâchement abandonné la lecture de ce livre composé d'articles d'André Gide paru dans la presse de la période de l'occupation.
Si le texte concernant Jacques Chardonne (premier round) a captivé mon attention, ainsi que la réponse à une enquête (genre questionnaire de Proust), dès l'entame du troisième round (interviews imaginaires) je n'avais déjà plus la rage de vaincre.
Voir André Gide répondre aux questions qu'il a lui-même imaginées, m'a paru un exercice de la plus grande tartuferie.
Aucun auteur, aujourd'hui, sous peine de paraître pour un jobard, n'oserait tenter pareils jeux de ping-pong.
Je me suis ennuyé ferme face à cette partie qui se résumait par un à moi - à moi interminable.
Mais lorsque André Gide a voulu me parler du théâtre de Goethe pendant vingt pages, puis sans entracte, m'expliquer Phèdre et Iphigénie (pour autant de pages), j'ai, par lassitude, baissé ma garde, et dans mon coin ma conscience a compris que c'était l'heure de jeter l'éponge.
Dernièrement, au cours d'une conversation, j'avais affirmé que j'avais besoin pour l'été de lectures légères, voire même futiles.
Alors direz-vous comme le seigneur Géronte :
- que diable allait-il faire dans cette galère ?
En termes diplomatiques je pourrai dire que j'ai renoncé, pour ne pas avouer que j'ai lâchement abandonné la lecture de ce livre composé d'articles d'André Gide paru dans la presse de la période de l'occupation.
Si le texte concernant Jacques Chardonne (premier round) a captivé mon attention, ainsi que la réponse à une enquête (genre questionnaire de Proust), dès l'entame du troisième round (interviews imaginaires) je n'avais déjà plus la rage de vaincre.
Voir André Gide répondre aux questions qu'il a lui-même imaginées, m'a paru un exercice de la plus grande tartuferie.
Aucun auteur, aujourd'hui, sous peine de paraître pour un jobard, n'oserait tenter pareils jeux de ping-pong.
Je me suis ennuyé ferme face à cette partie qui se résumait par un à moi - à moi interminable.
Mais lorsque André Gide a voulu me parler du théâtre de Goethe pendant vingt pages, puis sans entracte, m'expliquer Phèdre et Iphigénie (pour autant de pages), j'ai, par lassitude, baissé ma garde, et dans mon coin ma conscience a compris que c'était l'heure de jeter l'éponge.
Dernièrement, au cours d'une conversation, j'avais affirmé que j'avais besoin pour l'été de lectures légères, voire même futiles.
Alors direz-vous comme le seigneur Géronte :
- que diable allait-il faire dans cette galère ?
Ce dernier volume est singulièrement captivant, et ce d’abord parce qu’il nous invite à découvrir la pensée d’un critique aujourd’hui presque oublié, et qui pourtant fut en son temps un acteur important de la vie littéraire française : Marcel Drouin (1871-1943).
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Le premier volume (il y en aura deux) de cette édition de leur Correspondance - laquelle ajoute 260 lettres inédites à l’édition de Robert Mallet en 1948 - montre une relation très forte quoique non sans arrière-pensée entre les deux écrivains.
Lien : http://rss.feedsportal.com/c..
Lien : http://rss.feedsportal.com/c..
En 1893, voilà deux jeunes gens que bien des points communs rapprochent : l'âge, un certain anticonformisme par rapport aux attentes de leur milieu, une sensualité intense, la passion de la nature, le goût immodéré de la poésie.
Quand Jammes entend parler de Gide, il lui fait parvenir sa première plaquette, Vers. S'en suivent une amitié basée sur l'estime réciproque et une correspondance soutenue et enthousiaste, à la fois littéraire et amicale. Ils en viennent au tutoiement dès fin 95.
Ce n'est qu'en 1896 qu'ils se rencontrent pour la première fois, à Alger, car Gide voyage en compagnie de sa femme en Afrique et il invite Jammes à venir l'y rejoindre . Une amitié et une confiance plus profondes encore se nouent alors et, en 1898, Gide invite Jammes à séjourner dans son château familial de Normandie. Un excellent souvenir de part et d'autre !
En 1900, ils sont tous deux invités, en tant que représentants de la jeune école littéraire française, à donner une conférence à Bruxelles. Au retour, Gide accueille Jammes chez lui et lui présente Paul Claudel.
Mais, dès 1902, le jugement que chacun porte sur l'oeuvre de l'autre les divise : Gide juge médiocre Existences, de Jammes (il le lui fait comprendre avec une certaine délicatesse, ce dont Jammes est toutefois blessé : «[…] l'idée que désormais, grâce à ceux qui t'entourent, et quoique notre amitié n'y perde rien, tu te roidirais contre mes oeuvres futures»), tandis que Jammes juge L'Immoraliste de Gide tout à fait… immoral (réponse de Gide aux critiques de J :«Je n'ai jamais espéré, jamais souhaité même que mon Immoraliste te plût. Il me suffit qu'il ne se mette pas entre nous.»). Et Jammes le prosélyte revient à la charge, estimant de son devoir de ramener son ami dans le droit chemin («cet immoraliste étriqué, même encore plus malade» ; réponse de Gide : «Ne cherche pas plus longtemps à me persuader que j'eus tort d'écrire mon livre, tu n'y parviendrais pas.») ; quand le premier ne portait qu'un jugement littéraire, le second porte un jugement moral. L'amitié perdure cependant, grâce à des efforts de chaque côté, mais la secousse a été sévère («les derniers sentiments qui survivent à une amitié qui fut belle», écrit Jammes).
En 1905, Jammes renoue avec un catholicisme fervent, sous la direction de Claudel. Gide restera athée toute sa vie, ou peut-être plutôt panthéiste. Leur correspondance leur permet de préciser leurs positions respectives et Gide ira jusqu'à lire à voix haute en public L'Église habillée de feuilles, poème religieux que son ami vient de composer. Cette rupture spirituelle dans leurs habitudes de vie va malgré tout refroidir quelque peu leurs relations («Si ma sympathie pour toi m'a captieusement rapproché de ton Dieu, je voudrais pouvoir espérer que l'amour pour ton Dieu ne t'éloignera pas trop de moi.» écrit Gide) ; désormais, Jammes collabore à la Nouvelle Revue Française, dont Gide est l'un des créateurs. C'est alors que Gide fait paraître La Porte étroite, son oeuvre la plus résolument chrétienne. Jammes l'encense et Gide lui rend la pareille pour Rayons de miel.
Une nouvelle grave dissension naît lors du décès de leur ami commun, Charles-Louis Philippe, fin 1909. Gide demande à Jammes un article d'hommage pour la NRF ; mais l'article que ce dernier rédige critique Philippe ; Gide demande à Jammes de le modifier, ce qu'il refuse catégoriquement. L'article ne paraîtra pas. «Je crois que de continuer ma collaboration à la N.R.F. accentuerait les divergences qui existent entre nous.» écrit Jammes.
Cette fois, les relations entre les deux hommes s'espacent. Quelques lettres, avec les expressions de l'amitié, mais sans l'abandon et la verve d'autrefois, viennent rompre de loin en loin un silence persistant.
Une amitié moins durable, donc, que les dates 1893-1938 ne le laissent supposer (1938 est la date du décès de Jammes) et qui, commencée sous d'heureux auspices, s'étiolera, tant les différences entre les écrivains ne feront que croître avec la maturité.
Quand Jammes entend parler de Gide, il lui fait parvenir sa première plaquette, Vers. S'en suivent une amitié basée sur l'estime réciproque et une correspondance soutenue et enthousiaste, à la fois littéraire et amicale. Ils en viennent au tutoiement dès fin 95.
Ce n'est qu'en 1896 qu'ils se rencontrent pour la première fois, à Alger, car Gide voyage en compagnie de sa femme en Afrique et il invite Jammes à venir l'y rejoindre . Une amitié et une confiance plus profondes encore se nouent alors et, en 1898, Gide invite Jammes à séjourner dans son château familial de Normandie. Un excellent souvenir de part et d'autre !
En 1900, ils sont tous deux invités, en tant que représentants de la jeune école littéraire française, à donner une conférence à Bruxelles. Au retour, Gide accueille Jammes chez lui et lui présente Paul Claudel.
Mais, dès 1902, le jugement que chacun porte sur l'oeuvre de l'autre les divise : Gide juge médiocre Existences, de Jammes (il le lui fait comprendre avec une certaine délicatesse, ce dont Jammes est toutefois blessé : «[…] l'idée que désormais, grâce à ceux qui t'entourent, et quoique notre amitié n'y perde rien, tu te roidirais contre mes oeuvres futures»), tandis que Jammes juge L'Immoraliste de Gide tout à fait… immoral (réponse de Gide aux critiques de J :«Je n'ai jamais espéré, jamais souhaité même que mon Immoraliste te plût. Il me suffit qu'il ne se mette pas entre nous.»). Et Jammes le prosélyte revient à la charge, estimant de son devoir de ramener son ami dans le droit chemin («cet immoraliste étriqué, même encore plus malade» ; réponse de Gide : «Ne cherche pas plus longtemps à me persuader que j'eus tort d'écrire mon livre, tu n'y parviendrais pas.») ; quand le premier ne portait qu'un jugement littéraire, le second porte un jugement moral. L'amitié perdure cependant, grâce à des efforts de chaque côté, mais la secousse a été sévère («les derniers sentiments qui survivent à une amitié qui fut belle», écrit Jammes).
En 1905, Jammes renoue avec un catholicisme fervent, sous la direction de Claudel. Gide restera athée toute sa vie, ou peut-être plutôt panthéiste. Leur correspondance leur permet de préciser leurs positions respectives et Gide ira jusqu'à lire à voix haute en public L'Église habillée de feuilles, poème religieux que son ami vient de composer. Cette rupture spirituelle dans leurs habitudes de vie va malgré tout refroidir quelque peu leurs relations («Si ma sympathie pour toi m'a captieusement rapproché de ton Dieu, je voudrais pouvoir espérer que l'amour pour ton Dieu ne t'éloignera pas trop de moi.» écrit Gide) ; désormais, Jammes collabore à la Nouvelle Revue Française, dont Gide est l'un des créateurs. C'est alors que Gide fait paraître La Porte étroite, son oeuvre la plus résolument chrétienne. Jammes l'encense et Gide lui rend la pareille pour Rayons de miel.
Une nouvelle grave dissension naît lors du décès de leur ami commun, Charles-Louis Philippe, fin 1909. Gide demande à Jammes un article d'hommage pour la NRF ; mais l'article que ce dernier rédige critique Philippe ; Gide demande à Jammes de le modifier, ce qu'il refuse catégoriquement. L'article ne paraîtra pas. «Je crois que de continuer ma collaboration à la N.R.F. accentuerait les divergences qui existent entre nous.» écrit Jammes.
Cette fois, les relations entre les deux hommes s'espacent. Quelques lettres, avec les expressions de l'amitié, mais sans l'abandon et la verve d'autrefois, viennent rompre de loin en loin un silence persistant.
Une amitié moins durable, donc, que les dates 1893-1938 ne le laissent supposer (1938 est la date du décès de Jammes) et qui, commencée sous d'heureux auspices, s'étiolera, tant les différences entre les écrivains ne feront que croître avec la maturité.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de André Gide
Lecteurs de André Gide Voir plus
Quiz
Voir plus
André Gide
Né en ...
1869
1889
1909
1929
10 questions
108 lecteurs ont répondu
Thème :
André GideCréer un quiz sur cet auteur108 lecteurs ont répondu