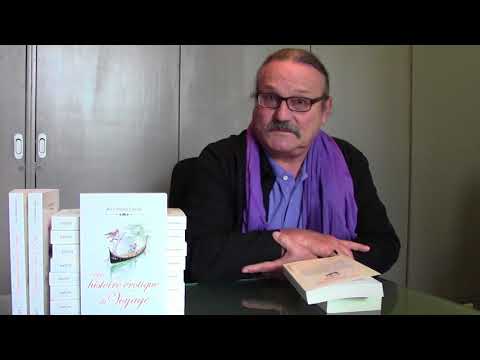Nationalité : France
Né(e) le : 01/08/1951
Né(e) le : 01/08/1951
Biographie :
Jean-Didier Urbain, docteur en anthropologie sociale et culturelle, est professeur à l'université Paris-Descartes.
1987 : docteur ès lettres et sciences humaines
De 1989 à 1996 : professeur de sociologie de la culture à l'université René-Descartes - Paris-V.
Professeur en sciences du langage appliquées aux sciences sociales à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Membre du groupe de recherche "Tourisme : lieux et réseaux" au CNRS.
Directeur scientifique du groupe "Prospective".
Jean-Didier Urbain, docteur en anthropologie sociale et culturelle, est professeur à l'université Paris-Descartes.
1987 : docteur ès lettres et sciences humaines
De 1989 à 1996 : professeur de sociologie de la culture à l'université René-Descartes - Paris-V.
Professeur en sciences du langage appliquées aux sciences sociales à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Membre du groupe de recherche "Tourisme : lieux et réseaux" au CNRS.
Directeur scientifique du groupe "Prospective".
Source : Le Monde
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (6)
Voir plusAjouter une vidéo
"Une histoire érotique du voyage" de Jean-Didier Urbain en librairie le 18 octobre,. Toute la malice, la curiosité et l'érudition de l'auteur, "Monsieur Voyage" en France, y sont concentrées pour dévoiler la face cachée de nos aventures à travers le vaste monde
Citations et extraits (37)
Voir plus
Ajouter une citation
De même, quel choix reste-t-il au voyageur d'agrément qui ne veut pas être touriste?
Ou bien il s'immobilise, soit qu'il reste chez lui; soit qu'il se sédentarise chez l'habitant - et alors il n'est plus un voyageur. Ou bien il voyage «se précipite dans les endroits non touristiques», et sa seule présence fait de ces endroits des lieux touristiques et de lui un touriste. Quoi qu'il fasse, ce voyageur est en situation d'échec; qu'il se déplace ou qu'il ne se déplace pas. C'est pourquoi, prisonnier de cette double contrainte, le touriste doit ne pas être là où il veut aller.
Ou bien il s'immobilise, soit qu'il reste chez lui; soit qu'il se sédentarise chez l'habitant - et alors il n'est plus un voyageur. Ou bien il voyage «se précipite dans les endroits non touristiques», et sa seule présence fait de ces endroits des lieux touristiques et de lui un touriste. Quoi qu'il fasse, ce voyageur est en situation d'échec; qu'il se déplace ou qu'il ne se déplace pas. C'est pourquoi, prisonnier de cette double contrainte, le touriste doit ne pas être là où il veut aller.
Plus une mécanique est complexe, plus elle s'expose à la panne en augmentant le nombre de ses possibles défaillances.
Dans cette conquête ethnographique d'univers proches par quelques explorateurs curieux de leur "voisin de palier", il y a donc, outre une certaine odeur de désobéissance, voire de provocation ou de transgression, une sorte de défi lancé à une coutume anthropologique bien étable. Ainsi que la dépeint avc humour Nigel Barley, selon cette coutume, pour qu'une réalité socioculturelle soit digne d'intérêt il faut qu'il s'agisse d'un peuple lointain qui, de préférence, pratique le culte du crâne, procède à la circoncision, possède un langage sifflé, momifie ses morts et, c'est encore meilleur, a la réputation d'être sauvage et rétif.
A l'image de celui-ci, à Madagascar, qui note que dans ce restaurant de Tuléar "les pizzas ne sont pas toujours bonnes", mais que dans cet autre les "viennoiseries" [sont] assez bonnes", ne réalise pas le côté surréaliste de sa remarque ! La mondialisation aidant, ce "baroudeur" de pizzeria et de boulangerie, c'est Tartarin rêvant encore de chocolat chaud au beau milieu de l'inconnu. C'est le septième pilier de la mésaventure en chair et en os. Un voyageur en proie à des contradictions qui voient les désirs de confort d'un Sancho Pança le disputer assidûment aux pulsions picaresques d'un Don Quichotte. Ce type de voyageurs n'est pas rare. Il est en chacun de nous...
Pour ou contre le tourisme, il faut en finir ici avec des schématismes qui ne font que figer une image, théoriser un stéréotype et appauvrir le sens d'une évolution sociale en la réduisant à un marché ou à une invasion. Que reste-t-il alors de cet événement considérable suscité par le voyage, le désir de découverte et de rencontre? Le tourisme, au XXe siècle, plus que la guerre, la colonisation ou le commerce des biens, est un formidable accélérateur de la circulation des traits culturels. Il précipite les dialectiques identitaires qui conduisent à la prise de conscience de soi et d'autrui. Comme l'invention de la prison au XIXe siècle ne peut se comprendre que si on la replace dans le cadre historique de la formation d'une société disciplinaire de surveillance (M. Foucault, Surveiller et punir (Naissance de la prison), Paris, Gallimard, 1975), le développement actuel du tourisme ne peut se comprendre qu'au regard de la formation en cours d'une société migrante de reconnaissance. Et s'il est vrai qu nous relevons toujours de cette société disciplinaire, dont le principe est l'enfermement, est-ce alors un hasard si cette autre, dont le principe est la mobilité, s'y superpose aujourd'hui?
Des causes, des formes et des effets de l’échec en voyage
D’hier et d’aujourd’hui, et même de demain, nul n’est épargné dans cet essai. Avant tout consacré à l’homme ordinaire, tout un chacun avec un peu de bonne foi devrait s’y retrouver. « Héros commun. Personnage disséminé. Marcheur innombrable », comme l’a évoqué Michel de Certeau1, cet homme sera ici le plus souvent une multitude anonyme de voyageurs sans qualités particulières. Contrairement aux voyageurs de Baudelaire, ceux-là ne sont pas étonnants. Ils ne sont que surprenants et surpris, pris en flagrant délit d’imperfection dans leur quête d’idéal.
En fait, quant à l’étonnement, le participe passé leur va mieux. Car ces voyageurs sont en général d’éternels étonnés. Leurs galères, péripéties, tribulations et autres mésaventures, bien qu’elles soient banales, et même fort prévisibles, les étonnent toujours. Depuis des lustres, ils ont pour coutume de tomber dans les pièges signalés ; de se heurter aux obstacles connus ; de faire des erreurs grossières ; et de recommencer. Rien n’y fait. Franchement, ce qu’ils font et disent est si habituel, pour ne pas dire convenu, que ces voyageurs n’ont rien d’étonnant, sauf leur acharnement ! Leur goût immodéré de la récidive ! Le mystère de leur opiniâtreté ! Est-ce celle de la revanche ? De la poursuite de la perfection ? De l’addiction ?
Surpris sempiternels, tour à tour stupéfaits, sidérés, consternés, les stupéfactions de ces voyageurs sont stupéfiantes ; leurs sidérations, sidérantes ; et leurs consternations, consternantes. Ce sont leurs surprises qui surprennent et leurs étonnements qui étonnent, portés qu’ils sont par ce qui semble être une aptitude à la désillusion ; une vocation à tomber des nues ; une prédilection ou une attraction indéfectible, voire une compétence, pour le fourvoiement et le désenchantement, laquelle, irrésistiblement, les pousse vers ce qui loupe, rate et déçoit ; passe à côté, échoue et frustre ; percute de plein fouet ou manque d’un rien et désole d’autant plus.
De l’insuccès au ratage, incontestables maestros du fiasco, ces voyageurs sont donc surprenants en ce que, invariablement, ils sont les responsables de leurs échecs. Agaçants de morgue ou désarmants de naïveté face au Monde et à l’Autre, les uns sont horripilants et les autres touchants. Mais par-delà, ils sont surtout d’une remarquable obstination dans l’infortune, ce dont on aimerait bien saisir les raisons…
D’hier et d’aujourd’hui, et même de demain, nul n’est épargné dans cet essai. Avant tout consacré à l’homme ordinaire, tout un chacun avec un peu de bonne foi devrait s’y retrouver. « Héros commun. Personnage disséminé. Marcheur innombrable », comme l’a évoqué Michel de Certeau1, cet homme sera ici le plus souvent une multitude anonyme de voyageurs sans qualités particulières. Contrairement aux voyageurs de Baudelaire, ceux-là ne sont pas étonnants. Ils ne sont que surprenants et surpris, pris en flagrant délit d’imperfection dans leur quête d’idéal.
En fait, quant à l’étonnement, le participe passé leur va mieux. Car ces voyageurs sont en général d’éternels étonnés. Leurs galères, péripéties, tribulations et autres mésaventures, bien qu’elles soient banales, et même fort prévisibles, les étonnent toujours. Depuis des lustres, ils ont pour coutume de tomber dans les pièges signalés ; de se heurter aux obstacles connus ; de faire des erreurs grossières ; et de recommencer. Rien n’y fait. Franchement, ce qu’ils font et disent est si habituel, pour ne pas dire convenu, que ces voyageurs n’ont rien d’étonnant, sauf leur acharnement ! Leur goût immodéré de la récidive ! Le mystère de leur opiniâtreté ! Est-ce celle de la revanche ? De la poursuite de la perfection ? De l’addiction ?
Surpris sempiternels, tour à tour stupéfaits, sidérés, consternés, les stupéfactions de ces voyageurs sont stupéfiantes ; leurs sidérations, sidérantes ; et leurs consternations, consternantes. Ce sont leurs surprises qui surprennent et leurs étonnements qui étonnent, portés qu’ils sont par ce qui semble être une aptitude à la désillusion ; une vocation à tomber des nues ; une prédilection ou une attraction indéfectible, voire une compétence, pour le fourvoiement et le désenchantement, laquelle, irrésistiblement, les pousse vers ce qui loupe, rate et déçoit ; passe à côté, échoue et frustre ; percute de plein fouet ou manque d’un rien et désole d’autant plus.
De l’insuccès au ratage, incontestables maestros du fiasco, ces voyageurs sont donc surprenants en ce que, invariablement, ils sont les responsables de leurs échecs. Agaçants de morgue ou désarmants de naïveté face au Monde et à l’Autre, les uns sont horripilants et les autres touchants. Mais par-delà, ils sont surtout d’une remarquable obstination dans l’infortune, ce dont on aimerait bien saisir les raisons…
Pour autant, ce n’est pas la raison pour laquelle la question du « voyage raté » a été préférée à celle du « vrai voyage ». Même « stupide », cette dernière n’est pas sans intérêt. Car ceux qui la posent, et la façon dont ils y répondent, nous en apprennent beaucoup, des cercles affinitaires aux évolutions des stratégies collectives de mobilité, sur les imaginaires culturels du voyage, leurs tendances et leurs mutations dans notre société. Ce pourrait être l’objet d’une autre étude.
Si donc la question du « vrai voyage » n’est pas considérée ici comme une bonne question, c’est qu’à nos yeux il n’y a pas de voyage qui ne serait pas vrai. Tous le sont, chacun étant porteur d’une vérité, d’un idéal, d’une perfection, d’un absolu. D’une part, si la vérité est un désir de conformité entre un acte et une idée : un geste et un concept, une expérience et un projet, alors tout voyage est vrai car il est avant tout ce désir, qu’il soit par la suite, une fois pris dans les turbulences du réel, comblé ou déçu. Et puis, d’autre part, pourquoi le voyage devrait-il être ou X ou Y ? A ou non A ? S’il y a une vérité du voyage, quelle qu’elle soit, pourquoi devrait-elle se soumettre à ce principe de contradiction ? Au nom de quoi ? Sous la haute autorité de qui ? La véracité du voyage et sa possible négation ne posent après tout, en référence à une supposée essence universelle et un supposé désir commun d’y accéder, qu’un faux problème. Alors doit-on rester captif de cette mystique-là, toujours en attente de la révélation du voyage « vrai de vrai » ? Du voyage AOC ?
Si donc la question du « vrai voyage » n’est pas considérée ici comme une bonne question, c’est qu’à nos yeux il n’y a pas de voyage qui ne serait pas vrai. Tous le sont, chacun étant porteur d’une vérité, d’un idéal, d’une perfection, d’un absolu. D’une part, si la vérité est un désir de conformité entre un acte et une idée : un geste et un concept, une expérience et un projet, alors tout voyage est vrai car il est avant tout ce désir, qu’il soit par la suite, une fois pris dans les turbulences du réel, comblé ou déçu. Et puis, d’autre part, pourquoi le voyage devrait-il être ou X ou Y ? A ou non A ? S’il y a une vérité du voyage, quelle qu’elle soit, pourquoi devrait-elle se soumettre à ce principe de contradiction ? Au nom de quoi ? Sous la haute autorité de qui ? La véracité du voyage et sa possible négation ne posent après tout, en référence à une supposée essence universelle et un supposé désir commun d’y accéder, qu’un faux problème. Alors doit-on rester captif de cette mystique-là, toujours en attente de la révélation du voyage « vrai de vrai » ? Du voyage AOC ?
Dans le souci d’échapper aux impasses et vaines disputes auxquelles conduit invariablement une sophistique sectaire faite, comme il se doit, de faux raisonnements et de mauvaise foi, je préciserai d’entrée que l’idée de cet essai est d’abord issue du refus de la sempiternelle question du « vrai voyage ». Ce fétichisme de la véracité empoisonne depuis trop longtemps attitudes et usages (les discours comme l’expérience, la réflexion savante aussi bien que le sens commun et les pratiques du voyage) et il a fait obstacle à une pensée détachée de cette quête obsessionnelle, qui a vu et voit encore nombre de voyageurs, partant à la poursuite du « Voyage perdu », toujours à l’affût de quartiers de noblesse, d’agrégation à une élite, de grands ancêtres et autres légitimités historiques et distinctives faute d’empreintes génétiques — faute d’ADN du « vrai voyage »…
Si millénaire, chinoise et philosophique qu’elle ait été, et au vu des multiples réponses qu’elle a suscitées — le problème n’étant pas qu’on ne peut y répondre, mais que tout le monde croit pouvoir y répondre —, cette question semble n’avoir jamais eu au final d’autre enjeu que d’imposer une norme. Et elle n’a eu de fait d’autre effet que de diviser la communauté des voyageurs en écoles rivales du voyage, sectes, clans, clubs ou classes. Tel Hamlet contemplant le crâne de Yorick, cette question en a même torturé certains doutant de leur identité. Être ou ne pas être un « vrai voyageur », ce serait là la question…
Si millénaire, chinoise et philosophique qu’elle ait été, et au vu des multiples réponses qu’elle a suscitées — le problème n’étant pas qu’on ne peut y répondre, mais que tout le monde croit pouvoir y répondre —, cette question semble n’avoir jamais eu au final d’autre enjeu que d’imposer une norme. Et elle n’a eu de fait d’autre effet que de diviser la communauté des voyageurs en écoles rivales du voyage, sectes, clans, clubs ou classes. Tel Hamlet contemplant le crâne de Yorick, cette question en a même torturé certains doutant de leur identité. Être ou ne pas être un « vrai voyageur », ce serait là la question…
Il ne s’agira pas de reconstituer l’image des bons, des beaux ou des grands voyages réussis : héroïques, insolites ou simplement heureux — de ces voyages bénis des dieux qui, avec ou sans accroc, traversent le réel et atteignent leur but conformément à l’idéal fixé, ajustant les faits au projet, l’expérience au rêve, et qui, en une apothéose jubilatoire, parviennent parfois même à les excéder. Ces bons, ces beaux, ces merveilleux voyages ne nous intéressent pas.
Pourquoi ? Parce qu’on leur préférera ici ceux que taraude l’échec en ce que ce sentiment est un révélateur. Il l’est avant, éprouvé comme intuition, appréhension, phobie. Pendant, ressenti comme erreur, accident ou désordre incoercible. Et après, traduit par le remords, le regret, la révolte ou la mélancolie. Anticipé, vécu ou souvenu, l’échec est cette scène pathétique qui voit, prématurée, progressive ou ultime, la faillite d’un concept qui dévoile alors, outre une théorie contrariée et un imaginaire trahi à travers ses décombres, les incompatibilités de l’une et de l’autre avec la réalité, c’est-à-dire, au-delà du rêve brisé (son contenu, sa forme, son histoire), les conditions de possibilité (et donc d’impossibilité) de sa réalisation. C’est pour cela qu’on en apprend plus encore par l’échec que par le succès, comme d’ailleurs l’on en apprend davantage d’un système à travers ses dysfonctionnements ou ses pannes qu’à travers son fonctionnement…
Pourquoi ? Parce qu’on leur préférera ici ceux que taraude l’échec en ce que ce sentiment est un révélateur. Il l’est avant, éprouvé comme intuition, appréhension, phobie. Pendant, ressenti comme erreur, accident ou désordre incoercible. Et après, traduit par le remords, le regret, la révolte ou la mélancolie. Anticipé, vécu ou souvenu, l’échec est cette scène pathétique qui voit, prématurée, progressive ou ultime, la faillite d’un concept qui dévoile alors, outre une théorie contrariée et un imaginaire trahi à travers ses décombres, les incompatibilités de l’une et de l’autre avec la réalité, c’est-à-dire, au-delà du rêve brisé (son contenu, sa forme, son histoire), les conditions de possibilité (et donc d’impossibilité) de sa réalisation. C’est pour cela qu’on en apprend plus encore par l’échec que par le succès, comme d’ailleurs l’on en apprend davantage d’un système à travers ses dysfonctionnements ou ses pannes qu’à travers son fonctionnement…
Le seul voyage qui vaille est celui qui comble le voyageur. C’est le voyage qui existe et s’éprouve comme tel, avant d’être fait, pendant qu’il se fait et après qu’il soit fait. L’existence précède l’essence. Cela signifie que le voyage réussi existe d’abord et qu’il n’est défini qu’ensuite comme vrai, selon des critères extérieurs à son vécu.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jean-Didier Urbain
Quiz
Voir plus
10 phrases incomplètes ... mais drôles 😂 🤣
Les tôles ondulées ...
c'est beau et mien
les grands rhums aident
où est le bec ?
Adam part !
les vaches aussi
10 questions
433 lecteurs ont répondu
Thèmes :
jeux de mots
, humour
, loufoque
, maximesCréer un quiz sur cet auteur433 lecteurs ont répondu