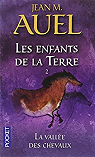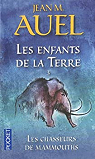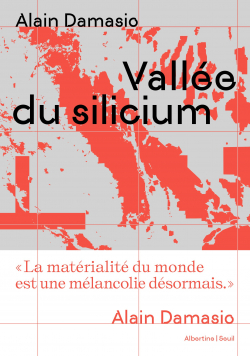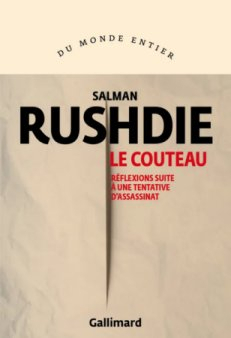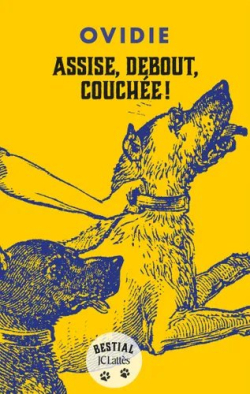Marylène Patou-Mathis/5
78 notes
Résumé :
" Non, les femmes préhistoriques ne consacraient pas tout leur temps à balayer la grotte et à garder les enfants en attendant que les hommes reviennent de la chasse. Les imaginer réduites à un rôle domestique et à un statut de mères relève du préjugé. Elles aussi poursuivaient les grands mammifères, fabriquaient des outils et des parures, construisaient les habitats, exploraient des formes d'expression symbolique. Aucune donnée archéologique ne prouve que, dans les ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'homme préhistorique est aussi une femme : Une histoire de l'invisibilité des femmesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (25)
Voir plus
Ajouter une critique
(...) Comme le fait remarquer avec espièglerie la préhistorienne dans son introduction, « Pour expliquer l'invisibilité des femmes préhistoriques, l'idée selon laquelle les vestiges archéologiques ne livrent guère d'éléments permettant de leur assigner un rôle social et économique est souvent avancée. Or il en est de même pour les hommes ! » On verra au fil de la lecture de ce livre iconoclaste que certains vestiges archéologiques sont cependant maintenant identifiables, et que les résultats de ces investigations démolissent ce qu'il faut bien appeler des stéréotypes de genre appliqués à la préhistoire. Celle-ci est née au milieu du XIXe siècle, et « Il est probable que les rôles tenus par les deux sexes décrits dans les premiers textes de cette nouvelle discipline aient plus à voir avec la réalité de l'époque qu'avec celle du temps des cavernes. » (...)
Les vestiges identifiables, pourtant, à la faveur de l'archéologie du genre, qui pose la question du genre en archéologie, livrent une vision des sociétés préhistoriques beaucoup moins homogène et stéréotypée que la préhistoire de papa. Il s'avère que les femmes préhistoriques sont de véritables athlètes, qu'elles chassent, sont guerrières parfois, dessinent au fond des grottes. En ce qui concerne les Vénus paléolithique, on les suppose, aujourd'hui, façonnées par des femmes et à leur usage, amulettes, aide-mémoire contraceptif ou calendrier obstétrical en raison du nombre d'encoches ou de sillons qu'elles portent. Ces hypothèses sont évidemment âprement critiquées, comme tout ce qui suppose aux femmes une maîtrise quelconque d'un aspect de leur vie. On voit aussi que les préjugés prétendument étayés par la science tels que le rôle des hormones dans la division sexuelle du travail ont chez certains préhistoriens contemporains la peau dure. Et pourtant… (...) les procédés d'analyse plus affinés aujourd'hui révèlent que certains guerriers enterrés avec leur apparat et leurs armes sont en fait des guerrières, que certains chefs aux riches tombeaux sont des cheffes. On trouve des traces de mains et de pieds de femmes jusqu'aux salles les plus reculées des grottes, et les empreintes de mains sont souvent féminines. Les ossatures féminines portent des blessures qu'on ne se fait pas en berçant les bambins et l'insertion des tendons atteste de musculatures puissantes. Les sociétés paléolithiques sont beaucoup plus horizontales qu'on l'avait supposé, et si certaines sociétés néolithiques voient l'avènement des hiérarchies, des subordinations de sexe et de la violence avec les formes nouvelles de propriété et de territoire, ce n'est pas le cas de toutes.
Patou-Mathis décortique ainsi les idées reçues en faisant un tour d'horizon des apports concrets, vérifiables, de la préhistoire actuelle, mais aussi de ce qui est encore invérifiable et invérifié et donne lieu à des hypothèses passionnantes une fois dépoussiéré le fond de misogynie originelle.(...)
C'est extrêmement bien construit et documenté, l'avéré y côtoie l'hypothétique et tout ce qui est invérifiable s'y voit renvoyé dos à dos, qu'il s'agisse du rôle supposé des femmes ou de celui non moins supposé des hommes. de surcroît, cet essai se lit comme un roman, la langue est vive, précise et sobre, et en apprenant des choses passionnantes on passe un excellent moment.
Lonnie pour Double Marge
Lien : https://revuelitteraire.fr/l..
Les vestiges identifiables, pourtant, à la faveur de l'archéologie du genre, qui pose la question du genre en archéologie, livrent une vision des sociétés préhistoriques beaucoup moins homogène et stéréotypée que la préhistoire de papa. Il s'avère que les femmes préhistoriques sont de véritables athlètes, qu'elles chassent, sont guerrières parfois, dessinent au fond des grottes. En ce qui concerne les Vénus paléolithique, on les suppose, aujourd'hui, façonnées par des femmes et à leur usage, amulettes, aide-mémoire contraceptif ou calendrier obstétrical en raison du nombre d'encoches ou de sillons qu'elles portent. Ces hypothèses sont évidemment âprement critiquées, comme tout ce qui suppose aux femmes une maîtrise quelconque d'un aspect de leur vie. On voit aussi que les préjugés prétendument étayés par la science tels que le rôle des hormones dans la division sexuelle du travail ont chez certains préhistoriens contemporains la peau dure. Et pourtant… (...) les procédés d'analyse plus affinés aujourd'hui révèlent que certains guerriers enterrés avec leur apparat et leurs armes sont en fait des guerrières, que certains chefs aux riches tombeaux sont des cheffes. On trouve des traces de mains et de pieds de femmes jusqu'aux salles les plus reculées des grottes, et les empreintes de mains sont souvent féminines. Les ossatures féminines portent des blessures qu'on ne se fait pas en berçant les bambins et l'insertion des tendons atteste de musculatures puissantes. Les sociétés paléolithiques sont beaucoup plus horizontales qu'on l'avait supposé, et si certaines sociétés néolithiques voient l'avènement des hiérarchies, des subordinations de sexe et de la violence avec les formes nouvelles de propriété et de territoire, ce n'est pas le cas de toutes.
Patou-Mathis décortique ainsi les idées reçues en faisant un tour d'horizon des apports concrets, vérifiables, de la préhistoire actuelle, mais aussi de ce qui est encore invérifiable et invérifié et donne lieu à des hypothèses passionnantes une fois dépoussiéré le fond de misogynie originelle.(...)
C'est extrêmement bien construit et documenté, l'avéré y côtoie l'hypothétique et tout ce qui est invérifiable s'y voit renvoyé dos à dos, qu'il s'agisse du rôle supposé des femmes ou de celui non moins supposé des hommes. de surcroît, cet essai se lit comme un roman, la langue est vive, précise et sobre, et en apprenant des choses passionnantes on passe un excellent moment.
Lonnie pour Double Marge
Lien : https://revuelitteraire.fr/l..
Attention le titre est un peu trompeur, ce livre interessant, errudi, et très documenté, est avant tout un essai féministe en trois parties.
La premiere : rien à voir avec la préhistoire, tente brillamment de démontrer que toute la science, les religions et la philosophie depuis les origines ne sont au service que des hommes (masculin) et elle démontre avec beaucoup d'exemples le traitement fait aux femmes jugées inferieures à l'homme jusqu'à une époque très récente (de Platon, à Darwin, Freud et beaucoup d'autres :presque tous !): on perçoit le ton très agacé de l'autrice.
La seconde (seule partie sur la préhistoire) à pour but de démontrer que rien, dans les découvertes faites dans cette science assez récente, ne montre que la société de ces époques était patriarcale, et que les femmes partageaient les travaux rudes, l'artisanat, la chasse, la guerre (contrairement au consensus scientifique qui les cantonait jusqu'alors plutôt à la reproduction)
La troisième partie parle des femmes rebelles de l'histoire de l'antiquité à aujourd'hui (scientifiques, politiques, guerrières, écrivaines,.....): préhistoire ou es tu ?
Le livre se termine par une conclusion purement féministe sur notre société actuelle. (les statistiques de femmes battues en France : que viennent elle faire la ?)
En résumé c'est intéressant, mais le titre (et la fonction de l'autrice : directrice de recherche CNRS sur la préhistoire), n'est pas en rapport avec le contenu.
La premiere : rien à voir avec la préhistoire, tente brillamment de démontrer que toute la science, les religions et la philosophie depuis les origines ne sont au service que des hommes (masculin) et elle démontre avec beaucoup d'exemples le traitement fait aux femmes jugées inferieures à l'homme jusqu'à une époque très récente (de Platon, à Darwin, Freud et beaucoup d'autres :presque tous !): on perçoit le ton très agacé de l'autrice.
La seconde (seule partie sur la préhistoire) à pour but de démontrer que rien, dans les découvertes faites dans cette science assez récente, ne montre que la société de ces époques était patriarcale, et que les femmes partageaient les travaux rudes, l'artisanat, la chasse, la guerre (contrairement au consensus scientifique qui les cantonait jusqu'alors plutôt à la reproduction)
La troisième partie parle des femmes rebelles de l'histoire de l'antiquité à aujourd'hui (scientifiques, politiques, guerrières, écrivaines,.....): préhistoire ou es tu ?
Le livre se termine par une conclusion purement féministe sur notre société actuelle. (les statistiques de femmes battues en France : que viennent elle faire la ?)
En résumé c'est intéressant, mais le titre (et la fonction de l'autrice : directrice de recherche CNRS sur la préhistoire), n'est pas en rapport avec le contenu.
Ayant adoré un précédent ouvrage de l'autrice (“Madame de Néandertal”), je me suis précipitée... et j'ai été déçue. Même si le sujet traité est assez intéressant, le contenu n'est pas très fidèle à ce que l'autrice vend dans les médias ! J'espérais tout savoir de la vie de nos ancêtres et après cette lecture, je reste sur ma faim.
LA STRUCTURE : Ce livre se divise en deux grandes parties : l'une sur l'histoire de l'invisibilisation des femmes par les préhistoriens, l'autre sur la femme préhistorique elle-même.
La première moitié de l'ouvrage décrit très (trop ?) précisément les injustices faites à la femme préhistorique pendant le 19ème siècle par les savants. J'ai eu beaucoup de mal à arriver au bout car il y a des redondances et une surabondance de longues citations. J'ai même dû sauter quelques pages pour ne pas abandonner l'ouvrage. le ton est très (trop ?) militant. Féministe de l'ancienne génération, j'ai personnellement trouvé le ton déplaisant car parfois trop agressif.
La seconde moitié de l'ouvrage (celle qui, au final, m'a attirée vers le livre) semble avoir été escamotée. Les paragraphes thématiques deviennent beaucoup plus courts comme si l'autrice n'était finalement pas très inspirée par la vie de nos ancêtres. Qui était vraiment les femmes de cette période ? Au final je n'en sais pas grand chose car les exemples sont très rapidement expliqués, sans effort de contextualisation, et toujours ramenés à la vision 19èmiste pour une critique cinglante.
CONCLUSION : C'est un livre très érudit, à ne pas mettre entre toutes les mains... Il n'y a pas eu d'effort pour rendre le langage accessible et la lecture fluide. J'ai l'impression que l'autrice n'a pas eu envie de s'adresser au grand public mais plutôt d'instrumentaliser la femme préhistorique pour produire un plaidoyer néo-féministe. Cette lecture aurait pu me plaire si on me l'avait vendue comme telle mais, attendant autre chose, je ressors de la lecture profondément frustrée.
LA STRUCTURE : Ce livre se divise en deux grandes parties : l'une sur l'histoire de l'invisibilisation des femmes par les préhistoriens, l'autre sur la femme préhistorique elle-même.
La première moitié de l'ouvrage décrit très (trop ?) précisément les injustices faites à la femme préhistorique pendant le 19ème siècle par les savants. J'ai eu beaucoup de mal à arriver au bout car il y a des redondances et une surabondance de longues citations. J'ai même dû sauter quelques pages pour ne pas abandonner l'ouvrage. le ton est très (trop ?) militant. Féministe de l'ancienne génération, j'ai personnellement trouvé le ton déplaisant car parfois trop agressif.
La seconde moitié de l'ouvrage (celle qui, au final, m'a attirée vers le livre) semble avoir été escamotée. Les paragraphes thématiques deviennent beaucoup plus courts comme si l'autrice n'était finalement pas très inspirée par la vie de nos ancêtres. Qui était vraiment les femmes de cette période ? Au final je n'en sais pas grand chose car les exemples sont très rapidement expliqués, sans effort de contextualisation, et toujours ramenés à la vision 19èmiste pour une critique cinglante.
CONCLUSION : C'est un livre très érudit, à ne pas mettre entre toutes les mains... Il n'y a pas eu d'effort pour rendre le langage accessible et la lecture fluide. J'ai l'impression que l'autrice n'a pas eu envie de s'adresser au grand public mais plutôt d'instrumentaliser la femme préhistorique pour produire un plaidoyer néo-féministe. Cette lecture aurait pu me plaire si on me l'avait vendue comme telle mais, attendant autre chose, je ressors de la lecture profondément frustrée.
J'ai découvert ce livre lors du passage de Marylène Patou-Mathis sur un plateau de télévision. En quelques minutes, elle a réussi à attirer mon intérêt et j'ai voulu en savoir plus.
L'autrice est une préhistorienne mais cet essai sur les femmes ne concerne pas uniquement cette période. Plus globalement il s'intéresse au rôle des femmes dans l'Histoire. le sous-titre « Une histoire de l'invisibilité des femmes » est donc beaucoup plus représentatif du contenu.
« Cela a toujours été comme ça ! » Cette phrase que l'on entend souvent pour justifier des injustices est fortement mis à mal par ce texte. En effet, l'essayiste utilise ses connaissances de l'âge de pierre afin de mettre le doigt sur des préjugés ancestraux. En revenant aux premières origines, elle tente de prouver que le patriarcat est une création de l'homme et non une chose innée.
Au fil des pages, il nous est raconté la position de la gente féminine par rapport aux hommes. A travers les différentes époques, le récit pointe les moments clés dans l'histoire qui ont fait pencher la balance du côté masculin. La religion, les philosophes et les scientifiques ont tant ressassé leurs messages dégradants que ces idées reçues se sont ancrés dans les esprits et qu'il est difficile encore aujourd'hui de changer les choses.
Toutes les informations récoltées par l'autrice sont très instructives et apportent des arguments importants au féminisme et au combat pour l'égalité. Je regrette seulement que le livre soit unilatéral. Je conçois que c'était l'objectif du projet mais sans nuance, la force du discours est un peu atténuée sur la longueur. Ceci étant dit, je conseille la lecture de ce livre, érudit et bien documenté, qui permet d'ouvrir certaines portes et de faire avancer la cause. Quand l'Histoire remet les femmes à leurs véritables places !
Lien : http://leslivresdek79.com/20..
L'autrice est une préhistorienne mais cet essai sur les femmes ne concerne pas uniquement cette période. Plus globalement il s'intéresse au rôle des femmes dans l'Histoire. le sous-titre « Une histoire de l'invisibilité des femmes » est donc beaucoup plus représentatif du contenu.
« Cela a toujours été comme ça ! » Cette phrase que l'on entend souvent pour justifier des injustices est fortement mis à mal par ce texte. En effet, l'essayiste utilise ses connaissances de l'âge de pierre afin de mettre le doigt sur des préjugés ancestraux. En revenant aux premières origines, elle tente de prouver que le patriarcat est une création de l'homme et non une chose innée.
Au fil des pages, il nous est raconté la position de la gente féminine par rapport aux hommes. A travers les différentes époques, le récit pointe les moments clés dans l'histoire qui ont fait pencher la balance du côté masculin. La religion, les philosophes et les scientifiques ont tant ressassé leurs messages dégradants que ces idées reçues se sont ancrés dans les esprits et qu'il est difficile encore aujourd'hui de changer les choses.
Toutes les informations récoltées par l'autrice sont très instructives et apportent des arguments importants au féminisme et au combat pour l'égalité. Je regrette seulement que le livre soit unilatéral. Je conçois que c'était l'objectif du projet mais sans nuance, la force du discours est un peu atténuée sur la longueur. Ceci étant dit, je conseille la lecture de ce livre, érudit et bien documenté, qui permet d'ouvrir certaines portes et de faire avancer la cause. Quand l'Histoire remet les femmes à leurs véritables places !
Lien : http://leslivresdek79.com/20..
(...)
J'avoue que je ne savais pas exactement à quoi m'attendre avec ce livre et la surprise n'en a été que meilleure: ç'a été une très bonne lecture! Et l'autrice colle à la fois à son titre et à son sous-titre.
C'est-à-dire qu'elle part de la Préhistoire pour arriver à nos jours, d'abord pour décrypter comment les femmes ont été invisibilisées par l'Histoire, puis comment les éléments découverts sur la Préhistoire ont été interprétés jusqu'ici et la façon dont ils auraient pu l'être de façon plus objective. En gros, l'Histoire est aussi écrite en fonction de qui l'écrit et de la société dans laquelle il vit. « Il » n'étant pas un sujet neutre, mais représentant bel et bien un « qui » masculin, dans 99,9% des cas.
Je n'ai que deux reproches à faire à cet essai: l'autrice emploie parfois des mots un peu compliqués pour la lectrice lambda que je suis, sans les expliquer, et c'est un peu fastidieux de s'interrompre pour chercher leur sens quand on ne le comprend pas avec le contexte; d'autre part, il y a environ une centaine de pages de notes et c'est extrêmement pénible de constamment devoir se référer à la fin de l'ouvrage (parfois il y a plus de 5 notes par page…), surtout que dans certains cas, il s'agit uniquement de citer un titre de livre… Ces deux points ralentissent une lecture qui, en dehors de ça, est très fluide et font parfois perdre le fil de l'idée qu'on était en train de suivre. C'est d'autant plus dommage que certaines de ces notes auraient pu être insérées directement dans le texte (par exemple des citations, puisque d'autres le sont déjà).
Ma lecture a été encore plus intéressante du fait que j'ai lu récemment le Chant du Bison d'Antonio Perez Henares et que j'ai pu constater presque « en temps réel » la véracité des faits soulignés par Marylène Patou-Mathis lorsqu'elle évoque la lecture patriarcale des artefacts préhistoriques mis au jour par les scientifiques.
Il est assez difficile de parler de ce livre, comme de la plupart des essais. Je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai lu, je ne pourrais que le faire mal, n'étant ni historienne, ni sociologue ou anthropologue (ou autre mot en -logue). Je me contenterai de vous conseiller cette lecture passionnante et très instructive!
Lien : https://bienvenueducotedeche..
J'avoue que je ne savais pas exactement à quoi m'attendre avec ce livre et la surprise n'en a été que meilleure: ç'a été une très bonne lecture! Et l'autrice colle à la fois à son titre et à son sous-titre.
C'est-à-dire qu'elle part de la Préhistoire pour arriver à nos jours, d'abord pour décrypter comment les femmes ont été invisibilisées par l'Histoire, puis comment les éléments découverts sur la Préhistoire ont été interprétés jusqu'ici et la façon dont ils auraient pu l'être de façon plus objective. En gros, l'Histoire est aussi écrite en fonction de qui l'écrit et de la société dans laquelle il vit. « Il » n'étant pas un sujet neutre, mais représentant bel et bien un « qui » masculin, dans 99,9% des cas.
Je n'ai que deux reproches à faire à cet essai: l'autrice emploie parfois des mots un peu compliqués pour la lectrice lambda que je suis, sans les expliquer, et c'est un peu fastidieux de s'interrompre pour chercher leur sens quand on ne le comprend pas avec le contexte; d'autre part, il y a environ une centaine de pages de notes et c'est extrêmement pénible de constamment devoir se référer à la fin de l'ouvrage (parfois il y a plus de 5 notes par page…), surtout que dans certains cas, il s'agit uniquement de citer un titre de livre… Ces deux points ralentissent une lecture qui, en dehors de ça, est très fluide et font parfois perdre le fil de l'idée qu'on était en train de suivre. C'est d'autant plus dommage que certaines de ces notes auraient pu être insérées directement dans le texte (par exemple des citations, puisque d'autres le sont déjà).
Ma lecture a été encore plus intéressante du fait que j'ai lu récemment le Chant du Bison d'Antonio Perez Henares et que j'ai pu constater presque « en temps réel » la véracité des faits soulignés par Marylène Patou-Mathis lorsqu'elle évoque la lecture patriarcale des artefacts préhistoriques mis au jour par les scientifiques.
Il est assez difficile de parler de ce livre, comme de la plupart des essais. Je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai lu, je ne pourrais que le faire mal, n'étant ni historienne, ni sociologue ou anthropologue (ou autre mot en -logue). Je me contenterai de vous conseiller cette lecture passionnante et très instructive!
Lien : https://bienvenueducotedeche..
Citations et extraits (25)
Voir plus
Ajouter une citation
Au sein des premieres églises paléochrétiennes, comme on le voit sur les fresques des catacombes romaines de Priscille (entre le IIe et le Ve siècle) restaurées récemment, des fernmes pouvaient célébrer la messe - une interprétation que conteste le Vatican. Dès que le christianisme devient une Eglise avec ses dogmes et ses lois, les fernmes sont très vite exclues des fonctions sacerdotales. Si, dans un premier temps, I'Église senble tenir un rôle protecteur à l'égard des femnes, au fur et à mesure que son pouvoir se consolide, «un mouvement régressif» se met en place. Le cas d'Hypatie est exemplaire. Elle est assassinée en mars 415 par un groupe de moines chrétiens, qui, n'acceptant pas qu'une femme soit érudite, la démembrèrent et la brûlèrent. Ils en feront, bien malgré eux, une «martyre de la philosophie», égérie des opposants au christianisme. Il faut se souvenir que ce n'est qu'en 1957 que le pape Pie XII déclara que l'homme et la femme sont égaux en droits et en dignité.
Les couvents de femmes, apparus au VIe siècle, en assurant à certaines femmes une sécurité matérielle, leur offrent la possibilité d'une vie spirituelle et parfois intellectuelle. IIs sont dirigés par des abbesses qui exercent un pouvoir égal à celui des abbés. Certaines connaîtront une grande renommée, comme au XIIe siècle, l'érudite Hildegarde de Bingen, auteure de nombreux livres.
Les couvents de femmes, apparus au VIe siècle, en assurant à certaines femmes une sécurité matérielle, leur offrent la possibilité d'une vie spirituelle et parfois intellectuelle. IIs sont dirigés par des abbesses qui exercent un pouvoir égal à celui des abbés. Certaines connaîtront une grande renommée, comme au XIIe siècle, l'érudite Hildegarde de Bingen, auteure de nombreux livres.
«Toute l'histoire des femmes a été faite par les hommes», écrivait Simone de Beauvoir. Sans surprise, le regard porté sur les humains préhistoriques est masculin. Les premiers préhistoriens vont calquer sur leur objet d'étude le modèle patriarcal de la répartition des rôles entre les sexes. On retrouve cette vision genrée jusqu'au début de la seconde moitié du XXe siècle, période pendant laquelle l'étude de l'évolution humaine demeure une sphère intellectuelle investie essentiellement par des hommes. Les travaux menés en anthropologie, en préhistoire et en archéologie peuvent être qualifiés d'androcentrés, les rapports sociaux dans lesquels les femmes sont impliquées y étant rarement pris en considération.
Tout au long du XIXe siècle, face aux disparités liées au sexe dans l'instruction, des femmes, soutenues par quelques hommes, vont lutter pour l'accès à la même éducation. Les plus grandes avancées vont avoir lieu sous la IIe République et surtout durant le Second Empire. Cependant, si les lois de Duruy (du 10 avril et 30 octobre 1867) obligent les communes de plus de 500 habitants à créer des écoles primaires et secondaires de filles, les programmes restent définis en fonction des rôles sociaux assignés aux femmes : travaux ménagers et puériculture.
S'appuyant sur les textes sacrés des diverses religions, tant monothéistes que polythéistes, théologiens, savants et philosophes ont décrété des siècles durant que les femmes étaient inférieures par «ordre divin» et par «nature ». Ainsi ont-ils pu justifier leur subordination, la différenciation des deux sexes étant prétendument nécessaire à l'harmonie «naturelle» de la famille et de la société. Au IVe siècle, si saint Augustin affirme légalité des deux sexes «dans I'ordre de la grâce», c'est-à-dire au ciel, il maintient I'infériorité des femmes dans «l'ordre de la nature», c'est-à-dire dans l'histoire. Argument qui sera maintes fois utilisé pour les exclure des sphères sociale et politique.
Dès les années 1970, des anthropologues et des sociologues, notamment anglo-saxons, vont opposer à la thèse du déterminisme biologique le concept de «genre», terme qui, à la diférence de «sexe», n'a pas une connotation biologique mais culturelle. Pour ses partisans, c'est la construction sociale qui assignerait un sens aux différences sexuelle. Les psychanalystes rejettent eux aussi le principe d'une identité sexuelle biologiquement déterminée. Pour Sigmund Freud et ses disciples, la sexualité étant tout autant liée à une représentation sociale, mentale ou subjective qu'à une différence anatomique, la différence des sexes n'existe pas dans I'inconscient et aucune personne n'est spécifiquement masculine ou féminine. Ce que soutiennent également dans les annees 2000 de nombreux neurobiologistes.
Videos de Marylène Patou-Mathis (9)
Voir plusAjouter une vidéo
Plus de 30 000 ans avant notre ère, plusieurs espèces d'humains ont cohabité, dont les Homo Sapiens et les Homo Neanderthalensis. Que se passerait-il si ces espèces pouvaient à nouveau se rencontrer ? Noëlle Michel a exploré cette question dans un roman, appuyée par l'éclairage scientifique de Marylène Patou-Mathis.
#bookclubculture #préhistoire #histoire __________ Venez participer au Book club, on vous attend par ici https://www.instagram.com/bookclubculture_ Et sur les réseaux sociaux avec le hashtag #bookclubculture
Retrouvez votre rendez-vous littéraire quotidien https://youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDrqL4fBA4¤££¤6Homo Sapiens16¤££¤ ou sur le site https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/bienvenue-au-book-club-part-2
Suivez France Culture sur : Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture
#bookclubculture #préhistoire #histoire __________ Venez participer au Book club, on vous attend par ici https://www.instagram.com/bookclubculture_ Et sur les réseaux sociaux avec le hashtag #bookclubculture
Retrouvez votre rendez-vous littéraire quotidien https://youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDrqL4fBA4¤££¤6Homo Sapiens16¤££¤ ou sur le site https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/bienvenue-au-book-club-part-2
Suivez France Culture sur : Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture
+ Lire la suite
autres livres classés : préhistoireVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Marylène Patou-Mathis (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3240 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3240 lecteurs ont répondu