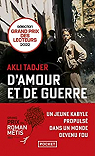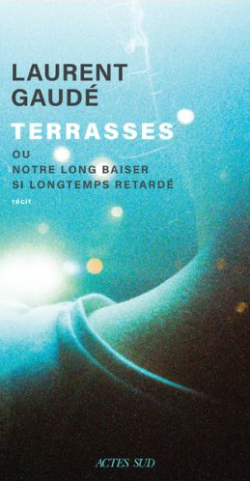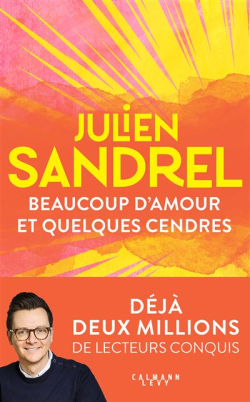Gwenaëlle Lenoir/5
55 notes
Résumé :
Un matin, un photographe militaire voit arriver, à l'hôpital où il travaille, quatre corps torturés. Puis d'autres, et d'autres encore. Au fil des clichés réglementaires qu'il est chargé de prendre, il observe, caché derrière son appareil photo, son pays s'abîmer dans la terreur. Peu à peu, lui qui n'a jamais remis en cause l'ordre établi se pose des questions. Mais se poser des questions, ce n'est pas prudent.
Avec une justesse troublante, ce roman raconte ... >Voir plus
Avec une justesse troublante, ce roman raconte ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Camera obscuraVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (30)
Voir plus
Ajouter une critique
Il y a très longtemps, au collège, nous avons eu comme lecture cursive un ouvrage avec le même titre "Camera obscura", un recueil de nouvelles de 1839 et un classique de la littérature néerlandaise de la main de Hildebrand, le pseudonyme de Nicolaas Beets, traduit en Français comme "La Chambre obscure".
La "Camera obscura" de Gwenaëlle Lenoir est une toute autre histoire, mille fois plus captivante, quand bien même s'il s'agit d'un récit angoissant et oppressant.
Un récit, par ailleurs, véridique.
Le narrateur (sans nom), marié avec sa bien-aimée Ania, une laborantine, et père de deux charmants enfants, Najma et Jamil, a une drôle de profession : il doit prendre des photos des morts qui arrivent à la morgue de l'hôpital militaire de son pays.
Comme son nom, ce pays n'est pas spécifié non plus, mais par recoupement tout porte à croire qu'il est question du paradis dictatorial de Bashar al-Assad, autrement dit la Syrie en pleine guerre civile, aidée par un autre despote criminel, l'occupant actuel du Kremlin.
Nous n'assistons pas aux combats proprement dits, mais nous suivons notre photographe des services secrets (syriens), qui reçoit à la morgue des livraisons de corps suppliciés plus ou moins atrocement, en nombre toujours croissant.
Ces corps martyrisés sont ceux des opposants au régime d'Assad, fréquemment des adolescents, comme le pauvre jeune Azzam Azzaz, à peine 16 ans, par exemple.
Notre photographe, un homme consciencieux et humain, souffre de plus en plus de sa tâche horrible, il passe des nuits blanches et finit par se sentir totalement déphasé.
Il n'en peut plus, mais se trouve coincé par son amour pour Ania et ses gosses.
Et en plus, il vit dans une peur constante.
À vous de découvrir s'il réussira à s'en sortir.
Gwenaëlle Lenoir nous offre dans cet ouvrage un aperçu dramatique des conditions de vie épouvantables dans la Syrie de père et fils Assad, avec tous ses morts et un nombre record d'exilés. La Syrie compte, selon l'ONU, le plus grand nombre de réfugiés au monde, soit environ 6,6 millions ou un quart de sa population globale.
Les atrocités dans l'objectif
Gwenaëlle Lenoir fait une entrée fracassante en littérature. Pour son premier roman, la journaliste a choisi de nous raconter les exactions du régime syrien à travers l'oeil d'un photographe chargé de faire cinq clichés de chaque cadavre arrivant à la morgue. Très vite, il ne va plus supporter ce que les morts lui disent. Mais il a aussi une famille à préserver.
Les premières lignes du livre, comme un photographe effectuant sa mise au point, nous expliquent que le personnage principal du roman est bien réel. «Ce photographe existe et vit caché quelque part en Europe. Son nom de code est César. Les atrocités décrites sont avérées, les faits sont documentés, mais sa voix est la mienne.» Si le pays et le président ne sont jamais cités, on comprend à la lecture et aux détails que nous sommes en Syrie sous le régime Bachar el-Assad.
On comprend aussi très vite que ce choix de discrétion est ici une question de vie ou de mort. Au fil des années, l'emprise du régime sur sa population s'est accentuée au point de rendre suspect tout regard un peu appuyé, toute remarque un tant soit peu critique. C'est dans ce contexte que le narrateur, photographe militaire, chargé de réaliser cinq photos règlementaires des cadavres livrés à la morgue, va comprendre que ses clichés racontent une histoire bien différente de celle qui figure sur les dossiers. Les blessures et les hématomes documentent la torture et l'homicide. Ce qui dans le service n'émeut plus personne, chacun ayant appris à ne jamais poser de questions et à détourner le regard. Tony et "moustache frémissante" vont même plus loin, entonnant un hymne à la gloire du régime dans l'espoir d'un avancement ou de privilèges.
César quant à lui se tait. Mais ce qu'il voit à travers son objectif s'imprime dans sa mémoire. Alors le soir, quand il rentre chez lui, il emporte avec lui toutes ces images perturbantes. Si Najma et Jamil, ses enfants, ne s'aperçoivent pas de ses doutes, Ania, son épouse, comprend très vite ses tourments et sa volonté de tout faire pour préserver les siens jusqu'à lui cacher la vérité: «Je ne parle pas des morts à Ania. Je les ramène pourtant à la maison, soir après soir. Au début, j'ai essayé de les semer. J'ai pris des chemins détournés pour rentrer. Mais ils m'ont suivi. Les morts sont des gens têtus. Ils m'accompagnent dans l'escalier de l'immeuble, rentrent dans l'appartement, dorment dans notre lit et commentent les informations à la télévision. Ils font les gros yeux quand Najma ou Jamil chantonnent leurs nouvelles comptines à la gloire du président.»
Aussi est-ce presque malgré lui qu'il enregistre ses photos sur une puce, qu'il note les noms sur une liste qui ne va cesser de s'allonger.
Gwenaëlle Lenoir réussit à merveille à rendre le dilemme qui l'assaille, entre son éthique et l'envie de protéger sa famille, entre l'envie de dénoncer les exactions de ce régime et le besoin quasi viscéral de ne pas abandonner les victimes aux mains de leurs bourreaux. «Je ne pouvais rien pour eux, seulement les photographier. Seulement refuser de participer à la danse macabre orchestrée par les employeurs des Tony de ce pays.»
Il va alors prendre de plus en plus de risques, se rapprocher d'un groupe de résistants et ainsi précipiter un épilogue d'une haute densité dramatique.
Si Gwenaëlle Lenoir s'est appuyée sur une histoire vraie, son écriture tout en ellipses et sa volonté de ne pas situer son récit dans le temps et l'espace, donnent à ce premier roman une valeur universelle. C'est le combat contre toutes les dictatures, la volonté de résistance, la soif d'humanité qui en font un bréviaire pour les temps troublés. C'est fort et émouvant. C'est une histoire bouleversante qui ne vous laissera pas indifférents.
NB. Tout d'abord, un grand merci pour m'avoir lu! Sur mon blog vous pourrez, outre cette chronique, découvrir les premières pages du livre. Vous découvrirez aussi mon «Grand Guide de la rentrée littéraire 2024».Enfin, en vous y abonnant, vous serez par ailleurs informé de la parution de toutes mes chroniques.
Lien : https://collectiondelivres.w..
Gwenaëlle Lenoir fait une entrée fracassante en littérature. Pour son premier roman, la journaliste a choisi de nous raconter les exactions du régime syrien à travers l'oeil d'un photographe chargé de faire cinq clichés de chaque cadavre arrivant à la morgue. Très vite, il ne va plus supporter ce que les morts lui disent. Mais il a aussi une famille à préserver.
Les premières lignes du livre, comme un photographe effectuant sa mise au point, nous expliquent que le personnage principal du roman est bien réel. «Ce photographe existe et vit caché quelque part en Europe. Son nom de code est César. Les atrocités décrites sont avérées, les faits sont documentés, mais sa voix est la mienne.» Si le pays et le président ne sont jamais cités, on comprend à la lecture et aux détails que nous sommes en Syrie sous le régime Bachar el-Assad.
On comprend aussi très vite que ce choix de discrétion est ici une question de vie ou de mort. Au fil des années, l'emprise du régime sur sa population s'est accentuée au point de rendre suspect tout regard un peu appuyé, toute remarque un tant soit peu critique. C'est dans ce contexte que le narrateur, photographe militaire, chargé de réaliser cinq photos règlementaires des cadavres livrés à la morgue, va comprendre que ses clichés racontent une histoire bien différente de celle qui figure sur les dossiers. Les blessures et les hématomes documentent la torture et l'homicide. Ce qui dans le service n'émeut plus personne, chacun ayant appris à ne jamais poser de questions et à détourner le regard. Tony et "moustache frémissante" vont même plus loin, entonnant un hymne à la gloire du régime dans l'espoir d'un avancement ou de privilèges.
César quant à lui se tait. Mais ce qu'il voit à travers son objectif s'imprime dans sa mémoire. Alors le soir, quand il rentre chez lui, il emporte avec lui toutes ces images perturbantes. Si Najma et Jamil, ses enfants, ne s'aperçoivent pas de ses doutes, Ania, son épouse, comprend très vite ses tourments et sa volonté de tout faire pour préserver les siens jusqu'à lui cacher la vérité: «Je ne parle pas des morts à Ania. Je les ramène pourtant à la maison, soir après soir. Au début, j'ai essayé de les semer. J'ai pris des chemins détournés pour rentrer. Mais ils m'ont suivi. Les morts sont des gens têtus. Ils m'accompagnent dans l'escalier de l'immeuble, rentrent dans l'appartement, dorment dans notre lit et commentent les informations à la télévision. Ils font les gros yeux quand Najma ou Jamil chantonnent leurs nouvelles comptines à la gloire du président.»
Aussi est-ce presque malgré lui qu'il enregistre ses photos sur une puce, qu'il note les noms sur une liste qui ne va cesser de s'allonger.
Gwenaëlle Lenoir réussit à merveille à rendre le dilemme qui l'assaille, entre son éthique et l'envie de protéger sa famille, entre l'envie de dénoncer les exactions de ce régime et le besoin quasi viscéral de ne pas abandonner les victimes aux mains de leurs bourreaux. «Je ne pouvais rien pour eux, seulement les photographier. Seulement refuser de participer à la danse macabre orchestrée par les employeurs des Tony de ce pays.»
Il va alors prendre de plus en plus de risques, se rapprocher d'un groupe de résistants et ainsi précipiter un épilogue d'une haute densité dramatique.
Si Gwenaëlle Lenoir s'est appuyée sur une histoire vraie, son écriture tout en ellipses et sa volonté de ne pas situer son récit dans le temps et l'espace, donnent à ce premier roman une valeur universelle. C'est le combat contre toutes les dictatures, la volonté de résistance, la soif d'humanité qui en font un bréviaire pour les temps troublés. C'est fort et émouvant. C'est une histoire bouleversante qui ne vous laissera pas indifférents.
NB. Tout d'abord, un grand merci pour m'avoir lu! Sur mon blog vous pourrez, outre cette chronique, découvrir les premières pages du livre. Vous découvrirez aussi mon «Grand Guide de la rentrée littéraire 2024».Enfin, en vous y abonnant, vous serez par ailleurs informé de la parution de toutes mes chroniques.
Lien : https://collectiondelivres.w..
Tous les jours, avec la même constance rigide, il applique le protocole à la lettre. Un rituel qui se répète inlassablement et qui consiste à enfiler sa blouse “le bras gauche en premier, laisser les pans flotter, tenir l'appareil photo du bras droit et pousser les battants de la porte avec l'épaule” avant d'entrer dans la morgue. Prendre cinq ou six clichés par corps et passer au suivant. Rester neutre, impassible, toujours, face à ces corps sans vie. Ne rien laisser paraître, ne pas changer les habitudes, jamais, car “c'est plus prudent”. Mais, ce jour-là, rien n'est comme d'habitude. le regard pesant des chefs derrière l'épaule, les ordres donnés, les corps mutilés, torturés sont autant de signes qui viennent alerter notre narrateur que sa normalité est en train de changer… L'angoisse monte, viscérale. Dans un pays dirigé par la tyrannie, le moindre faux pas, le moindre changement dans l'attitude, peut conduire à une dénonciation et tout droit dans les fourgons rouillés qui déposent les corps sans vie, mutilés, par dizaine tous les jours… Mais, face à l'horreur à l'état pur, est-il encore possible de se taire?
Quelle claque! J'ai été totalement happée et bouleversée par ce roman, qui n'en est pas vraiment un puisqu'il s'inspire de la vie de celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de code “César” et qui fût photographe légiste pour l'armée syrienne durant plusieurs années, notamment au moment des soulèvements révolutionnaires de 2011, avant d'être exfiltré en 2013. Grâce à lui et aux milliers de clichés qu'il a réussi à faire circuler, le monde a pu prendre conscience réellement des atrocités qui étaient commises en Syrie sous le régime de Bachir Al-Assad.
Avec le roman de Gwenaëlle Lenoir, on plonge au coeur de l'intériorité de cet homme qui a toujours respecté l'ordre établi, sans jamais le remettre en question et qui se retrouve, du jour au lendemain, à devoir faire un choix, un choix qui va contre ce qu'on lui a toujours appris et qui pourrait mettre en péril sa vie, mais aussi celle de sa famille, le choix de ne plus fermer les yeux sur les crimes commis par son régime… Avec une justesse bouleversante, l'autrice restitue le combat intime de cet homme, dévoré par la peur, le doute et la culpabilité, mais décidé à n'oublier aucun des morts dont il est le dépositaire.
Un texte percutant et fort, qui se lit d'une traite, la boule au ventre, presque en apnée. Un roman essentiel, qui redonne corps à une réalité que l'on connaît pourtant, que l'on suit à travers la presse, mais qui reste éloignée de nos préoccupations. “Camera obscura” marquera indéniablement cette rentrée littéraire d'hiver!
Merci aux éditions Julliard et à Babelio de m'avoir permis de faire cette découverte.
Quelle claque! J'ai été totalement happée et bouleversée par ce roman, qui n'en est pas vraiment un puisqu'il s'inspire de la vie de celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de code “César” et qui fût photographe légiste pour l'armée syrienne durant plusieurs années, notamment au moment des soulèvements révolutionnaires de 2011, avant d'être exfiltré en 2013. Grâce à lui et aux milliers de clichés qu'il a réussi à faire circuler, le monde a pu prendre conscience réellement des atrocités qui étaient commises en Syrie sous le régime de Bachir Al-Assad.
Avec le roman de Gwenaëlle Lenoir, on plonge au coeur de l'intériorité de cet homme qui a toujours respecté l'ordre établi, sans jamais le remettre en question et qui se retrouve, du jour au lendemain, à devoir faire un choix, un choix qui va contre ce qu'on lui a toujours appris et qui pourrait mettre en péril sa vie, mais aussi celle de sa famille, le choix de ne plus fermer les yeux sur les crimes commis par son régime… Avec une justesse bouleversante, l'autrice restitue le combat intime de cet homme, dévoré par la peur, le doute et la culpabilité, mais décidé à n'oublier aucun des morts dont il est le dépositaire.
Un texte percutant et fort, qui se lit d'une traite, la boule au ventre, presque en apnée. Un roman essentiel, qui redonne corps à une réalité que l'on connaît pourtant, que l'on suit à travers la presse, mais qui reste éloignée de nos préoccupations. “Camera obscura” marquera indéniablement cette rentrée littéraire d'hiver!
Merci aux éditions Julliard et à Babelio de m'avoir permis de faire cette découverte.
La 4ème de couverture résume bien le sujet en quelques phrases : Un matin, un photographe militaire voit arriver, à l'hôpital où il travaille, quatre corps torturés. Puis d'autres, et d'autres encore. Au fil des clichés réglementaires qu'il est chargé de prendre, il observe, caché derrière son appareil photo, son pays s'abîmer dans la terreur. Peu à peu, lui qui n'a jamais remis en cause l'ordre établi se pose des questions. Mais se poser des questions, ce n'est pas prudent. Avec une justesse troublante, ce roman raconte le cheminement saisissant d'un homme qui ose tourner le dos à son éducation et au régime qui a façonné sa vie. de sa discrétion, presque lâche, à sa colère et à son courage insensé, il dit comment il parvient à vaincre la folie qui le menace et à se dresser contre la barbarie.
Mon avis : le rythme est celui d'un roman policier ou d'un thriller avec un premier chapitre choc, totalement glaçant et pourtant addictif, il est déjà trop tard pour refermer le livre... Ensuite, retour en arrière : à l'hôpital militaire où les collègues du photographe sont acquis à la terrible répression policière qui touche les opposants au régime. Moustache, Tony, Freddy et Salim sont tous des militaires obéissant quels que soient les ordres, espérant une promotion, des avantages qu'on découvre dans l'effarement : argent extorqué aux familles, jusqu'aux viols et meurtres… Ce n'est pas une lecture pour les âmes trop sensibles et pas du tout une lecture pour s'endormir le soir. L'écriture de Gwenaëlle Lenoir nous met au coeur du choix : accepter l'ordre établi ou bien le contester et se mettre en danger... On a les scènes comme les voit le photographe de cette morgue qui ne désemplit pas. Freddy, une croix grossière et noire tatouée sur l'avant-bras droit, remplace Tony et apporte un saut dans l'horreur, lui qui « dit terroristes dix fois dans sa phrase, comme s'il donnait à manger au président sur son biceps. » Heureusement, on a en face de ces monstres, des résistants d'un courage qui force le respect, les Abou Georges, Aymar et surtout Abou Faisal !
Les sbires du président et les enfants « croient aux histoires simples du Grand Homme. » et il devient impossible d'apporter la contradiction sous peine de mort. le système de surveillance et la délation sont très bien rendus. J'ai été choqué de réaliser que Ania et son mari, le photographe, ne peuvent pas empêcher leurs enfants de chanter les chants à la louange du président appris à l'école, ce serait dangereux si ceux-ci parlaient mal du président ensuite. Et pourtant, avant ce chaos généralisé, une autre époque a existé.
Le photographe ne peut pas s'empêcher de garder une trace de ces crimes, réflexe d'humanité qui deviendra ensuite témoignage pour espérer que la justice soit possible.
Il transmet les photos à un réseau de résistants et devient ainsi un héros malgré lui, mettant sa femme Ania et ses deux enfants en danger. Il se met en danger s'il part de « l'hôpital » car il en sait trop. Il se met en danger s'il reste, tellement il est en retrait du comportement de haine de ses collègues. Il se met en danger s'il parle à Ania. « Ce n'est pas prudent » revient comme une rengaine tout au long du récit.
L'écriture est concise, terriblement efficace, toujours dans l'action, comme un oeil qui observe et imprime l'image, nous la rend exacte à chaque phrase comme une vraie chambre obscure avec l'image sur le papier photosensible. Sur des bannières, en ville, « Le président a le visage masqué par des lunettes de soleil d'aviateur, les lèvres serrées, le cou démesurément long, le menton levé. Il ne protège pas la ville. Il la mate. » Gwenaëlle Lenoir a des expressions définitives pour exprimer le malaise du photographe : « Dans la cour, j'ai respiré l'air des gaz d'échappements à grandes goulées » ou encore « A l'époque on ne tuait pas les enfants comme on écrase les insectes. »
Beau titre que ce Camera obscura, cette chambre obscure permettant de capter une image inversée de la réalité. Et cette pièce là où sont réceptionnés les « terroristes », en fait des manifestants ou des opposants, mérite bien d'être qualifiée d'obscure. L'autrice parvient à traquer ce moment où on ne peut plus fermer les yeux, ce moment où tout devient clair et terriblement dangereux, promesse de libération ou de mort. Alors il y a la peur qui prend de plus en plus de place et on tremble avec ces hommes, ces femmes, vivant au mauvais endroit, au mauvais moment.
Gwenaëlle Lenoir annonce : « Ce livre est un roman dont le personnage principal est réel. Ce photographe existe et vit caché quelque part en Europe. Son nom de code est César. Les atrocités décrites sont avérées, les faits sont documentés, mais sa voix est la mienne. » César, photographe légiste de la police militaire syrienne, a risqué sa vie pour documenter les crimes du régime de Bachar el-Assad entre 2011 et 2013.
Journaliste indépendante et spécialiste du monde arabe et de l'Afrique de l'Est, Gwenaëlle Lenoir, ancienne Grande reporter à France 3, a écrit pour la presse et Mediapart, notamment sur les bouleversements au Soudan depuis le destitution d'Omar el-Béchir en 2019. Elle montre ici qu'elle est aussi une autrice talentueuse. Son Camera obscura est un livre important, un des meilleurs lus dans le cadre de la sélection pour le prix Orange du livre 2024 auquel j'ai l'honneur de participer.
******
Chroniques avec photo sur blog Bibliofeel ou page Facebook Clesbibliofeel...
Lien : https://clesbibliofeel.blog/..
Mon avis : le rythme est celui d'un roman policier ou d'un thriller avec un premier chapitre choc, totalement glaçant et pourtant addictif, il est déjà trop tard pour refermer le livre... Ensuite, retour en arrière : à l'hôpital militaire où les collègues du photographe sont acquis à la terrible répression policière qui touche les opposants au régime. Moustache, Tony, Freddy et Salim sont tous des militaires obéissant quels que soient les ordres, espérant une promotion, des avantages qu'on découvre dans l'effarement : argent extorqué aux familles, jusqu'aux viols et meurtres… Ce n'est pas une lecture pour les âmes trop sensibles et pas du tout une lecture pour s'endormir le soir. L'écriture de Gwenaëlle Lenoir nous met au coeur du choix : accepter l'ordre établi ou bien le contester et se mettre en danger... On a les scènes comme les voit le photographe de cette morgue qui ne désemplit pas. Freddy, une croix grossière et noire tatouée sur l'avant-bras droit, remplace Tony et apporte un saut dans l'horreur, lui qui « dit terroristes dix fois dans sa phrase, comme s'il donnait à manger au président sur son biceps. » Heureusement, on a en face de ces monstres, des résistants d'un courage qui force le respect, les Abou Georges, Aymar et surtout Abou Faisal !
Les sbires du président et les enfants « croient aux histoires simples du Grand Homme. » et il devient impossible d'apporter la contradiction sous peine de mort. le système de surveillance et la délation sont très bien rendus. J'ai été choqué de réaliser que Ania et son mari, le photographe, ne peuvent pas empêcher leurs enfants de chanter les chants à la louange du président appris à l'école, ce serait dangereux si ceux-ci parlaient mal du président ensuite. Et pourtant, avant ce chaos généralisé, une autre époque a existé.
Le photographe ne peut pas s'empêcher de garder une trace de ces crimes, réflexe d'humanité qui deviendra ensuite témoignage pour espérer que la justice soit possible.
Il transmet les photos à un réseau de résistants et devient ainsi un héros malgré lui, mettant sa femme Ania et ses deux enfants en danger. Il se met en danger s'il part de « l'hôpital » car il en sait trop. Il se met en danger s'il reste, tellement il est en retrait du comportement de haine de ses collègues. Il se met en danger s'il parle à Ania. « Ce n'est pas prudent » revient comme une rengaine tout au long du récit.
L'écriture est concise, terriblement efficace, toujours dans l'action, comme un oeil qui observe et imprime l'image, nous la rend exacte à chaque phrase comme une vraie chambre obscure avec l'image sur le papier photosensible. Sur des bannières, en ville, « Le président a le visage masqué par des lunettes de soleil d'aviateur, les lèvres serrées, le cou démesurément long, le menton levé. Il ne protège pas la ville. Il la mate. » Gwenaëlle Lenoir a des expressions définitives pour exprimer le malaise du photographe : « Dans la cour, j'ai respiré l'air des gaz d'échappements à grandes goulées » ou encore « A l'époque on ne tuait pas les enfants comme on écrase les insectes. »
Beau titre que ce Camera obscura, cette chambre obscure permettant de capter une image inversée de la réalité. Et cette pièce là où sont réceptionnés les « terroristes », en fait des manifestants ou des opposants, mérite bien d'être qualifiée d'obscure. L'autrice parvient à traquer ce moment où on ne peut plus fermer les yeux, ce moment où tout devient clair et terriblement dangereux, promesse de libération ou de mort. Alors il y a la peur qui prend de plus en plus de place et on tremble avec ces hommes, ces femmes, vivant au mauvais endroit, au mauvais moment.
Gwenaëlle Lenoir annonce : « Ce livre est un roman dont le personnage principal est réel. Ce photographe existe et vit caché quelque part en Europe. Son nom de code est César. Les atrocités décrites sont avérées, les faits sont documentés, mais sa voix est la mienne. » César, photographe légiste de la police militaire syrienne, a risqué sa vie pour documenter les crimes du régime de Bachar el-Assad entre 2011 et 2013.
Journaliste indépendante et spécialiste du monde arabe et de l'Afrique de l'Est, Gwenaëlle Lenoir, ancienne Grande reporter à France 3, a écrit pour la presse et Mediapart, notamment sur les bouleversements au Soudan depuis le destitution d'Omar el-Béchir en 2019. Elle montre ici qu'elle est aussi une autrice talentueuse. Son Camera obscura est un livre important, un des meilleurs lus dans le cadre de la sélection pour le prix Orange du livre 2024 auquel j'ai l'honneur de participer.
******
Chroniques avec photo sur blog Bibliofeel ou page Facebook Clesbibliofeel...
Lien : https://clesbibliofeel.blog/..
@Camera obscura de @Gwenaëlle Lenoir est un livre d'une puissance phénoménale.
Les hommes sont fous. Notre terre tourne avec des hommes fous, devenus fous, rendus fous ; des bourreaux, des victimes, des victimes, des bourreaux ; des gouvernements tout puissants qui massacrent, torturent, exterminent ; des pays où un soupir peut être interprété comme un acte terroriste. Terroriste ? Oui ? Non ? Selon sa place sur l'échiquier politique. Selon l'époque. Notre monde n'a-t-il pas toujours été fou ? En France, lors de la 2ème guerre mondiale, sous le régime totalitaire de Vichy, nous avions nous-aussi nos terroristes. Il s'agissait alors de Jean Moulin ou d'autres résistants. Un monde où la peur devient compagne. La peur stupéfie, sidère mais elle révèle. Toujours.
Dans un pays du Moyen-Orient, un homme au long cou tétanise la population.
Lire @Camera obscura de @Gwenaëlle Lenoir, c'est comme se prendre un coup de poing dans le ventre. Cette lecture coupe le souffle.
@Camera obscura, c'est l'histoire d'un Syrien dans un contexte de cécité concertée. A l'international, les pays font mine de vouloir aider à trouver une solution politique mais les dictateurs d'ici ou là savent que les intérêts géopolitiques, économiques ou stratégiques des autres pays leur donnent le plus efficace des blancs-seings.
En réponse à la révolution pacifique et tellement pleine d'espoir de 2011, la vie en Syrie devient la quintessence d'un enfer totalitaire. La répression de Bachar el Assad est de plus en plus sanglante. Tortures, enlèvements indiscriminés, exécutions sommaires, procès à qui il ne reste du procès que le nom et le tout dans un climat d'insécurité attisé en permanence. Assad, entouré de ses militaires, miliciens, mouchards et autres affidés, a soigneusement maillé son filet et il surveille également le niveau d'enthousiasme de la population lors des nombreux événements dédiés à sa personne. le culte de la personnalité, Staline, perpétrant des horreurs, menant de front sa politique totalitaire, avait déjà montré le chemin. Chacun devait admirer et obéir au Grand Homme. Cette méthode du culte de l'homme providentiel sera souvent reproduite dans ces mêmes régimes politiques. Bachar el Assad en fait son miel.
@Camera Obscura commence comme l'histoire d'un jeune couple que l'on pourrait croire ordinaire, une femme, un homme, deux enfants, du travail et la sécurité dans les bras l'un de l'autre, l'intimité comme unique espace de liberté. Unique espace de liberté ? Ça fait tousser. Toujours être sur ses gardes : « Ce n'est pas prudent. ». Combien de fois cette phrase est-elle répétée dans le livre ? Tout le monde se méfie de tout le monde. La vie des Syriens, c'est comme un perpétuel travail d'équilibriste et ils ne sont pas si mauvais dans leurs nombreux et obligés numéros. Les filles du jeune couple fredonnent la dernière chanson apprise à l'école sur la grandeur du dictateur. Des gages ostentatoires d'adhésion, il faut en donner à ce régime autoritaire, bouche sèche et poings serrés. Sinon, « Ce n'est pas prudent. ». Pour le reste, tout se joue dans la sphère intime. Dans le silence, il exècre cette situation, César. Oui, César, c'est le pseudo de ce Syrien extraordinaire. Cinq lettres gravées dans la peur, la sueur et le sang. César est un photographe de cadavres déposés dans une morgue militaire. Photographe légiste, c'est son métier. Pour ne rien oublier, César, dans ce contexte où chaque Syrien est une cible potentielle, a pris l'habitude de garder en lui ses mots et ses pensées interdites qui ne cessent de virevolter, de se cogner et de dire la révolte dans sa tête. On ne peut quand même pas oublier qui l'on est, non ? Sa femme et lui regardent les infos interdites mais pour leurs filles, il ne faut même pas qu'elles puissent entendre le moindre souffle de la première syllabe d'un mot de critique ou d'opposition au régime. Voilà la réalité. Voilà la fatalité.
Voilà comment César devait protéger sa famille. Mais cette vie-là, il a fini par ne plus pouvoir s'en accommoder. Il n'en voulait plus, pour lui et encore moins pour ses enfants. Il n'en pouvait plus.
« Je devinais ses globes oculaires sous ses paupières gonflées. Je ne voulais pas savoir ce qu'ils avaient vu. J'ai regardé l'étiquette à son poignet droit, elle disait qu'il s'appelait Azzam Azzaz et qu'il avait seize ans. J'ai senti les larmes monter de ma gorge et je me suis réfugié derrière mon appareil. J'ai photographié Azzam. de haut en bas, centimètre par centimètre. Et puis encore de bas en haut. J'ai tout photographié. Chaque trace. Chaque coup. Chaque traînée de sang. Chaque os. J'ai fait pareil pour les autres. J'ai coincé mes larmes dans ma gorge et j'ai photographié. » (Trois)
César n'était pas né pour être un héros, il ne l'aurait même pas voulu. César tremblait pour sa famille. A certains moments, l'angoisse devenait si forte que s'il avait pu, il se serait barré en courant… Mais non, il ne pouvait laisser ce monde-là, son pays abîmé « dans des flots de sang » ; il ne pouvait laisser le pays de ses ancêtres devenir ce théâtre de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Alors, il y est allé, César ; jusqu'au bout. Photos dupliquées sur une clé USB, clés USB exfiltrées et pour finir, lui-aussi exfiltré.
Il a fait passer la frontière à des milliers de photos qui ont permis à tant de Syriens de connaître enfin le sort de leurs proches disparus. Ces cadavres torturés, énucléés, aux organes génitaux coupés, ces hommes, ces femmes torturées et violées jusqu'à de très jeunes êtres, presque encore des enfants, morts en portant leur tee-shirt Mickey préféré, il les a vus, César, de plus près que n'importe qui. Ces visages, ces corps brisés, il les a regardés en face, ces cadavres si nombreux, de plus en plus nombreux, ces cadavres qu'on ne savait plus où mettre et qui par terre, disposés n'importe comment dans la cour de la caserne, déclenchaient des rires salaces. Ce n'est pas humain cette indécence, ce manque de respect, cette barbarie. Cette injustice.
@Gwénaëlle Lenoir nous transmet, avec infiniment de retenue et de délicatesse, l'état de César, de ses perpétuels doutes allant croissant, de ses questions sans autre réponse que celles du fait du prince, le climat autoritaire et arbitraire de son pays, cette permanence de terreur viscérale avec cette sueur qui poisse la peau, cette atmosphère irrespirable dans laquelle César vit de plus en plus mal. Les réseaux de résistance au régime lui évitent de devenir, à son tour, un cadavre parmi d'autres, photographié par un nouveau photographe légiste de la morgue militaire.
@Gwenaëlle Lenoir a bâti son roman en retraçant l'histoire réelle de cet homme intranquille et son talent d'auteure est immense pour nous faire réaliser à quel point César est notre frère en humanité. Nous descendons avec lui au plus profond de son âme et de ses tripes. Avec des phrases concises, précises, directes et comme écrites au rythme des battements irréguliers de son coeur, nous le voyons, César. Notre vue n'a plus rien de flou et nous avons envie de lui tendre la main. « Je ne pouvais rien pour eux, seulement les photographier. Seulement refuser de participer à la danse macabre orchestré […] de ce pays […] » (Seize). Comme dans toutes les situations de résistance à l'oppression où les décisions se prennent très rapidement, in situ, @Gwénaëlle Lenoir va à l'essentiel. Elle ne s'encombre pas de l'inutile. Et elle réussit à nous projeter physiquement dans les sensations de César. Notre respiration se bloque, nous étouffons avec lui, nous sentons le poids de toutes ses questions et en particulier celles de mari et de père. Cela le taraude et nous taraude. Que va-t-il se passer ensuite ? Et les répercussions après ce séisme ? Quelles seront-elles ?
La prose de @Gwénaëlle Lenoir est humble et pudique. Ses mots sont souvent durs à avaler ; ils ont un goût de limaille mais le texte reste beau. Presque un oxymore avec le thème de l'ouvrage.
Avec @Camera obscura, @Gwénaëlle Lenoir rend un bouleversant hommage à cet homme remarquable qu'est César, à ce héros qui n'aurait peut-être jamais parié sur lui-même.
Cet ouvrage est poignant et le lire à cet instant, alors que tant de pays sont dévastés par la guerre et que sont commis impunément des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des exactions tout le temps, nous fait réfléchir à nouveau sur la fraternité humaine et alors seulement une possible justice.
Aucun être humain exilé de son pays ne l'a quitté dans la joie et la bonne humeur. S'en aller pour x ou x raison, le choisir ou y être contraint, c'est toujours une douleur.
@Camera obscura est un roman magnifique qui contient l'humanité entière en peu de pages. Votre livre nous permet de nous décentrer. L'Europe n'est pas le monde. Merci, @Gwenaëlle Lenoir. Infiniment.
Les hommes sont fous. Notre terre tourne avec des hommes fous, devenus fous, rendus fous ; des bourreaux, des victimes, des victimes, des bourreaux ; des gouvernements tout puissants qui massacrent, torturent, exterminent ; des pays où un soupir peut être interprété comme un acte terroriste. Terroriste ? Oui ? Non ? Selon sa place sur l'échiquier politique. Selon l'époque. Notre monde n'a-t-il pas toujours été fou ? En France, lors de la 2ème guerre mondiale, sous le régime totalitaire de Vichy, nous avions nous-aussi nos terroristes. Il s'agissait alors de Jean Moulin ou d'autres résistants. Un monde où la peur devient compagne. La peur stupéfie, sidère mais elle révèle. Toujours.
Dans un pays du Moyen-Orient, un homme au long cou tétanise la population.
Lire @Camera obscura de @Gwenaëlle Lenoir, c'est comme se prendre un coup de poing dans le ventre. Cette lecture coupe le souffle.
@Camera obscura, c'est l'histoire d'un Syrien dans un contexte de cécité concertée. A l'international, les pays font mine de vouloir aider à trouver une solution politique mais les dictateurs d'ici ou là savent que les intérêts géopolitiques, économiques ou stratégiques des autres pays leur donnent le plus efficace des blancs-seings.
En réponse à la révolution pacifique et tellement pleine d'espoir de 2011, la vie en Syrie devient la quintessence d'un enfer totalitaire. La répression de Bachar el Assad est de plus en plus sanglante. Tortures, enlèvements indiscriminés, exécutions sommaires, procès à qui il ne reste du procès que le nom et le tout dans un climat d'insécurité attisé en permanence. Assad, entouré de ses militaires, miliciens, mouchards et autres affidés, a soigneusement maillé son filet et il surveille également le niveau d'enthousiasme de la population lors des nombreux événements dédiés à sa personne. le culte de la personnalité, Staline, perpétrant des horreurs, menant de front sa politique totalitaire, avait déjà montré le chemin. Chacun devait admirer et obéir au Grand Homme. Cette méthode du culte de l'homme providentiel sera souvent reproduite dans ces mêmes régimes politiques. Bachar el Assad en fait son miel.
@Camera Obscura commence comme l'histoire d'un jeune couple que l'on pourrait croire ordinaire, une femme, un homme, deux enfants, du travail et la sécurité dans les bras l'un de l'autre, l'intimité comme unique espace de liberté. Unique espace de liberté ? Ça fait tousser. Toujours être sur ses gardes : « Ce n'est pas prudent. ». Combien de fois cette phrase est-elle répétée dans le livre ? Tout le monde se méfie de tout le monde. La vie des Syriens, c'est comme un perpétuel travail d'équilibriste et ils ne sont pas si mauvais dans leurs nombreux et obligés numéros. Les filles du jeune couple fredonnent la dernière chanson apprise à l'école sur la grandeur du dictateur. Des gages ostentatoires d'adhésion, il faut en donner à ce régime autoritaire, bouche sèche et poings serrés. Sinon, « Ce n'est pas prudent. ». Pour le reste, tout se joue dans la sphère intime. Dans le silence, il exècre cette situation, César. Oui, César, c'est le pseudo de ce Syrien extraordinaire. Cinq lettres gravées dans la peur, la sueur et le sang. César est un photographe de cadavres déposés dans une morgue militaire. Photographe légiste, c'est son métier. Pour ne rien oublier, César, dans ce contexte où chaque Syrien est une cible potentielle, a pris l'habitude de garder en lui ses mots et ses pensées interdites qui ne cessent de virevolter, de se cogner et de dire la révolte dans sa tête. On ne peut quand même pas oublier qui l'on est, non ? Sa femme et lui regardent les infos interdites mais pour leurs filles, il ne faut même pas qu'elles puissent entendre le moindre souffle de la première syllabe d'un mot de critique ou d'opposition au régime. Voilà la réalité. Voilà la fatalité.
Voilà comment César devait protéger sa famille. Mais cette vie-là, il a fini par ne plus pouvoir s'en accommoder. Il n'en voulait plus, pour lui et encore moins pour ses enfants. Il n'en pouvait plus.
« Je devinais ses globes oculaires sous ses paupières gonflées. Je ne voulais pas savoir ce qu'ils avaient vu. J'ai regardé l'étiquette à son poignet droit, elle disait qu'il s'appelait Azzam Azzaz et qu'il avait seize ans. J'ai senti les larmes monter de ma gorge et je me suis réfugié derrière mon appareil. J'ai photographié Azzam. de haut en bas, centimètre par centimètre. Et puis encore de bas en haut. J'ai tout photographié. Chaque trace. Chaque coup. Chaque traînée de sang. Chaque os. J'ai fait pareil pour les autres. J'ai coincé mes larmes dans ma gorge et j'ai photographié. » (Trois)
César n'était pas né pour être un héros, il ne l'aurait même pas voulu. César tremblait pour sa famille. A certains moments, l'angoisse devenait si forte que s'il avait pu, il se serait barré en courant… Mais non, il ne pouvait laisser ce monde-là, son pays abîmé « dans des flots de sang » ; il ne pouvait laisser le pays de ses ancêtres devenir ce théâtre de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Alors, il y est allé, César ; jusqu'au bout. Photos dupliquées sur une clé USB, clés USB exfiltrées et pour finir, lui-aussi exfiltré.
Il a fait passer la frontière à des milliers de photos qui ont permis à tant de Syriens de connaître enfin le sort de leurs proches disparus. Ces cadavres torturés, énucléés, aux organes génitaux coupés, ces hommes, ces femmes torturées et violées jusqu'à de très jeunes êtres, presque encore des enfants, morts en portant leur tee-shirt Mickey préféré, il les a vus, César, de plus près que n'importe qui. Ces visages, ces corps brisés, il les a regardés en face, ces cadavres si nombreux, de plus en plus nombreux, ces cadavres qu'on ne savait plus où mettre et qui par terre, disposés n'importe comment dans la cour de la caserne, déclenchaient des rires salaces. Ce n'est pas humain cette indécence, ce manque de respect, cette barbarie. Cette injustice.
@Gwénaëlle Lenoir nous transmet, avec infiniment de retenue et de délicatesse, l'état de César, de ses perpétuels doutes allant croissant, de ses questions sans autre réponse que celles du fait du prince, le climat autoritaire et arbitraire de son pays, cette permanence de terreur viscérale avec cette sueur qui poisse la peau, cette atmosphère irrespirable dans laquelle César vit de plus en plus mal. Les réseaux de résistance au régime lui évitent de devenir, à son tour, un cadavre parmi d'autres, photographié par un nouveau photographe légiste de la morgue militaire.
@Gwenaëlle Lenoir a bâti son roman en retraçant l'histoire réelle de cet homme intranquille et son talent d'auteure est immense pour nous faire réaliser à quel point César est notre frère en humanité. Nous descendons avec lui au plus profond de son âme et de ses tripes. Avec des phrases concises, précises, directes et comme écrites au rythme des battements irréguliers de son coeur, nous le voyons, César. Notre vue n'a plus rien de flou et nous avons envie de lui tendre la main. « Je ne pouvais rien pour eux, seulement les photographier. Seulement refuser de participer à la danse macabre orchestré […] de ce pays […] » (Seize). Comme dans toutes les situations de résistance à l'oppression où les décisions se prennent très rapidement, in situ, @Gwénaëlle Lenoir va à l'essentiel. Elle ne s'encombre pas de l'inutile. Et elle réussit à nous projeter physiquement dans les sensations de César. Notre respiration se bloque, nous étouffons avec lui, nous sentons le poids de toutes ses questions et en particulier celles de mari et de père. Cela le taraude et nous taraude. Que va-t-il se passer ensuite ? Et les répercussions après ce séisme ? Quelles seront-elles ?
La prose de @Gwénaëlle Lenoir est humble et pudique. Ses mots sont souvent durs à avaler ; ils ont un goût de limaille mais le texte reste beau. Presque un oxymore avec le thème de l'ouvrage.
Avec @Camera obscura, @Gwénaëlle Lenoir rend un bouleversant hommage à cet homme remarquable qu'est César, à ce héros qui n'aurait peut-être jamais parié sur lui-même.
Cet ouvrage est poignant et le lire à cet instant, alors que tant de pays sont dévastés par la guerre et que sont commis impunément des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des exactions tout le temps, nous fait réfléchir à nouveau sur la fraternité humaine et alors seulement une possible justice.
Aucun être humain exilé de son pays ne l'a quitté dans la joie et la bonne humeur. S'en aller pour x ou x raison, le choisir ou y être contraint, c'est toujours une douleur.
@Camera obscura est un roman magnifique qui contient l'humanité entière en peu de pages. Votre livre nous permet de nous décentrer. L'Europe n'est pas le monde. Merci, @Gwenaëlle Lenoir. Infiniment.
critiques presse (1)
Gwenaëlle Lenoir signe un roman percutant inspiré par le photographe syrien César qui a illustré par ses clichés les massacres perpétrés par le régime de Damas sur son peuple à partir de la révolution de 2011. La journaliste a choisi la littérature pour narrer l’indicible. Saisissant.
Lire la critique sur le site : Culturebox
Citations et extraits (26)
Voir plus
Ajouter une citation
(Les premières pages du livre)
Ce livre est un roman dont le personnage principal est réel. Ce photographe existe et vit caché quelque part en Europe. Son nom de code est César. Les atrocités décrites sont avérées, les faits sont documentés, mais sa voix est la mienne.
UN
Ania dort et elle sait que je suis mort. Elle a lu le communiqué. Tout le monde a lu le communiqué. Tout le monde sait que je suis mort, mes amis aussi bien que mes ennemis.
Ania fronce les sourcils, ses paupières battent, ses lèvres se tendent. Son épaule gauche tressaute en petits mouvements saccadés puis s’arrête, s’affaisse, calme et blanche au-dessus de la couverture bleue. Alors ce sont ses doigts qui se mettent à danser, ceux de la main gauche, toujours, le majeur et l’index. Peut-être l’alliance est-elle trop lourde pour permettre à l’annulaire de se joindre aux autres.
Je suis mort. J’ai été abattu comme un traître sur cette route grise et droite.
Je me rappelle bien comment je suis mort. Je suis en voiture. Je roule et je roule. La route express vers le nord est défoncée par endroits. J’évite un cratère de justesse. Une roquette, sûrement. La radio n’a pas parlé de combats par ici. La radio ne parle pas de ce genre de choses. Je chantonne.
Les deux voitures devant moi ralentissent, je vois leurs feux stop rougir. Je devine quelque chose sur la route, mais trop loin encore pour que je distingue ce que c’est. Je me rapproche vite, même si je lève le pied. C’est un barrage. Les deux voitures arrêtées sont entourées par des hommes armés. L’un d’eux fait de grands gestes avec son fusil dans ma direction, je pile. Les uniformes que portent les hommes du barrage ne sont pas réglementaires. Leurs vestes et leurs pantalons ne correspondent pas. Ils ont des baskets aux pieds et les cheveux longs. L’un d’eux a une queue-de-cheval, à la mode chez les jeunes Occidentaux. Un autre arbore une barbe fournie et des cheveux bouclés qui descendent dans sa nuque. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des rebelles.
Je suis soulagé. Je préfère un check-point de la résistance à un barrage de l’armée du président. Un des hommes s’approche de ma voiture. J’ouvre la vitre. Il me dévisage. Il me demande mes papiers, je lui tends ma carte d’identité. Je sens le soulagement me quitter, il reflue, il va se nicher tout au fond de mon estomac et commence à former une boule d’angoisse. Le type ne sourit pas. Il me fait signe avec son revolver : « Descends. » J’obéis. Je coupe le moteur et sors de la voiture. Il appelle un autre homme, me désigne d’un signe de tête. Ils me poussent vers une baraque en tôle à moitié brûlée sur le bas-côté. Ça devait être un abri pour des vendeurs à la sauvette de boissons et de fruits, il y en a tout le long des routes express du pays. Nous passons derrière. L’homme qui me suit sort son revolver et tire. Le monde explose sous le bruit de la détonation.
DEUX
Ma vie est morte bien avant moi.
Mon enfance était belle. J’habitais la même impasse qu’Ania. Ania était déjà plus importante pour moi que les jeux de cerceaux et les ballons tirés dans la poussière. Pour sortir de chez elle, pour rentrer chez elle, elle devait passer devant ma fenêtre. Elle était jolie dans son uniforme d’écolière, sa jupe au-dessous du genou, sa chemise blanche et sa veste grise. Elle secouait ses tresses aux rubans verts et blancs quand je prenais son cartable trop lourd pour elle. Elle me disait : « On voit que le printemps arrive, il y a des fleurs aux arbres et tu n’as plus peur de marcher dans les flaques d’eau, que tu es valeureux, dis-moi ! » Elle avait, quoi ? neuf ans, dix ans, et moi un peu moins. J’aimais presque autant qu’elle les gâteaux à la fleur d’oranger que sa mère nous servait au retour de l’école.
L’hiver, les ornières dans le sol se remplissaient d’eau et de boue, l’été d’un sable décoloré. Les feuilles des arbres n’étaient jamais vraiment vertes, toujours un peu grises. Le bruit de la ville parvenait à nos fenêtres, étouffé et doux. À l’adolescence, vivre ainsi à l’écart du vacarme de la ville me pesait. Je l’aurais bien fait sauter, notre impasse. Mais le doux bruit des talons d’Ania sur le sol et le léger balancement de ses hanches d’un bout à l’autre de la rue la rendaient unique.
J’ai pourtant quitté notre impasse sans regret, du moins je l’ai pensé à l’époque. Lorsque je me suis marié avec Ania, nous avons emménagé dans un autre quartier, dans un appartement rien qu’à nous. Les fenêtres donnaient sur une belle avenue sans ornière, aux hauts arbres couverts de feuilles plus vertes que dans l’impasse. On voyait la montagne en se penchant un peu sur le balcon. Il y avait même un petit jardin au pied de notre immeuble. Je trouvais que ce serait bien pour les enfants, sans le dire encore à Ania.
Mes parents aussi ont quitté la rue. Ils sont devenus vieux, ils ont pris leur retraite, sont retournés au village et ont fini tranquillement leur vie entre leur potager et leur champ d’amandiers. Je ne suis pas allé sur leur tombe depuis longtemps. Je n’aime pas déranger les morts. Et puis ça n’aurait pas été prudent.
TROIS
Après, bien après, notre pays s’est abîmé dans les flots de sang.
Je me souviens des premiers suppliciés. Je me souviens du matin où ils sont arrivés. Ils étaient quatre. Il faisait beau, la pluie de la nuit avait lavé le ciel et les rues. Elle m’avait mis d’humeur joyeuse et légère, je n’avais pas envie d’aller travailler, je voulais continuer à regarder Ania courir après les enfants, les presser pour avaler le petit déjeuner, leur répéter qu’ils étaient en retard. Elle avait oublié sur la table du salon leurs gâteaux et leurs berlingots de lait pour la récréation. J’ai descendu les escaliers quatre à quatre, l’ai rattrapée avant que la voiture ne tourne au coin de la rue, puis je suis resté un moment sur le seuil de l’immeuble pour profiter des bouffées de printemps. La rue sentait bon. Le petit jardin au pied de notre immeuble était propre, prêt à accueillir les gamins, ses balançoires et son toboggan fraîchement brossés par le concierge. J’avais hâte de retrouver ces fins de journées printanières, d’observer depuis notre fenêtre Ania qui surveillait distraitement Najma et Jamil. Mes étoiles. Je regardais Najma et Jamil grandir depuis déjà huit et cinq ans. Ils me ravissaient chaque jour davantage. Ania aussi me ravissait davantage de jour en nuit. J’ai eu du mal à quitter la douceur de notre appartement. Mais mon supérieur ne transigeait pas avec les horaires, ni avec le reste d’ailleurs. « Le service de l’État ne supporte pas l’imperfection » était sa phrase préférée. Il m’avait prévenu dès mon premier jour de travail, la moustache frémissante : dans son service, pas d’à peu près, les horaires devaient être strictement respectés. J’ai lavé les bols des enfants et ma tasse de café. J’ai mis mon Canon dans ma sacoche, ajouté deux gâteaux secs à la fleur d’oranger confectionnés par la mère d’Ania, et je suis parti pour une journée de travail aussi banale qu’une autre.
La sentinelle à l’entrée de l’hôpital m’a salué comme tous les matins, sans chaleur. Les jeunes gens qui occupent ce poste ne m’aiment pas beaucoup, en général. Ils n’ont qu’une vague idée de mon métier, mais les ouï-dire leur suffisent. Je sens bien qu’ils hésitent tous entre dégoût et circonspection. Celui-là ne faisait pas exception. Il ne faisait exception en rien, d’ailleurs. Dix-huit ou dix-neuf ans, une veste kaki trop légère pour la saison, des chaussures impeccablement cirées, une kalachnikov aussi raide que la justice et une colonne vertébrale plus ou moins souple selon son interlocuteur. Avec moi, il ne savait pas trop comment la tenir. Je n’entrais pas dans la catégorie des pékins, mais ma profession ne me valait ni prestige ni honneur. À vrai dire, je m’en foutais, ce matin-là encore plus que les autres. Il faisait beau. C’était le printemps. J’étais heureux.
Les quatre étaient là quand je suis arrivé au bureau. Ils avaient dû être amenés juste avant l’aube. Parmi le personnel de jour, nul ne les avait vu arriver, je me suis renseigné plus tard, l’air de rien. Ils avaient en tout cas chamboulé le service. Moustache frémissante, mon supérieur, avait quitté son bureau et se tenait debout au milieu du service, une lettre officielle entre les doigts. Face à lui, son adjoint Salim tirait sur sa cigarette en apnée, son mauvais œil, le droit, tressautait sous sa paupière morte. Il m’avait raconté un soir qu’il avait pris un coup de poing vicieux alors qu’il essayait de protéger sa cousine d’une bande de voyous sur la promenade de la rivière. Les médecins n’avaient pas réussi à sauver l’œil, ni la paupière, il avait eu au moins la satisfaction de mettre en fuite les agresseurs et de sauver l’honneur de sa parente. Il déclamait son récit aussi fort que s’il s’agissait d’une épopée, tantôt sombre, tantôt facétieux, avec des phrases grandiloquentes. Nous fêtions le départ en retraite d’un collègue et avions tous abusé de l’arak qu’il avait apporté de son village. La vantardise de Salim traversait mon esprit embrouillé et je me retenais de rire. Je soupçonnais chez lui de longue date une susceptibilité à la hauteur de sa lâcheté. Je connaissais aussi sa capacité de nuisance. Mieux valait ne pas prêter le flanc au soupçon d’ironie ni laisser traîner le moindre sourcil dubitatif. Même si l’arak affaiblissait son acuité. J’avais donc fait semblant de le croire et m’étais exclamé comme il fallait. Depuis, il m’invitait de temps à autre à boire un verre dans un bar faussement branché tenu par un de ses amis, dans un quartier résidentiel à un jet de pierre de la vieille ville. Il épanchait sa soif et son manque de reconnaissance en me débitant ses conquêtes féminines, se lamentait sur son sort d’homme marié à une matrone frigide, m’assommait de ses certitudes footballistiques, le tout arrosé d’odes au président chantées à voix trop haute. Les deux premières fois, une Ania glaciale m’avait accueilli à mon retour. Elle avait inspecté mes vêtement
Ce livre est un roman dont le personnage principal est réel. Ce photographe existe et vit caché quelque part en Europe. Son nom de code est César. Les atrocités décrites sont avérées, les faits sont documentés, mais sa voix est la mienne.
UN
Ania dort et elle sait que je suis mort. Elle a lu le communiqué. Tout le monde a lu le communiqué. Tout le monde sait que je suis mort, mes amis aussi bien que mes ennemis.
Ania fronce les sourcils, ses paupières battent, ses lèvres se tendent. Son épaule gauche tressaute en petits mouvements saccadés puis s’arrête, s’affaisse, calme et blanche au-dessus de la couverture bleue. Alors ce sont ses doigts qui se mettent à danser, ceux de la main gauche, toujours, le majeur et l’index. Peut-être l’alliance est-elle trop lourde pour permettre à l’annulaire de se joindre aux autres.
Je suis mort. J’ai été abattu comme un traître sur cette route grise et droite.
Je me rappelle bien comment je suis mort. Je suis en voiture. Je roule et je roule. La route express vers le nord est défoncée par endroits. J’évite un cratère de justesse. Une roquette, sûrement. La radio n’a pas parlé de combats par ici. La radio ne parle pas de ce genre de choses. Je chantonne.
Les deux voitures devant moi ralentissent, je vois leurs feux stop rougir. Je devine quelque chose sur la route, mais trop loin encore pour que je distingue ce que c’est. Je me rapproche vite, même si je lève le pied. C’est un barrage. Les deux voitures arrêtées sont entourées par des hommes armés. L’un d’eux fait de grands gestes avec son fusil dans ma direction, je pile. Les uniformes que portent les hommes du barrage ne sont pas réglementaires. Leurs vestes et leurs pantalons ne correspondent pas. Ils ont des baskets aux pieds et les cheveux longs. L’un d’eux a une queue-de-cheval, à la mode chez les jeunes Occidentaux. Un autre arbore une barbe fournie et des cheveux bouclés qui descendent dans sa nuque. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des rebelles.
Je suis soulagé. Je préfère un check-point de la résistance à un barrage de l’armée du président. Un des hommes s’approche de ma voiture. J’ouvre la vitre. Il me dévisage. Il me demande mes papiers, je lui tends ma carte d’identité. Je sens le soulagement me quitter, il reflue, il va se nicher tout au fond de mon estomac et commence à former une boule d’angoisse. Le type ne sourit pas. Il me fait signe avec son revolver : « Descends. » J’obéis. Je coupe le moteur et sors de la voiture. Il appelle un autre homme, me désigne d’un signe de tête. Ils me poussent vers une baraque en tôle à moitié brûlée sur le bas-côté. Ça devait être un abri pour des vendeurs à la sauvette de boissons et de fruits, il y en a tout le long des routes express du pays. Nous passons derrière. L’homme qui me suit sort son revolver et tire. Le monde explose sous le bruit de la détonation.
DEUX
Ma vie est morte bien avant moi.
Mon enfance était belle. J’habitais la même impasse qu’Ania. Ania était déjà plus importante pour moi que les jeux de cerceaux et les ballons tirés dans la poussière. Pour sortir de chez elle, pour rentrer chez elle, elle devait passer devant ma fenêtre. Elle était jolie dans son uniforme d’écolière, sa jupe au-dessous du genou, sa chemise blanche et sa veste grise. Elle secouait ses tresses aux rubans verts et blancs quand je prenais son cartable trop lourd pour elle. Elle me disait : « On voit que le printemps arrive, il y a des fleurs aux arbres et tu n’as plus peur de marcher dans les flaques d’eau, que tu es valeureux, dis-moi ! » Elle avait, quoi ? neuf ans, dix ans, et moi un peu moins. J’aimais presque autant qu’elle les gâteaux à la fleur d’oranger que sa mère nous servait au retour de l’école.
L’hiver, les ornières dans le sol se remplissaient d’eau et de boue, l’été d’un sable décoloré. Les feuilles des arbres n’étaient jamais vraiment vertes, toujours un peu grises. Le bruit de la ville parvenait à nos fenêtres, étouffé et doux. À l’adolescence, vivre ainsi à l’écart du vacarme de la ville me pesait. Je l’aurais bien fait sauter, notre impasse. Mais le doux bruit des talons d’Ania sur le sol et le léger balancement de ses hanches d’un bout à l’autre de la rue la rendaient unique.
J’ai pourtant quitté notre impasse sans regret, du moins je l’ai pensé à l’époque. Lorsque je me suis marié avec Ania, nous avons emménagé dans un autre quartier, dans un appartement rien qu’à nous. Les fenêtres donnaient sur une belle avenue sans ornière, aux hauts arbres couverts de feuilles plus vertes que dans l’impasse. On voyait la montagne en se penchant un peu sur le balcon. Il y avait même un petit jardin au pied de notre immeuble. Je trouvais que ce serait bien pour les enfants, sans le dire encore à Ania.
Mes parents aussi ont quitté la rue. Ils sont devenus vieux, ils ont pris leur retraite, sont retournés au village et ont fini tranquillement leur vie entre leur potager et leur champ d’amandiers. Je ne suis pas allé sur leur tombe depuis longtemps. Je n’aime pas déranger les morts. Et puis ça n’aurait pas été prudent.
TROIS
Après, bien après, notre pays s’est abîmé dans les flots de sang.
Je me souviens des premiers suppliciés. Je me souviens du matin où ils sont arrivés. Ils étaient quatre. Il faisait beau, la pluie de la nuit avait lavé le ciel et les rues. Elle m’avait mis d’humeur joyeuse et légère, je n’avais pas envie d’aller travailler, je voulais continuer à regarder Ania courir après les enfants, les presser pour avaler le petit déjeuner, leur répéter qu’ils étaient en retard. Elle avait oublié sur la table du salon leurs gâteaux et leurs berlingots de lait pour la récréation. J’ai descendu les escaliers quatre à quatre, l’ai rattrapée avant que la voiture ne tourne au coin de la rue, puis je suis resté un moment sur le seuil de l’immeuble pour profiter des bouffées de printemps. La rue sentait bon. Le petit jardin au pied de notre immeuble était propre, prêt à accueillir les gamins, ses balançoires et son toboggan fraîchement brossés par le concierge. J’avais hâte de retrouver ces fins de journées printanières, d’observer depuis notre fenêtre Ania qui surveillait distraitement Najma et Jamil. Mes étoiles. Je regardais Najma et Jamil grandir depuis déjà huit et cinq ans. Ils me ravissaient chaque jour davantage. Ania aussi me ravissait davantage de jour en nuit. J’ai eu du mal à quitter la douceur de notre appartement. Mais mon supérieur ne transigeait pas avec les horaires, ni avec le reste d’ailleurs. « Le service de l’État ne supporte pas l’imperfection » était sa phrase préférée. Il m’avait prévenu dès mon premier jour de travail, la moustache frémissante : dans son service, pas d’à peu près, les horaires devaient être strictement respectés. J’ai lavé les bols des enfants et ma tasse de café. J’ai mis mon Canon dans ma sacoche, ajouté deux gâteaux secs à la fleur d’oranger confectionnés par la mère d’Ania, et je suis parti pour une journée de travail aussi banale qu’une autre.
La sentinelle à l’entrée de l’hôpital m’a salué comme tous les matins, sans chaleur. Les jeunes gens qui occupent ce poste ne m’aiment pas beaucoup, en général. Ils n’ont qu’une vague idée de mon métier, mais les ouï-dire leur suffisent. Je sens bien qu’ils hésitent tous entre dégoût et circonspection. Celui-là ne faisait pas exception. Il ne faisait exception en rien, d’ailleurs. Dix-huit ou dix-neuf ans, une veste kaki trop légère pour la saison, des chaussures impeccablement cirées, une kalachnikov aussi raide que la justice et une colonne vertébrale plus ou moins souple selon son interlocuteur. Avec moi, il ne savait pas trop comment la tenir. Je n’entrais pas dans la catégorie des pékins, mais ma profession ne me valait ni prestige ni honneur. À vrai dire, je m’en foutais, ce matin-là encore plus que les autres. Il faisait beau. C’était le printemps. J’étais heureux.
Les quatre étaient là quand je suis arrivé au bureau. Ils avaient dû être amenés juste avant l’aube. Parmi le personnel de jour, nul ne les avait vu arriver, je me suis renseigné plus tard, l’air de rien. Ils avaient en tout cas chamboulé le service. Moustache frémissante, mon supérieur, avait quitté son bureau et se tenait debout au milieu du service, une lettre officielle entre les doigts. Face à lui, son adjoint Salim tirait sur sa cigarette en apnée, son mauvais œil, le droit, tressautait sous sa paupière morte. Il m’avait raconté un soir qu’il avait pris un coup de poing vicieux alors qu’il essayait de protéger sa cousine d’une bande de voyous sur la promenade de la rivière. Les médecins n’avaient pas réussi à sauver l’œil, ni la paupière, il avait eu au moins la satisfaction de mettre en fuite les agresseurs et de sauver l’honneur de sa parente. Il déclamait son récit aussi fort que s’il s’agissait d’une épopée, tantôt sombre, tantôt facétieux, avec des phrases grandiloquentes. Nous fêtions le départ en retraite d’un collègue et avions tous abusé de l’arak qu’il avait apporté de son village. La vantardise de Salim traversait mon esprit embrouillé et je me retenais de rire. Je soupçonnais chez lui de longue date une susceptibilité à la hauteur de sa lâcheté. Je connaissais aussi sa capacité de nuisance. Mieux valait ne pas prêter le flanc au soupçon d’ironie ni laisser traîner le moindre sourcil dubitatif. Même si l’arak affaiblissait son acuité. J’avais donc fait semblant de le croire et m’étais exclamé comme il fallait. Depuis, il m’invitait de temps à autre à boire un verre dans un bar faussement branché tenu par un de ses amis, dans un quartier résidentiel à un jet de pierre de la vieille ville. Il épanchait sa soif et son manque de reconnaissance en me débitant ses conquêtes féminines, se lamentait sur son sort d’homme marié à une matrone frigide, m’assommait de ses certitudes footballistiques, le tout arrosé d’odes au président chantées à voix trop haute. Les deux premières fois, une Ania glaciale m’avait accueilli à mon retour. Elle avait inspecté mes vêtement
Je suis resté seul avec les morts. J’allais les quitter moi aussi, j'allais les abandonner à leurs souffrances, seuls sur les carreaux blancs, sans respect ni tendresse, aux mains de leurs bourreaux. Je ne pouvais rien pour eux, seulement les photographier. Seulement refuser de participer à la danse macabre orchestrée par les employeurs des Tony de ce pays. p. 105
Je ne parle pas des morts à Ania. Je les ramène pourtant à la maison, soir après soir. Au début, j'ai essayé de les semer. J'ai pris des chemins détournés pour rentrer. Mais ils m'ont suivi. Les morts sont des gens têtus. Ils m'accompagnent dans l'escalier de l’immeuble, rentrent dans l'appartement, dorment dans notre lit et commentent les informations à la télévision. Ils font les gros yeux quand Najma ou Jamil chantonnent leurs nouvelles comptines à la gloire du président.
Les morts sont des gens discrets. Pendant longtemps, ni Ania ni les enfants ne se sont rendu compte de leur présence. p. 73
Les morts sont des gens discrets. Pendant longtemps, ni Ania ni les enfants ne se sont rendu compte de leur présence. p. 73
Je fais taire Najma et Jamil, je les rends muets et sourds, je ne leur apprends pas les mots que le président n'aime pas. Ces mots-là, je les garde pour moi, je les ai enfermés dans ma tête, je leur ai interdit ma langue, ils se cognent contre les parois de mon cerveau, ils n'ont pas le droit de sortir, ils crient à l'intérieur. Pourtant, ces mots-là sont chantés sur les places des villes et des villages.
" Nous avons oublié depuis si longtemps la franchise. Nous n’avons appris que la méfiance et la dissimulation. "
(page 103).
(page 103).

L'Arabe du futur, tome 1 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984)
Riad Sattouf
459
critiques
112
citations

L'Arabe du futur, tome 2 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985)
Riad Sattouf
217
critiques
52
citations

L'Arabe du futur, tome 3 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1985-1987)
Riad Sattouf
154
critiques
52
citations
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Gwenaëlle Lenoir (2)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (2 - littérature francophone )
Françoise Sagan : "Le miroir ***"
brisé
fendu
égaré
perdu
20 questions
3715 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, littérature francophoneCréer un quiz sur ce livre3715 lecteurs ont répondu