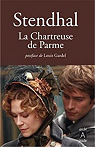Critiques de Stendhal (832)
Après Tristan et Yseult, Roméo et Juliette... Julien Sorel et Mme de Rênal ! Faut-il chercher l'intrus ? Peut-être ! Car peut-on considérer que l'amour que se portent les deux premiers couples énoncés soit le même que pour le dernier ? Julien est un jeune arriviste rongé par l'orgueil. Précepteur des enfants du couple de Rênal, il s'entiche de la maîtresse de maison. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil ! Mais celui-ci renonce à cet amour qui briserait son rêve de réussite. Les rumeurs courent... L'époux l'apprend et licencie le jeune précepteur. Ce dernier entre alors au séminaire où il fait la connaissance de l'Abbé Pirard qui, comprenant son ambition, le fait entrer au service du Marquis de la Mole. Celui-ci a une fille, Mathilde... Je vous le donne en mille, Julien va récidiver, tomber amoureux de celle-ci et lui faire un enfant... Mais c'est sans compter sur Mme de Rênal !!! Bref, je ne dévoile pas tout...
Paru trois ans après Armance, roman qui passa à la trappe, ce texte est issu d'un fait divers. En effet, en 1827, la Gazette des Tribunaux relate le procès d'un certain Antoine Berthet, 25 ans, fils d'un petit artisan, ancien séminariste devenu précepteur, jugé pour meurtre et condamné. Il n'en faut pas plus à Stendhal pour créer ainsi son personnage de Julien. En le saupoudrant de sa haine contre l'Église (merci à l'Abbé Raillane de l'en avoir dégoûté à jamais), de ses souvenirs de l'adolescent provincial et timide qu'il était et qui ne voyait que par Paris pour réussir, on obtient ainsi un chef-d'oeuvre. Zola prononcera cette superbe phrase à ce sujet : "Personne n'a possédé à un pareil degré la mécanique de l'âme". Tout est dit !
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
Paru trois ans après Armance, roman qui passa à la trappe, ce texte est issu d'un fait divers. En effet, en 1827, la Gazette des Tribunaux relate le procès d'un certain Antoine Berthet, 25 ans, fils d'un petit artisan, ancien séminariste devenu précepteur, jugé pour meurtre et condamné. Il n'en faut pas plus à Stendhal pour créer ainsi son personnage de Julien. En le saupoudrant de sa haine contre l'Église (merci à l'Abbé Raillane de l'en avoir dégoûté à jamais), de ses souvenirs de l'adolescent provincial et timide qu'il était et qui ne voyait que par Paris pour réussir, on obtient ainsi un chef-d'oeuvre. Zola prononcera cette superbe phrase à ce sujet : "Personne n'a possédé à un pareil degré la mécanique de l'âme". Tout est dit !
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
Julien Sorel, franc-comtois et fils de rien, destiné aux bas étages du clergé provincial, va peu à peu, à force de hasards et de coups de dé audacieux, s'essayer dans le grand monde et s'efforcer de devenir, s'il y arrive "Julien-Le-Magnifique"...
De ce monde qui lui est inconnu, il devra apprendre tant les règles que les dérèglements, les joies que les frustrations et tâcher, si possible, de ne pas se perdre lui-même en faisant adopter à sa morale une géométrie variable.
Dans les méandres de cette hiérarchie sociale, et puisque le seul trésor dont il dispose en propre est son esprit, son charme et sa beauté, il rencontrera des femmes, sur lesquelles il devra circonvenir en usant d'amour, à moins que ce ne soit le contraire... Je vous laisse évidemment vous plonger plus avant dans l'histoire si, par bonheur, celle-ci ne vous a jamais été imposée au lycée quand vous n'en éprouviez pas l'envie, ou si, par fortune, vous avez encore la possibilité de la découvrir avec un regard neuf.
Évidemment, un classique incontournable et beau ; beau dans l'acception la plus noble du terme en littérature. Et l'un des premiers exemples de l'évolution de la psychologie d'un personnage en cours de roman, spécialité qui deviendra l'apanage, quelques années plus tard, de Dostoïevski.
Écrit tout en finesse, pas si différent de la vision d'un Balzac, car Julien Sorel ressemble tellement à Eugène de Rastignac (Le Père Goriot) ou Lucien Chardon (Illusions Perdues) que c'en est frappant, mais sans la pointe de vinaigre blanc que Balzac n'oublie jamais de mettre dans ses recettes. Stendhal, lui, utilise son style plus direct et pour ainsi dire plus journalistique tout en soignant la psychologie et les hésitations dans les choix de tous ses personnages. Si l'on veut à tous prix tenter une comparaison, c'est de Tolstoï que Stendhal se rapproche le plus et notre Julien ressemble beaucoup au Boris Doubretskoï de La Guerre et La Paix.
En guise de conclusion et pour finir cette indigente critique face à l'ampleur de l’œuvre et son indicible grandeur, (je me rends compte en la relisant que cette critique est vraiment très mal construite et vous prie de m'en excuser) si par hasard vous aimez ce genre de trame narrative où un jeune provincial fait son chemin dans Paris grâce aux dames de ses conquêtes, je vous conseille, dans une genre un peu plus truculent, drôle et libertin, un grand classique mais malheureusement trop peu connu de Marivaux, Le paysan parvenu, qui je l'espère, vous ravira tout autant, mais ceci, bien sûr n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand chose.
De ce monde qui lui est inconnu, il devra apprendre tant les règles que les dérèglements, les joies que les frustrations et tâcher, si possible, de ne pas se perdre lui-même en faisant adopter à sa morale une géométrie variable.
Dans les méandres de cette hiérarchie sociale, et puisque le seul trésor dont il dispose en propre est son esprit, son charme et sa beauté, il rencontrera des femmes, sur lesquelles il devra circonvenir en usant d'amour, à moins que ce ne soit le contraire... Je vous laisse évidemment vous plonger plus avant dans l'histoire si, par bonheur, celle-ci ne vous a jamais été imposée au lycée quand vous n'en éprouviez pas l'envie, ou si, par fortune, vous avez encore la possibilité de la découvrir avec un regard neuf.
Évidemment, un classique incontournable et beau ; beau dans l'acception la plus noble du terme en littérature. Et l'un des premiers exemples de l'évolution de la psychologie d'un personnage en cours de roman, spécialité qui deviendra l'apanage, quelques années plus tard, de Dostoïevski.
Écrit tout en finesse, pas si différent de la vision d'un Balzac, car Julien Sorel ressemble tellement à Eugène de Rastignac (Le Père Goriot) ou Lucien Chardon (Illusions Perdues) que c'en est frappant, mais sans la pointe de vinaigre blanc que Balzac n'oublie jamais de mettre dans ses recettes. Stendhal, lui, utilise son style plus direct et pour ainsi dire plus journalistique tout en soignant la psychologie et les hésitations dans les choix de tous ses personnages. Si l'on veut à tous prix tenter une comparaison, c'est de Tolstoï que Stendhal se rapproche le plus et notre Julien ressemble beaucoup au Boris Doubretskoï de La Guerre et La Paix.
En guise de conclusion et pour finir cette indigente critique face à l'ampleur de l’œuvre et son indicible grandeur, (je me rends compte en la relisant que cette critique est vraiment très mal construite et vous prie de m'en excuser) si par hasard vous aimez ce genre de trame narrative où un jeune provincial fait son chemin dans Paris grâce aux dames de ses conquêtes, je vous conseille, dans une genre un peu plus truculent, drôle et libertin, un grand classique mais malheureusement trop peu connu de Marivaux, Le paysan parvenu, qui je l'espère, vous ravira tout autant, mais ceci, bien sûr n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand chose.
Hier, où j'ai passé pratiquement ma journée à le dévorer, comme la première fois où je l'avais lu, "Le Rouge & le Noir" m'est apparu comme l'un des plus grands romans jamais écrits.
Pour être franche, je n'ai jamais très bien compris les reproches de "sécheresse" qu'on faisait au style stendhalien. C'est vrai que ce romantique se distingue avec éclat des délires hugoliens et qu'il n'a pas les tics irritants des auteurs de feuilletons comme Balzac. Avec lui, il n'y a pas non plus ces affreuses plongées dans le mélodrame larmoyant qui - à mes yeux en tous cas - décrédibilisent un roman aussi puissant pourtant que "Le Père Goriot." Bref, avec Stendhal, le lecteur contemporain s'y retrouve tout en sachant très bien, habileté suprême, qu'il a devant lui un auteur du XIXème.
La qualité majeure de Stendhal, c'est son art de conteur. Celui-ci ne doit jamais lasser, surtout pas s'il s'autorise des digressions. Et Stendhal, tout au long des 512 pages du Livre de Poche, ne lasse pas un seul instant. Ses descriptions, sans être minimalistes, vont droit à l'essentiel - et l'on sent en lui l'amour qu'il portait aux paysages franc-comtois. Son analyse des personnages est précise, "scalpellisée" et impitoyable. Paradoxe étrange, lui qui a imposé au moins deux types "romantiques" - Julien Sorel et Fabrice del Dongo - les a façonnés comme des êtres changeants, qui ne cessent d'évoluer.
Julien par exemple nous est tout d'abord montré comme une espèce de jeune arriviste dominé par la Haine. On peut ici utiliser la majuscule car Julien ne vit que pour haïr. Il flambe de haine : haine contre son père (et on la partage très vite !), haine contre ses frères (deux abrutis), haine contre la société sous le règne de Charles X (où régnait à nouveau la loi des castes que l'épopée napoléonienne avait envoyée au diable), haine de l'Autre de façon générale (car, ayant grandi dans un milieu qui ne le considérait que comme une machine à raporter quelque chose, Julien ne peut tout simplement pas concevoir qu'on puisse s'intéresser à lui par amitié ou amour). On finit même par se demander si Julien Sorel ne se hait pas lui-même ...
Il y a, chez ce garçon séduisant, intelligent, prompt à apprendre et désireux de se faire une place au soleil, une forme d'autisme terrible qui finira par le mener à sa perte - une perte que cet idéaliste forcené accueille pratiquement comme une délivrance. Mais en dépit des apparences, qui pourraient laisser croire que son caractère ne se modifie pas au cours du roman, Stendhal convie son lecteur à enregistrer de menus détails qui, un à un, le recomposent subtilement de façon telle que le Julien Sorel final est bien plus grand, bien plus "pur" et tout aussi vrai que le Julien Sorel du premier chapitre.
Autre exemple singulièrement frappant : le caractère entier et pourtant incroyablement instable de Mathilde de La Mole, laquelle paraît souffrir d'une exaltation proche de la maladie mentale.
Rappelons les grands traits de l'intrigue :
M. de Rênal, le maire de Verrières, une petite ville de Franche-Comté, veut à tout prix un précepteur pour ses trois fils. Non tant d'ailleurs pour les instruire que pour contrarier son grand rival, M. de Valenod, que le retour des Bourbon a tiré de la misère où il croupissait avec sa famille. Ayant entendu dire, par le curé Chélan, le plus grand bien du jeune Julien Sorel, le dernier des trois fils du menuisier local, Rênal lui propose la place et disons à la décharge du maire qu'il refusera de verser le salaire du jeune homme à son rapace de père.
Installé chez les Rênal, Julien, qui est ombrageusement fier et prend chaque mot, chaque regard qu'on lui adresse pratiquement pour une insulte, se met en tête de séduire la maîtresse de maison. Non qu'il l'aime mais parce qu'il estime que cela serait, chez lui, une marque de caractère et de courage.
L'inévitable arrive et, au grand étonnement de Julien (qui est souvent d'une naïveté extraordinaire quant à ses ressources personnelles), non seulement sa maîtresse semble vraiment tenir à lui mais lui-même éprouve envers elle un sentiment bien plus fort qu'il ne se le serait imaginé.
Mais les gens jasent, la chose est inévitable. Mis au courant par des lettres anonymes qu'il tente en vain d'ignorer, M. de Rênal est bien obligé d'évoquer ses soupçons. Les amants décident de ne plus se revoir et le curé Chélan expédie Julien au séminaire de Besançon.
C'est là que Julien se lie d'amitié avec le directeur, l'abbé Pirard. Comme celui-ci, homme intègre et rogue, est d'obédience janséniste alors que le reste du séminaire en tient pour les Jésuites, on ne saurait dire que le choix de Julien soit heureux. Pourtant, c'est par l'entremise de l'abbé Pirard qu'il va être mis en relation avec le marquis de la Mole, descendant de Boniface de La Mole qui, au XVIème siècle, avait été l'amant de la Reine Margot et qui, pour avoir tenté d'enlever Henri III et le duc d'Alençon, avait été condamné à avoir la tête tranchée en place de Grève.
Le marquis cherche un secrétaire et Julien entre dans la place. La Chance l'y attend mais ... saura-t-il la saisir ? ...
Même si l'on connaît l'issue fatale de ce roman, on est pris par le récit, on s'entête à y avancer pas à pas, on ne veut pas en perdre une seule virgule. De façon très moderne, Stendhal glisse dans son texte des monologues intérieurs qui plongent le lecteur dans l'esprit même du personnage visé. Et puis, cette description au petit point de la société française, provinciale comme parisienne, à la veille de 1830 est un vrai régal de cynisme et de férocité.
Stendhal, un auteur scolaire ? ... Non, un romancier : et un grand. ;o)
Pour être franche, je n'ai jamais très bien compris les reproches de "sécheresse" qu'on faisait au style stendhalien. C'est vrai que ce romantique se distingue avec éclat des délires hugoliens et qu'il n'a pas les tics irritants des auteurs de feuilletons comme Balzac. Avec lui, il n'y a pas non plus ces affreuses plongées dans le mélodrame larmoyant qui - à mes yeux en tous cas - décrédibilisent un roman aussi puissant pourtant que "Le Père Goriot." Bref, avec Stendhal, le lecteur contemporain s'y retrouve tout en sachant très bien, habileté suprême, qu'il a devant lui un auteur du XIXème.
La qualité majeure de Stendhal, c'est son art de conteur. Celui-ci ne doit jamais lasser, surtout pas s'il s'autorise des digressions. Et Stendhal, tout au long des 512 pages du Livre de Poche, ne lasse pas un seul instant. Ses descriptions, sans être minimalistes, vont droit à l'essentiel - et l'on sent en lui l'amour qu'il portait aux paysages franc-comtois. Son analyse des personnages est précise, "scalpellisée" et impitoyable. Paradoxe étrange, lui qui a imposé au moins deux types "romantiques" - Julien Sorel et Fabrice del Dongo - les a façonnés comme des êtres changeants, qui ne cessent d'évoluer.
Julien par exemple nous est tout d'abord montré comme une espèce de jeune arriviste dominé par la Haine. On peut ici utiliser la majuscule car Julien ne vit que pour haïr. Il flambe de haine : haine contre son père (et on la partage très vite !), haine contre ses frères (deux abrutis), haine contre la société sous le règne de Charles X (où régnait à nouveau la loi des castes que l'épopée napoléonienne avait envoyée au diable), haine de l'Autre de façon générale (car, ayant grandi dans un milieu qui ne le considérait que comme une machine à raporter quelque chose, Julien ne peut tout simplement pas concevoir qu'on puisse s'intéresser à lui par amitié ou amour). On finit même par se demander si Julien Sorel ne se hait pas lui-même ...
Il y a, chez ce garçon séduisant, intelligent, prompt à apprendre et désireux de se faire une place au soleil, une forme d'autisme terrible qui finira par le mener à sa perte - une perte que cet idéaliste forcené accueille pratiquement comme une délivrance. Mais en dépit des apparences, qui pourraient laisser croire que son caractère ne se modifie pas au cours du roman, Stendhal convie son lecteur à enregistrer de menus détails qui, un à un, le recomposent subtilement de façon telle que le Julien Sorel final est bien plus grand, bien plus "pur" et tout aussi vrai que le Julien Sorel du premier chapitre.
Autre exemple singulièrement frappant : le caractère entier et pourtant incroyablement instable de Mathilde de La Mole, laquelle paraît souffrir d'une exaltation proche de la maladie mentale.
Rappelons les grands traits de l'intrigue :
M. de Rênal, le maire de Verrières, une petite ville de Franche-Comté, veut à tout prix un précepteur pour ses trois fils. Non tant d'ailleurs pour les instruire que pour contrarier son grand rival, M. de Valenod, que le retour des Bourbon a tiré de la misère où il croupissait avec sa famille. Ayant entendu dire, par le curé Chélan, le plus grand bien du jeune Julien Sorel, le dernier des trois fils du menuisier local, Rênal lui propose la place et disons à la décharge du maire qu'il refusera de verser le salaire du jeune homme à son rapace de père.
Installé chez les Rênal, Julien, qui est ombrageusement fier et prend chaque mot, chaque regard qu'on lui adresse pratiquement pour une insulte, se met en tête de séduire la maîtresse de maison. Non qu'il l'aime mais parce qu'il estime que cela serait, chez lui, une marque de caractère et de courage.
L'inévitable arrive et, au grand étonnement de Julien (qui est souvent d'une naïveté extraordinaire quant à ses ressources personnelles), non seulement sa maîtresse semble vraiment tenir à lui mais lui-même éprouve envers elle un sentiment bien plus fort qu'il ne se le serait imaginé.
Mais les gens jasent, la chose est inévitable. Mis au courant par des lettres anonymes qu'il tente en vain d'ignorer, M. de Rênal est bien obligé d'évoquer ses soupçons. Les amants décident de ne plus se revoir et le curé Chélan expédie Julien au séminaire de Besançon.
C'est là que Julien se lie d'amitié avec le directeur, l'abbé Pirard. Comme celui-ci, homme intègre et rogue, est d'obédience janséniste alors que le reste du séminaire en tient pour les Jésuites, on ne saurait dire que le choix de Julien soit heureux. Pourtant, c'est par l'entremise de l'abbé Pirard qu'il va être mis en relation avec le marquis de la Mole, descendant de Boniface de La Mole qui, au XVIème siècle, avait été l'amant de la Reine Margot et qui, pour avoir tenté d'enlever Henri III et le duc d'Alençon, avait été condamné à avoir la tête tranchée en place de Grève.
Le marquis cherche un secrétaire et Julien entre dans la place. La Chance l'y attend mais ... saura-t-il la saisir ? ...
Même si l'on connaît l'issue fatale de ce roman, on est pris par le récit, on s'entête à y avancer pas à pas, on ne veut pas en perdre une seule virgule. De façon très moderne, Stendhal glisse dans son texte des monologues intérieurs qui plongent le lecteur dans l'esprit même du personnage visé. Et puis, cette description au petit point de la société française, provinciale comme parisienne, à la veille de 1830 est un vrai régal de cynisme et de férocité.
Stendhal, un auteur scolaire ? ... Non, un romancier : et un grand. ;o)
Ma fille ainée qui est en première a eu la grande chance de commencer l'année scolaire avec cette œuvre. Moi, même je n'y avais pas échappé.
Comme a mon habitude j'accompagne mes enfants dans leurs lectures scolaires. Je lis ou relis ces romans qu'ils sont dans l'obligation d'étudier.
J'ai toujours aimé Stendhal, le personnage et sa façon d'écrire. A tel point qu'à l'époque j'avais enchainé avec La chartreuse de Parme.
Avec cette relecture mon opinion sur ce roman n'a pas changé, et elle s'est même peut être affermi.
Dans la vie réelle je n'aime pas les hypocrites et les opportunistes, alors il était certains que je n'aurais pas beaucoup de sympathie pour Julien Sorel. Je n'ai jamais aimé le personnage, ni son comportement.
Il en va de même pour Madame de Rénal, trop naïve a mon goût.
Mais , et c'est là pour moi ou réside tout le talent de Stendhal, c'est de faire un grand roman avec des personnages antipathiques. Car son histoire se tient et est très prenante. On a envie de savoir le dénouement. Et puis les mœurs et coutumes de l'époque sont décrits avec brio. Et c'est sans compter sur l'ambiguïté des sentiments et des actes des personnages tout au long de la lecture qui donne sa grandeur a ce roman.
Et puis l'écriture de Stendhal est pour moi a l'inverse de son personnage d'une grande franchise.
Pour conclure un classique que j'ai adoré, bien plus que ma fille qui déteste autant que moi Julien Sorel.
Comme a mon habitude j'accompagne mes enfants dans leurs lectures scolaires. Je lis ou relis ces romans qu'ils sont dans l'obligation d'étudier.
J'ai toujours aimé Stendhal, le personnage et sa façon d'écrire. A tel point qu'à l'époque j'avais enchainé avec La chartreuse de Parme.
Avec cette relecture mon opinion sur ce roman n'a pas changé, et elle s'est même peut être affermi.
Dans la vie réelle je n'aime pas les hypocrites et les opportunistes, alors il était certains que je n'aurais pas beaucoup de sympathie pour Julien Sorel. Je n'ai jamais aimé le personnage, ni son comportement.
Il en va de même pour Madame de Rénal, trop naïve a mon goût.
Mais , et c'est là pour moi ou réside tout le talent de Stendhal, c'est de faire un grand roman avec des personnages antipathiques. Car son histoire se tient et est très prenante. On a envie de savoir le dénouement. Et puis les mœurs et coutumes de l'époque sont décrits avec brio. Et c'est sans compter sur l'ambiguïté des sentiments et des actes des personnages tout au long de la lecture qui donne sa grandeur a ce roman.
Et puis l'écriture de Stendhal est pour moi a l'inverse de son personnage d'une grande franchise.
Pour conclure un classique que j'ai adoré, bien plus que ma fille qui déteste autant que moi Julien Sorel.
Le Rouge et le Noir est un roman d'initiation, où le héros, le jeune Julien Sorel, fils de charpentier, qui tente de s'élever dans la société, devra franchir de nombreux obstacles.
Passionné par Napoléon, il rêve d'une grande destinée en revêtant l'habit de soldat (rouge). Le hasard de la vie va lui faire prendre la soutane (noire).
Son caractère est changeant, il ne sait pas très bien où est sa place. Est-il ouvrier, fils de paysan ou petit-bourgeois, de par son éducation? Il se révèle à la fois timide, étourdi, ignorant, sensible, mais aussi, paradoxalement, froid calculateur, arriviste, égoïste, prêt à tout pour assouvir ses rêves de grandeur.
Il manque tout autant de clairvoyance en amour. Il croit connaitre le bonheur, là où il n'y a qu'ambition, désir de possession, envie de triomphe sur ceux qui lui sont socialement supérieurs.
Dans la société où il évolue, il n'y a plus de place pour ses ambitions de héros solitaire. Il se trompe. Il sacrifie le bonheur simple à des idéologies dépassées.
Mathilde, sa conquête amoureuse, lui ressemble. Elle ne voit en Julien qu'un moyen de provoquer les siens. Elle rêve d'une grande histoire d'amour tragique et impossible, au-delà des conventions sociales. Elle essaie de tromper son ennui, elle aime le risque, l'aventure, la bravoure.
Ils sont tous les deux victimes de leur imagination romanesque.
Le roman retrace l'évolution du personnage, de l'ignorance, vers la désillusion et enfin la clairvoyance. Arrivé à ses fins, mis sur un piédestal, il trouvera dans sa chute les vraies réponses sur le bonheur et les réalités de la société.
Formidable portrait des mœurs de cette société française de la période de restauration, avec les forces qui s'affrontent de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie, et de la société industrielle grimpante. Avec hypocrisie, mensonges et trahisons, chacun essaie de se faire sa place, de triompher, de s'élever socialement, en écrasant l'autre au passage.
C'est aussi un roman psychologique avec des personnages hauts en couleurs. On peut parfois éprouver de l'ennui et de l'agacement à la lecture de ce roman. Le côté un peu trop naïf et froidement calculateur, puis tout à coup se transformant en grande sensiblerie, en folie, dérange et semble improbable.
Rouge et noir, couleurs opposées, comme le sont les sentiments qui traversent Julien Sorel, à la fois fils d'ouvrier et petit-bourgeois.
Passionné par Napoléon, il rêve d'une grande destinée en revêtant l'habit de soldat (rouge). Le hasard de la vie va lui faire prendre la soutane (noire).
Son caractère est changeant, il ne sait pas très bien où est sa place. Est-il ouvrier, fils de paysan ou petit-bourgeois, de par son éducation? Il se révèle à la fois timide, étourdi, ignorant, sensible, mais aussi, paradoxalement, froid calculateur, arriviste, égoïste, prêt à tout pour assouvir ses rêves de grandeur.
Il manque tout autant de clairvoyance en amour. Il croit connaitre le bonheur, là où il n'y a qu'ambition, désir de possession, envie de triomphe sur ceux qui lui sont socialement supérieurs.
Dans la société où il évolue, il n'y a plus de place pour ses ambitions de héros solitaire. Il se trompe. Il sacrifie le bonheur simple à des idéologies dépassées.
Mathilde, sa conquête amoureuse, lui ressemble. Elle ne voit en Julien qu'un moyen de provoquer les siens. Elle rêve d'une grande histoire d'amour tragique et impossible, au-delà des conventions sociales. Elle essaie de tromper son ennui, elle aime le risque, l'aventure, la bravoure.
Ils sont tous les deux victimes de leur imagination romanesque.
Le roman retrace l'évolution du personnage, de l'ignorance, vers la désillusion et enfin la clairvoyance. Arrivé à ses fins, mis sur un piédestal, il trouvera dans sa chute les vraies réponses sur le bonheur et les réalités de la société.
Formidable portrait des mœurs de cette société française de la période de restauration, avec les forces qui s'affrontent de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie, et de la société industrielle grimpante. Avec hypocrisie, mensonges et trahisons, chacun essaie de se faire sa place, de triompher, de s'élever socialement, en écrasant l'autre au passage.
C'est aussi un roman psychologique avec des personnages hauts en couleurs. On peut parfois éprouver de l'ennui et de l'agacement à la lecture de ce roman. Le côté un peu trop naïf et froidement calculateur, puis tout à coup se transformant en grande sensiblerie, en folie, dérange et semble improbable.
Rouge et noir, couleurs opposées, comme le sont les sentiments qui traversent Julien Sorel, à la fois fils d'ouvrier et petit-bourgeois.
Fabrice del Dongo vient de rejoindre ma galerie personnelle d’anti-héros romanesques, gueules d’amour et destins pourris, aux côtés d’Heathcliff, de Julien Sorel, ou Fanfan la tulipe…Il pourrait même faire partie des finalistes, ce dadais qui fait succomber non seulement toutes les nobles dames de la cour de Parme, mais aussi tout ce qui porte jupon en Italie. Bien entendu, personne n’ émeut son coeur, jusqu’au jour où il tombe raide dingue de la seule qui soit inaccessible, la douce et vertueuse Clélia. Il faut dire que le chemin qui le mène de Waterloo où par amour pour Napoléon, Fabrice se rend pour jouer à la guerre, (résultat : il est recherché par toutes les polices de France et d’Italie, ce grand benêt), est complexe. A son retour en Italie, nombre d’influents personnages l’attendent au tournant, et c’est une altercation pour rivalité amoureuse, qui tourne mal, qui met le feu aux poudres. La Cour de Parme se saisit de ce fait divers pour en faire un fromage, et Fabrice devient l’enjeu des guerres d’influence qui font et défont les carrières des notables. La chaste passion de la duchesse Gina pour son troublant neveu est le rempart sans lequel le beau Fabrice aurait rapidement fini sa vie dans le noeud coulant d’une corde, pour peu que les geôliers ne l’aient pas empoisonnés avant la sentence.
Un détail, qui en dit long sur les moeurs de la société italienne du dix-neuvième siècle : il est prêtre ce jeune homme!
Les classiques ne le sont pas devenus par hasard : s’ils ont traversé les décennies et sont toujours l’objet d’analyse pour les professionnels et de délices pour les lecteurs amateurs, ce n’est pas un effet de mode. Et il est dommage que ce passage obligé pendant les études, mal présenté, vécu comme un pensum , conduisent à des rejets parfois irréversibles pour les jeunes élèves, avec le risque que, comme pour les épinards de la cantine, ils ne soient plus jamais disposés à y goûter .
Enfin, un mot sur l‘écriture, dont le style désuet confère une ambiance de vieille photo sépia et participe au charme de ce monument de la littérature romantique
Lien : http://kittylamouette.blogsp..
Un détail, qui en dit long sur les moeurs de la société italienne du dix-neuvième siècle : il est prêtre ce jeune homme!
Les classiques ne le sont pas devenus par hasard : s’ils ont traversé les décennies et sont toujours l’objet d’analyse pour les professionnels et de délices pour les lecteurs amateurs, ce n’est pas un effet de mode. Et il est dommage que ce passage obligé pendant les études, mal présenté, vécu comme un pensum , conduisent à des rejets parfois irréversibles pour les jeunes élèves, avec le risque que, comme pour les épinards de la cantine, ils ne soient plus jamais disposés à y goûter .
Enfin, un mot sur l‘écriture, dont le style désuet confère une ambiance de vieille photo sépia et participe au charme de ce monument de la littérature romantique
Lien : http://kittylamouette.blogsp..
Pour apprécier une telle oeuvre littéraire, je vois plusieurs conditions :
-- aimer Rome et, si possible, y avoir passé plusieurs jours
-- aimer la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique
-- aimer l'histoire, l'Antiquité, le monde romain
-- accepter les très nombreuses digressions de Stendhal, parfois sur des dizaines de pages
-- parvenir au bout de la préface de Michel Crouzet (31 pages)
-- enchaîner avec 590 pages stendhaliennes
-- ne pas s'astreindre à lire la totalité des 125 pages de notes
Remplir les trois premières est déjà la garantie d'une très agréable lecture dans laquelle c'est un réel plaisir de pénétrer pour s'imprégner des visions de Stendhal sur la ville éternelle, de son approche historique, de ses comparaisons avec la France, l'Angleterre, de sa culture superbement documentée du monde romain, de l'Italie, de toutes ses pensées et réflexions qui font la richesse de cet ouvrage.
Stendhal a passé avec des amis et des amies plusieurs mois à Rome, il s'impose donc comme un guide incomparable et il le fait à la fois en laissant aller ses pas de manière un peu aléatoire, tout en ciblant des visites bien précises. Il faut du temps pour cela ce qui permet d'éviter de se ruer à la chapelle Sixtine ou au forum sans avoir pris le temps de sillonner la ville, ce musée à ciel ouvert, pour réserver au moment venu le coup de foudre de l'entrée dans Saint-Pierre, cette gigantesque capitale de la chrétienté.
Stendhal prend le temps d'énumérer tous les sites et c'est un peu chaotique par l'ordre de ses visites. Il est quelquefois dans la même journée à Saint-Paul-hors-les-murs et à la colline du Janicule où il considère le panorama depuis San't Onofrio comme le plus beau du monde, aidé en cette appréciation par Le Tasse qui est inhumé face à cette vision inoubliable de Rome. Il détaille chaque monument, son architecture intérieure et extérieure. Ses coups de coeur sont pour le Panthéon et le Colisée. Il ne s'attarde pas devant la fontaine de Trevi, passe des heures à Saint-Pierre et aux musées du Vatican. Ainsi, plus de vingt pages sont consacrées aux Chambres de Raphaël et quasiment autant à la Sixtine. Se faisant, il détaille les personnalités des deux géants, Raphaël et Michel-Ange. Il cite une quinzaine d'églises dites majeures et commente les détails de quatre-vingts autres, sur des pages et des pages.
Il évoque l'histoire romaine antique, le martyre des premiers chrétiens, mais aussi celle des différentes dominations sur la ville et, pas des moindres, celle des papes. Il se trouve d'ailleurs à Rome le 10 février 1829, jour de la mort de Léon XII, et le 31 mars de la même année pour l'élection de Pie VIII.
Stendhal raconte de nombreuses anecdotes autour notamment de la légende de la papesse Jeanne, des amours contrariées de la religieuse Francesca et même d'une affaire criminelle jugée par la Cour d'Assises de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Et bien d'autres...
A la fin du livre, il propose une possibilité de découverte de Rome en dix journées qu'il remplit tellement que son estimation me semble devoir être multipliée par deux. D'autant que si l'on est dix jours à Rome, on aura le désir d'aller à Tivoli voir la villa d'Este et les cascades et de passer une longue fin d'après-midi dans la villa Adriana.
Alors, le mieux, si l'on peut, c'est de se rendre à Rome trois fois qui donneront envie d'y aller une quatrième, une cinquième et toujours encore sans déception possible.
Pour ma prochaine visite, j'emporterai certainement ces Promenades stendhaliennes et en relirai quelques extraits devant les panoramas des collines, les jardins du Vatican ou de la villa Médicis. Car ce livre ne peut retourner s'empoussiérer définitivement dans les rayons de mes bibliothèques, il ne peut s'oublier et, franchement, la lecture de la dernière page m'a empreint d'un regret que je n'imaginais pas en débutant la Préface.
-- aimer Rome et, si possible, y avoir passé plusieurs jours
-- aimer la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique
-- aimer l'histoire, l'Antiquité, le monde romain
-- accepter les très nombreuses digressions de Stendhal, parfois sur des dizaines de pages
-- parvenir au bout de la préface de Michel Crouzet (31 pages)
-- enchaîner avec 590 pages stendhaliennes
-- ne pas s'astreindre à lire la totalité des 125 pages de notes
Remplir les trois premières est déjà la garantie d'une très agréable lecture dans laquelle c'est un réel plaisir de pénétrer pour s'imprégner des visions de Stendhal sur la ville éternelle, de son approche historique, de ses comparaisons avec la France, l'Angleterre, de sa culture superbement documentée du monde romain, de l'Italie, de toutes ses pensées et réflexions qui font la richesse de cet ouvrage.
Stendhal a passé avec des amis et des amies plusieurs mois à Rome, il s'impose donc comme un guide incomparable et il le fait à la fois en laissant aller ses pas de manière un peu aléatoire, tout en ciblant des visites bien précises. Il faut du temps pour cela ce qui permet d'éviter de se ruer à la chapelle Sixtine ou au forum sans avoir pris le temps de sillonner la ville, ce musée à ciel ouvert, pour réserver au moment venu le coup de foudre de l'entrée dans Saint-Pierre, cette gigantesque capitale de la chrétienté.
Stendhal prend le temps d'énumérer tous les sites et c'est un peu chaotique par l'ordre de ses visites. Il est quelquefois dans la même journée à Saint-Paul-hors-les-murs et à la colline du Janicule où il considère le panorama depuis San't Onofrio comme le plus beau du monde, aidé en cette appréciation par Le Tasse qui est inhumé face à cette vision inoubliable de Rome. Il détaille chaque monument, son architecture intérieure et extérieure. Ses coups de coeur sont pour le Panthéon et le Colisée. Il ne s'attarde pas devant la fontaine de Trevi, passe des heures à Saint-Pierre et aux musées du Vatican. Ainsi, plus de vingt pages sont consacrées aux Chambres de Raphaël et quasiment autant à la Sixtine. Se faisant, il détaille les personnalités des deux géants, Raphaël et Michel-Ange. Il cite une quinzaine d'églises dites majeures et commente les détails de quatre-vingts autres, sur des pages et des pages.
Il évoque l'histoire romaine antique, le martyre des premiers chrétiens, mais aussi celle des différentes dominations sur la ville et, pas des moindres, celle des papes. Il se trouve d'ailleurs à Rome le 10 février 1829, jour de la mort de Léon XII, et le 31 mars de la même année pour l'élection de Pie VIII.
Stendhal raconte de nombreuses anecdotes autour notamment de la légende de la papesse Jeanne, des amours contrariées de la religieuse Francesca et même d'une affaire criminelle jugée par la Cour d'Assises de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Et bien d'autres...
A la fin du livre, il propose une possibilité de découverte de Rome en dix journées qu'il remplit tellement que son estimation me semble devoir être multipliée par deux. D'autant que si l'on est dix jours à Rome, on aura le désir d'aller à Tivoli voir la villa d'Este et les cascades et de passer une longue fin d'après-midi dans la villa Adriana.
Alors, le mieux, si l'on peut, c'est de se rendre à Rome trois fois qui donneront envie d'y aller une quatrième, une cinquième et toujours encore sans déception possible.
Pour ma prochaine visite, j'emporterai certainement ces Promenades stendhaliennes et en relirai quelques extraits devant les panoramas des collines, les jardins du Vatican ou de la villa Médicis. Car ce livre ne peut retourner s'empoussiérer définitivement dans les rayons de mes bibliothèques, il ne peut s'oublier et, franchement, la lecture de la dernière page m'a empreint d'un regret que je n'imaginais pas en débutant la Préface.
Sans doute l’un des chefs-d’œuvre du roman au XIXème siècle. C’est le roman du sublime, de la grandeur et de l’achèvement (au niveau artistique) qui illustre cette chasse au bonheur ; conception stendhalienne. Et comme dans son premier roman Stendhal choisit un héros singulier qu’on suit depuis son très jeune âge. L’auteur dédie son ouvrage improvisé en cinquante-deux jours au « Happy few », à ceux qui savent jouir, aimer et agissent avec liberté, bref ceux qui sauront déguster son roman. Et tout lecteur est ravi d’en faire partie.
Fabrice Del Dongo (un nom à ne pas oublier) passe une enfance médiocre et fastidieuse entre des occupations infructueuses et des jeux triviaux (pas comme celle de Pantagruel en tout cas) mais amusants pour l’enfant qu’il était. Ensuite, il cherche la gloire dans l’action militaire et vit la fameuse bataille de Waterloo que Stendhal, avec art, nous décrit à travers le regard candide (d’ailleurs, on pense à Candide à la guerre) de son jeune héros. Il y rencontre une vivandière sympathique, et blessé, il est reçu cordialement par une famille étrangère. De retour, il sera calomnié par son frère mais sa tante et son amant l’aident et le protègent. Il mène ensuite, plusieurs amourettes jusqu’au jour où il rencontre une comédienne dont l’amant, jaloux, le défie ; cette rixe finira par la mort de ce dernier. Ainsi, il est emprisonné à la tour Farnèse. Là, il rencontre celle qui deviendra son grand amour, Clélia, fille du gouverneur de la citadelle. Son ultime objectif dans sa prison sera de voir sa Clélia et de discuter avec elle. Leur amour grandissant se trouve condamné après l’évasion ingénieuse de Fabrice à cause du vœu fait à la Madone. Clélia se marie, forcée, et Fabrice devient archevêque… je m’arrête là. Le livre est une suite de péripéties aussi captivantes les unes que les autres. L’appétit d’écrire augmentait pour Stendhal au fur et à mesure (d’ailleurs son style devient plus majestueux), ainsi que la lecture.
Le réalisme se mêle au romantisme dans ce roman. Voilà justement pourquoi je préfère Stendhal à Balzac et à Musset romancier. On trouve de très belles pages d’un lyrisme suave où s’accumulent beaux paysages, fantaisies, sentiments de joie profonde et intérieure (le bonheur peut se trouver là où l’on s’y attend le moins), promenades solitaires, en plus des fameux passages où Fabrice, en prison, goûte le bonheur extrême et l’amour tendre. Le roman a gardé une place pour la politique et l’Histoire, et des personnages comme Rassi et Mosca sont les types du politicien scrupuleux et machiavélique. De même, le roman fait revivre le temps où Bossuet émerveillait par son éloquence ; Fabrice prêchait dans des églises pleines.
Pour finir, on trouve certaines ressemblances entre Fabrice et Julien : les deux sont ambitieux, pris en aversion par leurs pères et frères, aimés par une femme âgée et une jeune vierge, cherchant le bonheur, attirés par la gloire militaire et férus de la légende napoléonienne, or Fabrice vit d’action et d’émotion plus que de réflexion, il est plus indécis.
Un roman à ne pas rater.
Fabrice Del Dongo (un nom à ne pas oublier) passe une enfance médiocre et fastidieuse entre des occupations infructueuses et des jeux triviaux (pas comme celle de Pantagruel en tout cas) mais amusants pour l’enfant qu’il était. Ensuite, il cherche la gloire dans l’action militaire et vit la fameuse bataille de Waterloo que Stendhal, avec art, nous décrit à travers le regard candide (d’ailleurs, on pense à Candide à la guerre) de son jeune héros. Il y rencontre une vivandière sympathique, et blessé, il est reçu cordialement par une famille étrangère. De retour, il sera calomnié par son frère mais sa tante et son amant l’aident et le protègent. Il mène ensuite, plusieurs amourettes jusqu’au jour où il rencontre une comédienne dont l’amant, jaloux, le défie ; cette rixe finira par la mort de ce dernier. Ainsi, il est emprisonné à la tour Farnèse. Là, il rencontre celle qui deviendra son grand amour, Clélia, fille du gouverneur de la citadelle. Son ultime objectif dans sa prison sera de voir sa Clélia et de discuter avec elle. Leur amour grandissant se trouve condamné après l’évasion ingénieuse de Fabrice à cause du vœu fait à la Madone. Clélia se marie, forcée, et Fabrice devient archevêque… je m’arrête là. Le livre est une suite de péripéties aussi captivantes les unes que les autres. L’appétit d’écrire augmentait pour Stendhal au fur et à mesure (d’ailleurs son style devient plus majestueux), ainsi que la lecture.
Le réalisme se mêle au romantisme dans ce roman. Voilà justement pourquoi je préfère Stendhal à Balzac et à Musset romancier. On trouve de très belles pages d’un lyrisme suave où s’accumulent beaux paysages, fantaisies, sentiments de joie profonde et intérieure (le bonheur peut se trouver là où l’on s’y attend le moins), promenades solitaires, en plus des fameux passages où Fabrice, en prison, goûte le bonheur extrême et l’amour tendre. Le roman a gardé une place pour la politique et l’Histoire, et des personnages comme Rassi et Mosca sont les types du politicien scrupuleux et machiavélique. De même, le roman fait revivre le temps où Bossuet émerveillait par son éloquence ; Fabrice prêchait dans des églises pleines.
Pour finir, on trouve certaines ressemblances entre Fabrice et Julien : les deux sont ambitieux, pris en aversion par leurs pères et frères, aimés par une femme âgée et une jeune vierge, cherchant le bonheur, attirés par la gloire militaire et férus de la légende napoléonienne, or Fabrice vit d’action et d’émotion plus que de réflexion, il est plus indécis.
Un roman à ne pas rater.
La volonté stendhalienne de Mina de Vanghel
Stendhal, dans cette nouvelle posthume, semble assez pressé de dérouler son intrigue, l’usage du passé simple à gogo rend le récit expéditif et laisse peu de répit au lecteur pour s’arrêter sur la personnalité de Mina de Vanghel, portrait d’une femme ingénieuse et en quête de liberté au XIXème siècle.
Pas de procès. Si le récit n’est pas publié du vivant de l’auteur on peut supposer qu’il n’en avait pas encore l’étoffe, ainsi je ne vois pas cet ouvrage comme une nouvelle mais comme une ébauche.
“C’était une âme trop ardente pour se contenter du réel de la vie”. Ce qu’il reste de cette histoire d’une passion ? Une étoile filante vengeresse et presque érotomane.
“Se venger, c’est agir ; agir, c’est espérer.” Stendhal est un écrivain de l’action, du mouvement fait homme, de la “vida grande” ainsi qu’il le rapportait dans son journal…il est aussi un individualiste, Régis Debray l’a bien souligné dans son ouvrage sur l’écrivain national, par opposition à Victor Hugo.
Certes les choix du héros stendhalien sont discutables, il/elle se trompe et parfois le tragique vient de l’absolue contingence qui amène implacablement le héros au trépas. Mais comment savoir a priori ? N’est-ce pas le risque que courent tous les entrepreneurs de l’existence ? Milan Kundera lui-même soulignait que “l'homme ne peut jamais savoir ce qu'il faut vouloir car il n'a qu'une vie et il ne peut la comparer à des vies antérieures ni la rectifier dans des vies ultérieures.”
Ainsi, les héros stendhaliens se dressent seuls, presque en marge de leurs semblables, par leur seule ingéniosité ils tracent leur propre voix, et se coupent ainsi de ce que peut tolérer le commun des hommes. Stendhal ne disait-il pas “dans tous les partis, plus un homme a d’esprit, moins il est de son parti” ?
Qu’en pensez-vous ?
Stendhal, dans cette nouvelle posthume, semble assez pressé de dérouler son intrigue, l’usage du passé simple à gogo rend le récit expéditif et laisse peu de répit au lecteur pour s’arrêter sur la personnalité de Mina de Vanghel, portrait d’une femme ingénieuse et en quête de liberté au XIXème siècle.
Pas de procès. Si le récit n’est pas publié du vivant de l’auteur on peut supposer qu’il n’en avait pas encore l’étoffe, ainsi je ne vois pas cet ouvrage comme une nouvelle mais comme une ébauche.
“C’était une âme trop ardente pour se contenter du réel de la vie”. Ce qu’il reste de cette histoire d’une passion ? Une étoile filante vengeresse et presque érotomane.
“Se venger, c’est agir ; agir, c’est espérer.” Stendhal est un écrivain de l’action, du mouvement fait homme, de la “vida grande” ainsi qu’il le rapportait dans son journal…il est aussi un individualiste, Régis Debray l’a bien souligné dans son ouvrage sur l’écrivain national, par opposition à Victor Hugo.
Certes les choix du héros stendhalien sont discutables, il/elle se trompe et parfois le tragique vient de l’absolue contingence qui amène implacablement le héros au trépas. Mais comment savoir a priori ? N’est-ce pas le risque que courent tous les entrepreneurs de l’existence ? Milan Kundera lui-même soulignait que “l'homme ne peut jamais savoir ce qu'il faut vouloir car il n'a qu'une vie et il ne peut la comparer à des vies antérieures ni la rectifier dans des vies ultérieures.”
Ainsi, les héros stendhaliens se dressent seuls, presque en marge de leurs semblables, par leur seule ingéniosité ils tracent leur propre voix, et se coupent ainsi de ce que peut tolérer le commun des hommes. Stendhal ne disait-il pas “dans tous les partis, plus un homme a d’esprit, moins il est de son parti” ?
Qu’en pensez-vous ?
Julien Sorel est fils d'exploitant de scierie dans la petite ville de Verrières.
Il apprend le latin avec un parent chirurgien et avec le bon abbé Chélan, curé de la paroisse.
Monsieur de Rênal, maire de Verrières l'engage comme précepteur pour apprendre le latin à ses trois enfants.
On va suivre le chemin de Julien, à Verrières où il tombera amoureux de Madame de Rênal.
Du séminaire de Besançon, il sera envoyé par l'abbé Pirard, comme secrétaire du marquis de la Mole à Paris.
Là, il continuera à servir ses ambitions en séduisant la fille de la maison, la jeune Mathilde.
Il arrive presque à ses fins. Mathilde, enceinte parvient à convaincre son père d'épouser Julien qui se fait anoblir par le marquis.
Il devient chevalier mais Madame de Rênal détruit sa réputation en dénonçant son arrivisme et sa malhonnêteté.
Toutes ces intrigues finissent par un drame de la vengeance et Julien est condamné à mort malgré l'acharnement de ces dames à le sauver.
Le thème du jeune homme qui se brûle les ailes est bien souvent abordé dans la littérature du 19ème siècle et jamais récompensé.
Cette période est bien intéressante : on y voit les nouveaux bourgeois, premiers industriels avec comme unique but, faire fortune.
La noblesse et le clergé sont remis à l'honneur.
Un nouveau monde se remet en place après le départ de Napoléon dont il ne faut plus parler dans la bourgeoisie.
Les sentiments amoureux sont longuement et fougueusement décrits par Stendhal.
J'ai lu le livre par petits extraits, en plusieurs semaines comme toujours quand j'aborde un classique. Je n'arrive jamais à lire un livre d'un autre siècle d'une traite.
L'écriture est très belle, l'époque intéressante ,le rythme est très différent du nôtre, alors cela demande du temps et des entractes mais le détour en vaut la peine.
Challenge pavés 2017 contre l'illettrisme.
Il apprend le latin avec un parent chirurgien et avec le bon abbé Chélan, curé de la paroisse.
Monsieur de Rênal, maire de Verrières l'engage comme précepteur pour apprendre le latin à ses trois enfants.
On va suivre le chemin de Julien, à Verrières où il tombera amoureux de Madame de Rênal.
Du séminaire de Besançon, il sera envoyé par l'abbé Pirard, comme secrétaire du marquis de la Mole à Paris.
Là, il continuera à servir ses ambitions en séduisant la fille de la maison, la jeune Mathilde.
Il arrive presque à ses fins. Mathilde, enceinte parvient à convaincre son père d'épouser Julien qui se fait anoblir par le marquis.
Il devient chevalier mais Madame de Rênal détruit sa réputation en dénonçant son arrivisme et sa malhonnêteté.
Toutes ces intrigues finissent par un drame de la vengeance et Julien est condamné à mort malgré l'acharnement de ces dames à le sauver.
Le thème du jeune homme qui se brûle les ailes est bien souvent abordé dans la littérature du 19ème siècle et jamais récompensé.
Cette période est bien intéressante : on y voit les nouveaux bourgeois, premiers industriels avec comme unique but, faire fortune.
La noblesse et le clergé sont remis à l'honneur.
Un nouveau monde se remet en place après le départ de Napoléon dont il ne faut plus parler dans la bourgeoisie.
Les sentiments amoureux sont longuement et fougueusement décrits par Stendhal.
J'ai lu le livre par petits extraits, en plusieurs semaines comme toujours quand j'aborde un classique. Je n'arrive jamais à lire un livre d'un autre siècle d'une traite.
L'écriture est très belle, l'époque intéressante ,le rythme est très différent du nôtre, alors cela demande du temps et des entractes mais le détour en vaut la peine.
Challenge pavés 2017 contre l'illettrisme.
Sans surprise, c'est une très belle écriture classique que l'on découvre avec ce monument signé Stendhal. Dans la droite lignée du courant romantique, Fabrice del Dongo offre une très belle figure de héros (ou plutôt d'anti-héros) et ses amours contrariées répondent à tous les codes du genre.
Toutefois, je n'ai pas été ensorcelée comme je peux l'être avec d'autres auteurs de la période. Nonobstant un contexte social et historique parfaitement rendu qui nous transporte vraiment dans cette "sublissime" Italie que j'aime passionnément, j'ai souffert des longueurs de la narration et, plus que tout, d'un dénouement abrupte et expédié en trois paragraphes.
Challenge XIXème siècle 2017
Challenge MULTI-DÉFIS 2017
Challenge Petit Bac 2016 - 2017
Challenge PAVES 2016 - 2017
Toutefois, je n'ai pas été ensorcelée comme je peux l'être avec d'autres auteurs de la période. Nonobstant un contexte social et historique parfaitement rendu qui nous transporte vraiment dans cette "sublissime" Italie que j'aime passionnément, j'ai souffert des longueurs de la narration et, plus que tout, d'un dénouement abrupte et expédié en trois paragraphes.
Challenge XIXème siècle 2017
Challenge MULTI-DÉFIS 2017
Challenge Petit Bac 2016 - 2017
Challenge PAVES 2016 - 2017
Il est des noms intemporels qui traverseront allègrement les siècles.
C'est le cas pour au moins deux héros stendhaliens.
Fabrice Del Dongo dans : La chartreuse de Parme et Julien Sorel dans : Le rouge et le noir.
J'ai lu ces deux romans dans ma jeunesse estudiantine comme tant d'autres.
Aujourd'hui, en relisant les aventures de Julien Sorel et Mme de Rénal, je retombe sous ce charme d'antan.
Ces deux noms résonnent de manière charmante, cette histoire d'amour, aujourd'hui peut-être un peu désuète, fascine malgré tout.
Et, on se laisse porter au gré des pages, à suivre le parcours de ce fils de charpentier haï et rejeté par les siens.
Peut-on raisonnablement lui reprocher cette ambition sans presque aucune limite pour recevoir du Monde tous les honneurs ?
Julien Sorel nous apparaît comme un jeune homme attachant malgré ses failles.
D'ailleurs, à son procès, Mme Deville qui ne l'aimat point pleure à sa condamnation.
Oui, on peut assurément passer de belles heures avec Julien Sorel et Mme de Rénal sans oublier l'intrépide et fière Mlle de la Mole: Mathilde.
Beaucoup d'autres éclairages sont donnés sur la société de l'époque du roman, sur l'hypocrisie, sur les parvenus,...
Le régal du: Le Rouge et le Noir, c'est que presque tout à chacun peut y trouver un centre d'intérêt.
Aussi, serait-il sage et agréable de relire le Rouge et le noir, encore une fois ?
C'est le cas pour au moins deux héros stendhaliens.
Fabrice Del Dongo dans : La chartreuse de Parme et Julien Sorel dans : Le rouge et le noir.
J'ai lu ces deux romans dans ma jeunesse estudiantine comme tant d'autres.
Aujourd'hui, en relisant les aventures de Julien Sorel et Mme de Rénal, je retombe sous ce charme d'antan.
Ces deux noms résonnent de manière charmante, cette histoire d'amour, aujourd'hui peut-être un peu désuète, fascine malgré tout.
Et, on se laisse porter au gré des pages, à suivre le parcours de ce fils de charpentier haï et rejeté par les siens.
Peut-on raisonnablement lui reprocher cette ambition sans presque aucune limite pour recevoir du Monde tous les honneurs ?
Julien Sorel nous apparaît comme un jeune homme attachant malgré ses failles.
D'ailleurs, à son procès, Mme Deville qui ne l'aimat point pleure à sa condamnation.
Oui, on peut assurément passer de belles heures avec Julien Sorel et Mme de Rénal sans oublier l'intrépide et fière Mlle de la Mole: Mathilde.
Beaucoup d'autres éclairages sont donnés sur la société de l'époque du roman, sur l'hypocrisie, sur les parvenus,...
Le régal du: Le Rouge et le Noir, c'est que presque tout à chacun peut y trouver un centre d'intérêt.
Aussi, serait-il sage et agréable de relire le Rouge et le noir, encore une fois ?
Contrairement à quelques lecteurs ici qui ont découvert Le Rouge et le Noir lors des célèbres dissections de textes et cocktails d’extraits riches en chiasmes, oxymores et autres C.O.D, je n’ai jamais eu le privilège d’étudier cet ouvrage, et c’est me sentant un peu lésé – à tort à en juger l’amertume de certains initiés scolairement à Stendhal - que j’ai décidé d’en faire la connaissance.
J’ai adoré, parfois même exalté cette œuvre géniale.
On ne peut faire l’économie de ce qui – à mon sens – est la subjugation première de l’ouvrage : Julien Sorel. A l’exception de sa propre famille, ce dernier séduit Madame De Rhénal, son mari, ses enfants, Mathilde de la Mole & ses parents, les abbés Pirard & Chélan, Fouqué, Elisa, Mme De Fervaques et d’innombrables lecteurs à travers les âges, tout cela bien souvent malgré lui. On rêve de Julien, mais on se rêve aussi en Julien.
Sa jeunesse sans compromission, la force de son caractère, celle qui fait les grands hommes selon Nietzche, grand admirateur de Stendhal et de Napoléon.
Julien n’est pas un homme de raison, il est un héros de cœur, d’instinct. Un instinct de survie d’abord, il doit se forger une armure dans une société au sein de laquelle il semble n’avoir rien à faire, et que pourtant il va marquer de son sceau indélébile.
Mais aussi un héros de cœur, qui s’éveille à l’amour, la passion mais aussi au monde, à ses codes, un monde dont chaque nouvelle génération hérite sans l’avoir choisi.
Par Julien, le lecteur comme les personnages que l’auteur place sur sa route, ressentent l’énergie la plus pure et féroce circuler au détour de chaque page.
Julien Sorel est ce que l’on pourrait appeler un moraliste, son éthique bouleverse de par sa rigueur. L’homme en proie aux doutes finit par laisser place au héros romanesque, celui qui vit et meurt pour ses principes. Même s’il ne théorise en rien sa pensée, le lecteur peut la comprendre à travers le témoignage empirique de l’existence de Julien.
Cependant, ce qui rend Sorel définitivement acquis au cœur du lecteur, ce sont bien ses maladresses & ses doutes (tantôt le Rouge et les honneurs, en costume sur son cheval, ou dans les cafés de Besançon tantôt le Noir du séminaire et des textes en latin) et toujours cette énergie qui le pousse encore plus haut, toujours plus haut.
Le lecteur fait la connaissance de cet « enfant de 1830 » alors qu’il est dans une misère sociale apriori sans issues. Mais très vite, pitié et compassion vont laisser place à l’étonnement ainsi qu’à la fascination pour l’incroyable ascension sociale sans compromissions de Julien. On remarque avec l’abbé Pirard ou encore le Marquis de la Mole l’immense potentiel et surtout le cœur du jeune homme.
"La société étant divisée par tranches, comme un bambou, la grande affaire d'un homme est de monter dans la classe supérieure à la sienne et tout l'effort de cette classe est de l'empêcher de monter." Stendhal
Le Rouge et le Noir c’est aussi le roman d’une époque, et après Julien, c’est maintenant de Stendhal dont il faut écrire un mot.
Le style de Stendhal, je l’ai lu à plusieurs reprises dans certaines critiques serait froid, difficile, indigeste. Je ne partage pas du tout cet avis. Au contraire, la plume de Stendhal est tout à fait agréable, parfois même, l’auteur glisse quelques phrases au détour desquelles le lecteur ne peut que s’arrêter et méditer. De plus, en de (trop) rares et délicieuses occasions, il prend la liberté audacieuse de s’adresser directement au lecteur, lui faisant part de ces hésitations sur tels ou tels passages, ou des possibles censures dues à une conversation avec son éditeur, le tout non sans ironie.
C’est également un roman d’actualité, d’abord parce qu’il s’insère dans l’actualité de son temps, l’année 1830 et la fin de la restauration d’ailleurs l’histoire elle-même est inspirée d’un fait réel. Stendhal va si loin dans la chronique de son temps qu’il prédit même certains évènements liés à l’avènement futur de la monarchie de Juillet !
Outre cette prouesse qui démontre le degré d’analyse socio politique que l’auteur avait de son temps, Stendhal nous livre, à côté de la personnalité de Julien, le personnage de Mathilde de la Mole qui est une figure ardente, moderne, complexe et normale. La psychologie de ces deux personnages est particulièrement aboutie et atteint un niveau rarement égalé dans mes lectures.
La liaison de ces deux personnages est romanesque et dans le même temps très vraisemblable. La psychologie de Mathilde laisse entrevoir quelques rouages de la machine amoureuse, son amour tantôt pour Julien, tantôt pour la représentation qu’elle se fait de Julien en est l’exemple parlant.
J’ai adoré, parfois même exalté cette œuvre géniale.
On ne peut faire l’économie de ce qui – à mon sens – est la subjugation première de l’ouvrage : Julien Sorel. A l’exception de sa propre famille, ce dernier séduit Madame De Rhénal, son mari, ses enfants, Mathilde de la Mole & ses parents, les abbés Pirard & Chélan, Fouqué, Elisa, Mme De Fervaques et d’innombrables lecteurs à travers les âges, tout cela bien souvent malgré lui. On rêve de Julien, mais on se rêve aussi en Julien.
Sa jeunesse sans compromission, la force de son caractère, celle qui fait les grands hommes selon Nietzche, grand admirateur de Stendhal et de Napoléon.
Julien n’est pas un homme de raison, il est un héros de cœur, d’instinct. Un instinct de survie d’abord, il doit se forger une armure dans une société au sein de laquelle il semble n’avoir rien à faire, et que pourtant il va marquer de son sceau indélébile.
Mais aussi un héros de cœur, qui s’éveille à l’amour, la passion mais aussi au monde, à ses codes, un monde dont chaque nouvelle génération hérite sans l’avoir choisi.
Par Julien, le lecteur comme les personnages que l’auteur place sur sa route, ressentent l’énergie la plus pure et féroce circuler au détour de chaque page.
Julien Sorel est ce que l’on pourrait appeler un moraliste, son éthique bouleverse de par sa rigueur. L’homme en proie aux doutes finit par laisser place au héros romanesque, celui qui vit et meurt pour ses principes. Même s’il ne théorise en rien sa pensée, le lecteur peut la comprendre à travers le témoignage empirique de l’existence de Julien.
Cependant, ce qui rend Sorel définitivement acquis au cœur du lecteur, ce sont bien ses maladresses & ses doutes (tantôt le Rouge et les honneurs, en costume sur son cheval, ou dans les cafés de Besançon tantôt le Noir du séminaire et des textes en latin) et toujours cette énergie qui le pousse encore plus haut, toujours plus haut.
Le lecteur fait la connaissance de cet « enfant de 1830 » alors qu’il est dans une misère sociale apriori sans issues. Mais très vite, pitié et compassion vont laisser place à l’étonnement ainsi qu’à la fascination pour l’incroyable ascension sociale sans compromissions de Julien. On remarque avec l’abbé Pirard ou encore le Marquis de la Mole l’immense potentiel et surtout le cœur du jeune homme.
"La société étant divisée par tranches, comme un bambou, la grande affaire d'un homme est de monter dans la classe supérieure à la sienne et tout l'effort de cette classe est de l'empêcher de monter." Stendhal
Le Rouge et le Noir c’est aussi le roman d’une époque, et après Julien, c’est maintenant de Stendhal dont il faut écrire un mot.
Le style de Stendhal, je l’ai lu à plusieurs reprises dans certaines critiques serait froid, difficile, indigeste. Je ne partage pas du tout cet avis. Au contraire, la plume de Stendhal est tout à fait agréable, parfois même, l’auteur glisse quelques phrases au détour desquelles le lecteur ne peut que s’arrêter et méditer. De plus, en de (trop) rares et délicieuses occasions, il prend la liberté audacieuse de s’adresser directement au lecteur, lui faisant part de ces hésitations sur tels ou tels passages, ou des possibles censures dues à une conversation avec son éditeur, le tout non sans ironie.
C’est également un roman d’actualité, d’abord parce qu’il s’insère dans l’actualité de son temps, l’année 1830 et la fin de la restauration d’ailleurs l’histoire elle-même est inspirée d’un fait réel. Stendhal va si loin dans la chronique de son temps qu’il prédit même certains évènements liés à l’avènement futur de la monarchie de Juillet !
Outre cette prouesse qui démontre le degré d’analyse socio politique que l’auteur avait de son temps, Stendhal nous livre, à côté de la personnalité de Julien, le personnage de Mathilde de la Mole qui est une figure ardente, moderne, complexe et normale. La psychologie de ces deux personnages est particulièrement aboutie et atteint un niveau rarement égalé dans mes lectures.
La liaison de ces deux personnages est romanesque et dans le même temps très vraisemblable. La psychologie de Mathilde laisse entrevoir quelques rouages de la machine amoureuse, son amour tantôt pour Julien, tantôt pour la représentation qu’elle se fait de Julien en est l’exemple parlant.
Ayant lu, dans la même collection, le voyage relaté par Victor Hugo, de Bordeaux aux Pyrénées Centrales, j'ai abordé très confiant la lecture de Stendhal en suivant son périple de Bordeaux à Marseille.
Sur la forme déjà, le style de Stendhal, voire son absence bien souvent, n'a rien à voir avec la prose magnifique, lyrique de Victor Hugo, capable d'admiration pour toutes ses découvertes, les décrivant avec son talent bien connu qu'il est un réel plaisir de savourer à chaque phrase.
Sur le fond, Stendhal critique tout ou presque, paysages, climat, villes, architecture, peintures exposées dans les musées, les églises ou les cathédrales, et les humains, en prennent également pour leur grade, à l'exception surprenante des marseillais dont il critique la grossièreté mais admire leur art de vivre sur une terre privilégiée.
Ne trouvent grâce à ses yeux que la ville de Bordeaux, plus belle de France pour lui, encore qu'il ne manque pas de critiquer l'architecture du théâtre et l'ordonnancement de certaines rues ou avenues, et, les sourcils des filles d'Angoulême, de Bordeaux et de quelques cités espagnoles qu'il a traversées, purs fantasmes stendhaliens.
Il se plaint sans cesse du temps, du voyage, des auberges et des hôtels, des cafés où on lui sert le thé la plupart du temps dans de l'eau tiède, sauf à Marseille. D'ailleurs, j'ai éprouvé un bref regain d'intérêt pour la lecture une fois arrivé dans la cité phocéenne.
Mais avant, qu'il s'agisse de Bayonne, Pau, Tarbes, Auch, Carcassonne et surtout Montpellier où il n'a apprécié que le musée Fabre, tout n'est quasiment que laideur. Une exception pour Toulouse où il admire la basilique Saint-Sernin mais honnit la place du Capitole et pour Narbonne qui est également épargnée par ses critiques.
Il faut cependant reconnaître sa vaste connaissance historique, notamment sur le plan artistique, particulièrement en peinture, même s'il ne manque pas de suggérer de décrocher de nombreux tableaux qu'il dit horribles.
Je possède un énorme pavé de Stendhal sur ses promenades dans Rome -- 597 pages très serrées, suivies de près de 300 autres de notes -- que je viens de feuilleter et je me dis que c'est peut-être jouable à raison de dix pages par semaine, soit quasiment deux années avec Stendhal...
Ce bref voyage dans le Midi ne m'incite pas à le suivre dans la Ville Eternelle, mais il s'agit de Rome et non plus de Tarbes ou Montpellier... Si un lecteur m'y encourage... qui sait?
Sur la forme déjà, le style de Stendhal, voire son absence bien souvent, n'a rien à voir avec la prose magnifique, lyrique de Victor Hugo, capable d'admiration pour toutes ses découvertes, les décrivant avec son talent bien connu qu'il est un réel plaisir de savourer à chaque phrase.
Sur le fond, Stendhal critique tout ou presque, paysages, climat, villes, architecture, peintures exposées dans les musées, les églises ou les cathédrales, et les humains, en prennent également pour leur grade, à l'exception surprenante des marseillais dont il critique la grossièreté mais admire leur art de vivre sur une terre privilégiée.
Ne trouvent grâce à ses yeux que la ville de Bordeaux, plus belle de France pour lui, encore qu'il ne manque pas de critiquer l'architecture du théâtre et l'ordonnancement de certaines rues ou avenues, et, les sourcils des filles d'Angoulême, de Bordeaux et de quelques cités espagnoles qu'il a traversées, purs fantasmes stendhaliens.
Il se plaint sans cesse du temps, du voyage, des auberges et des hôtels, des cafés où on lui sert le thé la plupart du temps dans de l'eau tiède, sauf à Marseille. D'ailleurs, j'ai éprouvé un bref regain d'intérêt pour la lecture une fois arrivé dans la cité phocéenne.
Mais avant, qu'il s'agisse de Bayonne, Pau, Tarbes, Auch, Carcassonne et surtout Montpellier où il n'a apprécié que le musée Fabre, tout n'est quasiment que laideur. Une exception pour Toulouse où il admire la basilique Saint-Sernin mais honnit la place du Capitole et pour Narbonne qui est également épargnée par ses critiques.
Il faut cependant reconnaître sa vaste connaissance historique, notamment sur le plan artistique, particulièrement en peinture, même s'il ne manque pas de suggérer de décrocher de nombreux tableaux qu'il dit horribles.
Je possède un énorme pavé de Stendhal sur ses promenades dans Rome -- 597 pages très serrées, suivies de près de 300 autres de notes -- que je viens de feuilleter et je me dis que c'est peut-être jouable à raison de dix pages par semaine, soit quasiment deux années avec Stendhal...
Ce bref voyage dans le Midi ne m'incite pas à le suivre dans la Ville Eternelle, mais il s'agit de Rome et non plus de Tarbes ou Montpellier... Si un lecteur m'y encourage... qui sait?
Résumé :" Fils de charpentier, Julien Sorel est trop sensible et trop ambitieux pour suivre la carrière familiale dans la scierie d’une petite ville de province.
En secret, il nourrit une fascination pour Bonaparte et ses mémoires compilés dans Mémorial de Saint-Hélène de Las Cases.
Il rêve d’une ascension similaire à celle de l’empereur. Julien trouve une place de précepteur dans la maison du maire, Monsieur de Rénal, et noue une relation interdite avec son épouse. Chassé lorsque cette idylle est découverte, il rentre au séminaire de Besançon.
Avant peu, il monte à Paris et devient le secrétaire du Marquis de la Mole, dont il séduira la fille Mathilde.
Jusqu’au bout, Julien Sorel verra son ambition contrecarrée par ses sentiments, qui le conduiront à sa perte."
J'ai eu ce livre à étudier en cours de littérature il y a quelques années et je me souviens encore de ma réaction face à ce pavé : Au secours, Stendhal, je sens que ça va être ch... Mais en élève consciencieuse, je mis suis mise de bien mauvais cœur... Pour ne plus m'arrêter!!
La romantique qui sommeille en moi à adoré l'histoire d'amour interdite entre Julien Sorel et Mme de Rénal. Quant à sa relation avec Mathilde, bien que plus simple et autorisée, elle semble terriblement fade à côté de la passion que son amant a pour sa patronne.
La fin m'a surprise, et c'est sûrement ce qui fait toute l'intensité du récit.
Je me souviens à avoir été sous le choc plusieurs jours, incapable de commencer un autre livre. Il fallait que je "digére" celui-ci.
Je suis heureuse que Stendhal ait été au programme cette année-là, car je ne suis pas sûre que je l'aurait lu, sans ça.
Je le recommande à tous.
En secret, il nourrit une fascination pour Bonaparte et ses mémoires compilés dans Mémorial de Saint-Hélène de Las Cases.
Il rêve d’une ascension similaire à celle de l’empereur. Julien trouve une place de précepteur dans la maison du maire, Monsieur de Rénal, et noue une relation interdite avec son épouse. Chassé lorsque cette idylle est découverte, il rentre au séminaire de Besançon.
Avant peu, il monte à Paris et devient le secrétaire du Marquis de la Mole, dont il séduira la fille Mathilde.
Jusqu’au bout, Julien Sorel verra son ambition contrecarrée par ses sentiments, qui le conduiront à sa perte."
J'ai eu ce livre à étudier en cours de littérature il y a quelques années et je me souviens encore de ma réaction face à ce pavé : Au secours, Stendhal, je sens que ça va être ch... Mais en élève consciencieuse, je mis suis mise de bien mauvais cœur... Pour ne plus m'arrêter!!
La romantique qui sommeille en moi à adoré l'histoire d'amour interdite entre Julien Sorel et Mme de Rénal. Quant à sa relation avec Mathilde, bien que plus simple et autorisée, elle semble terriblement fade à côté de la passion que son amant a pour sa patronne.
La fin m'a surprise, et c'est sûrement ce qui fait toute l'intensité du récit.
Je me souviens à avoir été sous le choc plusieurs jours, incapable de commencer un autre livre. Il fallait que je "digére" celui-ci.
Je suis heureuse que Stendhal ait été au programme cette année-là, car je ne suis pas sûre que je l'aurait lu, sans ça.
Je le recommande à tous.
On peut s’interroger du choix du titre du roman de Stendhal, de sa symbolique. Dans cette « chronique du XIXe siècle », comme il le sous-titre par la suite, il met en bascule les deux couleurs comme une alternative qui décide selon le choix qu’il en est fait par ses protagonistes d’une couleur ou d’une autre, du rouge ou du noir. Le choix d’une carrière pour Julien Sorel, rouge ce sera l’armée, non pas pour l’uniforme mais pour l’écho qu’il en a des campagnes napoléoniennes et du sang versé, noir ce sera le clergé, et cette fois pour la couleur de l’habit de séminariste, personne vouée à l’apprentissage des connaissances mais qui n’a pas fait vœux de chasteté, et ce dernier point est capital pour l’importance de l’intrigue et la tension dramatique du roman. Julien Sorel opte pour cette dernière vocation dans les faits mais pour la première en esprit. Ainsi, son ambition lui ouvre la petite porte du salon de Monsieur de Rênal en tant que précepteur de ses enfants grâce à l’ancien testament qu’il a appris par cœur, et le cœur de Madame de Rênal grâce à son tempérament guerrier et conquérant que lui inspirent les mémoires de Napoléon Bonaparte qu’il admire.
Cette entrée dans le monde est l’opportunité que Julien Sorel espérait pour s’extraire du milieu social misérable dans lequel il est né et auquel il était destiné d’y croupir le restant de son existence, car il est fils de charpentier. Y voit-on là une allusion christique ? S’il n’en a certes pas les vertus spirituelles, ni la vocation, il ne se sert de la religion et de son organisation qu’à des fins de réussite personnelle et d’ascension sociale, son égo, pourrait-on supposer, s’accapare une destinée messianique idéalisée afin d’être l’élu de tous mais Stendhal récupère la vie de son héros en le portant non pas sur la croix, mais sur l’échafaud, la modernité des moyens ayant fait son œuvre (on n’arrête pas le progrès).
« Le Rouge et le Noir », sont aussi les deux composantes essentielles du roman, la passion et la mort. Julien Sorel séduit par sa jeunesse, rassure, endort, manipule par le noir de son habit, mais ses sentiments ne sont que le reflet de la véracité de ses ambitions. On doute de la sincérité de ses intentions auprès d’une Madame de Rênal, on ne croit que peu à son amour pour Mathilde de la Mole tant sa soif de réussite sociale étouffe tout sentimentalisme. Ce n’est qu’au seuil de la mort, lorsque les enjeux se sont évaporés, que la vraie nature de ses sentiments se révèle. Julien Sorel est un parvenu dont l’arrivisme ne se mesure pas en pièces sonnantes et trébuchantes, l’argent ne l’intéresse pas, mais par le rang qu’il parvient à occuper parmi le Monde. Il serait faux de réduire les roucoulements de nos amoureux à une simple et bête arlequinade (en référence aux éditions Arlequin, entendant bien que le magistral roman de Stendhal ne saurait souffrir la moindre comparaison avec les mièvreries diffusées par la dite maison d’édition). Il y a dans les passions qui nous sont comptées, la politique. Julien Sorel gouverne sa vie comme on gouverne un état. Si l’amour a des raisons que la raison ne connaît pas, pour Julien Sorel, l’amour est raison.
Fort de son tempérament guerrier et d’une intelligence vouée à sa réussite sociale, Julien Sorel échappe à la destinée qui lui était promise à sa naissance. Il se joue des desseins divins, provoque le ciel et obtient tout ce dont il espérait et même au-delà : une épouse passionnément amoureuse, une descendance, des biens patrimoniaux, un titre et un rang. Ce serait sans compter la colère céleste qui place sur son chemin un amour oublié, un excès de zèle couronné d’une lettre vengeresse et c’est la chute, la déchéance et la mort.
C’est le roman de la compromission. Julien Sorel vend son âme au diable pour nourrir les appétits de son égo, mais le malin décide de la fin, de son heure et de sa nature, pour enfin toucher son dû.
Editions Gallimard, Folio classique, 661 pages.
Cette entrée dans le monde est l’opportunité que Julien Sorel espérait pour s’extraire du milieu social misérable dans lequel il est né et auquel il était destiné d’y croupir le restant de son existence, car il est fils de charpentier. Y voit-on là une allusion christique ? S’il n’en a certes pas les vertus spirituelles, ni la vocation, il ne se sert de la religion et de son organisation qu’à des fins de réussite personnelle et d’ascension sociale, son égo, pourrait-on supposer, s’accapare une destinée messianique idéalisée afin d’être l’élu de tous mais Stendhal récupère la vie de son héros en le portant non pas sur la croix, mais sur l’échafaud, la modernité des moyens ayant fait son œuvre (on n’arrête pas le progrès).
« Le Rouge et le Noir », sont aussi les deux composantes essentielles du roman, la passion et la mort. Julien Sorel séduit par sa jeunesse, rassure, endort, manipule par le noir de son habit, mais ses sentiments ne sont que le reflet de la véracité de ses ambitions. On doute de la sincérité de ses intentions auprès d’une Madame de Rênal, on ne croit que peu à son amour pour Mathilde de la Mole tant sa soif de réussite sociale étouffe tout sentimentalisme. Ce n’est qu’au seuil de la mort, lorsque les enjeux se sont évaporés, que la vraie nature de ses sentiments se révèle. Julien Sorel est un parvenu dont l’arrivisme ne se mesure pas en pièces sonnantes et trébuchantes, l’argent ne l’intéresse pas, mais par le rang qu’il parvient à occuper parmi le Monde. Il serait faux de réduire les roucoulements de nos amoureux à une simple et bête arlequinade (en référence aux éditions Arlequin, entendant bien que le magistral roman de Stendhal ne saurait souffrir la moindre comparaison avec les mièvreries diffusées par la dite maison d’édition). Il y a dans les passions qui nous sont comptées, la politique. Julien Sorel gouverne sa vie comme on gouverne un état. Si l’amour a des raisons que la raison ne connaît pas, pour Julien Sorel, l’amour est raison.
Fort de son tempérament guerrier et d’une intelligence vouée à sa réussite sociale, Julien Sorel échappe à la destinée qui lui était promise à sa naissance. Il se joue des desseins divins, provoque le ciel et obtient tout ce dont il espérait et même au-delà : une épouse passionnément amoureuse, une descendance, des biens patrimoniaux, un titre et un rang. Ce serait sans compter la colère céleste qui place sur son chemin un amour oublié, un excès de zèle couronné d’une lettre vengeresse et c’est la chute, la déchéance et la mort.
C’est le roman de la compromission. Julien Sorel vend son âme au diable pour nourrir les appétits de son égo, mais le malin décide de la fin, de son heure et de sa nature, pour enfin toucher son dû.
Editions Gallimard, Folio classique, 661 pages.
" Le rouge et le noir ", ce grand classique contient quelques scènes cultes, comme celle où Julien à l'aide d'une échelle fait irruption dans la chambre de Madame de Rénal :
"Quel accueil me feront les chiens de garde, pensait-il ? Les chiens aboyèrent.....(1)
Il appuya son échelle à côté de la fenêtre, et frappa lui-même contre le volet, d'abord doucement, puis plus fort. Quelque obscurité qu'il fasse, on peut me tirer un coup de fusil, pensa Julien, le coeur tremblant....(2)
Il ouvrit le volet assez pour passer la tête .Tout à coup il vit une joue qui s'appuyait à la vitre contre laquelle était son oeil. Il tressaillit, et s'éloigna un peu....(3)
Un petit bruit sec se fit entendre ; l'espagnolette de la fenêtre cédait ; il poussa la croisée, et sauta légèrement dans la chambre. Il serra Madame de Rénal dans ses bras ; elle tremblait, et avait à peine la force de le repousser. Ainsi, Julien obtint ce qu'il avait désiré avec tant de passion, ainsi obtenu avec un tel art, ce ne fut plus qu'un plaisir...(4)"
1 : Julien, lors de sa tendre enfance, avait été mordu au mollet par un caniche nain, d'où son appréhension en entendant les chiens aboyer.
2 : Julien, lors de sa tendre enfance, avait volé des pommes dans un verger et le propriétaire l'ayant vu, lui avait tiré quelques plombs dans les fesses, d'où son appréhension.
3 : Julien, lors de sa tendre enfance, avait fait un bisou sur la joue de sa voisine (du même âge que lui), qui se croyant enceinte avait tout dit à ses parents. le père de sa voisine avait attrapé Julien et lui avait asséné quelques bons coups de martinet sur le postérieur, d'où son appréhension dans ses relations avec les filles car comme le dit Lacan :" Qui aime bien, châtie bien "
4 : Pour lire la version complète de la nuit torride qu'ils ont passée ensemble se rendre à la Bibliothèque nationale, à la section "L'enfer", on y trouve toutes les scènes "explicites" censurées. Demander le responsable de la section, M. Visselar.
Lien : https://kostickritic.blogspo..
"Quel accueil me feront les chiens de garde, pensait-il ? Les chiens aboyèrent.....(1)
Il appuya son échelle à côté de la fenêtre, et frappa lui-même contre le volet, d'abord doucement, puis plus fort. Quelque obscurité qu'il fasse, on peut me tirer un coup de fusil, pensa Julien, le coeur tremblant....(2)
Il ouvrit le volet assez pour passer la tête .Tout à coup il vit une joue qui s'appuyait à la vitre contre laquelle était son oeil. Il tressaillit, et s'éloigna un peu....(3)
Un petit bruit sec se fit entendre ; l'espagnolette de la fenêtre cédait ; il poussa la croisée, et sauta légèrement dans la chambre. Il serra Madame de Rénal dans ses bras ; elle tremblait, et avait à peine la force de le repousser. Ainsi, Julien obtint ce qu'il avait désiré avec tant de passion, ainsi obtenu avec un tel art, ce ne fut plus qu'un plaisir...(4)"
1 : Julien, lors de sa tendre enfance, avait été mordu au mollet par un caniche nain, d'où son appréhension en entendant les chiens aboyer.
2 : Julien, lors de sa tendre enfance, avait volé des pommes dans un verger et le propriétaire l'ayant vu, lui avait tiré quelques plombs dans les fesses, d'où son appréhension.
3 : Julien, lors de sa tendre enfance, avait fait un bisou sur la joue de sa voisine (du même âge que lui), qui se croyant enceinte avait tout dit à ses parents. le père de sa voisine avait attrapé Julien et lui avait asséné quelques bons coups de martinet sur le postérieur, d'où son appréhension dans ses relations avec les filles car comme le dit Lacan :" Qui aime bien, châtie bien "
4 : Pour lire la version complète de la nuit torride qu'ils ont passée ensemble se rendre à la Bibliothèque nationale, à la section "L'enfer", on y trouve toutes les scènes "explicites" censurées. Demander le responsable de la section, M. Visselar.
Lien : https://kostickritic.blogspo..
Quand on a des papillons dans le ventre, une envie folle de quelqu'un qu'on commence à connaître, quand on a une passion obsessionnelle pour cette personne, doit-on, et surtout peut-on résister stoïquement ?
Verrières, petite ville dans le Doubs, 1827. Julien Sorel est fils de charpentier. Il est méprisé par ses frères, forces de la nature, et même battu par son père parce qu'il est fin, délicat, ambitieux, et lit beaucoup. L'abbé Chilon le forme à la prêtrise. Julien a une mémoire prodigieuse. le maire, Monsieur de Rênal, cherche un précepteur parlant latin pour ses trois jeunes enfants. Il engage Julien. Mme de Rênal s'ennuie entre un mari coléreux et une vie de province paisible.
Coup de foudre simultané entre Mme de Rênal et Julien !
Elle prend l'initiative.
Mais elle résiste, car sa réputation de femme mariée est en jeu.
Combat moral intense !
La nuit, Julien grimpe à l'échelle....
Elle cède. La chose finit par se savoir. Julien est obligé de quitter Verrières et va au séminaire à Besançon.
Puis, par le fil des relations, il est recruté par Mr de la Mole à Paris.
Mlle de la Mole s'ennuie entre des amoureux riches, beaux, mais plats sur les quels elle a le dessus en moqueries à toutes les conversations, et une vie parisienne sans épopées héroïques comme celles dont elle rêve des temps de son aïeul Benjamin de la Mole, Henri III, la reine Margot, et Henri IV.
Julien est fort en gueule comme Danton. Elle est séduite.
Coup de foudre entre Mlle de la Mole et Julien.
Elle prend l'initiative !
Mathilde de la Mole, jeune fille d'esprit hautaine, orgueilleuse, ayant plusieurs partis en vue, résiste : elle ne va pas tomber amoureuse d'un petit abbé !
Combat moral très intense, car Mlle de la Mole est bien plus orgueilleuse que Louise de Rênal.
Le combat fait rage entre son envie viscérale de ce beau jeune homme audacieux et courageux, un peu fou, et loin du caractère mielleux de ses prétendants, et qui lui rappelle son aïeul Benjamin de la Mole, et son cerveau qui s'insurge contre ce charpentier de province, de tellement basse extraction, alors que son père, le marquis de la Mole vise un poste de ministre !
Bref !
La nuit, Julien grimpe à l'échelle...
.
Lourd au début, le récit s'anime ensuite.
Des épisodes du roman semblent hors contexte, comme la conspiration du marquis.
Une première force du roman est sa portée contre la religion qui est blâmée, par l'hypocrisie du vicaire Frilair, menteur et calculateur, qui vise un poste d'évêque, mais aussi par le jeune jésuite qui veut absolument confesser le condamné pour voir son nom étalé dans les journaux. Il y a aussi la lettre qui, dictée par un homme d'église à Louise de Rênal qui trahit Julien, met celle-ci en mauvaise posture entre la passion et le devoir moral.
Mais ce qui est captivant, c'est l'analyse des sentiments, le questionnement des amoureux, que ce soit Louise et Julien ou Mathilde et Julien.
Julien est au départ un plébéien révolté complexé par sa classe sociale. Il admire les exploits de Napoléon. En tant que secrétaire, il se "hisse" à la classe des petits bourgeois, mais ce n'est pas assez ; il imagine, soupçonne des complots que feraient dans son dos Mathilde et ses soupirants pour se moquer de lui.
La force De Stendhal, c'est cette capacité d'analyse de l'observation, de l'amusement puis de la naissance de l'amour...
Puis il y le combat, la lutte, les pièges tendus, les rêves ( ce petit curé serait un Danton ! ) de l'un comme de l'autre. le doute. Entre la pensée et le parler, il y a parfois un gouffre que comble l'imagination.
Et enfin l'auteur décrit le développement de la passion dévorante, obsessionnelle qui submerge tous les obstacles après une lutte acharnée du Viscéral, du Cerveau et du Coeur, passion qui explose comme un barrage qui cède sous la pression de l'eau, que les amants ne peuvent plus cacher, que ce soit à l'un comme à l'autre, ou à l'entourage !
.
Je me suis ennuyé au début, mais le style est prenant à la fin :)
Ceci est une relecture.
.
Verrières, petite ville dans le Doubs, 1827. Julien Sorel est fils de charpentier. Il est méprisé par ses frères, forces de la nature, et même battu par son père parce qu'il est fin, délicat, ambitieux, et lit beaucoup. L'abbé Chilon le forme à la prêtrise. Julien a une mémoire prodigieuse. le maire, Monsieur de Rênal, cherche un précepteur parlant latin pour ses trois jeunes enfants. Il engage Julien. Mme de Rênal s'ennuie entre un mari coléreux et une vie de province paisible.
Coup de foudre simultané entre Mme de Rênal et Julien !
Elle prend l'initiative.
Mais elle résiste, car sa réputation de femme mariée est en jeu.
Combat moral intense !
La nuit, Julien grimpe à l'échelle....
Elle cède. La chose finit par se savoir. Julien est obligé de quitter Verrières et va au séminaire à Besançon.
Puis, par le fil des relations, il est recruté par Mr de la Mole à Paris.
Mlle de la Mole s'ennuie entre des amoureux riches, beaux, mais plats sur les quels elle a le dessus en moqueries à toutes les conversations, et une vie parisienne sans épopées héroïques comme celles dont elle rêve des temps de son aïeul Benjamin de la Mole, Henri III, la reine Margot, et Henri IV.
Julien est fort en gueule comme Danton. Elle est séduite.
Coup de foudre entre Mlle de la Mole et Julien.
Elle prend l'initiative !
Mathilde de la Mole, jeune fille d'esprit hautaine, orgueilleuse, ayant plusieurs partis en vue, résiste : elle ne va pas tomber amoureuse d'un petit abbé !
Combat moral très intense, car Mlle de la Mole est bien plus orgueilleuse que Louise de Rênal.
Le combat fait rage entre son envie viscérale de ce beau jeune homme audacieux et courageux, un peu fou, et loin du caractère mielleux de ses prétendants, et qui lui rappelle son aïeul Benjamin de la Mole, et son cerveau qui s'insurge contre ce charpentier de province, de tellement basse extraction, alors que son père, le marquis de la Mole vise un poste de ministre !
Bref !
La nuit, Julien grimpe à l'échelle...
.
Lourd au début, le récit s'anime ensuite.
Des épisodes du roman semblent hors contexte, comme la conspiration du marquis.
Une première force du roman est sa portée contre la religion qui est blâmée, par l'hypocrisie du vicaire Frilair, menteur et calculateur, qui vise un poste d'évêque, mais aussi par le jeune jésuite qui veut absolument confesser le condamné pour voir son nom étalé dans les journaux. Il y a aussi la lettre qui, dictée par un homme d'église à Louise de Rênal qui trahit Julien, met celle-ci en mauvaise posture entre la passion et le devoir moral.
Mais ce qui est captivant, c'est l'analyse des sentiments, le questionnement des amoureux, que ce soit Louise et Julien ou Mathilde et Julien.
Julien est au départ un plébéien révolté complexé par sa classe sociale. Il admire les exploits de Napoléon. En tant que secrétaire, il se "hisse" à la classe des petits bourgeois, mais ce n'est pas assez ; il imagine, soupçonne des complots que feraient dans son dos Mathilde et ses soupirants pour se moquer de lui.
La force De Stendhal, c'est cette capacité d'analyse de l'observation, de l'amusement puis de la naissance de l'amour...
Puis il y le combat, la lutte, les pièges tendus, les rêves ( ce petit curé serait un Danton ! ) de l'un comme de l'autre. le doute. Entre la pensée et le parler, il y a parfois un gouffre que comble l'imagination.
Et enfin l'auteur décrit le développement de la passion dévorante, obsessionnelle qui submerge tous les obstacles après une lutte acharnée du Viscéral, du Cerveau et du Coeur, passion qui explose comme un barrage qui cède sous la pression de l'eau, que les amants ne peuvent plus cacher, que ce soit à l'un comme à l'autre, ou à l'entourage !
.
Je me suis ennuyé au début, mais le style est prenant à la fin :)
Ceci est une relecture.
.
"Armance" ou la passion refoulée ! Comme j’adore... J’ai toujours trouvé un côté très shakespearien à Stendhal, il parvient de manière magnifique, et tellement naturelle, à mettre en scène le tragique amoureux, et cette impression et plus que confirmée avec ce délicieux roman purement et parfaitement stendhalien, où règne un romantisme douloureux – et ce toujours sur fond historique, ici le sortir de la révolution. L’intrigue repose sur la lutte dans la souffrance contre un amour qui dépasse et submerge, l’amour impossible entre deux cousins, Armance et Octave ; ou plutôt rendu impossible par les deux protagonistes que pourtant tout tend à lier, y compris la famille des deux partis. Ils ne vivent que de leur amour, par et pour lui, mais ils sont bien trop aveuglés par leur orgueil et leur sens du sacrifice, pour être heureux et vivre en paix. Je trouve Octave en amant rêveur et solitaire merveilleux, le héros romantique par excellence… Qu’il est tourmenté et mélancolique ! Peut-être trop idéaliste dans sa vision du monde et de l’amour, et trop impulsif dans ses sentiments, c’est ce qui lui fait apparaître l’imperfection de toute chose encore plus grande, et ce qui fait de lui un héros souffrant magnifique. Mais celle qui me touche le plus, c’est incontestablement la jeune Armance, impuissante face à la grandeur de ses sentiments, et si magnifique dans sa souffrance et son abnégation ! Un couple malheureux à la hauteur des Fabrice Del Dongo/ Clélia Conti ("La Chartreuse de Parme") et Julien Sorel/Madame de Rénal ("Le Rouge et le Noir"). D’ailleurs, la fin d’"Armance" fait écho de manière troublante à celle de "La Chartreuse de Parme", écrit bien plus tard que le premier...
Bref, pour moi, une très belle découverte, courte mais intense, et la première petite merveille sur l’amour contrarié née de la plume du grand Stendhal !
Bref, pour moi, une très belle découverte, courte mais intense, et la première petite merveille sur l’amour contrarié née de la plume du grand Stendhal !
À réserver aux inconditionnels de Stendhal, car Lamiel est malheureusement un roman très inachevé, un brouillon dont le degré d’élaboration se situe à peine au tiers de celui de Lucien Leuwen, selon les spécialistes.
C’est bien dommage, car elle est pleine de potentiel, Lamiel, avec sa dévorante passion de la curiosité et son allergie à l’ennui, qui la fait tomber malade. Si Stendhal souffre quand il écrit ce roman de crises de goutte et d’horribles migraines, et a même la sensation de s’être «colleté avec le néant», cette «histoire fort immorale» est plutôt drôle et réjouissante dans ses attaques contre le carcan des convenances que l’héroïne envoie tranquillement valdinguer.
En contrepoint, il y a la satire de ses parents adoptifs, les Hautemare, aussi petitement dévots qu’il se peut. La très pieuse Mme Hautemare décide d’adopter une petite fille pour empêcher que leur héritage aille au neveu de son mari, «un impie», un «jacobin» qui «manque la messe fort souvent». Difficile de ne pas sourire du coup en voyant où leur éducation ne parlant «que de devoirs et de péchés» mène Lamiel, la rendant par exemple très désireuse de s’instruire sur cet amour contre lequel on s’acharne tant à la mettre en garde. La façon très rationnelle dont elle mène son expérimentation en la matière tranche avec les rôles généralement dévolus aux héroïnes du XIXème siècle: elle se choisit un «grand nigaud de vingt ans, fort blond» qui a déjà eu trois maîtresses et elle le paye pour qu’il la mène au bois (le truc au top des interdits des Hautemare et du curé). À la fin de l’expérimentation, Lamiel éclate de rire en se répétant : «Comment, ce fameux amour, ce n'est que ça !»
Dans l’état d’avancement où il se trouve, le livre est sans doute moins profond, moins fort que ce à quoi Stendhal nous a habitué, les personnages secondaires sont plus caricaturaux, mais il est très loin d’être dénué d’intérêt et de charme avec son humour et son héroïne étonnante.
C’est bien dommage, car elle est pleine de potentiel, Lamiel, avec sa dévorante passion de la curiosité et son allergie à l’ennui, qui la fait tomber malade. Si Stendhal souffre quand il écrit ce roman de crises de goutte et d’horribles migraines, et a même la sensation de s’être «colleté avec le néant», cette «histoire fort immorale» est plutôt drôle et réjouissante dans ses attaques contre le carcan des convenances que l’héroïne envoie tranquillement valdinguer.
En contrepoint, il y a la satire de ses parents adoptifs, les Hautemare, aussi petitement dévots qu’il se peut. La très pieuse Mme Hautemare décide d’adopter une petite fille pour empêcher que leur héritage aille au neveu de son mari, «un impie», un «jacobin» qui «manque la messe fort souvent». Difficile de ne pas sourire du coup en voyant où leur éducation ne parlant «que de devoirs et de péchés» mène Lamiel, la rendant par exemple très désireuse de s’instruire sur cet amour contre lequel on s’acharne tant à la mettre en garde. La façon très rationnelle dont elle mène son expérimentation en la matière tranche avec les rôles généralement dévolus aux héroïnes du XIXème siècle: elle se choisit un «grand nigaud de vingt ans, fort blond» qui a déjà eu trois maîtresses et elle le paye pour qu’il la mène au bois (le truc au top des interdits des Hautemare et du curé). À la fin de l’expérimentation, Lamiel éclate de rire en se répétant : «Comment, ce fameux amour, ce n'est que ça !»
Dans l’état d’avancement où il se trouve, le livre est sans doute moins profond, moins fort que ce à quoi Stendhal nous a habitué, les personnages secondaires sont plus caricaturaux, mais il est très loin d’être dénué d’intérêt et de charme avec son humour et son héroïne étonnante.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Stendhal
Quiz
Voir plus
La chartreuse de Parme
De quel pays est originaire le héros du roman ?
France
Italie
Espagne
Allemagne
10 questions
209 lecteurs ont répondu
Thème : La Chartreuse de Parme de
StendhalCréer un quiz sur cet auteur209 lecteurs ont répondu