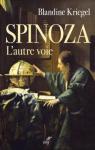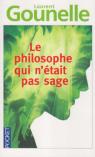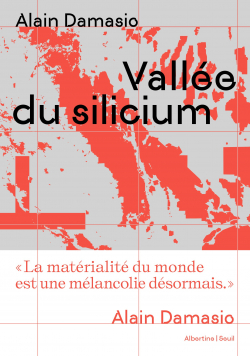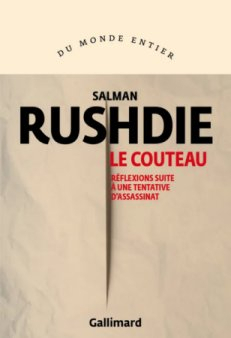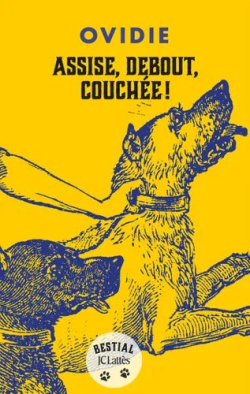"Le livre de l'amour infini" de Maxime Rovère émerge comme une oeuvre singulière et se fait remarquer parmi les nouvelles sorties. Au coeur de ce roman philosophique se trouve la vie d'Apollonios de Tyane, un éminent penseur grec du premier siècle de notre ère.
L'ouvrage met en lumière les défis de la vie intérieure, notamment à travers le personnage de Damis, disciple d'Apollonios, aux prises avec les tourments de l'amour pour Psyché. Dans un monde où les passions et les attachements entravent souvent le chemin vers la sagesse, la notion de détachement se révèle cruciale. Cependant, cette quête est constamment mise à l'épreuve par des forces extérieures, telles que la politique tyrannique de Néron, qui entrave la transmission de la sagesse.
La mort, omniprésente dans la philosophie d'Apollonios, est également explorée avec profondeur. Pour cet héritier de la tradition pythagoricienne, la mort n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape nécessaire à la perfection de l'existence.
Le roman nous emmène également dans un voyage à travers l'histoire et la géographie, à la découverte des sagesses de l'Inde, de la Grèce et de l'Afrique noire.
Pourtant, malgré son titre évocateur, "Le livre de l'amour infini" n'est pas un manuel de développement personnel ordinaire. Il ne promet pas une quête facile vers un amour infini accessible à tous. Au contraire, il souligne l'exigence et le caractère collectif de cette quête, où l'amour infini est synonyme d'un exercice constant visant à atteindre la sagesse.

Maxime Rovere/5
64 notes
Résumé :
1677. Un groupe d’intellectuels publie à Amsterdam un livre intitulé Œuvres posthumes avec pour nom d’auteur : B.d.S. Qui se cache derrière ces initiales? Bento de Spinoza, certes... mais pas seulement. Son livre est le produit d’échanges palpitants entre les savants de toute l’Europe, de querelles entre les communautés juives et chrétiennes mal unies, d’amitiés éternelles et même d’amours déçues.
Cette fantaisie historique et philosophique, entièreme... >Voir plus
Cette fantaisie historique et philosophique, entièreme... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le clan SpinozaVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (14)
Voir plus
Ajouter une critique
Au début du 17ème siècle la famille de Spinoza a quitté le Portugal pour La Hollande afin de pouvoir pratiquer sa religion dans un pays où vit déjà une importante communauté juive. Bento Spinoza est né en 1632 à Amsterdam. Il sera chassé de sa communauté en 1656 pour des raisons plus économiques qu'idéologiques. Il développe en effet assez librement ses idées, bénéficiant du climat de liberté qui règne entre 1650 et 1670 dans les Provinces Unies.
La vie intellectuelle y est très riche, les idées de Descartes sont débattues, la place de la religion dans la connaissance humaine, des découvertes bouleversent les sciences et les mathématiques. Spinoza va s'éloigner de la religion, considérant que Dieu est la Nature et la cause de toute chose, que les choses de la nature sont nécessaires, que seule la raison permet de saisir la vérité et qu'elle peut s'exercer sur tout. Entouré d'amis malgré une vie frugale, il va rédiger son célèbre texte, l'Éthique, à partir d'un raisonnement mathématique et défendre la liberté de philosopher dans son Traité théologico-politique. Bien d'autres figures intellectuelles en relation avec lui sont évoquées, van den Enden, Oldenburg, Leibniz...
L'intérêt du roman de Maxime Rovere, c'est de nous peindre cette époque où nait la notion de liberté, où le développement du commerce, des sciences, de la philosophie affranchissent l'homme du discours religieux dogmatique, où les aspirations politiques commencent à vouloir s'éloigner des monarchies absolues, contexte historique de la naissance d'une oeuvre fondatrice de la modernité. Loin des clichés et des pensées figées, il nous offre un tableau vivant de cette époque autour de la figure d'un philosophe attachant car resté fidèle à lui-même, modeste bien que génial, humble dans sa contribution à l'histoire de la pensée. Un roman qui puise directement aux sources de l'histoire et de la philosophie, donc d'une lecture parfois un peu ardue mais passionnante.
La vie intellectuelle y est très riche, les idées de Descartes sont débattues, la place de la religion dans la connaissance humaine, des découvertes bouleversent les sciences et les mathématiques. Spinoza va s'éloigner de la religion, considérant que Dieu est la Nature et la cause de toute chose, que les choses de la nature sont nécessaires, que seule la raison permet de saisir la vérité et qu'elle peut s'exercer sur tout. Entouré d'amis malgré une vie frugale, il va rédiger son célèbre texte, l'Éthique, à partir d'un raisonnement mathématique et défendre la liberté de philosopher dans son Traité théologico-politique. Bien d'autres figures intellectuelles en relation avec lui sont évoquées, van den Enden, Oldenburg, Leibniz...
L'intérêt du roman de Maxime Rovere, c'est de nous peindre cette époque où nait la notion de liberté, où le développement du commerce, des sciences, de la philosophie affranchissent l'homme du discours religieux dogmatique, où les aspirations politiques commencent à vouloir s'éloigner des monarchies absolues, contexte historique de la naissance d'une oeuvre fondatrice de la modernité. Loin des clichés et des pensées figées, il nous offre un tableau vivant de cette époque autour de la figure d'un philosophe attachant car resté fidèle à lui-même, modeste bien que génial, humble dans sa contribution à l'histoire de la pensée. Un roman qui puise directement aux sources de l'histoire et de la philosophie, donc d'une lecture parfois un peu ardue mais passionnante.
Ouvrage de fiction sans doute le plus documenté, ni tout à fait essai, ni roman littéraire, ni réduit à une exégèse philosophique, le livre de Maxime Rovere est avant tout le fruit d'une immense passion de l'auteur pour l'oeuvre majeure de Spinoza, l'Éthique, et la mise en pratique d'une démarche philosophique authentique : s'abstraire du texte pour entamer une véritable réflexion personnelle.
Telle est la principale leçon de l'héritage de Bento de Spinoza : le philosophe ne propose pas un corpus déjà constitué visant à élaborer une nouvelle théorie. Il ne se pose pas en savant, mais ambitionne, non de changer l'ordre des choses, mais d'amener son lecteur à faire table rase de ses préjugés et de son ignorance pour comprendre par la Raison et accéder à la véritable connaissance. Il faut être capable de penser contre sa propre expérience, contre ses propres convictions. C'est ce à quoi conduit l'abstraction, l'épreuve la plus simple et la plus difficile de la philosophie. L'écueil le plus courant est que le lecteur s'en tienne au texte, alors que la connaissance surgit de la friction entre le texte et la réflexion du lecteur.
Le « clan de Spinoza » entreprend un travail historico-philosophique qui déconstruit le mythe d'un philosophe d'exception, solitaire, tailleur de lentilles et athée. Loin de l'image de l'homme sage, ascétique, chantre de la joie et d'une béatitude quasi mystique, Rovere nous fait découvrir la cacophonie créatrice des idées qui parcourent l'Europe du XVIIe siècle, de rencontres avec Gottfried Wilhelm Leibniz, Henry Oldenburg, Nicolas Sténon ou Thomas Hobbes, ouvrant la voie à Rousseau, à Voltaire et aux Lumières en posant la Raison comme principe absolu face aux croyances.
En parcourant les tensions théologico-religieuses entre cartésiens, les rivalités rabbiniques entre Menasseh ben Israël et Saül Levi Morteira, ou les joutes intellectuelles avec Johannes Bouwmeester, Adriaen Koerbagh, Henry Oldenburg, Pierre Balling, et les intrigues politiques soutenues par Franciscus van den Enden, Spinoza apparaît de façon inédite au coeur d'un réseau d'hommes épris de liberté. Ils forgent, par impulsions violentes, dans l'atmosphère extraordinairement créative du « Siècle d'or » hollandais, le monde moderne de demain. En ce sens, les intellectuels et philosophes du XVIIe siècle ne sont pas des écrivains, mais des hommes d'action.
Outre la prodigieuse audace et subtilité des idées, souvent obscurcies par la rigueur géométrique et mathématique de leur démonstration, le livre de Rovere nous dépeint un homme plein de passion, de colère, d'ironie et de déceptions, traqué par ses ennemis, fuyant la gloire et renonçant à publier de son vivant, protégé par un cercle d'amis et d'admirateurs fidèles.
N'en déplaise aux contemplatifs, la tristesse, la colère ou la souffrance sont des nécessités de la nature humaine, liées à des forces qui nous submergent. La béatitude n'est que la connaissance rationnelle de Dieu. Et l'amour de Dieu s'exprime, dans l'esprit humain, par la joie de comprendre.
L'icône d'un Spinoza apôtre de la béatitude et du désir, c'est précisément cette image-là que l'Éthique a voulu détruire. Avec des méthodes qu'il tente de construire au gré des contextes et des difficultés, cette philosophie s'attache à transformer rationnellement les passions et les forces actives capables de perfectionner leur efficacité.
Pour restituer ces facettes de la vie, l'universitaire Rovere s'empare de la plume d'un romancier, employant parfois un langage trivial au plus près du jaillissement des idées et des controverses qui ont alimenté collectivement l'oeuvre de Spinoza, jamais vraiment enfermé dans la solitude. Ne cédant en rien à la rigueur historique, Rovere, puisant dans les sources les plus exhaustives (*) explorées en collaboration avec son réseau d'experts pendant plus de cinq ans, réussit l'exploit de faire parler et incarner au quotidien les préoccupations de personnages authentiques ayant vécu il y a plus de trois siècles et demi.
Singulièrement décrié par ses contemporains, Spinoza fut le penseur le plus radical et iconoclaste de son temps sur la religion, la politique, l'éthique, la psychologie humaine et la métaphysique. Mais comme le remarque Maxime Rovere, jamais Spinoza n'a été autant lu aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé. Pourquoi ce regain tardif de popularité pour un philosophe que Pierre Bayle qualifiait ironiquement d'« auteur obscur même pour les esprits les plus savants » ?
Pourquoi lisons-nous Spinoza aujourd'hui ? N'est-ce pas parce qu'au XVIIe siècle comme au XXIe, des communautés ne s'entendent pas et que des religions continuent à s'affronter ? Spinoza peut alors apparaître comme un remède à nos malheurs contemporains. Car « dans un rapport humain, on cesse d'être dans le vrai dès lors que l'on entre dans l'affrontement : toute formule qui détruit la relation perd sa vérité de facto. de ce point de vue, la raison n'apparaît pas principalement comme une lumière divine, ni seulement comme une révélation de l'absolu mathématique, mais comme une manière d'organiser ensemble le bric-à-brac des choses et des pensées. Quiconque a eu un jour besoin d'un appui, et quiconque a déjà été utile par ses conseils, sait bien que la sagesse humaine dépend principalement des effets que nous produisons sur les autres. La sagesse opère essentiellement comme un transfert subtil où les paroles de l'un donnent de la force à l'autre, où quelque chose circule et s'entretient par un cercle de confiance et de reconnaissance. le sage, c'est toujours l'autre. Et réciproquement, on ne peut être que le sage de l'autre. »
Si l'on ne peut être qu'admiratif de cette remarquable fresque historique qui redonne vie au monde qui a vu naître la Raison moderne entre crises religieuses, expansion du commerce, constitution des États modernes et révolutions dans tous les domaines du savoir, on pourra également se saisir de ce livre comme d'un véritable exercice de raisonnement spinoziste, au sens où il éclaire la manière dont la pensée la plus claire ne naît que dans une multiplicité de relations intellectuelles et affectives.
Dans tous les cas, il s'agit d'un très beau livre dont le principal mérite est de tenir la promesse de la philosophie : toujours produire des joies individuelles et universelles de la pensée.
(*) Soulignons l'exceptionnel travail bibliographique, offrant toutes ses sources sur le site Internet.
Telle est la principale leçon de l'héritage de Bento de Spinoza : le philosophe ne propose pas un corpus déjà constitué visant à élaborer une nouvelle théorie. Il ne se pose pas en savant, mais ambitionne, non de changer l'ordre des choses, mais d'amener son lecteur à faire table rase de ses préjugés et de son ignorance pour comprendre par la Raison et accéder à la véritable connaissance. Il faut être capable de penser contre sa propre expérience, contre ses propres convictions. C'est ce à quoi conduit l'abstraction, l'épreuve la plus simple et la plus difficile de la philosophie. L'écueil le plus courant est que le lecteur s'en tienne au texte, alors que la connaissance surgit de la friction entre le texte et la réflexion du lecteur.
Le « clan de Spinoza » entreprend un travail historico-philosophique qui déconstruit le mythe d'un philosophe d'exception, solitaire, tailleur de lentilles et athée. Loin de l'image de l'homme sage, ascétique, chantre de la joie et d'une béatitude quasi mystique, Rovere nous fait découvrir la cacophonie créatrice des idées qui parcourent l'Europe du XVIIe siècle, de rencontres avec Gottfried Wilhelm Leibniz, Henry Oldenburg, Nicolas Sténon ou Thomas Hobbes, ouvrant la voie à Rousseau, à Voltaire et aux Lumières en posant la Raison comme principe absolu face aux croyances.
En parcourant les tensions théologico-religieuses entre cartésiens, les rivalités rabbiniques entre Menasseh ben Israël et Saül Levi Morteira, ou les joutes intellectuelles avec Johannes Bouwmeester, Adriaen Koerbagh, Henry Oldenburg, Pierre Balling, et les intrigues politiques soutenues par Franciscus van den Enden, Spinoza apparaît de façon inédite au coeur d'un réseau d'hommes épris de liberté. Ils forgent, par impulsions violentes, dans l'atmosphère extraordinairement créative du « Siècle d'or » hollandais, le monde moderne de demain. En ce sens, les intellectuels et philosophes du XVIIe siècle ne sont pas des écrivains, mais des hommes d'action.
Outre la prodigieuse audace et subtilité des idées, souvent obscurcies par la rigueur géométrique et mathématique de leur démonstration, le livre de Rovere nous dépeint un homme plein de passion, de colère, d'ironie et de déceptions, traqué par ses ennemis, fuyant la gloire et renonçant à publier de son vivant, protégé par un cercle d'amis et d'admirateurs fidèles.
N'en déplaise aux contemplatifs, la tristesse, la colère ou la souffrance sont des nécessités de la nature humaine, liées à des forces qui nous submergent. La béatitude n'est que la connaissance rationnelle de Dieu. Et l'amour de Dieu s'exprime, dans l'esprit humain, par la joie de comprendre.
L'icône d'un Spinoza apôtre de la béatitude et du désir, c'est précisément cette image-là que l'Éthique a voulu détruire. Avec des méthodes qu'il tente de construire au gré des contextes et des difficultés, cette philosophie s'attache à transformer rationnellement les passions et les forces actives capables de perfectionner leur efficacité.
Pour restituer ces facettes de la vie, l'universitaire Rovere s'empare de la plume d'un romancier, employant parfois un langage trivial au plus près du jaillissement des idées et des controverses qui ont alimenté collectivement l'oeuvre de Spinoza, jamais vraiment enfermé dans la solitude. Ne cédant en rien à la rigueur historique, Rovere, puisant dans les sources les plus exhaustives (*) explorées en collaboration avec son réseau d'experts pendant plus de cinq ans, réussit l'exploit de faire parler et incarner au quotidien les préoccupations de personnages authentiques ayant vécu il y a plus de trois siècles et demi.
Singulièrement décrié par ses contemporains, Spinoza fut le penseur le plus radical et iconoclaste de son temps sur la religion, la politique, l'éthique, la psychologie humaine et la métaphysique. Mais comme le remarque Maxime Rovere, jamais Spinoza n'a été autant lu aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé. Pourquoi ce regain tardif de popularité pour un philosophe que Pierre Bayle qualifiait ironiquement d'« auteur obscur même pour les esprits les plus savants » ?
Pourquoi lisons-nous Spinoza aujourd'hui ? N'est-ce pas parce qu'au XVIIe siècle comme au XXIe, des communautés ne s'entendent pas et que des religions continuent à s'affronter ? Spinoza peut alors apparaître comme un remède à nos malheurs contemporains. Car « dans un rapport humain, on cesse d'être dans le vrai dès lors que l'on entre dans l'affrontement : toute formule qui détruit la relation perd sa vérité de facto. de ce point de vue, la raison n'apparaît pas principalement comme une lumière divine, ni seulement comme une révélation de l'absolu mathématique, mais comme une manière d'organiser ensemble le bric-à-brac des choses et des pensées. Quiconque a eu un jour besoin d'un appui, et quiconque a déjà été utile par ses conseils, sait bien que la sagesse humaine dépend principalement des effets que nous produisons sur les autres. La sagesse opère essentiellement comme un transfert subtil où les paroles de l'un donnent de la force à l'autre, où quelque chose circule et s'entretient par un cercle de confiance et de reconnaissance. le sage, c'est toujours l'autre. Et réciproquement, on ne peut être que le sage de l'autre. »
Si l'on ne peut être qu'admiratif de cette remarquable fresque historique qui redonne vie au monde qui a vu naître la Raison moderne entre crises religieuses, expansion du commerce, constitution des États modernes et révolutions dans tous les domaines du savoir, on pourra également se saisir de ce livre comme d'un véritable exercice de raisonnement spinoziste, au sens où il éclaire la manière dont la pensée la plus claire ne naît que dans une multiplicité de relations intellectuelles et affectives.
Dans tous les cas, il s'agit d'un très beau livre dont le principal mérite est de tenir la promesse de la philosophie : toujours produire des joies individuelles et universelles de la pensée.
(*) Soulignons l'exceptionnel travail bibliographique, offrant toutes ses sources sur le site Internet.
Essai philosophique qui se présente « non comme une fiction d'après une histoire vraie (ce qu'il est en première approximation), mais comme une recherche pour approcher par tous les moyens littéraires la “vérité“ d'un univers disparu. »
Dans l'Espagne puis le Portugal d'après la Reconquista, les Juifs, “convertis“ ou “marranes“, toujours persécutés, ne se sentent pas à l'aise et beaucoup émigrent. À la toute fin du XVIe siècle la famille de Spinoza part en France, à Nantes, puis, après y avoir commercé une vingtaine d'années, rejoint Amsterdam où est déjà installée une importante communauté juive. Laquelle est l'objet de querelles en partie animées par un certain Uriel da Costa qui se rebelle contre des fidélités au Livre et aux traditions qu'il juge dogmatiques et fallacieuses. le Rabbi Menasseh, qualifié de philochrétien, prendra une certaine relève dans la contestation, tandis que le Rabbi en chef Morteira se chargera de la continuité des traditions et réorganisera la Synagogue d'Amsterdam en créant le Mahamad, sorte de Conseil supérieur centralisant la Justice et les sanctions dans la communauté.
Bento Spinoza naît en 1632. Éduqué dans une institution hébraïque, une Yeshiva, il manifeste assez tôt une nette indépendance d'esprit. Celle-ci sera nourrie plus tard par des amitiés avec des personnalités comme Pieter Balling, Isaac et Simon de Vries, Jarig Jellesz, etc. Il fera la connaissance de Franciscus van den Enden, professeur de latin qui anime une école et se révèlera bien plus tard un ardent révolutionnaire décidé à fonder une république en Bretagne. Il se liera également avec Sténon, un éminent anatomiste qui reniera sa foi protestante pour devenir un ardent pèlerin catholique, ainsi qu'avec Adriaen Koerbagh, encyclopédiste et l'anglais Oldenburg avec qui il entretiendra une correspondance passionnée, enfin avec l'allemand Leibnitz.
Le XVIIe siècle découvre ou approfondit les sciences, fondamentales ou appliquées, les mathématiques, la géométrie, l'astronomie, les lois de la pesanteur, l'optique, etc. Tout cela, qui exige rigueur et méthode, devient vite incontournable, faisant de la Raison le credo de l'époque. Descartes acquiert le statut de référence absolue. Bien d'autres penseurs foisonnent en Europe.
Armés de la Raison cartésienne, Spinoza et ses amis en font le soutien de la Foi et de la Sagesse, plaçant Dieu dans leur Panthéon, mais un Dieu dont ils redéfinissent les contours. Accusé d'athéisme, Spinoza s'en défendra vigoureusement. Seulement son Dieu à lui n'est pas de chair, à l'image de l'homme, et omnipotent, mais assimilé en fait à la Nature, au monde, intégré à soi. C'est le principe absolu de l'existence.
L'ambition de l'auteur, Maxime Rovere, spécialiste de Spinoza, était de mêler des faits réels, établis, des citations - matière pour les historiens -, avec des extensions fictives, romanesques, de manière à montrer « comment la pensée trouve son chemin dans le concret d'une vie ». le résultat est animé, mouvementé même et tourne non seulement autour de Spinoza, mais aussi de ses proches, de son milieu intellectuel, de la communauté juive (qui l'a excommunié), des mouvements politiques et militaires de l'époque. Les passages “romancés“ alternent avec des considérations philosophiques continues, relevées par l'auteur dans des écrits ou des archives, ou élaborées par Rovere lui-même, comme une série de pensums, de concepts, de synthèses. Mon sentiment au terme de cette lecture est tout de même et avant tout, d'avoir lu un manuel de philosophie… masqué, et pourtant de n'avoir pas vraiment été imprégné par le spinosisme, pensée complexe appréhendée sommairement ou par bribes, et qu'il me reste à approfondir.
Dans l'Espagne puis le Portugal d'après la Reconquista, les Juifs, “convertis“ ou “marranes“, toujours persécutés, ne se sentent pas à l'aise et beaucoup émigrent. À la toute fin du XVIe siècle la famille de Spinoza part en France, à Nantes, puis, après y avoir commercé une vingtaine d'années, rejoint Amsterdam où est déjà installée une importante communauté juive. Laquelle est l'objet de querelles en partie animées par un certain Uriel da Costa qui se rebelle contre des fidélités au Livre et aux traditions qu'il juge dogmatiques et fallacieuses. le Rabbi Menasseh, qualifié de philochrétien, prendra une certaine relève dans la contestation, tandis que le Rabbi en chef Morteira se chargera de la continuité des traditions et réorganisera la Synagogue d'Amsterdam en créant le Mahamad, sorte de Conseil supérieur centralisant la Justice et les sanctions dans la communauté.
Bento Spinoza naît en 1632. Éduqué dans une institution hébraïque, une Yeshiva, il manifeste assez tôt une nette indépendance d'esprit. Celle-ci sera nourrie plus tard par des amitiés avec des personnalités comme Pieter Balling, Isaac et Simon de Vries, Jarig Jellesz, etc. Il fera la connaissance de Franciscus van den Enden, professeur de latin qui anime une école et se révèlera bien plus tard un ardent révolutionnaire décidé à fonder une république en Bretagne. Il se liera également avec Sténon, un éminent anatomiste qui reniera sa foi protestante pour devenir un ardent pèlerin catholique, ainsi qu'avec Adriaen Koerbagh, encyclopédiste et l'anglais Oldenburg avec qui il entretiendra une correspondance passionnée, enfin avec l'allemand Leibnitz.
Le XVIIe siècle découvre ou approfondit les sciences, fondamentales ou appliquées, les mathématiques, la géométrie, l'astronomie, les lois de la pesanteur, l'optique, etc. Tout cela, qui exige rigueur et méthode, devient vite incontournable, faisant de la Raison le credo de l'époque. Descartes acquiert le statut de référence absolue. Bien d'autres penseurs foisonnent en Europe.
Armés de la Raison cartésienne, Spinoza et ses amis en font le soutien de la Foi et de la Sagesse, plaçant Dieu dans leur Panthéon, mais un Dieu dont ils redéfinissent les contours. Accusé d'athéisme, Spinoza s'en défendra vigoureusement. Seulement son Dieu à lui n'est pas de chair, à l'image de l'homme, et omnipotent, mais assimilé en fait à la Nature, au monde, intégré à soi. C'est le principe absolu de l'existence.
L'ambition de l'auteur, Maxime Rovere, spécialiste de Spinoza, était de mêler des faits réels, établis, des citations - matière pour les historiens -, avec des extensions fictives, romanesques, de manière à montrer « comment la pensée trouve son chemin dans le concret d'une vie ». le résultat est animé, mouvementé même et tourne non seulement autour de Spinoza, mais aussi de ses proches, de son milieu intellectuel, de la communauté juive (qui l'a excommunié), des mouvements politiques et militaires de l'époque. Les passages “romancés“ alternent avec des considérations philosophiques continues, relevées par l'auteur dans des écrits ou des archives, ou élaborées par Rovere lui-même, comme une série de pensums, de concepts, de synthèses. Mon sentiment au terme de cette lecture est tout de même et avant tout, d'avoir lu un manuel de philosophie… masqué, et pourtant de n'avoir pas vraiment été imprégné par le spinosisme, pensée complexe appréhendée sommairement ou par bribes, et qu'il me reste à approfondir.
Relu dernièrement et avec le même plaisir.
Ce faux roman historique est une petite merveille, il peut se rapprocher de l'écriture et l'immense culture d'un Rabelais, d'un Jean d'Ormesson.
Ce n'est pas un sot qui a écrit ce livre, mais un agrégé de philosophie, qui pousse jusqu'au doctorat, et qui continue son rêve, affine sa passion, l'incarne tout entière, grâce aux nombreux personnages du récit.
Je comprends tout à fait ce besoin de faire perdurer, voire d'éterniser un héros qui a occupé pendant de longues années son temps.
Maxime Rovere aime trop Spinoza pour le laisser dans des oubliettes, ou figé dans ses habits de philosophe amidonnés, aseptisés, tel que les exégètes l'ont sans grande imagination toujours commenté et présenté.
Alors quelle magique idée que celle-là qui permet d'aborder sous divers angles ce philosophe et son époque, ses amis et ennemis, grâce au récit émaillé de dialogues savoureux et didactiques, qui sont comme un film, une fresque, un moment digne de passer dans une émission télévisée comme Secrets d'Histoire.
Voila un pied de nez aux vieux universitaires grincheux qui ne supportent pas ce genre d'ouvrage.
Voici qui récompensera toutes ces années de travail, pour un jeune universitaire qui a cherché par tous les moyens, de poursuivre son étude, son amour pour la Philosophie, la reflexions, la vérité.
Pour tous les amoureux de la belle langue, du roman, de Spinoza, du XVIIeme siècle, de tout ce qui rend savant et heureux.
Ce faux roman historique est une petite merveille, il peut se rapprocher de l'écriture et l'immense culture d'un Rabelais, d'un Jean d'Ormesson.
Ce n'est pas un sot qui a écrit ce livre, mais un agrégé de philosophie, qui pousse jusqu'au doctorat, et qui continue son rêve, affine sa passion, l'incarne tout entière, grâce aux nombreux personnages du récit.
Je comprends tout à fait ce besoin de faire perdurer, voire d'éterniser un héros qui a occupé pendant de longues années son temps.
Maxime Rovere aime trop Spinoza pour le laisser dans des oubliettes, ou figé dans ses habits de philosophe amidonnés, aseptisés, tel que les exégètes l'ont sans grande imagination toujours commenté et présenté.
Alors quelle magique idée que celle-là qui permet d'aborder sous divers angles ce philosophe et son époque, ses amis et ennemis, grâce au récit émaillé de dialogues savoureux et didactiques, qui sont comme un film, une fresque, un moment digne de passer dans une émission télévisée comme Secrets d'Histoire.
Voila un pied de nez aux vieux universitaires grincheux qui ne supportent pas ce genre d'ouvrage.
Voici qui récompensera toutes ces années de travail, pour un jeune universitaire qui a cherché par tous les moyens, de poursuivre son étude, son amour pour la Philosophie, la reflexions, la vérité.
Pour tous les amoureux de la belle langue, du roman, de Spinoza, du XVIIeme siècle, de tout ce qui rend savant et heureux.
Voilà un roman qui se démarque des autres et à plusieurs titres.
L'auteur y fait preuve d'une érudition encyclopédique étonnante. Il semble avoir tout lu sur le sujet qui l'intéresse, d'où l'abondance de titres et de dates, avec indication de la langue dans laquelle les oeuvres ont été rédigées. Il pousse sa fidélité si loin qu'il signale par des guillemets les citations et extraits de ces ouvrages, qu'il s'agisse d'un ou deux mots ou de phrases plus longues avec respect des tournures employées alors. Il en profite pour mettre à mal les clichés qui encombrent les biographies sur Spinoza, prouvant qu'ils ne reposent sur rien.
Dès lors le roman est un roman sans être un roman. Les nombreuses interventions de l'auteur dans ses pages, ses fréquentes adresses au lecteur se démarquent de la production habituelle. de même, le choix d'y inclure poèmes, chansons, pièces de théâtre, décisions judiciaires en fait un patchwork qui reflète la vie de toute une époque. Roman ambitieux donc, où figures populaires côtoient les grands noms de l'Histoire tels que Guillaume d'Orange, Louis XIV et des intellectuels tels que Descartes, Spinoza, Hobbes, Leibnitz et tant d'autres. le roman comme résurrection du passé.
Dernière originalité : l'auteur ne craint pas la difficulté et fait oeuvre de vulgarisation. Il résume en effet les différents textes qui jalonnent la vie de Spinoza et nous en donne un aperçu clair et succinct. de la sorte il met en relief tant les clivages religieux et philosophiques des Pays-Bas à leur âge d'or que l'effort de certains pour penser par eux-mêmes et se libérer du carcan des confessions religieuses (catholicisme, calvinisme, judaïsme), toutes conservatrices et répressives. C'est donc un éloge indirect de la philosophie et de la raison auquel il nous convie.
Est-ce pour autant un chef-d'oeuvre ? Non. Pour plusieurs raisons. D'abord, l'auteur a beau enseigner la philosophie, il ne maîtrise pas la langue française comme on le voudrait. Il confond ainsi refouler avec refluer, est fâché à plus d'une reprise avec l'accord du participe passé. L'unité de ton n'est pas son fort, lui qui mêle style noble et relevé avec mots crus et orduriers, ce qui a de quoi choquer esthétiquement. Enfin le drame vécu par Spinoza dans sa lutte contre l'obscurantisme n'est pas rendu de façon assez intense et saisissante.
Un très bon livre quand même, au-dessus de la médiocrité habituelle.
L'auteur y fait preuve d'une érudition encyclopédique étonnante. Il semble avoir tout lu sur le sujet qui l'intéresse, d'où l'abondance de titres et de dates, avec indication de la langue dans laquelle les oeuvres ont été rédigées. Il pousse sa fidélité si loin qu'il signale par des guillemets les citations et extraits de ces ouvrages, qu'il s'agisse d'un ou deux mots ou de phrases plus longues avec respect des tournures employées alors. Il en profite pour mettre à mal les clichés qui encombrent les biographies sur Spinoza, prouvant qu'ils ne reposent sur rien.
Dès lors le roman est un roman sans être un roman. Les nombreuses interventions de l'auteur dans ses pages, ses fréquentes adresses au lecteur se démarquent de la production habituelle. de même, le choix d'y inclure poèmes, chansons, pièces de théâtre, décisions judiciaires en fait un patchwork qui reflète la vie de toute une époque. Roman ambitieux donc, où figures populaires côtoient les grands noms de l'Histoire tels que Guillaume d'Orange, Louis XIV et des intellectuels tels que Descartes, Spinoza, Hobbes, Leibnitz et tant d'autres. le roman comme résurrection du passé.
Dernière originalité : l'auteur ne craint pas la difficulté et fait oeuvre de vulgarisation. Il résume en effet les différents textes qui jalonnent la vie de Spinoza et nous en donne un aperçu clair et succinct. de la sorte il met en relief tant les clivages religieux et philosophiques des Pays-Bas à leur âge d'or que l'effort de certains pour penser par eux-mêmes et se libérer du carcan des confessions religieuses (catholicisme, calvinisme, judaïsme), toutes conservatrices et répressives. C'est donc un éloge indirect de la philosophie et de la raison auquel il nous convie.
Est-ce pour autant un chef-d'oeuvre ? Non. Pour plusieurs raisons. D'abord, l'auteur a beau enseigner la philosophie, il ne maîtrise pas la langue française comme on le voudrait. Il confond ainsi refouler avec refluer, est fâché à plus d'une reprise avec l'accord du participe passé. L'unité de ton n'est pas son fort, lui qui mêle style noble et relevé avec mots crus et orduriers, ce qui a de quoi choquer esthétiquement. Enfin le drame vécu par Spinoza dans sa lutte contre l'obscurantisme n'est pas rendu de façon assez intense et saisissante.
Un très bon livre quand même, au-dessus de la médiocrité habituelle.
critiques presse (1)
Sur la vie de Spinoza, on a beaucoup écrit et spéculé — particulièrement pour expliquer son exclusion de la communauté juive. M. Rovère rouvre le dossier et en propose une version à la fois originale et romancée.
Lire la critique sur le site : LaViedesIdees
Citations et extraits (50)
Voir plus
Ajouter une citation
Admettons un moment qu'un athée nie l'existence de Dieu. La seule explication que Spinoza y voit, c'est que cette personne en connaît pas le sens technique, le sens philosophique du mot Dieu. Car en métaphysique, ce terme désigne une évidence qui sans lui n'aurait pas de nom : c'est le principe absolu de l'existence. On peut discuter des confusions entre ce qui existe ou pas, mais l'essence même de l'existence s'impose à tous ceux qui ne sont pas complètement fous. Inutile d'aller plus loin, car si on étudie bien cette chose-là, on s'aperçoit qu'elle possède toutes les propriétés nécessaires à ce qu'on appelle "Dieu" : l'Existence est absolument infinie, elle ne peut ni apparaître ni disparaître, et la chaîne infinie des causes est tout simplement inconcevable sans elle.
Ainsi, au lieu de chercher comment attribuer l'existence à un Être infini, parfait, omnipotent, etc.; Spinoza préfère montrer en quoi l'existence considérée par sa nature seule correspond à la définition de Dieu. Si l'existence est Dieu, vous conviendrez que la proposition [Dieu n'existe pas] n'a aucun sens, puisque, selon cette définition, Dieu est l'existence.
La question de savoir si dieu existe ou pas se trouve donc vidée de signification, puisqu'on ne peut pas séparer le verbe et le nom : [Dieu] et [exister] sont deux termes qui signifient la même chose, même s'ils n'ont pas la même syntaxe.
Il en est de même pour la question de savoir si l'on y croit ou pas car nul n'a jamais eu le besoin d'y croire car il suffit d'exister. Ainsi, Dieu n'est pas un objet de foi mais un concept métaphysique très simple, et ceux qui le pensent indémontrable ne savent tout simplement pas ce que c'est.
En somme, Dieu n'est ni une puissance en dehors de l'univers, ni une essence mystérieuse qui se tient en surplomb, ni un maître des signes antérieurs à nos codes, rien en un mot que l'on puisse considérer comme transcendant, c'est-à-dire comme extérieur à la nature.
Disons, pour résumer, que le mot Dieu permet de désigner l'infini désordonné de la Nature comme la puissance d'un seul et même Être. En réalité, la Nature entendue comme la somme des choses existantes n'est pas totalisable. Le concept de Dieu, essence indivisible, résout cette difficulté en désignant ce qui existe comme l'expression d'une puissance unique.
Certes, cette divine unicité que nous reconnaissons dans le chaos de l'existence n'est que le reflet de nous-mêmes; mais n'oublions pas que nous-mêmes, nous n'existons pas avant de nous y reconnaître. On ne devient soi-même qu'à mesure que s'éclaire en soi...l'idée de Dieu.
Ainsi, au lieu de chercher comment attribuer l'existence à un Être infini, parfait, omnipotent, etc.; Spinoza préfère montrer en quoi l'existence considérée par sa nature seule correspond à la définition de Dieu. Si l'existence est Dieu, vous conviendrez que la proposition [Dieu n'existe pas] n'a aucun sens, puisque, selon cette définition, Dieu est l'existence.
La question de savoir si dieu existe ou pas se trouve donc vidée de signification, puisqu'on ne peut pas séparer le verbe et le nom : [Dieu] et [exister] sont deux termes qui signifient la même chose, même s'ils n'ont pas la même syntaxe.
Il en est de même pour la question de savoir si l'on y croit ou pas car nul n'a jamais eu le besoin d'y croire car il suffit d'exister. Ainsi, Dieu n'est pas un objet de foi mais un concept métaphysique très simple, et ceux qui le pensent indémontrable ne savent tout simplement pas ce que c'est.
En somme, Dieu n'est ni une puissance en dehors de l'univers, ni une essence mystérieuse qui se tient en surplomb, ni un maître des signes antérieurs à nos codes, rien en un mot que l'on puisse considérer comme transcendant, c'est-à-dire comme extérieur à la nature.
Disons, pour résumer, que le mot Dieu permet de désigner l'infini désordonné de la Nature comme la puissance d'un seul et même Être. En réalité, la Nature entendue comme la somme des choses existantes n'est pas totalisable. Le concept de Dieu, essence indivisible, résout cette difficulté en désignant ce qui existe comme l'expression d'une puissance unique.
Certes, cette divine unicité que nous reconnaissons dans le chaos de l'existence n'est que le reflet de nous-mêmes; mais n'oublions pas que nous-mêmes, nous n'existons pas avant de nous y reconnaître. On ne devient soi-même qu'à mesure que s'éclaire en soi...l'idée de Dieu.
En mettant en oeuvre un livre de philosophie géométrique, Spinoza ne fait plus l'exposé d'une théorie déjà constituée (comme il le croyait au départ), il aménage avec ses amis un terrain d'expérimentations philosophiques.
Seules les personnes aguerries en latin, en géométrie et en métaphysique peuvent pénétrer le détail des arguments. Mais le style géométrique laisse la porte à tous ceux qui voudraient dénoncer ou interdire le libre exercice de la Raison.
Le texte réserve aux initiés ses effets les plus saisissants.
Primo, il a l'effet de table rase : le format mathématique donne à la philosophie l'aspect d'un ensemble d'abstractions parfaitement autonomes, qui ne présupposent rien. Cela convient très bien au refus des cartésiens de se référer aux traditions qui les encombrent.
Le dispositif hypothético-déductif donne l'illusion que la raison est sans passé, comme si rien dans le monde n'avait jamais été écrit. Cette fiction permet de réfléchir beaucoup plus vite.
Secundo, le fait de définir les termes qu'on emploie permet de réduire de manière drastique les ambiguïtés du langage courant : chaque définition détermine pour chaque mot un usage précis, non extensible, qui délimite une fois pour toutes es conditions de validité. Ce style instrumental, vise à limiter les imperfections du langage courant.
Tertio, l'un des enjeux de la forme démonstrative est de permettre des enchaînements d'idées rigoureux mais simples, sans s'embarrasser des subtilités de la logique.
Quatro, cette séquence de nécessité pure espère se communiquer à ses lecteurs avec une certitude absolue, que Spinoza nomme....la certitude mathématique : ainsi, au-delà de son exigence de pureté, l'ordre géométrique engage l'espoir d'un partage à l'identique d'une seule et même vérité, qui ne devrait théoriquement laisser place ni aux erreurs, ni aux interprétations.
Quinto et ultimo, ce n'est pas parce que cette philosophie se conçoit comme un triangle qu'elle ne contient point de pointes. Au contraire; loin d'avoir renoncé aux provocations qui l'ont rendu célèbre, Spinoza a trouvé dans cette forme d'écriture le moyen de jeter des phrases à la tête des lecteurs sans les avoir préparés.
Seules les personnes aguerries en latin, en géométrie et en métaphysique peuvent pénétrer le détail des arguments. Mais le style géométrique laisse la porte à tous ceux qui voudraient dénoncer ou interdire le libre exercice de la Raison.
Le texte réserve aux initiés ses effets les plus saisissants.
Primo, il a l'effet de table rase : le format mathématique donne à la philosophie l'aspect d'un ensemble d'abstractions parfaitement autonomes, qui ne présupposent rien. Cela convient très bien au refus des cartésiens de se référer aux traditions qui les encombrent.
Le dispositif hypothético-déductif donne l'illusion que la raison est sans passé, comme si rien dans le monde n'avait jamais été écrit. Cette fiction permet de réfléchir beaucoup plus vite.
Secundo, le fait de définir les termes qu'on emploie permet de réduire de manière drastique les ambiguïtés du langage courant : chaque définition détermine pour chaque mot un usage précis, non extensible, qui délimite une fois pour toutes es conditions de validité. Ce style instrumental, vise à limiter les imperfections du langage courant.
Tertio, l'un des enjeux de la forme démonstrative est de permettre des enchaînements d'idées rigoureux mais simples, sans s'embarrasser des subtilités de la logique.
Quatro, cette séquence de nécessité pure espère se communiquer à ses lecteurs avec une certitude absolue, que Spinoza nomme....la certitude mathématique : ainsi, au-delà de son exigence de pureté, l'ordre géométrique engage l'espoir d'un partage à l'identique d'une seule et même vérité, qui ne devrait théoriquement laisser place ni aux erreurs, ni aux interprétations.
Quinto et ultimo, ce n'est pas parce que cette philosophie se conçoit comme un triangle qu'elle ne contient point de pointes. Au contraire; loin d'avoir renoncé aux provocations qui l'ont rendu célèbre, Spinoza a trouvé dans cette forme d'écriture le moyen de jeter des phrases à la tête des lecteurs sans les avoir préparés.
A la question de savoir "comment pouvons-nous être entièrement responsables de nos mauvaises actions, sans que Dieu les aient se laissées se produire ?", Spinoza, comme l'avait observé Maïmonide, affirme que le Bien et le mal ne font pas partie des vérité divines, car ces notions se rapportent à des choses changeantes. En particulier, insiste Spinoza, la notion que nous avons du Mal n'est que l'ombre projetée d'un Mieux imaginaire.
Les difficultés soulevées par cette question reviennent à confondre les objets de pensée avec les choses du monde.
A rebours des théologiens et des prédicateurs, Spinoza ne se destine pas à orienter ses semblables dans la vie. Il travaille, c'est différent, à modifier les manières de penser.
L'un des principes les plus fondamentaux de la philosophie est celui de L'ABSTRACTION.
Même "pratique", la Raison ne peut pas, ne doit pas embraser les problèmes de l'existence tels qu'ils nous arrivent parce que l'inextricable épaisseur de l'expérience humaine en rend les paramètres trop, imprécis.
On peut résumer cette difficulté par ces mots : "Prétendre pouvoir tirer de l'observation de la suite des choses l'ordre des causes qu'il est nécessaire de concevoir est une entreprise désespérée"
La philosophie ne peut pas être sans cesse hantée par les soucis qui se posent dans la vie. Le témoignage de la conscience emporte avec lui trop de convictions d'origine incertaine, non dites, inexpliquées. Pour que la philosophie traverse et modifie nos conceptions, il faut accepter de rompre avec l'apparent concret du vécu, se rendre capable de penser à rebours de tout ce qu'on a jamais pensé. Penser contre sa propre expérience, contre ses propres convictions, c'est d'ailleurs l'une des choses que l'abstraction rend plus faciles. C'est en cette mise à l'épreuve que la philosophie s'articule bel et bien à la vie- mais par contradiction. Malgré ses longues années d'études, le philosophe n'est pas un savant. il ne découvre la vérité qu'à chaque fois qu'il trébuche. Ce sont les points de blocage qui font avancer la philosophie, car le propre du philosophe, n'est pas d'avoir raison; c'est qu'il guette le moment d'avoir tort.
Les difficultés soulevées par cette question reviennent à confondre les objets de pensée avec les choses du monde.
A rebours des théologiens et des prédicateurs, Spinoza ne se destine pas à orienter ses semblables dans la vie. Il travaille, c'est différent, à modifier les manières de penser.
L'un des principes les plus fondamentaux de la philosophie est celui de L'ABSTRACTION.
Même "pratique", la Raison ne peut pas, ne doit pas embraser les problèmes de l'existence tels qu'ils nous arrivent parce que l'inextricable épaisseur de l'expérience humaine en rend les paramètres trop, imprécis.
On peut résumer cette difficulté par ces mots : "Prétendre pouvoir tirer de l'observation de la suite des choses l'ordre des causes qu'il est nécessaire de concevoir est une entreprise désespérée"
La philosophie ne peut pas être sans cesse hantée par les soucis qui se posent dans la vie. Le témoignage de la conscience emporte avec lui trop de convictions d'origine incertaine, non dites, inexpliquées. Pour que la philosophie traverse et modifie nos conceptions, il faut accepter de rompre avec l'apparent concret du vécu, se rendre capable de penser à rebours de tout ce qu'on a jamais pensé. Penser contre sa propre expérience, contre ses propres convictions, c'est d'ailleurs l'une des choses que l'abstraction rend plus faciles. C'est en cette mise à l'épreuve que la philosophie s'articule bel et bien à la vie- mais par contradiction. Malgré ses longues années d'études, le philosophe n'est pas un savant. il ne découvre la vérité qu'à chaque fois qu'il trébuche. Ce sont les points de blocage qui font avancer la philosophie, car le propre du philosophe, n'est pas d'avoir raison; c'est qu'il guette le moment d'avoir tort.
Un présage, ce pourrait être une manière d'halluciner ce qui va advenir à partir des causes. On pourrait admettre une sorte de pressentiment vrai, une sorte d'indifférence réalisée par l'imagination....
Spinoza admet que l'imagination puisse être déterminée seulement par la disposition de l'âme et qu'à sa manière elle enchaîne ses images et ses mots et les rattache les uns aux autres selon un ordre, comme fait l'intellect de ses démonstrations.
La différence entre l'intellect et l'imagination cesse donc d'être une opposition entre ordre et désordre, et l'image s'affirme comme une sorte de double corporel de l'idée, si bien que nous ne pouvons à peu près rien comprendre dont l'imagination ne forme, à partir d'une trace, une certaine image.
Spinoza admet que l'imagination puisse être déterminée seulement par la disposition de l'âme et qu'à sa manière elle enchaîne ses images et ses mots et les rattache les uns aux autres selon un ordre, comme fait l'intellect de ses démonstrations.
La différence entre l'intellect et l'imagination cesse donc d'être une opposition entre ordre et désordre, et l'image s'affirme comme une sorte de double corporel de l'idée, si bien que nous ne pouvons à peu près rien comprendre dont l'imagination ne forme, à partir d'une trace, une certaine image.
Et toi, écervelé ! Qui t'as ensorcelé au point de te faire croire que tu avales, puis tu chies le Suprême Eternel ?
Cette phrase ironise violemment sur l'une des conséquences du dogme catholique ; si le corps de Jésus, homme et Dieu, est présent réellement (et non symboliquement) dans le pain et le vin de la communion, ceux qui le mangent finissent par l'avoir dans les intestins.
Le très sérieux problème de la digestion de l'hostie a conduit les théologiens catholiques à échafauder de subtiles distinctions tout au long des siècles; mais depuis la réforme, ce Dieu qui vous sort par le cul est un incontournable des fins de soirées parmi les calvinistes, les luthériens, les juifs, les libertins et les libres penseurs.
Cette phrase ironise violemment sur l'une des conséquences du dogme catholique ; si le corps de Jésus, homme et Dieu, est présent réellement (et non symboliquement) dans le pain et le vin de la communion, ceux qui le mangent finissent par l'avoir dans les intestins.
Le très sérieux problème de la digestion de l'hostie a conduit les théologiens catholiques à échafauder de subtiles distinctions tout au long des siècles; mais depuis la réforme, ce Dieu qui vous sort par le cul est un incontournable des fins de soirées parmi les calvinistes, les luthériens, les juifs, les libertins et les libres penseurs.
Videos de Maxime Rovere (26)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : roman philosophiqueVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Maxime Rovere (11)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
443 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre443 lecteurs ont répondu