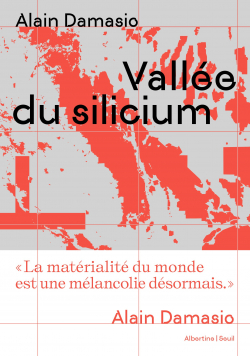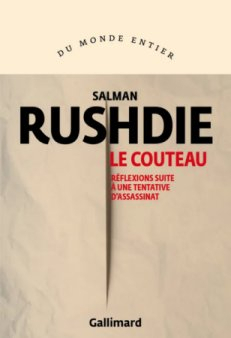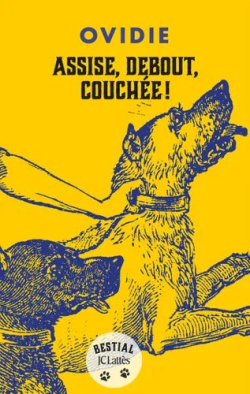Interview de Pierre Chaillot, auteur de "Covid19 ce que révèlent les chiffres officiels", Préface de Laurent Mucchielli, Directeur de recherche au CNRS
Postface de Laurent Toubiana, épidémiologiste et chercheur à l'INSERM
« On peut discuter de tout sauf des chiffres » a dit un jour l'ex-ministre de la Santé Olivier Véran.
Après trois ans passés à collecter et à analyser la quasi-totalité des chiffres qui concernent la crise du Covid 19, dans les organismes officiels français et internationaux, le statisticien Pierre Chaillot peut affirmer le contraire : on doit discuter de tout et surtout des chiffres. En particulier de ceux que les responsables politiques et médicaux ont choisis délibérément de ne pas citer car ils risquaient de provoquer l'effondrement du récit officiel.
Pierre Chaillot expose donc dans ce livre le résultat de ses analyses. Les données qu'il cite sont toutes sourcées, ses calculs sont entièrement ouverts à la consultation sur son site et ses hypothèses ont été discutées et revues par des spécialistes (statistiques, informatique, mathématique, épidémiologie). Ses conclusions sont stupéfiantes. Mortalité, hospitalisations, tests, efficacité vaccinale, effets secondaires, rien ne résiste à la confrontation ordonnée de la totalité des chiffres et, devant les yeux du lecteur effaré, la propagande s'écroule.
Pierre Chaillot est statisticien.
Il a souhaité reverser tous les droits issus de la vente de ce livre à la Fondation Où Est Mon Cycle, constituée pour venir en aide aux femmes qui ont subi de graves perturbations hormonales à la suite de la vaccination Covid.
Pierre Chaillot a créé et anime la chaine @Decoderleco

Laurent Mucchielli/5
2 notes
Résumé :
La démocratie est un être fragile et imparfait, produit d’une histoire qui n’est pas linéaire. Proclamés dans la lutte et dans le sang par les révolutions des xviiie et xixe siècles, repris par l’ONU dans une Déclaration se voulant universelle en 1948, les droits humains fondamentaux constituent depuis toujours un obstacle aux appétits insatiables de pouvoir et d’argent des puissants de ce monde.
À l’opposé des «experts» convoqués par ces puissants pour soute... >Voir plus
À l’opposé des «experts» convoqués par ces puissants pour soute... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Défendre la démocratie : une sociologie engagéeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Essai critique du sociologue autour des quelques crises vécues dernièrement en France et dans le monde avant que les spectres de la guerre (en Ukraine et en Israël/Palestine) ne chassent de notre mémoire ces évènements pourtant remarquables à bien des égards.
Les trois premières parties : Banlieues, Gilets jaunes et Covid mènent à la dernière intitulée Démocratie.
Après avoir analysé les émeutes de banlieues de 2005 en donnant, ce qui est rare, la parole aux ex-émeutiers eux-mêmes, il analyse la crise "gilets jaunes".
On ne peut bien sûr pas résumer ici la totalité des arguments développés par l'auteur mais on note une similarité dans l'opposition entre "gagnants de la mondialisation", essentiellement les cadres de grandes métropoles mondialisées exerçant des professions du secteur tertiaire et les "perdants", les ouvriers des zones périurbaines et les jeunes sans avenir des cités reléguées. Leurs problématiques, bien que différentes, aboutissent à la même quasi-impasse d'émancipation par le travail rémunérateur et d'accession à une reconnaissance sociale.
"au-delà des circonstances, ce sont des fractures sociales profondes qui s'expriment et qui, diagnostiquées de longue date, ne devraient pas surprendre."
Il passe ensuite à ce qu'un lecteur perçoit comme étant le plus personnel et ayant été vécu le plus douloureusement : le Covid.
N'étant pas directement affecté par les deux crises précédentes (il n'est pas jeune de banlieue et n'a pas été éborgné par un tir de LBD), celle du Covid l'a impacté puisqu'il s'est opposé publiquement au scénario concocté par l'exécutif de restrictions de libertés et de vaccination généralisée.
Il revient abondamment sur le déroulé des évènements, interroge notre perception de ce qui s'est passé. Revient sur des chiffres.
Le lecteur pourra s'interroger sur la distance qui semble marquer cette crise pourtant d'ampleur inédite. Cela semble si loin alors que...
On se dit que finalement, l'analyse de celle-ci, à part dans quelques ouvrages critiques comme celui-ci, a été assez peu fait.
Quid de la mortalité des moins de soixante-cinq ans?
Quid de tout ce qui a été dit de l'hydroxychloroquine comme molécule dangereuse, des études bidonnées du "Launcet" et de celles du professeur Raoult ?
Quid de la comparaison entre pays peu vaccinés et pays très vaccinés?
Etc., etc., etc...
On lit ici des choses mais on a quand même l'impression globale que c'est pour tous de l'histoire ancienne et au détour d'une conversation, on entend nos relations énoncer toujours les mêmes banalités non vérifiées (peut-on nous-même tout vérifier tout le temps ?), la même ignorance de bonne foi. La vérité ne semble pas être une priorité ni même l'objet de recherche...
Ce qui amène l'auteur à sa quatrième partie, celle de la démocratie et de son vecteur indispensable : les médias. Pas de démocratie sans informations fiables.
Là, cette analyse de la crise du Covid résonne de manière surprenante avec les crises postérieures à l'écriture de ce livre. Car ce qui a été initié avec les gilets jaunes, puis avec le Covid se répète maintenant avec une régularité de métronome : Ukraine puis Gaza en sont des exemples. Certes, la sociologie n'a peut-être pas à s'occuper de politique internationale mais ce que met en lumière ce livre est surtout la sociologie des médias.
Les chapitres intitulés : "Les mots pour disqualifier les voix critiques", "Les « bons experts » tournant en boucle dans les médias", "La chasse à l'homme : Didier Raoult", "L'intimidation et la police de la pensée", "Emphase et dramatisation versus invisibilisation et censure selon l'intérêt du moment", "Du journalisme à la communication et à la propagande durant la crise sanitaire" amènent à un dernier "Conclusion : un nouveau cartel de la censure impose une pensée unique".
Et là, il me semble que cela caractérise assez bien toutes les crises ultérieures. Presque gentiment, il écrit des journalistes français : "Loin de se positionner simplement dans un idéal d'indépendance et de recherche de la vérité, ils ont été à de nombreuses reprises des acteurs de la propagande dès lors qu'ils se sentaient investis d'une mission éducative en quelque sorte."
C'est en fin d'ouvrage que l'on comprend que ce livre est dédié aux soignants suspendus alors qu'ils faisaient avec conscience et honnêteté leur travail. Suspendus après avoir été applaudis lorsque nous avion peur. L'auteur n'est pas tendre avec le pouvoir et les médias dont il dénonce :
« Aveuglement idéologique, la corruption organisée, la quête du pouvoir, les phénomènes de cour et le conformisme ».
Intéressant retour en arrière qui éclaire le présent et notre capacité (salvatrice ?) d'oubli.
Les trois premières parties : Banlieues, Gilets jaunes et Covid mènent à la dernière intitulée Démocratie.
Après avoir analysé les émeutes de banlieues de 2005 en donnant, ce qui est rare, la parole aux ex-émeutiers eux-mêmes, il analyse la crise "gilets jaunes".
On ne peut bien sûr pas résumer ici la totalité des arguments développés par l'auteur mais on note une similarité dans l'opposition entre "gagnants de la mondialisation", essentiellement les cadres de grandes métropoles mondialisées exerçant des professions du secteur tertiaire et les "perdants", les ouvriers des zones périurbaines et les jeunes sans avenir des cités reléguées. Leurs problématiques, bien que différentes, aboutissent à la même quasi-impasse d'émancipation par le travail rémunérateur et d'accession à une reconnaissance sociale.
"au-delà des circonstances, ce sont des fractures sociales profondes qui s'expriment et qui, diagnostiquées de longue date, ne devraient pas surprendre."
Il passe ensuite à ce qu'un lecteur perçoit comme étant le plus personnel et ayant été vécu le plus douloureusement : le Covid.
N'étant pas directement affecté par les deux crises précédentes (il n'est pas jeune de banlieue et n'a pas été éborgné par un tir de LBD), celle du Covid l'a impacté puisqu'il s'est opposé publiquement au scénario concocté par l'exécutif de restrictions de libertés et de vaccination généralisée.
Il revient abondamment sur le déroulé des évènements, interroge notre perception de ce qui s'est passé. Revient sur des chiffres.
Le lecteur pourra s'interroger sur la distance qui semble marquer cette crise pourtant d'ampleur inédite. Cela semble si loin alors que...
On se dit que finalement, l'analyse de celle-ci, à part dans quelques ouvrages critiques comme celui-ci, a été assez peu fait.
Quid de la mortalité des moins de soixante-cinq ans?
Quid de tout ce qui a été dit de l'hydroxychloroquine comme molécule dangereuse, des études bidonnées du "Launcet" et de celles du professeur Raoult ?
Quid de la comparaison entre pays peu vaccinés et pays très vaccinés?
Etc., etc., etc...
On lit ici des choses mais on a quand même l'impression globale que c'est pour tous de l'histoire ancienne et au détour d'une conversation, on entend nos relations énoncer toujours les mêmes banalités non vérifiées (peut-on nous-même tout vérifier tout le temps ?), la même ignorance de bonne foi. La vérité ne semble pas être une priorité ni même l'objet de recherche...
Ce qui amène l'auteur à sa quatrième partie, celle de la démocratie et de son vecteur indispensable : les médias. Pas de démocratie sans informations fiables.
Là, cette analyse de la crise du Covid résonne de manière surprenante avec les crises postérieures à l'écriture de ce livre. Car ce qui a été initié avec les gilets jaunes, puis avec le Covid se répète maintenant avec une régularité de métronome : Ukraine puis Gaza en sont des exemples. Certes, la sociologie n'a peut-être pas à s'occuper de politique internationale mais ce que met en lumière ce livre est surtout la sociologie des médias.
Les chapitres intitulés : "Les mots pour disqualifier les voix critiques", "Les « bons experts » tournant en boucle dans les médias", "La chasse à l'homme : Didier Raoult", "L'intimidation et la police de la pensée", "Emphase et dramatisation versus invisibilisation et censure selon l'intérêt du moment", "Du journalisme à la communication et à la propagande durant la crise sanitaire" amènent à un dernier "Conclusion : un nouveau cartel de la censure impose une pensée unique".
Et là, il me semble que cela caractérise assez bien toutes les crises ultérieures. Presque gentiment, il écrit des journalistes français : "Loin de se positionner simplement dans un idéal d'indépendance et de recherche de la vérité, ils ont été à de nombreuses reprises des acteurs de la propagande dès lors qu'ils se sentaient investis d'une mission éducative en quelque sorte."
C'est en fin d'ouvrage que l'on comprend que ce livre est dédié aux soignants suspendus alors qu'ils faisaient avec conscience et honnêteté leur travail. Suspendus après avoir été applaudis lorsque nous avion peur. L'auteur n'est pas tendre avec le pouvoir et les médias dont il dénonce :
« Aveuglement idéologique, la corruption organisée, la quête du pouvoir, les phénomènes de cour et le conformisme ».
Intéressant retour en arrière qui éclaire le présent et notre capacité (salvatrice ?) d'oubli.
Citations et extraits (1)
Ajouter une citation
Elles ont au contraire conforté le cœur de la rhétorique gouvernementale consistant à réduire le débat politique à un clivage libéral/populiste et, concrètement, à l’affrontement entre le macronisme et l’extrême droite. Persuadés pour beaucoup de « faire le bien » en défendant le gouvernement face à l’extrême droite, la plupart des journalistes se sont ainsi mués en « chiens de garde » de la propagande politico-industrielle du moment, et celles et ceux qui n’étaient pas d’accord n’ont manifestement pas pu ou pas voulu s’y opposer. S’écarter de la doxa a en effet un coût élevé. Au sein même des principales entreprises médiatiques, celles et ceux qui n’étaient pas d’accord avec la ligne éditoriale ont probablement subi diverses formes de pression directes et indirectes pour se taire ou se conformer, sous peine d’être ostracisés au sein même de leur profession.
Videos de Laurent Mucchielli (5)
Voir plusAjouter une vidéo
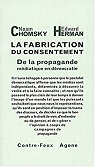
La fabrication du consentement : De la propagande médiatique en démocratie
Noam Chomsky
7
critiques
12
citations
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Laurent Mucchielli (23)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philosophes au cinéma
Ce film réalisé par Derek Jarman en 1993 retrace la vie d'un philosophe autrichien né à Vienne en 1889 et mort à Cambridge en 1951. Quel est son nom?
Ludwig Wittgenstein
Stephen Zweig
Martin Heidegger
8 questions
160 lecteurs ont répondu
Thèmes :
philosophie
, philosophes
, sociologie
, culture générale
, cinema
, adapté au cinéma
, adaptation
, littératureCréer un quiz sur ce livre160 lecteurs ont répondu