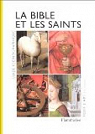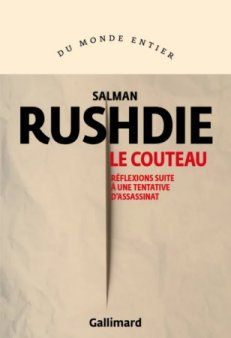Édouard Manet (1832-1883) : Nuits magnétiques par Jean Daive (1983 / France Culture). Diffusion sur France Culture le 8 juin 1983. Peinture : Édouard Manet, "Autoportrait à la palette", 1879. Par Jean Daive. Réalisation Pamela Doussaud. Avec Philippe Lacoue-Labarthe (critique, philosophe, écrivain), Dominique Fourcade (écrivain), Marcelin Pleynet (écrivain, critique d'art), Jean-Pierre Bertrand (artiste peintre), Joerg Ortner (graveur, peintre), Jean-Michel Alberola (artiste), Constantin Byzantios (peintre), Isabelle Monod-Fontaine (conservatrice au musée Georges Pompidou) et Françoise Cachin (conservatrice au musée d'Orsay). Lectures de Jean Daive. Édouard Manet, né le 23 janvier 1832 à Paris et mort le 30 avril 1883 dans la même ville, est un peintre et graveur français majeur de la fin du XIXe siècle. Précurseur de la peinture moderne qu'il affranchit de l'académisme, Édouard Manet est à tort considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme : il s'en distingue en effet par une facture soucieuse du réel qui n'utilise pas (ou peu) les nouvelles techniques de la couleur et le traitement particulier de la lumière. Il s'en rapproche cependant par certains thèmes récurrents comme les portraits, les paysages marins, la vie parisienne ou encore les natures mortes, tout en peignant de façon personnelle, dans une première période, des scènes de genre : sujets espagnols notamment d'après Vélasquez et odalisques d'après Le Titien. Il refuse de suivre des études de droit et il échoue à la carrière d'officier de marine militaire. Le jeune Manet entre en 1850 à l'atelier du peintre Thomas Couture où il effectue sa formation de peintre, le quittant en 1856. En 1860, il présente ses premières toiles, parmi lesquelles le "Portrait de M. et Mme Auguste Manet". Ses tableaux suivants, "Lola de Valence", "La Femme veuve", "Combat de taureau", "Le Déjeuner sur l'herbe" ou "Olympia", font scandale. Manet est rejeté des expositions officielles, et joue un rôle de premier plan dans la « bohème élégante ». Il y fréquente des artistes qui l'admirent comme Henri Fantin-Latour ou Edgar Degas et des hommes de lettres comme le poète Charles Baudelaire ou le romancier Émile Zola dont il peint un portrait : "Portrait d'Émile Zola". Zola a pris activement la défense du peintre au moment où la presse et les critiques s'acharnaient sur "Olympia". À cette époque, il peint "Le Joueur de fifre" (1866), le sujet historique de "L'Exécution de Maximilien" (1867) inspiré de la gravure de Francisco de Goya. Son œuvre comprend des marines comme "Clair de lune sur le port de Boulogne" (1869) ou des courses : "Les Courses à Longchamp" en 1864 qui valent au peintre un début de reconnaissance. Après la guerre franco-allemande de 1870 à laquelle il participe, Manet soutient les impressionnistes parmi lesquels il a des amis proches comme Claude Monet, Auguste Renoir ou Berthe Morisot qui devient sa belle-sœur et dont sera remarqué le célèbre portrait, parmi ceux qu'il fera d'elle, "Berthe Morisot au bouquet de violettes" (1872). À leur contact, il délaisse en partie la peinture d'atelier pour la peinture en plein air à Argenteuil et Gennevilliers, où il possède une maison. Sa palette s'éclaircit comme en témoigne "Argenteuil" de 1874. Il conserve cependant son approche personnelle faite de composition soignée et soucieuse du réel, et continue à peindre de nombreux sujets, en particulier des lieux de loisirs comme "Au Café" (1878), "La Serveuse de Bocks" (1879) et sa dernière grande toile, "Un bar aux Folies Bergère" (1881-1882), mais aussi le monde des humbles avec "Paveurs de la Rue Mosnier" ou des autoportraits ("Autoportrait à la palette", 1879).
Manet parvient à donner des lettres de noblesse aux natures mortes, genre qui occupait jusque-là dans la peinture une place décorative, secondaire. Vers la fin de sa vie (1880-1883) il s'attache à représenter fleurs, fruits et légumes en leur appliquant des accords de couleur dissonants, à l'époque où la couleur pure mourait, ce qu'André Malraux est un des premiers à souligner dans "Les Voix du silence". Le plus représentatif de cette évolution est "L'Asperge" qui témoigne de sa faculté à dépasser toutes les conventions. Manet multiplie aussi les portraits de femmes ("Nana", "La Blonde aux seins nus", "Berthe Morisot") ou d'hommes qui font partie de son entourage (Stéphane Mallarmé, Théodore Duret, Georges Clemenceau, Marcellin Desboutin, Émile Zola, Henri Rochefort).
Sources : France Culture et Wikipédia

Marcelin Pleynet/5
1 notes
Résumé :
« Ce livre est, en grande partie, constitué d’un cours que j’ai consacré à L’Enfant au toton de Chardin, dans le cadre de mon séminaire à l’école nationale des Beaux-Arts de Paris en 1993. » Marcelin Pleynet.
Une sorte d’énigme accompagne l’oeuvre de Chardin : sa réussite et son charme sont reconnus, mais le rapport avec son temps ne peut être défini. De quelle façon appartient-il au XVIIIe siècle ? Comment peut-il être à la fois du siècle de Boucher,... >Voir plus
Une sorte d’énigme accompagne l’oeuvre de Chardin : sa réussite et son charme sont reconnus, mais le rapport avec son temps ne peut être défini. De quelle façon appartient-il au XVIIIe siècle ? Comment peut-il être à la fois du siècle de Boucher,... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Chardin, le sentiment et l'esprit du tempsVoir plus
Citations et extraits (9)
Voir plus
Ajouter une citation
« L’on n’a guère vu jusques à présent un chef-d’oeuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs. »
La Bruyère
« Veramente quel uomo e stato un grande istoriatore e grande favoleggiatore. »
Bernini
Toujours l’art de Poussin surprend et intrigue, et d’abord par sa clarté. André Gide écrit en 1918 : « La très grande clarté, comme il advient souvent pour nos plus belles œuvres françaises, de Rameau, de Molière ou de Poussin, est, pour défendre une œuvre, la plus spécieuse ceinture ; on en vient à douter qu’il y ait là quelque secret ; il semble qu’on en touche le fond d’abord. Mais on y revient dix ans après et l’on entre plus avant encore1. » De son côté Philippe Sollers écrit, quelque quarante ans plus tard, en 1961 : « “Étrange”, “mystérieux”, sont des mots que Poussin provoque...2 ». Et dans un tout autre ordre d’idées, n’est-ce pas ce que met en évidence Jacques Thuillier lorsque, dans son introduction au récent catalogue consacré à Simon Vouet, il croit devoir justifier une éventuelle concurrence entre les deux artistes en déclarant curieusement : « L’antagonisme qu’ils avaient mis en scène révéla surtout les limites que le génie de Poussin s’était assignées à lui-même...3 ».
Et de fait on peut parler de la génération de Vouet, Stella, Vignon, La Tour, on ne parlera jamais de la génération de Poussin. C’est que paradoxalement la figure de Poussin, qui se confond avec celle du classicisme français, est inassimilable à la production picturale du xviie siècle ; où, pour l’y retrouver, il faut, comme le fait Jacques Thuillier, la diminuer. C’est seul et de loin que Poussin marque son siècle. La tentative, à laquelle il se prête de très mauvaise grâce, pour l’assimiler à la cour de Louis XIII et au milieu parisien, n’aboutit pas. Le plus prestigieux des peintres français aura travaillé à Paris moins de deux ans, et réalisé la grande majorité de ses chefs-d’œuvre à Rome. On sait que Poussin quitte pour la première fois Paris à l’âge de vingt-neuf ans, et n’y revient que sur l’invitation du cardinal de Richelieu en décembre 1640 (il a quarante-six ans) pour, à l’automne 1642, repartir définitivement pour Rome où il meurt en 1665.
Comme l’écrit très bien Philippe Sollers : « Poussin, c’est aussi une leçon de rhétorique sur le choix des moyens et l’ordre de leur mise en œuvre ; de rhétorique profonde, en ce qu’elle apparaît naturelle au plus haut degré4. » Et si l’art de Poussin se confond ainsi avec l’art français (Cézanne dira vouloir « faire du Poussin d’après nature ») et fonde le classicisme, c’est peut-être d’abord, en effet, parce que la distance rhétorique fut, chez lui, à ce point effective. On n’entend rien à la manière de Poussin si l’on ne retient pas que l’admirable et sévère Autoportrait qui est au Louvre est celui du « peintre des Bacchanales » (en 1635 Poussin copie Le Festin des dieux, tableau commencé par Giovanni Bellini et terminé par Titien), du peintre de L’Inspiration du poète (autour de 1630), du Paysage avec saint Mathieu et du Paysage avec saint Jean à Patmos (peints l’un et l’autre l’année de son retour à Rome).
Le choix des moyens et l’ordre de leur mise en œuvre impliquent que l’on tienne compte de l’étonnante diversité d’inspiration et d’invention que maîtrise l’art du peintre. Dans le grand ouvrage qu’il vient de publier sur Poussin, Alain Mérot déclare qu’une certaine critique a fait « la part trop belle à une érudition livresque et encyclopédique que Poussin était loin de posséder...5 ». Et l’on peut sans doute convenir que la science de Poussin fut à la fois moins encyclopédique et plus considérable que celle que lui attribue une critique dont l’expérience reste en effet livresque.
Ce n’est pas seulement, dès l’âge de vingt-six, vingt-sept ans, la décision de quitter Paris et d’aller s’installer à Rome (bien que ce voyage soit alors une aventure) qui témoigne du caractère aussi réfléchi qu’existentiel de la « science » du peintre. Tout ce que l’on sait de sa biographie, et l’on en sait beaucoup plus que les historiens et les biographes veulent bien le reconnaître, confirme le trait d’un caractère exceptionnel. La vocation du peintre est tardive et ne peut pas ne pas faire événement dans une famille paysanne qui n’est pas sans relation avec la bourgeoisie. Même si l’on s’emploie à démontrer le parcours convenu de la carrière de Poussin, comme le font certains biographes, il faut reconnaître que ce parcours est initialement moins préparé que ne le fut celui d’un certain nombre d’autres artistes de ce XVIIe siècle qui, comme par exemple Simon Vouet, sont fils de maîtres peintres.
On suppose que Poussin a étudié au collège des Jésuites de Rouen jusqu’en 1610-1611. Félibien détermine la vocation de Poussin à partir de sa rencontre avec le peintre Quentin Varin qui arrive aux Andelys entre 1611 et 1612. Encouragé par Varin, Poussin précipite les événements et moins d’un an plus tard il quitte sa famille pour se rendre à Paris. Ce premier déplacement sera accompagné de nombreux autres ; les années d’études, disons de 1612 (Poussin a dix-huit ans) à 1622, vont être ainsi ponctuées d’événements peu conventionnels. À peine deux ans après son arrivée à Paris, Poussin accompagne un jeune seigneur, Alexandre Courtois, qui a l’intention de lui faire décorer sa demeure du Poitou. Le projet se révélant irréalisable, Poussin rentrera à Paris par ses propres moyens, entreprenant « à pied un chemin aussi long, dont il finit par venir à bout non sans beaucoup d’épreuves et de fatigues6». L’une des figures les plus officielles de l’art français commence sa carrière comme un « petit peintre ambulant, mendiant ici ou là une commande pauvrement récompensée. Cette sorte de peintre sans feu ni lieu [...] n’était guère mieux traitée que les ramoneurs ou les montreurs d’ours7 ». Cette aventure sera suivie autour de 1617-1618 de la décision de se rendre à Rome. Voyage qu’il entreprend et qui se termine à Florence d’où il rentre à Paris « par la suite de quelque accident8». Les informations que rapportent les biographes du XVIIe siècle (qui sont déjà des hagiographes) laissent supposer que Poussin se rendit ensuite à Lyon, où il vécut quelque temps, et que de nouveau s’éveilla pour lui « l’envie aiguë de voir Rome […] encore qu’il ne se trouvât pas fort pourvu d’argent, ayant imprudemment dépensé tout ce qu’il avait avec des amis ; mais il espérait s’en procurer en peignant en chemin9 ». « À ce propos Nicolas contait que, ne lui étant resté qu’un écu de tout son avoir, se moquant de la Fortune [...] le soir même il le dépensait joyeusement à dîner avec ses compagnons10».
Ces anecdotes ne feraient que colorer la légende du peintre si l’occasion qui détermina finalement le séjour de Poussin à Rome ne venait en confirmer le caractère. N’est-ce pas en effet par l’intermédiaire du célèbre Giambattista Marino (le Cavalier Marin) que se réalise l’installation de Poussin à Rome ? Or le Cavalier Marin, que Poussin rencontre à Paris entre 1622 et 1623, est loin d’être un personnage conventionnel. Poète lauréat de la cour de France, le Cavalier Marin fréquente les libertins d’esprit et de mœurs (ceux qui se disent alors les « déniaisés11»), Tallemant des Réaux le présente comme participant à l’une des orgies qui occupent en ces années le libertinage parisien12. Il est un très informé lecteur de Lucrèce, et « un admirateur inconditionnel de Galilée, en qui il voyait un “inventeur” de merveilles “jamais vues”13 », et le grand poème L’Adone, qui fait de lui le plus grand écrivain italien vivant en cette première moitié du XVIIe siècle, sera condamné et mis à l’index en 1627.
Ce n’est pas le moindre des esprits de ce siècle qui protège Poussin de 1622 à 1625, qui facilite l’installation à Rome, et qui le recommande au cardinal Francesco Barberini en des termes particulièrement éclairants quant à la personnalité du peintre : « Vederete un giovane che a una furia di diavolo14. » Vous verrez un jeune homme qui a l’emportement (la fureur, l’impétuosité) d’un diable. Poussin est alors âgé de vingt-neuf ans. En ce début du XVIIe siècle, à vingt-neuf ans, l’homme est encore jeune mais déjà plus ce que nous entendons par « jeune homme ». C’est en tout cas un caractère peu convenu et attaché à un milieu et à un homme aussi peu conventionnel que possible, qui arrive à Rome en mars 1624.
Faut-il penser que la mort de son protecteur (le Cavalier Marin) en 1625, la condamnation du poème (L’Adone) pour lequel il a réalisé un certain nombre de dessins, changent de tout au tout son mode d’être, de sentir et de penser dans les années qui suivent ? À partir de 1625, la biographie de Poussin tend heureusement à se confondre avec l’histoire de son œuvre. Pourtant seize ans plus tard, Poussin a alors quarante-cinq ans, l’invitation du cardinal de Richelieu à venir travailler à Paris pour Louis XIII, et les péripéties du séjour parisien, soulignent les mêmes traits de caractère indépendant, et le même goût pour la compagnie de penseurs libertins.
C’est un peintre en pleine possession de ses moyens et au sommet de sa gloire que l’on retrouve à Paris le 5 avril 1642 dans une société que n’aurait pas reniée le Cavalier Marin. Les libertins réunis à la « petite débauche virtuosa15 » du 5 avril ne sont-ils pas aussi proches de cet autre protecteur romain de Poussin, Cassiano dal Pozzo, ami de Galilée ? On trouve là Pierre Bourdelot, que Poussin a connu à Rome, Gabriel Naudé, qui revient de Rome et lié à dal Pozzo, et « une des figures majeures du mouvement libertin », Pierre Richer, qui fait partie du cercle de Naudé, Guy Patin, également lié à Naudé, Pierre Gassendi, philosophe interprète de l’atomisme d’Épicure dont il fait un rival tout puissant d’Aristote, et Poussin. Une compagnie ne comptant que les esprits les plus brillants (Guy Patin les disait : « guéris du sot16 »), et un peintre dont tout tend à démontrer qu’il n’était pas là par hasard.
À quarante-cinq ans, Poussin n’est pas plus conventionnel qu’à vingt-neuf.
La Bruyère
« Veramente quel uomo e stato un grande istoriatore e grande favoleggiatore. »
Bernini
Toujours l’art de Poussin surprend et intrigue, et d’abord par sa clarté. André Gide écrit en 1918 : « La très grande clarté, comme il advient souvent pour nos plus belles œuvres françaises, de Rameau, de Molière ou de Poussin, est, pour défendre une œuvre, la plus spécieuse ceinture ; on en vient à douter qu’il y ait là quelque secret ; il semble qu’on en touche le fond d’abord. Mais on y revient dix ans après et l’on entre plus avant encore1. » De son côté Philippe Sollers écrit, quelque quarante ans plus tard, en 1961 : « “Étrange”, “mystérieux”, sont des mots que Poussin provoque...2 ». Et dans un tout autre ordre d’idées, n’est-ce pas ce que met en évidence Jacques Thuillier lorsque, dans son introduction au récent catalogue consacré à Simon Vouet, il croit devoir justifier une éventuelle concurrence entre les deux artistes en déclarant curieusement : « L’antagonisme qu’ils avaient mis en scène révéla surtout les limites que le génie de Poussin s’était assignées à lui-même...3 ».
Et de fait on peut parler de la génération de Vouet, Stella, Vignon, La Tour, on ne parlera jamais de la génération de Poussin. C’est que paradoxalement la figure de Poussin, qui se confond avec celle du classicisme français, est inassimilable à la production picturale du xviie siècle ; où, pour l’y retrouver, il faut, comme le fait Jacques Thuillier, la diminuer. C’est seul et de loin que Poussin marque son siècle. La tentative, à laquelle il se prête de très mauvaise grâce, pour l’assimiler à la cour de Louis XIII et au milieu parisien, n’aboutit pas. Le plus prestigieux des peintres français aura travaillé à Paris moins de deux ans, et réalisé la grande majorité de ses chefs-d’œuvre à Rome. On sait que Poussin quitte pour la première fois Paris à l’âge de vingt-neuf ans, et n’y revient que sur l’invitation du cardinal de Richelieu en décembre 1640 (il a quarante-six ans) pour, à l’automne 1642, repartir définitivement pour Rome où il meurt en 1665.
Comme l’écrit très bien Philippe Sollers : « Poussin, c’est aussi une leçon de rhétorique sur le choix des moyens et l’ordre de leur mise en œuvre ; de rhétorique profonde, en ce qu’elle apparaît naturelle au plus haut degré4. » Et si l’art de Poussin se confond ainsi avec l’art français (Cézanne dira vouloir « faire du Poussin d’après nature ») et fonde le classicisme, c’est peut-être d’abord, en effet, parce que la distance rhétorique fut, chez lui, à ce point effective. On n’entend rien à la manière de Poussin si l’on ne retient pas que l’admirable et sévère Autoportrait qui est au Louvre est celui du « peintre des Bacchanales » (en 1635 Poussin copie Le Festin des dieux, tableau commencé par Giovanni Bellini et terminé par Titien), du peintre de L’Inspiration du poète (autour de 1630), du Paysage avec saint Mathieu et du Paysage avec saint Jean à Patmos (peints l’un et l’autre l’année de son retour à Rome).
Le choix des moyens et l’ordre de leur mise en œuvre impliquent que l’on tienne compte de l’étonnante diversité d’inspiration et d’invention que maîtrise l’art du peintre. Dans le grand ouvrage qu’il vient de publier sur Poussin, Alain Mérot déclare qu’une certaine critique a fait « la part trop belle à une érudition livresque et encyclopédique que Poussin était loin de posséder...5 ». Et l’on peut sans doute convenir que la science de Poussin fut à la fois moins encyclopédique et plus considérable que celle que lui attribue une critique dont l’expérience reste en effet livresque.
Ce n’est pas seulement, dès l’âge de vingt-six, vingt-sept ans, la décision de quitter Paris et d’aller s’installer à Rome (bien que ce voyage soit alors une aventure) qui témoigne du caractère aussi réfléchi qu’existentiel de la « science » du peintre. Tout ce que l’on sait de sa biographie, et l’on en sait beaucoup plus que les historiens et les biographes veulent bien le reconnaître, confirme le trait d’un caractère exceptionnel. La vocation du peintre est tardive et ne peut pas ne pas faire événement dans une famille paysanne qui n’est pas sans relation avec la bourgeoisie. Même si l’on s’emploie à démontrer le parcours convenu de la carrière de Poussin, comme le font certains biographes, il faut reconnaître que ce parcours est initialement moins préparé que ne le fut celui d’un certain nombre d’autres artistes de ce XVIIe siècle qui, comme par exemple Simon Vouet, sont fils de maîtres peintres.
On suppose que Poussin a étudié au collège des Jésuites de Rouen jusqu’en 1610-1611. Félibien détermine la vocation de Poussin à partir de sa rencontre avec le peintre Quentin Varin qui arrive aux Andelys entre 1611 et 1612. Encouragé par Varin, Poussin précipite les événements et moins d’un an plus tard il quitte sa famille pour se rendre à Paris. Ce premier déplacement sera accompagné de nombreux autres ; les années d’études, disons de 1612 (Poussin a dix-huit ans) à 1622, vont être ainsi ponctuées d’événements peu conventionnels. À peine deux ans après son arrivée à Paris, Poussin accompagne un jeune seigneur, Alexandre Courtois, qui a l’intention de lui faire décorer sa demeure du Poitou. Le projet se révélant irréalisable, Poussin rentrera à Paris par ses propres moyens, entreprenant « à pied un chemin aussi long, dont il finit par venir à bout non sans beaucoup d’épreuves et de fatigues6». L’une des figures les plus officielles de l’art français commence sa carrière comme un « petit peintre ambulant, mendiant ici ou là une commande pauvrement récompensée. Cette sorte de peintre sans feu ni lieu [...] n’était guère mieux traitée que les ramoneurs ou les montreurs d’ours7 ». Cette aventure sera suivie autour de 1617-1618 de la décision de se rendre à Rome. Voyage qu’il entreprend et qui se termine à Florence d’où il rentre à Paris « par la suite de quelque accident8». Les informations que rapportent les biographes du XVIIe siècle (qui sont déjà des hagiographes) laissent supposer que Poussin se rendit ensuite à Lyon, où il vécut quelque temps, et que de nouveau s’éveilla pour lui « l’envie aiguë de voir Rome […] encore qu’il ne se trouvât pas fort pourvu d’argent, ayant imprudemment dépensé tout ce qu’il avait avec des amis ; mais il espérait s’en procurer en peignant en chemin9 ». « À ce propos Nicolas contait que, ne lui étant resté qu’un écu de tout son avoir, se moquant de la Fortune [...] le soir même il le dépensait joyeusement à dîner avec ses compagnons10».
Ces anecdotes ne feraient que colorer la légende du peintre si l’occasion qui détermina finalement le séjour de Poussin à Rome ne venait en confirmer le caractère. N’est-ce pas en effet par l’intermédiaire du célèbre Giambattista Marino (le Cavalier Marin) que se réalise l’installation de Poussin à Rome ? Or le Cavalier Marin, que Poussin rencontre à Paris entre 1622 et 1623, est loin d’être un personnage conventionnel. Poète lauréat de la cour de France, le Cavalier Marin fréquente les libertins d’esprit et de mœurs (ceux qui se disent alors les « déniaisés11»), Tallemant des Réaux le présente comme participant à l’une des orgies qui occupent en ces années le libertinage parisien12. Il est un très informé lecteur de Lucrèce, et « un admirateur inconditionnel de Galilée, en qui il voyait un “inventeur” de merveilles “jamais vues”13 », et le grand poème L’Adone, qui fait de lui le plus grand écrivain italien vivant en cette première moitié du XVIIe siècle, sera condamné et mis à l’index en 1627.
Ce n’est pas le moindre des esprits de ce siècle qui protège Poussin de 1622 à 1625, qui facilite l’installation à Rome, et qui le recommande au cardinal Francesco Barberini en des termes particulièrement éclairants quant à la personnalité du peintre : « Vederete un giovane che a una furia di diavolo14. » Vous verrez un jeune homme qui a l’emportement (la fureur, l’impétuosité) d’un diable. Poussin est alors âgé de vingt-neuf ans. En ce début du XVIIe siècle, à vingt-neuf ans, l’homme est encore jeune mais déjà plus ce que nous entendons par « jeune homme ». C’est en tout cas un caractère peu convenu et attaché à un milieu et à un homme aussi peu conventionnel que possible, qui arrive à Rome en mars 1624.
Faut-il penser que la mort de son protecteur (le Cavalier Marin) en 1625, la condamnation du poème (L’Adone) pour lequel il a réalisé un certain nombre de dessins, changent de tout au tout son mode d’être, de sentir et de penser dans les années qui suivent ? À partir de 1625, la biographie de Poussin tend heureusement à se confondre avec l’histoire de son œuvre. Pourtant seize ans plus tard, Poussin a alors quarante-cinq ans, l’invitation du cardinal de Richelieu à venir travailler à Paris pour Louis XIII, et les péripéties du séjour parisien, soulignent les mêmes traits de caractère indépendant, et le même goût pour la compagnie de penseurs libertins.
C’est un peintre en pleine possession de ses moyens et au sommet de sa gloire que l’on retrouve à Paris le 5 avril 1642 dans une société que n’aurait pas reniée le Cavalier Marin. Les libertins réunis à la « petite débauche virtuosa15 » du 5 avril ne sont-ils pas aussi proches de cet autre protecteur romain de Poussin, Cassiano dal Pozzo, ami de Galilée ? On trouve là Pierre Bourdelot, que Poussin a connu à Rome, Gabriel Naudé, qui revient de Rome et lié à dal Pozzo, et « une des figures majeures du mouvement libertin », Pierre Richer, qui fait partie du cercle de Naudé, Guy Patin, également lié à Naudé, Pierre Gassendi, philosophe interprète de l’atomisme d’Épicure dont il fait un rival tout puissant d’Aristote, et Poussin. Une compagnie ne comptant que les esprits les plus brillants (Guy Patin les disait : « guéris du sot16 »), et un peintre dont tout tend à démontrer qu’il n’était pas là par hasard.
À quarante-cinq ans, Poussin n’est pas plus conventionnel qu’à vingt-neuf.
De la nature morte de Chardin
Francis Ponge
A chaque instant
J’entends
Et, lorsque m’en est donné le loisir,
J’écoute
Le monde comme une symphonie.
Et, bien qu’en aucune façon je ne puisse croire
que j’en dirige l’exécution,
Néanmoins, il est en mon pouvoir de manier en moi certains engins ou dispositifs
Comparables aux amplificateurs, sélecteurs, écrans, diaphragmes,
Fort en usage, depuis quelque · temps, dans certaines techniques.
J’y suis, même, devenu assez expert
Pour, comme un organiste agile ou un bon chef d’orchestre,
Savoir faire sortir —
Non à proprement parler du silence —
Mais de la sourdine, de la non-remarque,
Telle ou telle voix, pour en jouir
Et faire jouir ma clientèle.
J ’éprouve vraiment une grande volupté
A jouer de cet instrument.
Lorsque,
Du regard et du bout de mon porte-plume —
Manié comme le bâton du chef d’orchestre, —
Je lance en solo La Bougie, par exemple, —
Qu’a-t-elle à dire ?
— Eh bien, je l’écoute.
Et elle s’exprime ;
Elle peut s’exprimer selon toutes les variations,
Les « Cadenze »
Qui lui plaisent.
Elle est ravie d’être ainsi autorisée.
Elle se donne, se met en valeur, peut-être un peu exagérément,
Puis rentre dans l’ombre — et je la suis du regard :
C’est alors que son murmure me touche surtout.
N’est-il pas bon,
Après une longue course l’hiver dans ]es bois, —
Que sais-je ?
Après un après-midi au cirque
Ou un voyage en avion, —
De rentrer chez soi et de regarder
Quelques pêches sur une assiette ?
Pour moi, j’aime cela.
J’allais dire que je préfère cela.
J’aime aussi beaucoup mettre les mains dans mes poches.
Peut-être est-ce un vice, mais je m’y adonne à tout bout de champ.
Par exemple, quand je suis en auto avec des amis et qu’ils s’exclament sur le paysage, je me paye le luxe, in petto, de reporter soudain mon regard sur le poignet du chauffeur ou sur le velours de son siège — et j’y prends des plaisirs inouïs.
Rien ne me paraît valoir ce spectacle.
Le paysage, j’en ai joui en un clin d’œil.
Là, il faut un petit peu d’attention, mais que des récompenses !
Je vous conseille ce petit exercice.
Il est évident que le poignet du chauffeur est alors, en quelque façon, éclairé par le paysage.
Je ne le nie pas.
-Et, si je me reporte au paysage, le voilà qui devient bien plus beau, de sortir du poignet du chauffeur.
L’autre jour, au restaurant où nous allions dîner avec des amis, H. C. me disait des choses passionnantes : tous les problèmes de l’heure étaient en question.
Tout en parlant, nous descendîmes au lavabo.
Eh bien, je ne sais pourquoi, brusquement,
La façon dont mon ami rejeta la serviette éponge,
Ou plutôt la façon dont ]a serviette-éponge se réarrangea sur son support — me parut beaucoup plus intéressante que le Marché Commun.
Plus rassurante aussi (et bouleversante, d’ailleurs) me parut cette serviette-éponge. Et, pendant le dîner, je fus ainsi sollicité plusieurs fois.
Je me permets de faire remarquer, au surplus, qu’une telle faculté de brusque accommodation de l’esprit peut présenter de réels avantages, en cas de soucis graves ou de douleurs physiques par exemple.
Quand on souffre beaucoup d’une dent il est très recommandable de se féliciter dans le même temps de l’état excellent de telle autre partie de son corps.
Je jure que cela décongestionne.
Ces pêches, ces noix, cette corbeille d’osier, ces raisins, cette timbale, cette bouteille avec son bouchon de liège, cette fontaine de cuivre, ce mortier de bois, ces harengs saurs,
Il n’y a aucun honneur, aucun mérite à choisir de tels sujets.
Aucun effort, aucune invention ; aucune preuve ici de supériorité d’esprit. Plutôt une preuve de paresse, ou d’indigence.
Partant de si bas, il va falloir dès lors d’autant plus d’attention, de prudence, de talent, de génie pour les rendre intéressants.
Nous risquons à chaque instant la médiocrité, la platitude ; ou la mièvrerie, la préciosité.
Mais certes leur façon d’encombrer notre espace, de venir en avant, de se faire (ou de se rendre) plus importants que notre regard,
Le drame (la fête, aussi bien) que constitue leur rencontre,
Leur respect leur mise en place,
Voilà un des plus grands sujets qui soient.
En quoi cela est-il bourgeois ? — Ce sont les biens proches,
Ce que l’on a, qu’on tient autour de soi.
Ce pot au feu. Cette musique de chambre.
Chardin ne s’en va pas vivre dans un monde de dieux ou de héros des anciennes mythologies ou de la religion.
Quand les anciennes mythologies ne nous sont plus de rien, felix culpa !, nous commençons à ressentir religieusement la réalité quotidienne.
Je crois que de plus en plus de reconnaissance sera vouée aux artistes qui auront fait preuve, par silence, par abstention pure et simple des thèmes imposés par l’idéologie de l’époque, — d’une bonne communion avec les non-artistes de leur temps.
Parce qu’ils auront été dans le fonds réellement vivant de ce temps, dans son état d’esprit officieux, — compte non tenu de ses superstructures idéologiques.
Comme on part d’en bas, comme aucun effort n’est donné, ou perdu, à se hausser au niveau d’un propos élevé ou splendide,
Tout ce qui vient en plus, tout ce qu’ajoute le génie de l’artiste apparaît pour transfigurer la manière, change la langue, fait faire des pas à l’esprit constitue un magnifique progrès.
Ainsi, chez Rameau.
Ainsi, chez Chardin, le « sens du vide », par exemple, autour du toton ou du joueur d’osselets ; ou celui d’une « lumière de rêve », dans le singe antiquaire.
Entreprenez de traiter de la façon la plus banale le plus commun des sujets : c’est alors que paraîtra votre génie.
Dans une gavotte de Rameau, toute la France danse, de façon à la fois noble et joyeuse, aristocratique et paysanne, enthousiaste et spirituelle : grave et gracieuse à la fois .
Dans la fontaine de cuivre de Chardin, dans quelques pèches près d’une timbale d’argent, non loin d’un panier de raisins, sous l’échancrure d’un mur de cuisine par où s’aperçoit le petit coin d’un paysage romantique, il y a toutes les cuisses de nymphes, les uniformes des gardes-françaises toutes les valeurs nobles et délicates du dix-huitième siècle. Et l’enthousiasme des Vestris.
Cela est offert pour ainsi dire dans le creux de la main. Sans avoir l’air d’y toucher. Sans prononcer un mot noble. Sans théâtre, sans affublement.
Rabaissant tranquillement notre regard sur les biens proches, l’âme et l’esprit ainsi se rassérènent, provisoirement .
Mais la grandeur, le drame aussitôt s’y retrouvent (l’enthousiasme et la fête, aussi bien).
L’on retrouve le pas.
La mort n’est-elle pas présente dans la pulsation normale du coeur, dans le tempo normal de la inspiration ? — Certes, elle y est présente, mais elle y va sans précipitation.
Entre le paisible et le fatal, Chardin fient un méritoire équilibre.
Le fatal, quant à moi, m’est d’autant plus sensible qu’il va d’un pas égal, sans éclats démonstratifs, va de soi.
Voilà donc la « santé ».
Voilà notre beauté.
Quand tout se réordonne, sans endimanchement, dans un éclairage de destin.
Voilà aussi pourquoi la moindre nature morte est un paysage métaphysique [16].
Peut-être tout vient-il de ce que l’homme, comme tous les individus du règne animal, est en quelque façon en trop dans la nature : une sorte de vagabond, qui, le romps de sa vie, cherche le lieu de son repos enfin : de sa mort.
Voilà pourquoi il attache tant d’importance à l’espace, qui est le lieu de son vagabondage, de sa divagation, de son slalom.
Voilà pourquoi le moindre arrangement des choses, dans le moindre fragment d’espace, le fascine :
D’un coup d’oeil, il y juge de son slalom, de son destin.
Le moindre arrangement des choses, dis-je, dans le moindre fragment d’espace,
Et non seulement la disposition des entrailles des poulets sacrés, celle des cartes battues puis étalées sur la table, celle du marc de café, celle des dés quand ils viennent d’être jetés.
Les grands signes ne sont pas qu’aux cieux.
Et il n’y a pas d’instant fatal, ou plutôt tout instant est fatal.
Ce n’est pas seulement le dernier matin qu’un homme sensible goûte dans une juste lumière la cigarette ou le verre de rhum.
Il se réveille dans cette disposition chaque jour..
Certes le temps s’écoule, mais pourtant jamais rien n’arrive.
Tout est là.
Tout l’avenir, aussi bien, — dans le moindre fragment d’espace.
Tout y est lisible,
Pour qui veut bien, pour qui sait bien l’y voir.
Pourtant chez quelques-uns seulement parmi les plus grands artistes, un pas de plus est fait.
L’indifférence est atteinte.
Par un certain adoucissement ou gommage de la hiératisation,
Il est redit, une seconde fois, que tout est simple ;
Que si le fatal va de soi,
L’inconscience aussi du fatal est fatale ;
Que la tranquillité est de droit.
Ce n’est qu’après ceux-là qu’on peut tirer l’échelle.
Francis Ponge
A chaque instant
J’entends
Et, lorsque m’en est donné le loisir,
J’écoute
Le monde comme une symphonie.
Et, bien qu’en aucune façon je ne puisse croire
que j’en dirige l’exécution,
Néanmoins, il est en mon pouvoir de manier en moi certains engins ou dispositifs
Comparables aux amplificateurs, sélecteurs, écrans, diaphragmes,
Fort en usage, depuis quelque · temps, dans certaines techniques.
J’y suis, même, devenu assez expert
Pour, comme un organiste agile ou un bon chef d’orchestre,
Savoir faire sortir —
Non à proprement parler du silence —
Mais de la sourdine, de la non-remarque,
Telle ou telle voix, pour en jouir
Et faire jouir ma clientèle.
J ’éprouve vraiment une grande volupté
A jouer de cet instrument.
Lorsque,
Du regard et du bout de mon porte-plume —
Manié comme le bâton du chef d’orchestre, —
Je lance en solo La Bougie, par exemple, —
Qu’a-t-elle à dire ?
— Eh bien, je l’écoute.
Et elle s’exprime ;
Elle peut s’exprimer selon toutes les variations,
Les « Cadenze »
Qui lui plaisent.
Elle est ravie d’être ainsi autorisée.
Elle se donne, se met en valeur, peut-être un peu exagérément,
Puis rentre dans l’ombre — et je la suis du regard :
C’est alors que son murmure me touche surtout.
N’est-il pas bon,
Après une longue course l’hiver dans ]es bois, —
Que sais-je ?
Après un après-midi au cirque
Ou un voyage en avion, —
De rentrer chez soi et de regarder
Quelques pêches sur une assiette ?
Pour moi, j’aime cela.
J’allais dire que je préfère cela.
J’aime aussi beaucoup mettre les mains dans mes poches.
Peut-être est-ce un vice, mais je m’y adonne à tout bout de champ.
Par exemple, quand je suis en auto avec des amis et qu’ils s’exclament sur le paysage, je me paye le luxe, in petto, de reporter soudain mon regard sur le poignet du chauffeur ou sur le velours de son siège — et j’y prends des plaisirs inouïs.
Rien ne me paraît valoir ce spectacle.
Le paysage, j’en ai joui en un clin d’œil.
Là, il faut un petit peu d’attention, mais que des récompenses !
Je vous conseille ce petit exercice.
Il est évident que le poignet du chauffeur est alors, en quelque façon, éclairé par le paysage.
Je ne le nie pas.
-Et, si je me reporte au paysage, le voilà qui devient bien plus beau, de sortir du poignet du chauffeur.
L’autre jour, au restaurant où nous allions dîner avec des amis, H. C. me disait des choses passionnantes : tous les problèmes de l’heure étaient en question.
Tout en parlant, nous descendîmes au lavabo.
Eh bien, je ne sais pourquoi, brusquement,
La façon dont mon ami rejeta la serviette éponge,
Ou plutôt la façon dont ]a serviette-éponge se réarrangea sur son support — me parut beaucoup plus intéressante que le Marché Commun.
Plus rassurante aussi (et bouleversante, d’ailleurs) me parut cette serviette-éponge. Et, pendant le dîner, je fus ainsi sollicité plusieurs fois.
Je me permets de faire remarquer, au surplus, qu’une telle faculté de brusque accommodation de l’esprit peut présenter de réels avantages, en cas de soucis graves ou de douleurs physiques par exemple.
Quand on souffre beaucoup d’une dent il est très recommandable de se féliciter dans le même temps de l’état excellent de telle autre partie de son corps.
Je jure que cela décongestionne.
Ces pêches, ces noix, cette corbeille d’osier, ces raisins, cette timbale, cette bouteille avec son bouchon de liège, cette fontaine de cuivre, ce mortier de bois, ces harengs saurs,
Il n’y a aucun honneur, aucun mérite à choisir de tels sujets.
Aucun effort, aucune invention ; aucune preuve ici de supériorité d’esprit. Plutôt une preuve de paresse, ou d’indigence.
Partant de si bas, il va falloir dès lors d’autant plus d’attention, de prudence, de talent, de génie pour les rendre intéressants.
Nous risquons à chaque instant la médiocrité, la platitude ; ou la mièvrerie, la préciosité.
Mais certes leur façon d’encombrer notre espace, de venir en avant, de se faire (ou de se rendre) plus importants que notre regard,
Le drame (la fête, aussi bien) que constitue leur rencontre,
Leur respect leur mise en place,
Voilà un des plus grands sujets qui soient.
En quoi cela est-il bourgeois ? — Ce sont les biens proches,
Ce que l’on a, qu’on tient autour de soi.
Ce pot au feu. Cette musique de chambre.
Chardin ne s’en va pas vivre dans un monde de dieux ou de héros des anciennes mythologies ou de la religion.
Quand les anciennes mythologies ne nous sont plus de rien, felix culpa !, nous commençons à ressentir religieusement la réalité quotidienne.
Je crois que de plus en plus de reconnaissance sera vouée aux artistes qui auront fait preuve, par silence, par abstention pure et simple des thèmes imposés par l’idéologie de l’époque, — d’une bonne communion avec les non-artistes de leur temps.
Parce qu’ils auront été dans le fonds réellement vivant de ce temps, dans son état d’esprit officieux, — compte non tenu de ses superstructures idéologiques.
Comme on part d’en bas, comme aucun effort n’est donné, ou perdu, à se hausser au niveau d’un propos élevé ou splendide,
Tout ce qui vient en plus, tout ce qu’ajoute le génie de l’artiste apparaît pour transfigurer la manière, change la langue, fait faire des pas à l’esprit constitue un magnifique progrès.
Ainsi, chez Rameau.
Ainsi, chez Chardin, le « sens du vide », par exemple, autour du toton ou du joueur d’osselets ; ou celui d’une « lumière de rêve », dans le singe antiquaire.
Entreprenez de traiter de la façon la plus banale le plus commun des sujets : c’est alors que paraîtra votre génie.
Dans une gavotte de Rameau, toute la France danse, de façon à la fois noble et joyeuse, aristocratique et paysanne, enthousiaste et spirituelle : grave et gracieuse à la fois .
Dans la fontaine de cuivre de Chardin, dans quelques pèches près d’une timbale d’argent, non loin d’un panier de raisins, sous l’échancrure d’un mur de cuisine par où s’aperçoit le petit coin d’un paysage romantique, il y a toutes les cuisses de nymphes, les uniformes des gardes-françaises toutes les valeurs nobles et délicates du dix-huitième siècle. Et l’enthousiasme des Vestris.
Cela est offert pour ainsi dire dans le creux de la main. Sans avoir l’air d’y toucher. Sans prononcer un mot noble. Sans théâtre, sans affublement.
Rabaissant tranquillement notre regard sur les biens proches, l’âme et l’esprit ainsi se rassérènent, provisoirement .
Mais la grandeur, le drame aussitôt s’y retrouvent (l’enthousiasme et la fête, aussi bien).
L’on retrouve le pas.
La mort n’est-elle pas présente dans la pulsation normale du coeur, dans le tempo normal de la inspiration ? — Certes, elle y est présente, mais elle y va sans précipitation.
Entre le paisible et le fatal, Chardin fient un méritoire équilibre.
Le fatal, quant à moi, m’est d’autant plus sensible qu’il va d’un pas égal, sans éclats démonstratifs, va de soi.
Voilà donc la « santé ».
Voilà notre beauté.
Quand tout se réordonne, sans endimanchement, dans un éclairage de destin.
Voilà aussi pourquoi la moindre nature morte est un paysage métaphysique [16].
Peut-être tout vient-il de ce que l’homme, comme tous les individus du règne animal, est en quelque façon en trop dans la nature : une sorte de vagabond, qui, le romps de sa vie, cherche le lieu de son repos enfin : de sa mort.
Voilà pourquoi il attache tant d’importance à l’espace, qui est le lieu de son vagabondage, de sa divagation, de son slalom.
Voilà pourquoi le moindre arrangement des choses, dans le moindre fragment d’espace, le fascine :
D’un coup d’oeil, il y juge de son slalom, de son destin.
Le moindre arrangement des choses, dis-je, dans le moindre fragment d’espace,
Et non seulement la disposition des entrailles des poulets sacrés, celle des cartes battues puis étalées sur la table, celle du marc de café, celle des dés quand ils viennent d’être jetés.
Les grands signes ne sont pas qu’aux cieux.
Et il n’y a pas d’instant fatal, ou plutôt tout instant est fatal.
Ce n’est pas seulement le dernier matin qu’un homme sensible goûte dans une juste lumière la cigarette ou le verre de rhum.
Il se réveille dans cette disposition chaque jour..
Certes le temps s’écoule, mais pourtant jamais rien n’arrive.
Tout est là.
Tout l’avenir, aussi bien, — dans le moindre fragment d’espace.
Tout y est lisible,
Pour qui veut bien, pour qui sait bien l’y voir.
Pourtant chez quelques-uns seulement parmi les plus grands artistes, un pas de plus est fait.
L’indifférence est atteinte.
Par un certain adoucissement ou gommage de la hiératisation,
Il est redit, une seconde fois, que tout est simple ;
Que si le fatal va de soi,
L’inconscience aussi du fatal est fatale ;
Que la tranquillité est de droit.
Ce n’est qu’après ceux-là qu’on peut tirer l’échelle.
Si l’on veut plus précisément savoir ce qu’il en est du temps dans l’œuvre de Chardin, c’est Chardin lui-même, j’entends ses tableaux qu’il faut consulter. Nombreux sont ceux qui proposent une réponse à cette question. Pourtant, parmi tous, il en est un qui y répond aussi clairement et déclarativement que possible, une des plus incontestables chefs-d’œuvre de Chardin, L’Enfant au toton (“Le portrait du fils de M. Godefroy”, appliqué à voir tourner un toton – 1737, musée du Louvre). [...]
Chardin y présente le plus jeune fils de Charles Godefroy, debout devant une table de jeu (une table dont le plateau est en creux) sur la droite de laquelle sont posés un livre, un carnet vert, une feuille de papier blanc roulée et un encrier avec une plume. Comme très souvent chez Chardin, le tiroir est entrouvert et laisse dépasser un crayon (porte-mine) en tout point semblable à celui que le peintre présente dans Le Jeune dessinateur taillant un crayon, que l’artiste semble avoir peint la même année que notre tableau. Pour l’essentiel, la scène est centrée sur l’attention de l’enfant qui considère un “toton” qu’il a lancé et qui est peint comme s’il était en train de tourner sur la table. Le catalogue du bicentenaire de la mort du peintre indique que le “toton” est “le seul élément mobile de l’œuvre”. C’est évidemment, si je puis dire, une façon de parler. Un mouvement peint n’est pas un élément mobile (même chez les Futuristes) ; la peinture représente la mobilité en l’immobilisant. C’est ce qui se passe avec ce “toton”, non moins fixe que l’enfant qui le considère.
La notice du catalogue de 1979 signale par ailleurs que l’œuvre a été abondamment commentée ; “chef-d’œuvre de fraîcheur et d’innocence”, elle est pour bien des critiques l’image de l’enfant candide. Mais ce qui frappe avant tout dans le tableau, c’est le calme détendu, le silence réfléchi du modèle. Philip Conisbee, quant à lui, écrit : “Plus qu’un portrait, et cela est coutumier chez Chardin, cette peinture renferme un contenu moral sur le dilemme entre le jeu et le travail, et plus profondément sur la précarité de la vie humaine.”
Rien de tout cela n’est bien entendu à écarter, même si l’on peut se demander ce qu’il en est pour Chardin (qui a consacré tant de tableaux aux jeux des enfants) du choix entre “le jeu” et “le travail” ? Pourquoi vouloir trouver un pathos moral là où il est si délibérément absent ? Il est vrai qu’avec cette peinture Chardin traite de sujets plus ou moins allégoriques (le jeu et le temps) qui ne sont jamais considérés sereinement. N’est-ce pas pourtant ce qu’il fait ?
Certes l’enfant, lançant sa toupie, “toton”, a lancé un coup de dé. Mais quelle toupie ? Quel dé ? Si cette toupie est un “toton”, elle définit le jeu et la méditation réfléchie de l’enfant. Mais elle implique aussi un certain ensemble de questions sur la représentation de l’objet, c’est-à-dire sur la façon dont le peintre pense ce qu’il peint.
Le toton est le plus souvent un cube traversé d’un pivot sur lequel il tourne. Il arrive que le toton soit un cylindre, mais il se développe alors en hauteur (comme une toupie), ce qui ne correspond pas à l’objet que Chardin nous présente. Enfin, le jeu lui-même, et le nom qu’il porte, justifie les quatre côtés du cube (du dé transformé en toupie grâce au pivot qui le traverse). Toton vient du latin totum qui veut dire “tout”. Ainsi les quatre faces du dé portent-elles chacune une lettre destinée à distribuer l’enjeu. A, initiale du latin “accipe” : prend. D, initiale de “da” : donne. P, initiale de “pone” : mettez. T, initiale de “totum”, signifiant que le joueur prend tout l’enjeu (La Grande Encyclopédie). Mais, entre les livres posés sur la droite de la table et le porte-mine du dessinateur qui, à gauche, sort du tiroir, quel est ici l’enjeu et comment serait-il distribué ? Ce porte-mine n’associe-t-il pas L’Enfant au toton au Jeune dessinateur..., et par cette association ne tend-il pas à présenter L’Enfant au toton comme une allégorie de la peinture ? La peinture, qui est, comment en douter, le véritable enjeu de l’œuvre ?
Pourtant, nous ne saurons rien d’autre que ce que le tableau peut proposer à notre contemplation de la contemplation d’un enfant dans son jeu. Faut-il aller plus avant et dire que l’enjeu c’est ici essentiellement le tableau du moment indéfiniment suspendu d’un jeu auquel nous sommes pris et qui nous engage à jouer, non pour gagner quelques bénéfices d’intelligence spéculative mais pour être dans le jeu qui ne joue que pour jouer, pour le plaisir de jouer, dans l’avant et dans l’après, sans avant et sans après, et d’être jouant ? “Le temps (l’aïon grec) est un enfant qui joue”, dit Héraclite, “cet enfant est roi (basileus)”, il est dans sa royauté, comme le jeune Auguste-Gabriel Godefroy est dans son silence.
Faut-il accorder une telle importance à ce jeu ? Il est, me semble-t-il, essentiel de lui accorder l’importance que l’on accorde à cette peinture, et plus généralement à l’œuvre de Chardin. [...]
Il y a bien d’autres dimensions attachées à ce jeu que Chardin s’est chargé de peindre en vérité. Et s’il n’eut pas besoin d’en savoir quoi que ce soit, nous n’avons, nous, rien à perdre à les connaître si nous voulons nous donner une chance de partager, dans son ouverture poétique, l’expérience et le sentiment du temps qui furent ceux de Chardin.
L’histoire des jeux précise que le jeu du “toton” prit un sens mystique lorsqu’il fut utilisé par la diaspora juive lors de la fête de PouRiM (Hanouca). La fête célèbre un miracle rapporté par le Talmud, selon lequel, après la victoire de Judas Maccabée, les juifs entrant dans le Temple ne trouvèrent plus qu’une petite fiole de l’huile pure consacrée à la consommation de la “ménora”, mais qui miraculeusement brûla pendant les huit jours nécessaires à la fabrication d’une nouvelle huile. À l’occasion de cette “fête des lumières ”, les enfants jouent avec un “toton”, toupie traditionnellement cubique, dont chaque face est ornée d’une lettre, initiale pour rappeler la phrase hébreue : “Nes gold hoyo shom” : il y eu un grand miracle là-bas.
Miracle, fête des lumières qui nous manquent, le tableau de Chardin interroge lui aussi le sentiment, l’esprit et l’essence du jeu d’un enfant. En peignant, il interroge cela même qu’il peint. Et c’est cela même qui répond.
La notice du catalogue de 1979 nous dit que “Le porte-craie (celui du Jeune dessinateur) placé dans le tiroir de la chiffonnière, la plume d’oie et la feuille de papier ont été abandonnés au profit de la distraction, du jeu, ce qui a permis d’interpréter facilement le symbolisme de l’œuvre.” Mais quelle pauvre interprétation, et comme elle répond mal de la fascination qu’exerce l’œuvre ! Et même de sa simple lecture, et du “silence réfléchi du modèle”.
Que regarde-t-il, ce modèle qui a posé pour Chardin ? Un objet que Chardin n’a pu entrevoir qu’un très bref instant dans l’état où il le peint. Si, comme l’indique la notice du catalogue, le “toton” est le seul élément mobile de l’œuvre, il y a aujourd’hui très exactement deux cent-soixante et un ans que ce “toton” tourne, fixe, sans tourner. Ce qui mérite bien en effet la fascination d’un enfant. Qui plus est, comme cela est très probable, si ce toton est un cube (un dé traversé par un pivot) qui tourne, Chardin a naturellement (si je puis dire) représenté une roue mais elle est carrée. Autant d’éléments dont il faut bien reconnaître qu’ils déjouent toutes dispositions vraisemblables d’une croyance en un réalisme (naturalisme) de représentation et d’une pensée chronologique du temps. Le temps de l’œuvre, c’est le temps de ce jeu, le temps lancé avec ce jeu, le temps lancé avec le toton que l’enfant considère dans un éternel présent qu’il ne cessera jamais de considérer. Et nous sommes aujourd’hui encore librement présents à l’œuvre, comme l’enfant l’est à presque rien, un regard sur le “tout” joué, le tout du “toton”, le tout de son jeu.
Chardin y présente le plus jeune fils de Charles Godefroy, debout devant une table de jeu (une table dont le plateau est en creux) sur la droite de laquelle sont posés un livre, un carnet vert, une feuille de papier blanc roulée et un encrier avec une plume. Comme très souvent chez Chardin, le tiroir est entrouvert et laisse dépasser un crayon (porte-mine) en tout point semblable à celui que le peintre présente dans Le Jeune dessinateur taillant un crayon, que l’artiste semble avoir peint la même année que notre tableau. Pour l’essentiel, la scène est centrée sur l’attention de l’enfant qui considère un “toton” qu’il a lancé et qui est peint comme s’il était en train de tourner sur la table. Le catalogue du bicentenaire de la mort du peintre indique que le “toton” est “le seul élément mobile de l’œuvre”. C’est évidemment, si je puis dire, une façon de parler. Un mouvement peint n’est pas un élément mobile (même chez les Futuristes) ; la peinture représente la mobilité en l’immobilisant. C’est ce qui se passe avec ce “toton”, non moins fixe que l’enfant qui le considère.
La notice du catalogue de 1979 signale par ailleurs que l’œuvre a été abondamment commentée ; “chef-d’œuvre de fraîcheur et d’innocence”, elle est pour bien des critiques l’image de l’enfant candide. Mais ce qui frappe avant tout dans le tableau, c’est le calme détendu, le silence réfléchi du modèle. Philip Conisbee, quant à lui, écrit : “Plus qu’un portrait, et cela est coutumier chez Chardin, cette peinture renferme un contenu moral sur le dilemme entre le jeu et le travail, et plus profondément sur la précarité de la vie humaine.”
Rien de tout cela n’est bien entendu à écarter, même si l’on peut se demander ce qu’il en est pour Chardin (qui a consacré tant de tableaux aux jeux des enfants) du choix entre “le jeu” et “le travail” ? Pourquoi vouloir trouver un pathos moral là où il est si délibérément absent ? Il est vrai qu’avec cette peinture Chardin traite de sujets plus ou moins allégoriques (le jeu et le temps) qui ne sont jamais considérés sereinement. N’est-ce pas pourtant ce qu’il fait ?
Certes l’enfant, lançant sa toupie, “toton”, a lancé un coup de dé. Mais quelle toupie ? Quel dé ? Si cette toupie est un “toton”, elle définit le jeu et la méditation réfléchie de l’enfant. Mais elle implique aussi un certain ensemble de questions sur la représentation de l’objet, c’est-à-dire sur la façon dont le peintre pense ce qu’il peint.
Le toton est le plus souvent un cube traversé d’un pivot sur lequel il tourne. Il arrive que le toton soit un cylindre, mais il se développe alors en hauteur (comme une toupie), ce qui ne correspond pas à l’objet que Chardin nous présente. Enfin, le jeu lui-même, et le nom qu’il porte, justifie les quatre côtés du cube (du dé transformé en toupie grâce au pivot qui le traverse). Toton vient du latin totum qui veut dire “tout”. Ainsi les quatre faces du dé portent-elles chacune une lettre destinée à distribuer l’enjeu. A, initiale du latin “accipe” : prend. D, initiale de “da” : donne. P, initiale de “pone” : mettez. T, initiale de “totum”, signifiant que le joueur prend tout l’enjeu (La Grande Encyclopédie). Mais, entre les livres posés sur la droite de la table et le porte-mine du dessinateur qui, à gauche, sort du tiroir, quel est ici l’enjeu et comment serait-il distribué ? Ce porte-mine n’associe-t-il pas L’Enfant au toton au Jeune dessinateur..., et par cette association ne tend-il pas à présenter L’Enfant au toton comme une allégorie de la peinture ? La peinture, qui est, comment en douter, le véritable enjeu de l’œuvre ?
Pourtant, nous ne saurons rien d’autre que ce que le tableau peut proposer à notre contemplation de la contemplation d’un enfant dans son jeu. Faut-il aller plus avant et dire que l’enjeu c’est ici essentiellement le tableau du moment indéfiniment suspendu d’un jeu auquel nous sommes pris et qui nous engage à jouer, non pour gagner quelques bénéfices d’intelligence spéculative mais pour être dans le jeu qui ne joue que pour jouer, pour le plaisir de jouer, dans l’avant et dans l’après, sans avant et sans après, et d’être jouant ? “Le temps (l’aïon grec) est un enfant qui joue”, dit Héraclite, “cet enfant est roi (basileus)”, il est dans sa royauté, comme le jeune Auguste-Gabriel Godefroy est dans son silence.
Faut-il accorder une telle importance à ce jeu ? Il est, me semble-t-il, essentiel de lui accorder l’importance que l’on accorde à cette peinture, et plus généralement à l’œuvre de Chardin. [...]
Il y a bien d’autres dimensions attachées à ce jeu que Chardin s’est chargé de peindre en vérité. Et s’il n’eut pas besoin d’en savoir quoi que ce soit, nous n’avons, nous, rien à perdre à les connaître si nous voulons nous donner une chance de partager, dans son ouverture poétique, l’expérience et le sentiment du temps qui furent ceux de Chardin.
L’histoire des jeux précise que le jeu du “toton” prit un sens mystique lorsqu’il fut utilisé par la diaspora juive lors de la fête de PouRiM (Hanouca). La fête célèbre un miracle rapporté par le Talmud, selon lequel, après la victoire de Judas Maccabée, les juifs entrant dans le Temple ne trouvèrent plus qu’une petite fiole de l’huile pure consacrée à la consommation de la “ménora”, mais qui miraculeusement brûla pendant les huit jours nécessaires à la fabrication d’une nouvelle huile. À l’occasion de cette “fête des lumières ”, les enfants jouent avec un “toton”, toupie traditionnellement cubique, dont chaque face est ornée d’une lettre, initiale pour rappeler la phrase hébreue : “Nes gold hoyo shom” : il y eu un grand miracle là-bas.
Miracle, fête des lumières qui nous manquent, le tableau de Chardin interroge lui aussi le sentiment, l’esprit et l’essence du jeu d’un enfant. En peignant, il interroge cela même qu’il peint. Et c’est cela même qui répond.
La notice du catalogue de 1979 nous dit que “Le porte-craie (celui du Jeune dessinateur) placé dans le tiroir de la chiffonnière, la plume d’oie et la feuille de papier ont été abandonnés au profit de la distraction, du jeu, ce qui a permis d’interpréter facilement le symbolisme de l’œuvre.” Mais quelle pauvre interprétation, et comme elle répond mal de la fascination qu’exerce l’œuvre ! Et même de sa simple lecture, et du “silence réfléchi du modèle”.
Que regarde-t-il, ce modèle qui a posé pour Chardin ? Un objet que Chardin n’a pu entrevoir qu’un très bref instant dans l’état où il le peint. Si, comme l’indique la notice du catalogue, le “toton” est le seul élément mobile de l’œuvre, il y a aujourd’hui très exactement deux cent-soixante et un ans que ce “toton” tourne, fixe, sans tourner. Ce qui mérite bien en effet la fascination d’un enfant. Qui plus est, comme cela est très probable, si ce toton est un cube (un dé traversé par un pivot) qui tourne, Chardin a naturellement (si je puis dire) représenté une roue mais elle est carrée. Autant d’éléments dont il faut bien reconnaître qu’ils déjouent toutes dispositions vraisemblables d’une croyance en un réalisme (naturalisme) de représentation et d’une pensée chronologique du temps. Le temps de l’œuvre, c’est le temps de ce jeu, le temps lancé avec ce jeu, le temps lancé avec le toton que l’enfant considère dans un éternel présent qu’il ne cessera jamais de considérer. Et nous sommes aujourd’hui encore librement présents à l’œuvre, comme l’enfant l’est à presque rien, un regard sur le “tout” joué, le tout du “toton”, le tout de son jeu.
« Cet autoportrait montre l’artiste au travail, tenant son crayon de pastel. Il n’est pas daté, mais Chardin y paraît nettemant plus amaigri et vieilli que sur ceux datés de 1771 et de 1775. Cet autoportrait pourrait être l’une des "... Têtes d’étude au pastel..." exposées au Salon de 1779, quelques semaines avant la mort de l’artiste. » (Musée du Louvre). Jacques Derrida l’évoque, avec les autoportraits de 1771 et 1775, dans Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, ouvrage édité à l’occasion de l’exposition qu’il présenta au Louvre du 26 octobre 1990 au 21 janvier 1991.
« [...] Augenblick sans durée « pendant » lequel, cependant, le dessinateur feint de fixer le centre de la tache aveugle. Même si rien ne se passe, si aucun événement n’a lieu, le signataire s’aveugle au reste du monde. Mais incapable de se voir, proprement et directement, tache aveugle ou trait transcendantal, il se contemple aussi aveuglément, il attaque sa vue jusqu’à épuisement de narcissisme. La vérité de ses propres yeux de voyant, au double sens de ce terme, c’est la dernière chose qui se puisse surprendre, et nue, sans attributs, sans lunettes, sans chapeau, sans bandeau sur la tête, en un miroir. Le visage nu ne peut se regarder en face, il ne peut se regarder dans une glace.
Cette dernière locution dit quelque chose de la honte ou de la pudeur qui fait partie du tableau. Elle l’engage dans l’irrépressible mouvement d’une confession. Même s’il n’y a pas encore de crime (réalité ou phantasme), même s’il n’y a pas de Gorgone, de miroir-bouclier, de geste agressif ou apotropaïque. Honte ou pudeur, certes, à peine surmontées pour être observées, gardées et regardées, respectées et tenues en respect, à la condition d’une part d’ombre. Mais aussi la peur livrée en spectacle, le se voir-vu-sans-être-vu, histrionisme et curiosité, exhibitionnisme et voyeurisme : le sujet de l’autoportrait devient la peur, il se fait peur.
Mais comme l’autre, là-bas, reste irréductible, comme il résiste à toute intériorisation, subjectivation, idéalisation dans un travail du deuil, la ruse du narcissisme n’en finit plus. Ce qu’on ne peut voir, on peut encore tenter de se le réapproprier, en calculer l’intérêt, le bénéfice, l’usure. On peut le décrire, l’écrire, le mettre en scène.
On dessinera d’une part l’artefact : des objets techniques destinés, comme des prothèses, à suppléer la vue, et d’abord à pallier cette ruine transcendantale de l’œil qui le menace et le séduit dès l’origine, par exemple le miroir, les longues vues, les lunettes, les jumelles, le monocle. Mais comme la perte de l’intuition directe, nous l’avons vu, est la condition ou l’hypothèse même du regard, la prothèse technique a lieu, son lieu, avant toute instrumentalisation, au plus proche de l’œil, comme une lentille de substance animale. Elle se détache immédiatement du corps propre. L’œil se détache [14], on peut le désirer, désirer l’arracher, se l’arracher même. Depuis toujours : l’histoire moderne de l’optique ne fait que représenter ou remarquer, selon des modes nouveaux, une défaillance de la vue dite naturelle, à commencer par les spectacles en anglais, comme nous le notions à l’instant, les lunettes du dessinateur. D’où les autoportraits avec lunettes. De Chardin l’Autoportrait dit à l’abat-jour dit bien l’abat-jour, puisqu’il plonge ou protège les yeux du peintre dans l’ombre (comme cet autre fétiche détachable, le chapeau dont les bords cachent presque les yeux de Fantin-Latour dans un autoportrait). Mais de surcroît, tout aussi jalousement, il abrite et montre à la fois les mêmes yeux derrière des lunettes dont les montants sont visibles. Le peintre semble poser de face, il vous fait face, inactif et immobile. Dans l’Autoportrait aux bésicles (lunettes sans montants, binocle de travail peut-être), Chardin se laisse voir ou se fait observer de profil, il paraît plus actif, un instant interrompu peut-être, et détournant les yeux du tableau. Mais c’est en train de peindre ou de dessiner, la main et l’instrument visibles au bord de la toile, qu’il se représente dans un autre autoportrait. A cet égard, on peut toujours considérer cet autoportrait comme un exemple parmi d’autres dans la série des Dessinateurs de Chardin [15]. Est-il en train de s’affairer autour de l’autoportrait ou d’autre chose, d’un autre modèle ? On ne saurait en décider. Dans les trois cas, lunettes sur les yeux, bandeau sur la tête — non pas les yeux bandés mais, cette fois la tête bandée, mot qui peut toujours faire penser, entre autres choses, à une blessure : à même le visage auquel ils n’appartiennent pas, détachables du corps propre comme des fétiches, le bandeau et les bésicles restent les suppléments illustres et les mieux exhibés de ces autoportraits. Ils distraient autant qu’ils concentrent. Le visage ne s’y montre pas nu, surtout pas, ce qui, bien entendu, démasque la nudité même. C’est ce qu’on appelle se montrer nu, montrer la nudité, le nu qui n’est rien sans la pudeur, l’art du voile, de la vitre ou du vêtement.
On peut aussi, d’autre part, surprendre ce qui ne se laisse pas surprendre, on peut dessiner les yeux clos : vision extatique, prière ou sommeil, masque du mort ou de l’homme blessé (voyez les yeux de l’Autoportrait dit l’homme blessé de Courbet (1854). [...] »
Jacques Derrida
« [...] Augenblick sans durée « pendant » lequel, cependant, le dessinateur feint de fixer le centre de la tache aveugle. Même si rien ne se passe, si aucun événement n’a lieu, le signataire s’aveugle au reste du monde. Mais incapable de se voir, proprement et directement, tache aveugle ou trait transcendantal, il se contemple aussi aveuglément, il attaque sa vue jusqu’à épuisement de narcissisme. La vérité de ses propres yeux de voyant, au double sens de ce terme, c’est la dernière chose qui se puisse surprendre, et nue, sans attributs, sans lunettes, sans chapeau, sans bandeau sur la tête, en un miroir. Le visage nu ne peut se regarder en face, il ne peut se regarder dans une glace.
Cette dernière locution dit quelque chose de la honte ou de la pudeur qui fait partie du tableau. Elle l’engage dans l’irrépressible mouvement d’une confession. Même s’il n’y a pas encore de crime (réalité ou phantasme), même s’il n’y a pas de Gorgone, de miroir-bouclier, de geste agressif ou apotropaïque. Honte ou pudeur, certes, à peine surmontées pour être observées, gardées et regardées, respectées et tenues en respect, à la condition d’une part d’ombre. Mais aussi la peur livrée en spectacle, le se voir-vu-sans-être-vu, histrionisme et curiosité, exhibitionnisme et voyeurisme : le sujet de l’autoportrait devient la peur, il se fait peur.
Mais comme l’autre, là-bas, reste irréductible, comme il résiste à toute intériorisation, subjectivation, idéalisation dans un travail du deuil, la ruse du narcissisme n’en finit plus. Ce qu’on ne peut voir, on peut encore tenter de se le réapproprier, en calculer l’intérêt, le bénéfice, l’usure. On peut le décrire, l’écrire, le mettre en scène.
On dessinera d’une part l’artefact : des objets techniques destinés, comme des prothèses, à suppléer la vue, et d’abord à pallier cette ruine transcendantale de l’œil qui le menace et le séduit dès l’origine, par exemple le miroir, les longues vues, les lunettes, les jumelles, le monocle. Mais comme la perte de l’intuition directe, nous l’avons vu, est la condition ou l’hypothèse même du regard, la prothèse technique a lieu, son lieu, avant toute instrumentalisation, au plus proche de l’œil, comme une lentille de substance animale. Elle se détache immédiatement du corps propre. L’œil se détache [14], on peut le désirer, désirer l’arracher, se l’arracher même. Depuis toujours : l’histoire moderne de l’optique ne fait que représenter ou remarquer, selon des modes nouveaux, une défaillance de la vue dite naturelle, à commencer par les spectacles en anglais, comme nous le notions à l’instant, les lunettes du dessinateur. D’où les autoportraits avec lunettes. De Chardin l’Autoportrait dit à l’abat-jour dit bien l’abat-jour, puisqu’il plonge ou protège les yeux du peintre dans l’ombre (comme cet autre fétiche détachable, le chapeau dont les bords cachent presque les yeux de Fantin-Latour dans un autoportrait). Mais de surcroît, tout aussi jalousement, il abrite et montre à la fois les mêmes yeux derrière des lunettes dont les montants sont visibles. Le peintre semble poser de face, il vous fait face, inactif et immobile. Dans l’Autoportrait aux bésicles (lunettes sans montants, binocle de travail peut-être), Chardin se laisse voir ou se fait observer de profil, il paraît plus actif, un instant interrompu peut-être, et détournant les yeux du tableau. Mais c’est en train de peindre ou de dessiner, la main et l’instrument visibles au bord de la toile, qu’il se représente dans un autre autoportrait. A cet égard, on peut toujours considérer cet autoportrait comme un exemple parmi d’autres dans la série des Dessinateurs de Chardin [15]. Est-il en train de s’affairer autour de l’autoportrait ou d’autre chose, d’un autre modèle ? On ne saurait en décider. Dans les trois cas, lunettes sur les yeux, bandeau sur la tête — non pas les yeux bandés mais, cette fois la tête bandée, mot qui peut toujours faire penser, entre autres choses, à une blessure : à même le visage auquel ils n’appartiennent pas, détachables du corps propre comme des fétiches, le bandeau et les bésicles restent les suppléments illustres et les mieux exhibés de ces autoportraits. Ils distraient autant qu’ils concentrent. Le visage ne s’y montre pas nu, surtout pas, ce qui, bien entendu, démasque la nudité même. C’est ce qu’on appelle se montrer nu, montrer la nudité, le nu qui n’est rien sans la pudeur, l’art du voile, de la vitre ou du vêtement.
On peut aussi, d’autre part, surprendre ce qui ne se laisse pas surprendre, on peut dessiner les yeux clos : vision extatique, prière ou sommeil, masque du mort ou de l’homme blessé (voyez les yeux de l’Autoportrait dit l’homme blessé de Courbet (1854). [...] »
Jacques Derrida
Rappelez-vous ce que Chardin nous disait au Salon : « Messieurs, messieurs, de la douceur. Entre tous les tableaux qui sont ici, cherchez le plus mauvais ; et sachez que deux mille malheureux ont brisé entre leurs dents le pinceau, de désespoir de faire jamais aussi mal. Parrocel, que vous appelez un barbouilleur, et qui l’est en effet, si vous le comparez à Vernet ; ce Parrocel est pourtant un homme rare, relativement à la multitude de ceux qui ont abandonné la carrière dans laquelle ils sont entrés avec lui. Le Moine disait qu’il fallait trente ans de métier pour savoir conserver son esquisse ; et Le Moine n’était pas un sot. Si vous voulez m’écouter, vous apprendrez peut-être à être indulgents. »
Chardin semblait douter qu’il y eût une éducation plus longue et plus pénible que celle du peintre, sans en excepter celle du médecin, du jurisconsulte, ou du docteur de Sorbonne. « On nous met, disait-il, à l’âge de sept à huit ans, le porte-crayon à la main. Nous commençons à dessiner, d’après l’exemple, des yeux, des bouches, des nez, des oreilles ; ensuite des pieds, des mains. Nous avons eu longtemps le dos courbé sur le porte-feuille, lorsqu’on nous place devant l’Hercule ou le Torse ; et vous n’avez pas été témoins des larmes que ce Satyre, ce Gladiateur, cette Vénus de Médicis, cet Antinoüs ont fait couler. Soyez sûrs que ces chefs-d’œuvre des artistes grecs n’exciteraient plus la jalousie des maîtres, s’ils avaient été livrés au dépit des élèves. Après avoir séché des journées et passé des nuits à la lampe, devant la nature immobile et inanimée, on nous présente la nature vivante ; et tout à coup le travail de toutes les années précédentes semble se réduire à rien : on ne fut pas plus emprunté la première fois qu’on prit le crayon. Il faut apprendre à l’œil à regarder la nature ; et combien ne l’ont jamais vue et ne la verront jamais ! C’est le supplice de notre vie [9]. On nous a tenus cinq à six ans devant le modèle, lorsqu’on nous livre à notre génie, nous en avons. Le talent ne se décide pas en un moment. Ce n’est pas au premier essai qu’on a la franchise de s’avouer son incapacité. Combien de tentatives tantôt heureuses, tantôt malheureuses ! Des années précieuses se sont écoulées, avant que le jour de dégoût, de lassitude et d’ennui soit venu. L’élève est âgé de dix-neuf à vingt ans, lorsque la palette lui tombant des mains, il reste sans état, sans ressources et sans mœurs ; car d’avoir sans cesse sous les yeux la nature toute nue, être jeune et sage, cela ne se peut. Que faire, que devenir ? Il faut se jeter dans quelques-unes de ces conditions subalternes, dont la porte est ouverte à la misère, ou mourir de faim. On prend le premier parti ; et à l’exception d’une vingtaine, qui viennent ici tous les deux ans s’exposer aux bêtes, les autres, ignorés et moins malheureux peut-être, ont le plastron sur la poitrine dans une salle d’armes, et le mousquet sur l’épaule dans un régiment, ou l’habit de théâtre sur les tréteaux. Ce que je vous dis là, c’est l’histoire de Belcourt, de Lekain et de Brizard, mauvais comédiens, de désespoir d’être médiocres peintres. »
Chardin nous raconta, s’il vous en souvient, qu’un de ses confrères, dont le fils était tambour dans un régiment, répondait à ceux qui lui en demandaient des nouvelles, qu’il avait quitté la peinture pour la musique ; puis, reprenant le ton sérieux, il ajouta : « Tous les pères de ces enfants incapables et déroutés, ne prennent pas la chose aussi gaîment. Ce que vous voyez est le fruit des travaux du petit nombre de ceux qui ont lutté avec plus ou moins de succès. Celui qui n’a pas senti la difficulté de l’art ne fait rien qui vaille ; celui qui, comme mon fils, l’a sentie trop tôt, ne fait rien du tout [10]. Et croyez que la plupart des hautes conditions de la société seraient vides, si l’on n’y était admis qu’après un examen aussi sévère que celui que nous subissons. »
Mais, lui dis-je, M. Chardin, il ne faut pas s’en prendre à tous , si
Mediocribus esse poetis,
Non homines, non di, non concessere columnœ.
HORAT . De Arte poet. v. 300 [11].
Et cet homme qui irrite les dieux, les hommes et les colonnes contre les Médiocres imitateurs de la nature, n’ignorait pas la difficulté du métier.
« Eh bien ! me répondit-il, il vaut mieux croire qu’il avertit le jeune élève du péril qu’il court, que de le rendre apologiste des dieux, des hommes et des colonnes. C’est comme s’il lui disait : Mon ami, prends garde, tu ne connais pas ton juge. Il ne sait rien, et n’en est pas moins cruel. Adieu, messieurs. De la douceur, de la douceur. »
Je crains bien que l’ami Chardin n’ait demandé l’aumône à des statues. Le goût est sourd à la prière. Ce que Malherbe a dit de la mort, je le dirais presque de la critique. Tout est soumis à sa loi ;
Et la garde qui veille aux barrières du Louvre
N’en défend pas nos rois.
Diderot, Salon de 1765.
Chardin semblait douter qu’il y eût une éducation plus longue et plus pénible que celle du peintre, sans en excepter celle du médecin, du jurisconsulte, ou du docteur de Sorbonne. « On nous met, disait-il, à l’âge de sept à huit ans, le porte-crayon à la main. Nous commençons à dessiner, d’après l’exemple, des yeux, des bouches, des nez, des oreilles ; ensuite des pieds, des mains. Nous avons eu longtemps le dos courbé sur le porte-feuille, lorsqu’on nous place devant l’Hercule ou le Torse ; et vous n’avez pas été témoins des larmes que ce Satyre, ce Gladiateur, cette Vénus de Médicis, cet Antinoüs ont fait couler. Soyez sûrs que ces chefs-d’œuvre des artistes grecs n’exciteraient plus la jalousie des maîtres, s’ils avaient été livrés au dépit des élèves. Après avoir séché des journées et passé des nuits à la lampe, devant la nature immobile et inanimée, on nous présente la nature vivante ; et tout à coup le travail de toutes les années précédentes semble se réduire à rien : on ne fut pas plus emprunté la première fois qu’on prit le crayon. Il faut apprendre à l’œil à regarder la nature ; et combien ne l’ont jamais vue et ne la verront jamais ! C’est le supplice de notre vie [9]. On nous a tenus cinq à six ans devant le modèle, lorsqu’on nous livre à notre génie, nous en avons. Le talent ne se décide pas en un moment. Ce n’est pas au premier essai qu’on a la franchise de s’avouer son incapacité. Combien de tentatives tantôt heureuses, tantôt malheureuses ! Des années précieuses se sont écoulées, avant que le jour de dégoût, de lassitude et d’ennui soit venu. L’élève est âgé de dix-neuf à vingt ans, lorsque la palette lui tombant des mains, il reste sans état, sans ressources et sans mœurs ; car d’avoir sans cesse sous les yeux la nature toute nue, être jeune et sage, cela ne se peut. Que faire, que devenir ? Il faut se jeter dans quelques-unes de ces conditions subalternes, dont la porte est ouverte à la misère, ou mourir de faim. On prend le premier parti ; et à l’exception d’une vingtaine, qui viennent ici tous les deux ans s’exposer aux bêtes, les autres, ignorés et moins malheureux peut-être, ont le plastron sur la poitrine dans une salle d’armes, et le mousquet sur l’épaule dans un régiment, ou l’habit de théâtre sur les tréteaux. Ce que je vous dis là, c’est l’histoire de Belcourt, de Lekain et de Brizard, mauvais comédiens, de désespoir d’être médiocres peintres. »
Chardin nous raconta, s’il vous en souvient, qu’un de ses confrères, dont le fils était tambour dans un régiment, répondait à ceux qui lui en demandaient des nouvelles, qu’il avait quitté la peinture pour la musique ; puis, reprenant le ton sérieux, il ajouta : « Tous les pères de ces enfants incapables et déroutés, ne prennent pas la chose aussi gaîment. Ce que vous voyez est le fruit des travaux du petit nombre de ceux qui ont lutté avec plus ou moins de succès. Celui qui n’a pas senti la difficulté de l’art ne fait rien qui vaille ; celui qui, comme mon fils, l’a sentie trop tôt, ne fait rien du tout [10]. Et croyez que la plupart des hautes conditions de la société seraient vides, si l’on n’y était admis qu’après un examen aussi sévère que celui que nous subissons. »
Mais, lui dis-je, M. Chardin, il ne faut pas s’en prendre à tous , si
Mediocribus esse poetis,
Non homines, non di, non concessere columnœ.
HORAT . De Arte poet. v. 300 [11].
Et cet homme qui irrite les dieux, les hommes et les colonnes contre les Médiocres imitateurs de la nature, n’ignorait pas la difficulté du métier.
« Eh bien ! me répondit-il, il vaut mieux croire qu’il avertit le jeune élève du péril qu’il court, que de le rendre apologiste des dieux, des hommes et des colonnes. C’est comme s’il lui disait : Mon ami, prends garde, tu ne connais pas ton juge. Il ne sait rien, et n’en est pas moins cruel. Adieu, messieurs. De la douceur, de la douceur. »
Je crains bien que l’ami Chardin n’ait demandé l’aumône à des statues. Le goût est sourd à la prière. Ce que Malherbe a dit de la mort, je le dirais presque de la critique. Tout est soumis à sa loi ;
Et la garde qui veille aux barrières du Louvre
N’en défend pas nos rois.
Diderot, Salon de 1765.
Videos de Marcelin Pleynet (6)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : histoire de l'artVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Marcelin Pleynet (38)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Arts et littérature ...
Quelle romancière publie "Les Hauts de Hurle-vent" en 1847 ?
Charlotte Brontë
Anne Brontë
Emily Brontë
16 questions
1104 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, art
, musique
, peinture
, cinemaCréer un quiz sur ce livre1104 lecteurs ont répondu