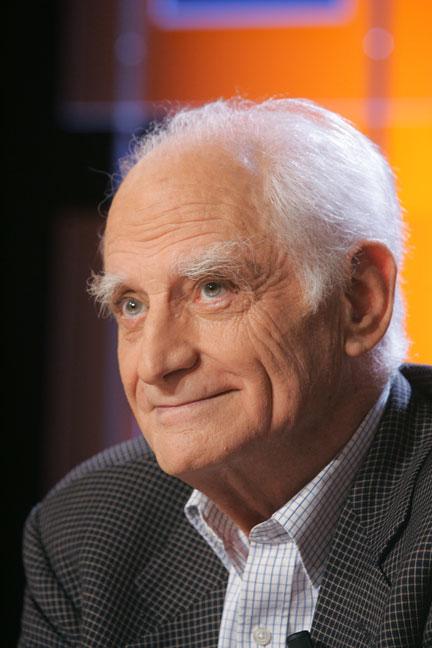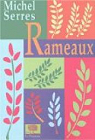Critiques de Michel Serres (277)
Un recueil d'articles consacré à plusieurs œuvres d'Hergé cherchant à dégager au fil des albums une philosophie de la communication. Très compliqué et rapidement ennuyeux.
Faire la critique d'un livre de Michel Serres est une gageure. Sa pensée est fluide et échappe sans cesse à qui veut la saisir d'un bloc et bien fou celui qui veut tenter de la résumer, de la réduire à quelques formules. Il faut plutôt s’imprégner de ce qu'il dit, sentir les résonances que son récit (oui, ce mot convient mieux qu'"essai") évoquent en soi. C'est une pensée non-déclarative et plus proche de l'algorithmique selon une comparaison qu'il établit vers la fin de l'ouvrage. Malgré tout tentons de donner un aperçu de la thématique du livre.
Le titre "Rameaux" évoque les mille ramifications du savoir. Un rameau est une bifurcation entre un tronc solide mais vieillissant et une nouvelle pousse. La ramification est nécessaire sinon c'est la sclérose. Mais pour autant c'est tout de même le vieux (le troc, la branche) qui porte et fabrique le rameau. Le livre évoque donc plusieurs type de ramifications, dans les sciences, dans l'histoire (de l'Univers, du non-vivant, du vivant, de l'homme, cet enchainement que Michel Serres appelle le Grand Récit), dans la philosophie aussi. Une partie du livre est étonnamment consacrée à Saint-Paul, héritier de 3 sagesses-tronc, le judaïsme, la philosophie grecque, l'efficacité romaine, et qui va lancer un nouveau rameau très différent de ces 3 là : le christianisme.
Pas de vérité assénée dans ce livre, aucune certitude mais des pistes pour mieux comprendre notre monde, des incitations à croiser les savoirs, à les cross-fertiliser. Pratiquement pas d'excommunication, ce n'est pas le style de Serres qui rappelle souvent la faiblesse de sa pensée comparée à l'univers, se mettant volontiers dans la descendance d'un Montaigne ou d'un Pascal. Descartes reçoit cependant quelques taloches pour son cogito qui oubliait un peu trop que l'homme était fils de la Nature et puis les créationnistes, décidément accrochés à leur arbre dont ils refusent de descendre.
Serres plaide pour une vie qui prend des risques, qui ose, qui explore mais sans orgueil, sans fanfaronnade. La vie est bien plus forte que nous, comme la mer est plus forte que le marin. On peut y habiter, tenter de gouverner (son bateau, notre société, son existence) mais en conjuguant prudence, audace et connaissance, toujours plus de connaissance !
J'en étais certain, en tentant de résumer cette pensée complexe et féconde, je l'ai hélas ramenée à quelques lieux communs. Pourtant les livres de Michel Serres sont d'une lecture passionnante et l'on aimerait en garder, après avoir fermé le livre, quelques éclats de sagesse.
Le titre "Rameaux" évoque les mille ramifications du savoir. Un rameau est une bifurcation entre un tronc solide mais vieillissant et une nouvelle pousse. La ramification est nécessaire sinon c'est la sclérose. Mais pour autant c'est tout de même le vieux (le troc, la branche) qui porte et fabrique le rameau. Le livre évoque donc plusieurs type de ramifications, dans les sciences, dans l'histoire (de l'Univers, du non-vivant, du vivant, de l'homme, cet enchainement que Michel Serres appelle le Grand Récit), dans la philosophie aussi. Une partie du livre est étonnamment consacrée à Saint-Paul, héritier de 3 sagesses-tronc, le judaïsme, la philosophie grecque, l'efficacité romaine, et qui va lancer un nouveau rameau très différent de ces 3 là : le christianisme.
Pas de vérité assénée dans ce livre, aucune certitude mais des pistes pour mieux comprendre notre monde, des incitations à croiser les savoirs, à les cross-fertiliser. Pratiquement pas d'excommunication, ce n'est pas le style de Serres qui rappelle souvent la faiblesse de sa pensée comparée à l'univers, se mettant volontiers dans la descendance d'un Montaigne ou d'un Pascal. Descartes reçoit cependant quelques taloches pour son cogito qui oubliait un peu trop que l'homme était fils de la Nature et puis les créationnistes, décidément accrochés à leur arbre dont ils refusent de descendre.
Serres plaide pour une vie qui prend des risques, qui ose, qui explore mais sans orgueil, sans fanfaronnade. La vie est bien plus forte que nous, comme la mer est plus forte que le marin. On peut y habiter, tenter de gouverner (son bateau, notre société, son existence) mais en conjuguant prudence, audace et connaissance, toujours plus de connaissance !
J'en étais certain, en tentant de résumer cette pensée complexe et féconde, je l'ai hélas ramenée à quelques lieux communs. Pourtant les livres de Michel Serres sont d'une lecture passionnante et l'on aimerait en garder, après avoir fermé le livre, quelques éclats de sagesse.
Comme d’autres je reste sur ma faim car je crois que j’attendais le traitement de l’état de conscience qui est à l’origine de la matérialisation des outils actuels plus que le constat que Michel SERRE nous présente.
« L’énergie suit la pensée » et les outils n’apparaissent que plus tard. Donc, ils sont le reflet, la matérialisation d’un état déjà dépassé et surtout, ils ne sont que des outils conçus pour libérer des pans entiers de notre activité (cérébrale, cognitive, physique …) qui peuvent ainsi être utilisés à autre chose. Pour ce faire « Poucette » doit déjà partager cet état de conscience ou au moins y être sensible car sinon elle peut devenir esclave de ces outils ; ne pas les utiliser, ou ne pas comprendre leur utilité…
Je ne m’attarderai donc pas sur ce livre et vais reprendre mes recherches. Si vous avez des pistes, n’hésitez pas à me les communiquer.
« L’énergie suit la pensée » et les outils n’apparaissent que plus tard. Donc, ils sont le reflet, la matérialisation d’un état déjà dépassé et surtout, ils ne sont que des outils conçus pour libérer des pans entiers de notre activité (cérébrale, cognitive, physique …) qui peuvent ainsi être utilisés à autre chose. Pour ce faire « Poucette » doit déjà partager cet état de conscience ou au moins y être sensible car sinon elle peut devenir esclave de ces outils ; ne pas les utiliser, ou ne pas comprendre leur utilité…
Je ne m’attarderai donc pas sur ce livre et vais reprendre mes recherches. Si vous avez des pistes, n’hésitez pas à me les communiquer.
"Pour que les pauvres, vous, moi, ayons dû courir de toute urgence au secours des riches, par l'intermédiaire de l’État, il aura fallu que les riches deviennent si colossalement riches qu'ils paraissent alors à tout le monde aussi nécessaires à notre survie que le Monde." (p. 6)
Crise, étymologiquement, s'apparente à fracture : une fracture tectonique irréversible dont n'apparaît pas encore l'ampleur de la faille.
Six événements récents, survenus depuis la Seconde guerre mondiale et en accélération depuis la décennie 1960-70, contribuent à la caractériser : 1) l'inversion de la proportion de la population s'adonnant à l'agriculture par rapport au total, entraînant l'urbanisation correspondante (sans précédent) et une modification de la perception du territoire et de la nature ; 2) la mobilité des personnes et des biens [sans parler des capitaux] ; 3) la modification des conditions sanitaires tendant à l'asymptote de l'éviction de la douleur (naguère condition habituelle et normale du corps) et à la détermination du moment de la naissance et presque de celui de la mort ; 4) la recomposition du paysage humain par la démographie ; 5) le remplacement du collectif par le connectif par les nouvelles technologies ; 6) le paradoxe de l'hyperpuissance militaire qui rend obsolète le concept de force guerrière (cf. USA vs Afghanistan).
La profondeur de ces modifications met en porte-à-faux les piliers de l'organisation socio-politique pluri-millénaire (indo-européenne) figurée par le symbole des dieux Jupiter (pouvoir des prêtres), Mars (pouvoir des guerriers), Quirinus (pouvoir des ploutocrates). D'un point de vue philosophique, par l'introduction de la finitude du Monde face à "l'hominescent infini", la crise périme la vision cartésienne de la nature au service de l'Homme, voire même la distinction plus ancienne entre sujet et objet, en instituant la Biogée, sur-ensemble où vivent en symbiose les humains et le Monde, capable à leur instar d'émettre, recevoir, stocker et traiter de l'information, comme sujet d'un "jeu à trois", et comme titulaire de droits.
Dès lors, les suggestions de l'auteur pour établir un nouvel ordre, un "Contrat naturel", portent sur la prise de parole de la Biogée au sein d'une instance mondiale (pas une institution inter-nationale, donc), qu'il appelle WAFEL (eau, air, feu, terre, vivants, en anglais), sorte de "parlement de la Biogée" où s'exprimeraient des savants et non des politiques. Il se défend de vouloir ainsi instaurer une nouvelle aristocratie de la manière suivante :
"Je ne demande pas qu'ils prennent le pouvoir, hélas tombé dangereusement en une telle déshérence que n'importe qui pourrait aujourd'hui le ramasser, mais qu'ils prennent la parole au nom des choses [...]" (pp. 58-59).
Pourtant, il exige de ces savants deux serments qui dans le fond n'en font qu'un : celui du partage des connaissances sans pouvoir en tirer aucun profit, sans que leurs applications ne puissent causer la violence, la destruction, la mort, la croissance de la misère, de l'ignorance, l'asservissement ou l'inégalité ; et qu'ils soient laïques, jurant de ne servir aucun intérêt militaire ni économique.
La faiblesse, absolue et relative, de ces suggestions par rapport au diagnostic a fortement mitigé mon appréciation de l'ouvrage. J'estime personnellement qu'elle tire son origine justement d'une erreur de jugement du pouvoir.
Crise, étymologiquement, s'apparente à fracture : une fracture tectonique irréversible dont n'apparaît pas encore l'ampleur de la faille.
Six événements récents, survenus depuis la Seconde guerre mondiale et en accélération depuis la décennie 1960-70, contribuent à la caractériser : 1) l'inversion de la proportion de la population s'adonnant à l'agriculture par rapport au total, entraînant l'urbanisation correspondante (sans précédent) et une modification de la perception du territoire et de la nature ; 2) la mobilité des personnes et des biens [sans parler des capitaux] ; 3) la modification des conditions sanitaires tendant à l'asymptote de l'éviction de la douleur (naguère condition habituelle et normale du corps) et à la détermination du moment de la naissance et presque de celui de la mort ; 4) la recomposition du paysage humain par la démographie ; 5) le remplacement du collectif par le connectif par les nouvelles technologies ; 6) le paradoxe de l'hyperpuissance militaire qui rend obsolète le concept de force guerrière (cf. USA vs Afghanistan).
La profondeur de ces modifications met en porte-à-faux les piliers de l'organisation socio-politique pluri-millénaire (indo-européenne) figurée par le symbole des dieux Jupiter (pouvoir des prêtres), Mars (pouvoir des guerriers), Quirinus (pouvoir des ploutocrates). D'un point de vue philosophique, par l'introduction de la finitude du Monde face à "l'hominescent infini", la crise périme la vision cartésienne de la nature au service de l'Homme, voire même la distinction plus ancienne entre sujet et objet, en instituant la Biogée, sur-ensemble où vivent en symbiose les humains et le Monde, capable à leur instar d'émettre, recevoir, stocker et traiter de l'information, comme sujet d'un "jeu à trois", et comme titulaire de droits.
Dès lors, les suggestions de l'auteur pour établir un nouvel ordre, un "Contrat naturel", portent sur la prise de parole de la Biogée au sein d'une instance mondiale (pas une institution inter-nationale, donc), qu'il appelle WAFEL (eau, air, feu, terre, vivants, en anglais), sorte de "parlement de la Biogée" où s'exprimeraient des savants et non des politiques. Il se défend de vouloir ainsi instaurer une nouvelle aristocratie de la manière suivante :
"Je ne demande pas qu'ils prennent le pouvoir, hélas tombé dangereusement en une telle déshérence que n'importe qui pourrait aujourd'hui le ramasser, mais qu'ils prennent la parole au nom des choses [...]" (pp. 58-59).
Pourtant, il exige de ces savants deux serments qui dans le fond n'en font qu'un : celui du partage des connaissances sans pouvoir en tirer aucun profit, sans que leurs applications ne puissent causer la violence, la destruction, la mort, la croissance de la misère, de l'ignorance, l'asservissement ou l'inégalité ; et qu'ils soient laïques, jurant de ne servir aucun intérêt militaire ni économique.
La faiblesse, absolue et relative, de ces suggestions par rapport au diagnostic a fortement mitigé mon appréciation de l'ouvrage. J'estime personnellement qu'elle tire son origine justement d'une erreur de jugement du pouvoir.
Très accessible, de quoi bien réfléchir !
Michel Serres nous livre ici ses réflexions sur l'arrivée des nouvelles technologies dans nos sociétés. Avec optimisme, il nous explique ce que notre jeunesse et nos sociétés à venir vont devoir traverser comme caps pour bien vivre cette nouvelle révolution, qu'il compare à l'invention de l'écriture ou celle de l'imprimerie. Il assume très bien la thèse qu'il avance et cet essai conduit forcément à se poser des questions, beaucoup de questions !
Michel Serres nous livre ici ses réflexions sur l'arrivée des nouvelles technologies dans nos sociétés. Avec optimisme, il nous explique ce que notre jeunesse et nos sociétés à venir vont devoir traverser comme caps pour bien vivre cette nouvelle révolution, qu'il compare à l'invention de l'écriture ou celle de l'imprimerie. Il assume très bien la thèse qu'il avance et cet essai conduit forcément à se poser des questions, beaucoup de questions !
Dans ce beau livre (livre d’art, livre cadeau, où, naturellement, l’image compte autant que le texte), Michel Serres se laisse aller à toute une série de variations poético-philosophiques sur le thème de la vision.
Partant de l’expérience esthétique du regardeur regardé — par exemple devant le fascinant Autoportrait au feutre gris de Vincent Van Gogh, où le peintre-modèle scrute au fond des yeux, de manière si troublante, le spectateur qui le regarde —, l’auteur (qui, à la fois, témoigne, analyse et se raconte) remet en question le privilège exclusif du point de vue humain sur le monde. Il diversifie et relativise au contraire les points de vue : non seulement en faisant droit aux visions différentes, celles des différentes espèces animales et même vivantes, mais en étendant, plus ou moins métaphoriquement, le pouvoir des yeux aux quatre éléments, au firmament, à la matière, à la nature entière (« objets inanimés, avez-vous donc des yeux ? »). Peuplé ainsi d’yeux innombrables (des orbites et trous noirs de l’espace à l’œil des cyclones et des tourbillons aquatiques, de l’éclat des astres à celui des minerais, des pupilles et rétines des espèces de toutes sortes aux lentilles, aux miroirs et aux oculaires des lacs et des glaces, du ciel et de la nuit constellés aux feuillages et aux plumages ocellés…) le monde devient véritablement « panoptique » ; tout y est visible et voyant à la fois. Tout y devient donc « visage » (voyant/vu) et « visite » (venir voir/se faire voir). S’y dessine en effet un réseau serré et complexe de rayons, au long desquels la lumière circule en incessants allers-retours, dialectiques et réflexifs, transformant tour à tour les points qu’elle relie en émetteurs et récepteurs de lumière, en sources et cibles de vision, en sujets et objets de savoir (encore un avatar du voir alors même qu’il ne serait plus visible que pour l’œil de l’esprit ?). Bref, « des yeux par myriades », comme résume Michel Serres… Et de même que toutes les couleurs, s’additionnant, se fondent en une seule, d’un blanc pur et laiteux (l’Arlequin bariolé se métamorphosant alors en Pierrot lunaire), de même toutes ces visions de l’univers finissent par s’unifier en une seule vision, transfigurante et mystique comme une aurore boréale, dans laquelle l’auteur semble lui-même, dans le dernier chapitre et sous références chrétiennes, mystérieusement happé. Comme l’est le héros de ce conte qu’il invoque en « signature » (et probablement en ultime confidence) à la dernière double page de l’ouvrage : « happé par ce puits d’attraction »… vertigineux comme le trou noir de la mort qui, sur l’illustration placée en regard, emporte dans un tourbillon les dernières couleurs de la vie… mais vers quoi ?
Hommage à la belle et charismatique personnalité de l’auteur, l’éditeur lui a visiblement donné carte blanche. Et celui-ci, naturellement, s’est fait plaisir : naviguant allègrement entre mythes, sciences, arts, religion et philosophie, reliant ainsi d’une traite tous les continents de la culture, surfant sur les images et les idées, les mots et les émotions, roulant dans la vague des phrases ou l’ondulation des sons et des rythmes… Au risque parfois — il faut le dire — de se caricaturer lui-même : de céder, par exemple, au démon du bon mot et à la griserie rhétorique, à la fantaisie des libres associations ou aux coquetteries de l’allusion et de la connivence. Mais le lecteur — sans être nécessairement dupe — se laisse aller volontiers au charme d’un tel voyage, plein d’imprévus et en si bonne compagnie, comme il se laisse aussi bousculer par tant d’érudition, moins tapageuse finalement que portée par une longue expérience, décantée, et volontiers créditée, du coup, d’une sagesse que, subjugué et intimidé, on suppose peut-être hors encore de sa propre portée.
Partant de l’expérience esthétique du regardeur regardé — par exemple devant le fascinant Autoportrait au feutre gris de Vincent Van Gogh, où le peintre-modèle scrute au fond des yeux, de manière si troublante, le spectateur qui le regarde —, l’auteur (qui, à la fois, témoigne, analyse et se raconte) remet en question le privilège exclusif du point de vue humain sur le monde. Il diversifie et relativise au contraire les points de vue : non seulement en faisant droit aux visions différentes, celles des différentes espèces animales et même vivantes, mais en étendant, plus ou moins métaphoriquement, le pouvoir des yeux aux quatre éléments, au firmament, à la matière, à la nature entière (« objets inanimés, avez-vous donc des yeux ? »). Peuplé ainsi d’yeux innombrables (des orbites et trous noirs de l’espace à l’œil des cyclones et des tourbillons aquatiques, de l’éclat des astres à celui des minerais, des pupilles et rétines des espèces de toutes sortes aux lentilles, aux miroirs et aux oculaires des lacs et des glaces, du ciel et de la nuit constellés aux feuillages et aux plumages ocellés…) le monde devient véritablement « panoptique » ; tout y est visible et voyant à la fois. Tout y devient donc « visage » (voyant/vu) et « visite » (venir voir/se faire voir). S’y dessine en effet un réseau serré et complexe de rayons, au long desquels la lumière circule en incessants allers-retours, dialectiques et réflexifs, transformant tour à tour les points qu’elle relie en émetteurs et récepteurs de lumière, en sources et cibles de vision, en sujets et objets de savoir (encore un avatar du voir alors même qu’il ne serait plus visible que pour l’œil de l’esprit ?). Bref, « des yeux par myriades », comme résume Michel Serres… Et de même que toutes les couleurs, s’additionnant, se fondent en une seule, d’un blanc pur et laiteux (l’Arlequin bariolé se métamorphosant alors en Pierrot lunaire), de même toutes ces visions de l’univers finissent par s’unifier en une seule vision, transfigurante et mystique comme une aurore boréale, dans laquelle l’auteur semble lui-même, dans le dernier chapitre et sous références chrétiennes, mystérieusement happé. Comme l’est le héros de ce conte qu’il invoque en « signature » (et probablement en ultime confidence) à la dernière double page de l’ouvrage : « happé par ce puits d’attraction »… vertigineux comme le trou noir de la mort qui, sur l’illustration placée en regard, emporte dans un tourbillon les dernières couleurs de la vie… mais vers quoi ?
Hommage à la belle et charismatique personnalité de l’auteur, l’éditeur lui a visiblement donné carte blanche. Et celui-ci, naturellement, s’est fait plaisir : naviguant allègrement entre mythes, sciences, arts, religion et philosophie, reliant ainsi d’une traite tous les continents de la culture, surfant sur les images et les idées, les mots et les émotions, roulant dans la vague des phrases ou l’ondulation des sons et des rythmes… Au risque parfois — il faut le dire — de se caricaturer lui-même : de céder, par exemple, au démon du bon mot et à la griserie rhétorique, à la fantaisie des libres associations ou aux coquetteries de l’allusion et de la connivence. Mais le lecteur — sans être nécessairement dupe — se laisse aller volontiers au charme d’un tel voyage, plein d’imprévus et en si bonne compagnie, comme il se laisse aussi bousculer par tant d’érudition, moins tapageuse finalement que portée par une longue expérience, décantée, et volontiers créditée, du coup, d’une sagesse que, subjugué et intimidé, on suppose peut-être hors encore de sa propre portée.
Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai découvert, avec joie, l'existence. Il me faut ce livre, qui est bel est bien devenu le fleuron de ma liste "Il suffit de passer le pont"
C’est un petit livre qui part des réflexions faites par les « vieux ronchons » partisans du c’était mieux avant ,pour les démonter.
Tous les grands sujets sont abordés :de la culture en passant par la communication,la guerre les maladies …
Sur un ton ironique,l’auteur nous fait réfléchir à notre facilité à oublier les réalités du passé et notre propension à l’enjoliver en pensant à notre jeunesse.
Tous les grands sujets sont abordés :de la culture en passant par la communication,la guerre les maladies …
Sur un ton ironique,l’auteur nous fait réfléchir à notre facilité à oublier les réalités du passé et notre propension à l’enjoliver en pensant à notre jeunesse.
Un tout petit livre qu'on imaginait rapide à lire. Un fil conducteur un peu bancal entre les différentes parties. Quelques très intéressants et profonds passages. Et puis le reste, assez creux et vain. Un tout petit livre que malheureusement j'ai eu du mal à finir.
J'avais vraiment très envi de lire Michel Serres, aillant beaucoup aimé sa série de documentaire sur L Histoire des Sciences, sur un ton très philosophique...
J'ai eu un peu peur, je l'avoue de le lire quand je me suis aperçue qu'il y avait un épais chapitre sur la Guerre... Et pourtant, même si quelques détails sont exagéré, oui, Michel Serres a vraiment une vision claire de la situation... J'y reviendrai...
Son livre commence par une Préface à la Nouvelle édition... Et on a envie de dire, laquelle??? Car oui, il y a au moins 3 éditions : 1990 (l'originale sans la préface) 2018 et 2020 ? On aimerai que les préfaces qui ne figurent pas dans l'Edition originale, soit daté... Mais à part cela rien à redire... Dès le début, Michel Serres a un discours compréhensible par tous... Et la préface est vraiment utile... Elle parle de politiques qui parlent d'écologies sans interroger les Ecologues (le livre de Ferry qui ne mentionne pas les biologistes dans son livre sur les 7 écologies en est un parfait exemple, et à lire le Pr Didier Raoult, on s'aperçoit qu'on n'écoute pas plus les médecins, il n'y en a pas un seul dans la commission gérant la crise!).
C'est que la division littéraires et scientifiques est grande, les uns ne comprenant pas les autres, parce que oui, la sélection sélectionne des spécialistes après une mauvaise éducation dans l''Education Nationale, et les rares personnes multi disciplinaires de talents ne sont écouté ni par les uns ni par les autres (Philippe Charlier, Michel Serres, Hubert Reeves.... Même pas par le Pr Didier Raoult, pourtant très bon chercheur, mais qui s'enferme dans sa spécialité... même s''il a la bonne démarche pour être ouvert, il est enfermé dans le monde médical, tout cela pour dire, que nombreux sont les exemples que Michel Serres ne cite pas, mais vont dans son sens.)
Après avoir parler de la séparation Science / Littérature qui nous divisent, il parle de non dialogue, amplifié par le brouillage sonore de la télévision... Comme le brouillage pendant la Seconde Guerre mondiale des Allemands empêchaient d'écouter radio Londres... On pourrait le sentir un brin antimilitariste, mais je ne l'affirmerai pas... Parce qu''il a raison... Nous faisons la guerre à la planète... et bien avant de lire son livre, je disais, cette guerre, je ne sais pas si la planète la perdra, ce qui est sûr c'est que nous allons la perdre...
De là il explique notre indécisions à régler tous les problèmes.... A travers la guerre,; que oui nous faisons économiquement, pas seulement avec des fusils, (voir les excès de défoliants et de Napalme au Vietnam, mais dans des buts plus économiques, l'histoire du scandale du Teflon, régler qu'en partie judiciairement( voir le Film Dark Water, et comment un agriculteur a tout perdu, y compris la vie!) il y a quelques années, et le film sur les pollutions de l'Eau : Erin Brockovich seule contre tous. Les moyens de télécommunications n'ont jamais servi autant à faire la guerre, y compris économique... Nous faisons une guerre économique aux Chinois, et c'est pareil, là aussi nous perdrons, et cela Michel Serres n'en parle pas, car le Chinois sait se reposer et préparer la lutte pour agir au bon moment, alors que nous nous ne savons pas...
Après nous avoir expliquer pourquoi nous n'y voyons pas clair, Michel Serres nous propose de réfléchir, de nous poser pour y voir plus clair, et d'agir efficacement aussi bien sur le long terme que le très inefficace cours terme... de revoir des notions fondamentales, de sciences, de droit pour agir finalement en étant de temps en temps en paix avec nous même, et donc les autres et la planète... Un livre que tout bon citoyen devrait lire... Et qui met les bases de la vraie réflexion... Sortons de l'ignorance où l'on nous a formaté...
Le livre part d'un constat, même athée nous devons nous aimer globalement en tant qu'humain (et pas seulement nos voisins ce qui conduit au gangstérisme et au racisme) , mais ce n'est que la première condition, le deuxième étant que nous devons, comme un bouddhiste, ou un St François d'Assise, peut importe notre Dieu, aimer le monde...
Et un autre constat, la science est né de la création de problème humain, (sur lesquels d'ailleurs elle ne doit pas créer d'effet négatifs prédictibles, ni de disputes de paternité, d'où elle est postérieure à la loi dans ces limites) et c'est la que le droit de la Nature pèche... car on a oublier de l'incorporer dans le droit, comme question de problème de survie humaine, comme par intérêt on n'a pas tenue compte des noirs dans un texte fondateur des Etats Unis, ou que le droit des femmes à été parfois biaisé alors qu'elle fait partie de l'unité Humanité, donc de l'Homme avec un grand H.
J'ai eu un peu peur, je l'avoue de le lire quand je me suis aperçue qu'il y avait un épais chapitre sur la Guerre... Et pourtant, même si quelques détails sont exagéré, oui, Michel Serres a vraiment une vision claire de la situation... J'y reviendrai...
Son livre commence par une Préface à la Nouvelle édition... Et on a envie de dire, laquelle??? Car oui, il y a au moins 3 éditions : 1990 (l'originale sans la préface) 2018 et 2020 ? On aimerai que les préfaces qui ne figurent pas dans l'Edition originale, soit daté... Mais à part cela rien à redire... Dès le début, Michel Serres a un discours compréhensible par tous... Et la préface est vraiment utile... Elle parle de politiques qui parlent d'écologies sans interroger les Ecologues (le livre de Ferry qui ne mentionne pas les biologistes dans son livre sur les 7 écologies en est un parfait exemple, et à lire le Pr Didier Raoult, on s'aperçoit qu'on n'écoute pas plus les médecins, il n'y en a pas un seul dans la commission gérant la crise!).
C'est que la division littéraires et scientifiques est grande, les uns ne comprenant pas les autres, parce que oui, la sélection sélectionne des spécialistes après une mauvaise éducation dans l''Education Nationale, et les rares personnes multi disciplinaires de talents ne sont écouté ni par les uns ni par les autres (Philippe Charlier, Michel Serres, Hubert Reeves.... Même pas par le Pr Didier Raoult, pourtant très bon chercheur, mais qui s'enferme dans sa spécialité... même s''il a la bonne démarche pour être ouvert, il est enfermé dans le monde médical, tout cela pour dire, que nombreux sont les exemples que Michel Serres ne cite pas, mais vont dans son sens.)
Après avoir parler de la séparation Science / Littérature qui nous divisent, il parle de non dialogue, amplifié par le brouillage sonore de la télévision... Comme le brouillage pendant la Seconde Guerre mondiale des Allemands empêchaient d'écouter radio Londres... On pourrait le sentir un brin antimilitariste, mais je ne l'affirmerai pas... Parce qu''il a raison... Nous faisons la guerre à la planète... et bien avant de lire son livre, je disais, cette guerre, je ne sais pas si la planète la perdra, ce qui est sûr c'est que nous allons la perdre...
De là il explique notre indécisions à régler tous les problèmes.... A travers la guerre,; que oui nous faisons économiquement, pas seulement avec des fusils, (voir les excès de défoliants et de Napalme au Vietnam, mais dans des buts plus économiques, l'histoire du scandale du Teflon, régler qu'en partie judiciairement( voir le Film Dark Water, et comment un agriculteur a tout perdu, y compris la vie!) il y a quelques années, et le film sur les pollutions de l'Eau : Erin Brockovich seule contre tous. Les moyens de télécommunications n'ont jamais servi autant à faire la guerre, y compris économique... Nous faisons une guerre économique aux Chinois, et c'est pareil, là aussi nous perdrons, et cela Michel Serres n'en parle pas, car le Chinois sait se reposer et préparer la lutte pour agir au bon moment, alors que nous nous ne savons pas...
Après nous avoir expliquer pourquoi nous n'y voyons pas clair, Michel Serres nous propose de réfléchir, de nous poser pour y voir plus clair, et d'agir efficacement aussi bien sur le long terme que le très inefficace cours terme... de revoir des notions fondamentales, de sciences, de droit pour agir finalement en étant de temps en temps en paix avec nous même, et donc les autres et la planète... Un livre que tout bon citoyen devrait lire... Et qui met les bases de la vraie réflexion... Sortons de l'ignorance où l'on nous a formaté...
Le livre part d'un constat, même athée nous devons nous aimer globalement en tant qu'humain (et pas seulement nos voisins ce qui conduit au gangstérisme et au racisme) , mais ce n'est que la première condition, le deuxième étant que nous devons, comme un bouddhiste, ou un St François d'Assise, peut importe notre Dieu, aimer le monde...
Et un autre constat, la science est né de la création de problème humain, (sur lesquels d'ailleurs elle ne doit pas créer d'effet négatifs prédictibles, ni de disputes de paternité, d'où elle est postérieure à la loi dans ces limites) et c'est la que le droit de la Nature pèche... car on a oublier de l'incorporer dans le droit, comme question de problème de survie humaine, comme par intérêt on n'a pas tenue compte des noirs dans un texte fondateur des Etats Unis, ou que le droit des femmes à été parfois biaisé alors qu'elle fait partie de l'unité Humanité, donc de l'Homme avec un grand H.
Michel Serres a quitté ce monde en 2019. Cet universitaire touche-à-tout a beaucoup écrit. Il a aussi tenu une chronique hebdomadaire sur France-Info pendant des années. J'ai souvent écouté ses échanges avec Michel Polacco: j'ai encore en tête sa voix très agréable. Il avait un bon sens et de la finesse; ce n'était pas de la haute philosophie, mais ses considérations sonnaient juste très souvent.
Le présent volume reprend ces chroniques entre Septembre 2004 et Février 2006. En réalité, je ne me souvenais pas précisément de ces interventions, mais c'est très intéressant de les lire une quinzaine d'années plus tard. On revisite l'actualité du moment et on a le plaisir de retrouver ces analyses stimulantes.
Le présent volume reprend ces chroniques entre Septembre 2004 et Février 2006. En réalité, je ne me souvenais pas précisément de ces interventions, mais c'est très intéressant de les lire une quinzaine d'années plus tard. On revisite l'actualité du moment et on a le plaisir de retrouver ces analyses stimulantes.
Un petit livre reprenant des entretiens réalisés par Michel Serres à l'INSEP. Que la philosophie est claire et passionnante quand elle exposée ainsi, de façon si accessible, et sur un sujet qui nous concerne tous, le rapport de notre corps au monde, la façon d'être dans le monde, l'art du mouvement.
Non, la pensée et l'esprit ne sont pas les plus importants, nos gestes et notre cœur méritent d'être objets philosophiques, et d'être plus valorisés. Le chirurgien, le joueur de football, le menuisier... ont intériorisé des gestes et ils ont en font une forme d'art. Il y a d'ailleurs des réflexions intéressantes sur le sport au cœur de la société du spectacle, sur la dramaturgie d'un match digne du théâtre antique, mais aussi sur le sport comme palliatif à la guerre.
D'un point de vue plus personnel et intime, c'est l'hommage du titre et du début qui m'a incité à livre ce livre, mon grand-père, si important pour moi, était un professeur de gymnastique, contemporain de Michel Serres dont il partageait plus que le prénom, mais aussi les idées humanistes, ainsi que l'amour pour le rugby - le vrai, le rugby de village, pas le sport professionnel tel qu'il est devenu. C'est donc mon grand-père que j'incarnais dans ces "professeurs de gymnastique" du titre, lui et ses colllégues qui nous enseignent à appréhender le monde qui nous entoure sur le plan physique. C'est aussi mon grand-père qui m'a initiée à la montagne, à la randonnée et à l'alpinisme, que Michel Serres célèbre aussi - car quoi de plus émouvant qu'une cordée qui relies des alpinistes qui marchent ensemble tout en se protégeant l'un l'autre ?
Non, la pensée et l'esprit ne sont pas les plus importants, nos gestes et notre cœur méritent d'être objets philosophiques, et d'être plus valorisés. Le chirurgien, le joueur de football, le menuisier... ont intériorisé des gestes et ils ont en font une forme d'art. Il y a d'ailleurs des réflexions intéressantes sur le sport au cœur de la société du spectacle, sur la dramaturgie d'un match digne du théâtre antique, mais aussi sur le sport comme palliatif à la guerre.
D'un point de vue plus personnel et intime, c'est l'hommage du titre et du début qui m'a incité à livre ce livre, mon grand-père, si important pour moi, était un professeur de gymnastique, contemporain de Michel Serres dont il partageait plus que le prénom, mais aussi les idées humanistes, ainsi que l'amour pour le rugby - le vrai, le rugby de village, pas le sport professionnel tel qu'il est devenu. C'est donc mon grand-père que j'incarnais dans ces "professeurs de gymnastique" du titre, lui et ses colllégues qui nous enseignent à appréhender le monde qui nous entoure sur le plan physique. C'est aussi mon grand-père qui m'a initiée à la montagne, à la randonnée et à l'alpinisme, que Michel Serres célèbre aussi - car quoi de plus émouvant qu'une cordée qui relies des alpinistes qui marchent ensemble tout en se protégeant l'un l'autre ?
Un petit ouvrage qui s’apprécie surtout lorsqu’on sait que c’est le dernier livre de Michel Serres avant son décès. On retrouve sa vivacité et ces traits d’esprit qui l’on fait apprécié de tous. Même sa passion était la philosophie, il ne regardait pas les autres avant prétention et fierté. Il souriait à la vie pour transmettre sa passion et sa joie de vivre. Sa réflexion sur le monde ne s’est jamais arrêtée. D’ailleurs, cela lui a permis de se faire connaître auprès du grand public avec sa Petite Doucette et Grand-Papa Ronchon. Deux générations qui confrontent leur point de vue avec d’un côté « C’était mieux avant » et de l’autre « c’est différent maintenant. Après avoir évoqué son côté espiègle lorsqu’il était jeune, sa prise de conscience dans la notion de lynchage, on retrouve nos deux personnages. Il parle littérature et aussi du virtuel, de la place qu’il prend dans les vies. M. Serres n’a jamais été un fervent utilisateur du numérique, alors il devait se retrouver assez dans Grand-Papa Ronchon. Qu’importe, en quelques mots, il insuffle un vent de bienveillance, d’humour et d’interrogations. J’ai aimé le moment où il questionne le sens et l’action du don. Car de ce mot à l’apparence si simple deux termes partagent son origine : dommage et pardonner. Des sens à l’opposé et pourtant, d’une façon complémentaire indissociable, dans l’idée. Et dans cette période assez trouble, ce mot a une place particulière et cela mérite de se demander ce que cela représente pour nous et de ce que l’on peut attendre ou pas de cette action. Les réponses sont propres à chacun.
» Ce livre est constitué de 5 entretiens de Michel Serres avec Bruno Latour (philosophe, anthropologue et sociologue) ? Ce dernier par son questionnement amène son interlocuteur d’abord à parler de sa formation puis à éclaircir certains aspects de sa pensée(qui n’est pas toujours facile à décrypter) . L’ensemble n’a ,pour moi ,que partiellement atteint son but car , faute sans doute de manque de formation philosophique, certains aperçus me restent obscurs.
À travers nombre de références culturelles connues, l’auteur donne une compréhension et une vision plus sereine et positive du changement civilisationnel qui est à l’oeuvre. Nos jeunes figés devant les écrans sont petit poucet, petite poucette, en référence à leur utilisation du pouce. Le petit Poucet est perdu et en danger, mais plutôt malin, il retrouvera son chemin. Et ce sont ses parents, la génération précédente, qui l’ont abandonné à son sort. La légende de saint Denis qui porte sa tête coupée de son corps, permet de passer de l’inquiétude sur l’abrutissement à une qualité extraordinaire, l’externalisation de certaines fonctions cognitives : mémoire encyclopédiques, calculs complexes… La figure littéraire inattendue de Boucicaut dans Au bonheur des dames (qui a l’idée géniale de désorganiser les rayons pour forcer les acheteurs à s’y perdre et à acheter ce qu’ils ne cherchaient pas), permet de repenser l’enseignement traditionnel (silence, organisation claire, conceptualisation) : ne serait-il pas plus adapté à notre époque de bouleverser les disciplines, de renverser l’intérêt pour la règle au profit de l’exemple, de l’abstrait au concret ?
La figure d’Humphrey Potter, jeune enfant travaillant à une tâche répétitive dans une locomotive, qui finit par astucieusement inventer une technique pour que l’ouvrage se fasse de lui-même aux moyens de fils, est utilisée pour montrer comme il est absurde de maintenir les élèves dans un apprentissage que tous jugent profondément ennuyeux. Ainsi, les usages des réseaux sociaux, les « j’aime » et les « partages » sont l’image même d’une volonté des enfants de donner plus de sens à leur apprentissage. La compétence figée de l’expert est rendue suspecte, à travers l’image du médecin sûr de lui, en face de la population organisée en réseaux qui peut, grâce au partage, acquérir une compétence valable pouvant rivaliser. À cette nouvelle complexité de la démocratie en réseaux, numérique, algorithmique, s’oppose l’ancienne simplicité pyramidale – celle de Khéops, celle d’Eiffel – représentant la hiérarchie de l’ancien régime.
Nous ne pouvons qu’être d’accord avec Michel Serres quant à la nécessité de réajuster nos pratiques pédagogiques et nos attentes sociétales, d’accorder davantage de confiance aux apprenants et aux nouvelles générations pour redéfinir les règles et s’approprier cette nouvelle civilisation transformée, à l’heure du numérique et d’autres circonstances importantes comme l’écologie, contexte qui fait que le XXe siècle est très loin derrière nous.
Le constat d’une nouvelle génération totalement reconfigurée, aux besoins différents de l’ancienne génération est au fond un constat toujours répété d’un « c’était mieux avant », mais caché, dissimulé sous le maquillage littéraire d’un « c’est pas si grave ! ». Souriant, certes, se voulant positif, mais en élaborant, avec l’aide de cette révolution technologique du numérique, une nouvelle génération qui serait profondément différente de l’ancienne, Michel Serres oublie d’interroger ce qui a changé avant même cette révolution, les effets de la révolution industrielle, de la massification de la culture, de ce qu’a fait cette ancienne génération de la merveilleuse éducation civilisée dont elle a été dotée.
Et nous affirmons à l’inverse : « c’était nettement moins bien avant ». Cette ancienne génération a conduit l’homme vers le non-sens, le tout économique, l’abstraction, le refus humain, la destruction de la planète, a érigé l’ennui comme devoir existentiel. Le silence d’autrefois, que le professeur d’université constate ne plus exister, n’est pas bouleversé par l’arrivée d’une nouvelle génération, mais par l’arrivée à l’université d’un spectre beaucoup plus large de population. L’enseignement était profondément élitiste. Il amenait et a amené à la formation d’élites inconscientes. Le bavardage renvoie le professeur à l’absurdité de ce monde absurde qu’il a créé : cette école qui inclut les pauvres et les acculturés, presque de force, mais n’a rien à leur proposer qui les concerne ; une école qui ment en disant que le diplôme fait l’avenir, que pousser les enfants à passer le bac fera reculer le chômage. Lui comme tant d’autres ont participé et participent encore à ce grand mensonge sociétal.
La société des loisirs est advenue pour calmer la grogne du travailleur esclave, non par la grande civilisation des élites. Occuper la tête des travailleurs en leur offrant loisirs et spectacles. Or, cette société du divertissement n’est plus assez forte, ou trop lamentable, pleine de contradictions, pour maintenir encore toute une société hors de l’ennui profond qu’il éprouve devant le travail auquel on lui demande de dévouer sa vie comme un esclave. Ce sont les esclaves étrangers prisonniers de guerre qui travaillaient dans l’ancienne société grecque et romaine, les serfs au Moyen-Âge, les esclaves noirs en Amérique, les enfants au XVIIIe, puis les ouvriers. Peut-on encore demeurer en admiration devant ces sociétés antiques où culmine l’inégalité ? Nombre d’intellectuels continuent de comparer cette société idéale, où une aristocratie sage recevait un enseignement qui lui garantissait l’accès ou le maintien à cette classe, pendant que l’immense majorité travaillait pour vivre, sans avoir le loisir de se poser la question de l’ennui, et une société de masse où l’on propose à l’ensemble de la société des savoirs d’élite, destinés à faire des recherches, à voyager, à savoir se comporter parmi une classe distinguée, tout ça pour à terme exercer un travail d’esclave, tout en souriant en mentant à tous sur la validité intellectuelle, civilisationnelle et culturelle de ce travail.
La nouvelle génération n’a pas découvert l’ennui au travail. La société du spectacle a simplement retardé l’explosion de cette grogne de l’ennui, de cette révolution des esclaves. Elle lui a cédé quelques miettes de privilèges : bribes de connaissance, temps de loisir, illusion de décider de son avenir, médecine… Mais tous ces « progrès » ne pourront faire passer le dégoût premier de l’esclave pour son travail, pour son futur enfermement, pour cette société inégalitaire, pour cette civilisation absurde qui vise à s’autodétruire. Elle instruit des règles du jeu. Des conditions d’esclavagisme plus ou moins belles qu’on pourra négocier si l’on est bien sage à l’école, puis dans le grand monde.
Cela dit sur les causes du vacarme, le constat demeure d’une génération différente, et le bien-fondé et l’envie de bien faire de Michel Serres l’amènent à proposer des idées intéressantes sur l’éducation. Se tourner vers l’exemple et l’application au détriment de la règle abstraite, ce n’est pas répondre à un nouveau besoin d’une génération numérique, mais bien répondre aux désirs de l’ensemble des élèves avant eux. L’école n’a jamais marché auparavant. Jamais. Elle a exclu. Elle a fabriqué une homogénéité qui lui permettait de faire régner l’obéissance docile de l’esclavon. Mais la rébellion des esclavons était là, derrière les masques. Les retours étaient violents, moqueurs, plus forts que tout le chahut indifférent des nouvelles générations. Ces petites poucettes sont tellement plus sages que les anciens apprenants. Renforcés, ils peuvent désormais chahuter, exprimer leur ennui. Ils n’ont plus besoin de faire de mauvais tours affreux lorsque l’enseignant tourne le dos.
Proposer un enseignement transdisciplinaire (brouiller les disciplines), distancié de la parole du maître (l’enseignant devient médiateur entre l’apprenant et un objet qu’il peut trouver dans de nombreux endroits : livres, internet...), passer du temps sur des cas pratiques (étude de cas, pédagogie par projet…), donner la parole à l’apprenant pour construire lui-même le cours (postures du laisser-faire, projets, co-construction, cours dialogué…), réinvestir l’enseignement d’un sens, d’une éthique, laisser entrer le monde réel, l’actualité (utilisation d’internet, partir des connaissances de l’apprenant…) sont les conséquences principales que l’on pourrait tirer non d’une génération qui ne tient pas en place – mais d’un ancien enseignement qui était profondément défectueux. Ces modifications et mutations de l’enseignement ont été amorcées il y a bien 200 ans déjà avec l’avènement des nouvelles pédagogies. Ces transformations investissent les différents enseignements, disciplines, structures et institutions, peu à peu. Mais comme le suggère lui-même M. Serres, le problème demeure cette addictive pyramidation des pouvoirs. L’école est une pyramide où le savoir à acquérir est défini d’en haut par une élite. L’auteur fuit d’ailleurs trop vite cette question de l’enseignement, pour regarder la société dans son ensemble, constatant l’injustice, l’absurdité des sociétés modernes (rangeant au passage la « lutte des classes » dans la catégorie des échecs du XXe siècle incarnés par l’idéologie soviétique, comme si la dictature bolchévique, puis stalinienne, le fascisme d’une classe, pouvait incarner une quelconque lutte des classes… là où évidemment a demeuré une pyramide faisant taire les uns, mentant aux autres.).
Dès lors que l’auteur fuit son sujet premier, il retrouve le sentier bien confortable d’une interprétation déjà pensée, préalable à l’enquête, à l’écriture. L’enthousiasme dans le code, l’algorithme, l’idée de l’ouverture du monde par les transports et les communications (qui au fond sont le leurre d’une classe privilégiée, l’impression d’avoir le bout du monde à sa porte quand ils ne quittent qu’à peine les environs de l’hôtel, qui est une reproduction de leur familier), les images usées de la tour de Babel, des pyramides… terminant son ouvrage sur l’image de la tour Eiffel, image honnie des artistes, image de l’industrie, image de la hiérarchie… Mais image cocorico tout de même.
Lien : https://leluronum.art.blog/2..
La figure d’Humphrey Potter, jeune enfant travaillant à une tâche répétitive dans une locomotive, qui finit par astucieusement inventer une technique pour que l’ouvrage se fasse de lui-même aux moyens de fils, est utilisée pour montrer comme il est absurde de maintenir les élèves dans un apprentissage que tous jugent profondément ennuyeux. Ainsi, les usages des réseaux sociaux, les « j’aime » et les « partages » sont l’image même d’une volonté des enfants de donner plus de sens à leur apprentissage. La compétence figée de l’expert est rendue suspecte, à travers l’image du médecin sûr de lui, en face de la population organisée en réseaux qui peut, grâce au partage, acquérir une compétence valable pouvant rivaliser. À cette nouvelle complexité de la démocratie en réseaux, numérique, algorithmique, s’oppose l’ancienne simplicité pyramidale – celle de Khéops, celle d’Eiffel – représentant la hiérarchie de l’ancien régime.
Nous ne pouvons qu’être d’accord avec Michel Serres quant à la nécessité de réajuster nos pratiques pédagogiques et nos attentes sociétales, d’accorder davantage de confiance aux apprenants et aux nouvelles générations pour redéfinir les règles et s’approprier cette nouvelle civilisation transformée, à l’heure du numérique et d’autres circonstances importantes comme l’écologie, contexte qui fait que le XXe siècle est très loin derrière nous.
Le constat d’une nouvelle génération totalement reconfigurée, aux besoins différents de l’ancienne génération est au fond un constat toujours répété d’un « c’était mieux avant », mais caché, dissimulé sous le maquillage littéraire d’un « c’est pas si grave ! ». Souriant, certes, se voulant positif, mais en élaborant, avec l’aide de cette révolution technologique du numérique, une nouvelle génération qui serait profondément différente de l’ancienne, Michel Serres oublie d’interroger ce qui a changé avant même cette révolution, les effets de la révolution industrielle, de la massification de la culture, de ce qu’a fait cette ancienne génération de la merveilleuse éducation civilisée dont elle a été dotée.
Et nous affirmons à l’inverse : « c’était nettement moins bien avant ». Cette ancienne génération a conduit l’homme vers le non-sens, le tout économique, l’abstraction, le refus humain, la destruction de la planète, a érigé l’ennui comme devoir existentiel. Le silence d’autrefois, que le professeur d’université constate ne plus exister, n’est pas bouleversé par l’arrivée d’une nouvelle génération, mais par l’arrivée à l’université d’un spectre beaucoup plus large de population. L’enseignement était profondément élitiste. Il amenait et a amené à la formation d’élites inconscientes. Le bavardage renvoie le professeur à l’absurdité de ce monde absurde qu’il a créé : cette école qui inclut les pauvres et les acculturés, presque de force, mais n’a rien à leur proposer qui les concerne ; une école qui ment en disant que le diplôme fait l’avenir, que pousser les enfants à passer le bac fera reculer le chômage. Lui comme tant d’autres ont participé et participent encore à ce grand mensonge sociétal.
La société des loisirs est advenue pour calmer la grogne du travailleur esclave, non par la grande civilisation des élites. Occuper la tête des travailleurs en leur offrant loisirs et spectacles. Or, cette société du divertissement n’est plus assez forte, ou trop lamentable, pleine de contradictions, pour maintenir encore toute une société hors de l’ennui profond qu’il éprouve devant le travail auquel on lui demande de dévouer sa vie comme un esclave. Ce sont les esclaves étrangers prisonniers de guerre qui travaillaient dans l’ancienne société grecque et romaine, les serfs au Moyen-Âge, les esclaves noirs en Amérique, les enfants au XVIIIe, puis les ouvriers. Peut-on encore demeurer en admiration devant ces sociétés antiques où culmine l’inégalité ? Nombre d’intellectuels continuent de comparer cette société idéale, où une aristocratie sage recevait un enseignement qui lui garantissait l’accès ou le maintien à cette classe, pendant que l’immense majorité travaillait pour vivre, sans avoir le loisir de se poser la question de l’ennui, et une société de masse où l’on propose à l’ensemble de la société des savoirs d’élite, destinés à faire des recherches, à voyager, à savoir se comporter parmi une classe distinguée, tout ça pour à terme exercer un travail d’esclave, tout en souriant en mentant à tous sur la validité intellectuelle, civilisationnelle et culturelle de ce travail.
La nouvelle génération n’a pas découvert l’ennui au travail. La société du spectacle a simplement retardé l’explosion de cette grogne de l’ennui, de cette révolution des esclaves. Elle lui a cédé quelques miettes de privilèges : bribes de connaissance, temps de loisir, illusion de décider de son avenir, médecine… Mais tous ces « progrès » ne pourront faire passer le dégoût premier de l’esclave pour son travail, pour son futur enfermement, pour cette société inégalitaire, pour cette civilisation absurde qui vise à s’autodétruire. Elle instruit des règles du jeu. Des conditions d’esclavagisme plus ou moins belles qu’on pourra négocier si l’on est bien sage à l’école, puis dans le grand monde.
Cela dit sur les causes du vacarme, le constat demeure d’une génération différente, et le bien-fondé et l’envie de bien faire de Michel Serres l’amènent à proposer des idées intéressantes sur l’éducation. Se tourner vers l’exemple et l’application au détriment de la règle abstraite, ce n’est pas répondre à un nouveau besoin d’une génération numérique, mais bien répondre aux désirs de l’ensemble des élèves avant eux. L’école n’a jamais marché auparavant. Jamais. Elle a exclu. Elle a fabriqué une homogénéité qui lui permettait de faire régner l’obéissance docile de l’esclavon. Mais la rébellion des esclavons était là, derrière les masques. Les retours étaient violents, moqueurs, plus forts que tout le chahut indifférent des nouvelles générations. Ces petites poucettes sont tellement plus sages que les anciens apprenants. Renforcés, ils peuvent désormais chahuter, exprimer leur ennui. Ils n’ont plus besoin de faire de mauvais tours affreux lorsque l’enseignant tourne le dos.
Proposer un enseignement transdisciplinaire (brouiller les disciplines), distancié de la parole du maître (l’enseignant devient médiateur entre l’apprenant et un objet qu’il peut trouver dans de nombreux endroits : livres, internet...), passer du temps sur des cas pratiques (étude de cas, pédagogie par projet…), donner la parole à l’apprenant pour construire lui-même le cours (postures du laisser-faire, projets, co-construction, cours dialogué…), réinvestir l’enseignement d’un sens, d’une éthique, laisser entrer le monde réel, l’actualité (utilisation d’internet, partir des connaissances de l’apprenant…) sont les conséquences principales que l’on pourrait tirer non d’une génération qui ne tient pas en place – mais d’un ancien enseignement qui était profondément défectueux. Ces modifications et mutations de l’enseignement ont été amorcées il y a bien 200 ans déjà avec l’avènement des nouvelles pédagogies. Ces transformations investissent les différents enseignements, disciplines, structures et institutions, peu à peu. Mais comme le suggère lui-même M. Serres, le problème demeure cette addictive pyramidation des pouvoirs. L’école est une pyramide où le savoir à acquérir est défini d’en haut par une élite. L’auteur fuit d’ailleurs trop vite cette question de l’enseignement, pour regarder la société dans son ensemble, constatant l’injustice, l’absurdité des sociétés modernes (rangeant au passage la « lutte des classes » dans la catégorie des échecs du XXe siècle incarnés par l’idéologie soviétique, comme si la dictature bolchévique, puis stalinienne, le fascisme d’une classe, pouvait incarner une quelconque lutte des classes… là où évidemment a demeuré une pyramide faisant taire les uns, mentant aux autres.).
Dès lors que l’auteur fuit son sujet premier, il retrouve le sentier bien confortable d’une interprétation déjà pensée, préalable à l’enquête, à l’écriture. L’enthousiasme dans le code, l’algorithme, l’idée de l’ouverture du monde par les transports et les communications (qui au fond sont le leurre d’une classe privilégiée, l’impression d’avoir le bout du monde à sa porte quand ils ne quittent qu’à peine les environs de l’hôtel, qui est une reproduction de leur familier), les images usées de la tour de Babel, des pyramides… terminant son ouvrage sur l’image de la tour Eiffel, image honnie des artistes, image de l’industrie, image de la hiérarchie… Mais image cocorico tout de même.
Lien : https://leluronum.art.blog/2..
"Dernier" livre de Michel Serres, le regretté (bien que Relire le relié vienne de paraître), ces Morales Espiègles sont une ode au chahut, à la désobéissance, au charivari, au carnaval ; mais pas sur tous les dos ni de n'importe quelle façon :
Il s'agit de rire doucement, sans être dur et méchant, vulgaire et vilain, prêt à blesser (voire tuer) pour rigoler.
Point de violence dans espièglerie, de l'humilité et de la modestie, et une grande dose d'humanité acquise au cours des lectures de la littérature classique: Cervantès en tête !
Comme dans presque tous ses derniers livres, Michel Serres offre là un résumé très condensé (80 pages offertes au Pommier pour les 20 ans de leur collaboration) de sa philosophie...
Une lecture aisée, intéressante et pleine d'émotion...
Il s'agit de rire doucement, sans être dur et méchant, vulgaire et vilain, prêt à blesser (voire tuer) pour rigoler.
Point de violence dans espièglerie, de l'humilité et de la modestie, et une grande dose d'humanité acquise au cours des lectures de la littérature classique: Cervantès en tête !
Comme dans presque tous ses derniers livres, Michel Serres offre là un résumé très condensé (80 pages offertes au Pommier pour les 20 ans de leur collaboration) de sa philosophie...
Une lecture aisée, intéressante et pleine d'émotion...
Petite Poucette représente la nouvelle génération, qui trouve l’information dans la machine.
Ce petit écrit érudit, à la fois sociologique et philosophique, résume les côtés positifs et négatifs de l’intrusion de la machine dans nos vies. C’est une réflexion sur la société actuelle, envahie et conduite par les technologies.
La rapidité de l’accès à l’information a changé dans le domaine de la connaissance : c’est « la fin de l’ère du savoir », supplanté par wikipedia et internet. Tout le monde est actif, présent sur la toile, car c’est l’ère de la décision, l’ère citoyenne.
Les choses ont changé : l’accès à la culture est plus rapide, les valeurs ne sont plus les mêmes. Les réseaux sociaux, les médias génèrent des milliers de voix, du bruit virtuel, la machine crée des raccourcis et accélère le rythme de nos vies. Tout ce numérique s’accorde une place importante, en dépit du réel.
Cependant, le fait de questionner sans cesse la machine afin d’accéder à l’information, a induit au fil du temps que Petite Poucette est devenue une mutante, car elle ne se sert plus de son cerveau comme elle le faisait dans le passé, sans l’aide des machines. Les concepts ne lui sont plus si familiers.
Ce livre est une vision importante de l’ère des machines, et qui peut servir à comprendre l’évolution de la société et son hystérisation actuelle pouvant lasser d’aucuns. J’aurais aimé que l’auteur ne féminise pas son personnage pour parler de ce sujet de la fin de l’ère du savoir, mais ce n’est qu’un clin d’œil personnel.
Ce petit écrit érudit, à la fois sociologique et philosophique, résume les côtés positifs et négatifs de l’intrusion de la machine dans nos vies. C’est une réflexion sur la société actuelle, envahie et conduite par les technologies.
La rapidité de l’accès à l’information a changé dans le domaine de la connaissance : c’est « la fin de l’ère du savoir », supplanté par wikipedia et internet. Tout le monde est actif, présent sur la toile, car c’est l’ère de la décision, l’ère citoyenne.
Les choses ont changé : l’accès à la culture est plus rapide, les valeurs ne sont plus les mêmes. Les réseaux sociaux, les médias génèrent des milliers de voix, du bruit virtuel, la machine crée des raccourcis et accélère le rythme de nos vies. Tout ce numérique s’accorde une place importante, en dépit du réel.
Cependant, le fait de questionner sans cesse la machine afin d’accéder à l’information, a induit au fil du temps que Petite Poucette est devenue une mutante, car elle ne se sert plus de son cerveau comme elle le faisait dans le passé, sans l’aide des machines. Les concepts ne lui sont plus si familiers.
Ce livre est une vision importante de l’ère des machines, et qui peut servir à comprendre l’évolution de la société et son hystérisation actuelle pouvant lasser d’aucuns. J’aurais aimé que l’auteur ne féminise pas son personnage pour parler de ce sujet de la fin de l’ère du savoir, mais ce n’est qu’un clin d’œil personnel.
Doux Jésus ! Quelle prise de tête !
C'était mieux avant est un petit pamphlet très court et bien écrit, au propos réfléchi et aux exemples bien choisis.
Néanmoins plusieurs regrets ont émaillés ma lecture:
Je suis un lecteur de Michel Serres, et si je suis loin d'avoir parcouru son immense œuvre, j'en ai lu les derniers ouvrages, notamment Petite Poucette, le livre qui l'a me semble-t-il révélé au grand public.
Et je trouve que dans ce dernier livre, il ne fait que redire, répéter ce qu'il martèle depuis longtemps, et particulièrement dans Petite Poucette, qui est déjà une belle synthèse de sa pensée.
"C'était mieux avant", antiène dont il se moque largement, ne fait que reprendre des morceaux de livres de Michel Serres et les juxtaposer en les résumant au maximum. C'est un condensé de lui.
On y gagne en rapidité de lecture et en nombre de page, mais on y perd sa verve, sa langue riche qui sait se déployer dans tout ce que propose le français pour nous faire comprendre sa pensée au plus juste, ses exemples éclairants, éclairés, bref, l'âme de cet auteur et sa force.
Si je souhaitais être méchant je dirai que c'est un peu le "petit Serres pour les Nuls".
Qu'on me comprenne bien, ce n'est pas les idées de cet ouvrage que j'attaque, au contraire, je conseille plutôt à ceux qui ont aimé le ton de Michel Serres de se pencher sur ses livres plus fournis afin d'en extraire la substantifique moelle eux même.
Néanmoins plusieurs regrets ont émaillés ma lecture:
Je suis un lecteur de Michel Serres, et si je suis loin d'avoir parcouru son immense œuvre, j'en ai lu les derniers ouvrages, notamment Petite Poucette, le livre qui l'a me semble-t-il révélé au grand public.
Et je trouve que dans ce dernier livre, il ne fait que redire, répéter ce qu'il martèle depuis longtemps, et particulièrement dans Petite Poucette, qui est déjà une belle synthèse de sa pensée.
"C'était mieux avant", antiène dont il se moque largement, ne fait que reprendre des morceaux de livres de Michel Serres et les juxtaposer en les résumant au maximum. C'est un condensé de lui.
On y gagne en rapidité de lecture et en nombre de page, mais on y perd sa verve, sa langue riche qui sait se déployer dans tout ce que propose le français pour nous faire comprendre sa pensée au plus juste, ses exemples éclairants, éclairés, bref, l'âme de cet auteur et sa force.
Si je souhaitais être méchant je dirai que c'est un peu le "petit Serres pour les Nuls".
Qu'on me comprenne bien, ce n'est pas les idées de cet ouvrage que j'attaque, au contraire, je conseille plutôt à ceux qui ont aimé le ton de Michel Serres de se pencher sur ses livres plus fournis afin d'en extraire la substantifique moelle eux même.
beau petit livre à lire avec delectation et à mettre absolument entre toutes les mains....
et oui , c'était mieux avant;...il n' y avait pas Babelio....
et oui , c'était mieux avant;...il n' y avait pas Babelio....
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Michel Serres
Quiz
Voir plus
Michel Serres nous manque déjà...
Certains les nomment génération Y ou "digital natives", les jeunes, (nouvelles ?), générations nous battent à plate couture devant un écran. Moi j'ai préféré les désigner sous le terme générique de ........?........
petite poucette
les pouces en or
petit poucet
poucez vous de là
10 questions
95 lecteurs ont répondu
Thème :
Michel SerresCréer un quiz sur cet auteur95 lecteurs ont répondu