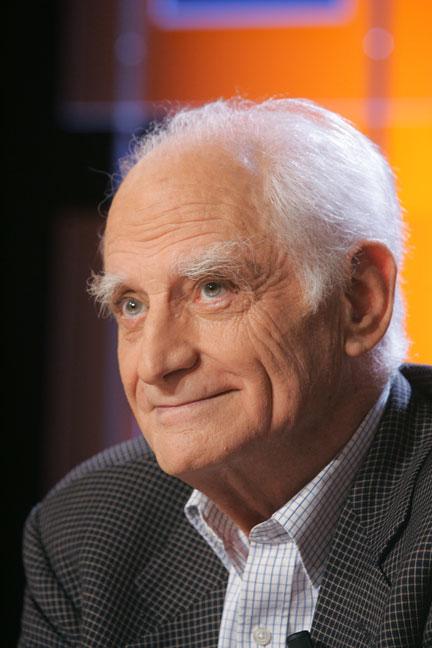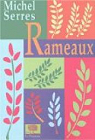Critiques de Michel Serres (277)
Mouais, je m'attendais à mieux, j'avais adoré le tiers instruit qui m'avait pas mal fait réfléchir à l'époque sur mon travail de formateur mais là, je m'interroge et me demande s'il n'a pas pris quelques raccourcis pour aller au bout de sa démonstration. La nouvelle génération de jeunes qui naviguent sur leurs smartphones à la vitesse de l'éclair fascine l'auteur, certes, moi aussi. Est-ce à dire qu'on n'a rien à leur apprendre sous prétexte que tout est disponible sur wikipédia ? Oui, le savoir est en ligne mais à condition d'aller croiser et vérifier ses sources à l'heure des vérités alternatives. Quand à la connaissance, c'est pour moi autre chose. Il me semble qu'il y a une confusion entre information, savoir et connaissance dans son propos.
Il faut s'approprier l'information pour en faire du savoir et il faut être capable de verbaliser ce savoir pour en faire de la connaissance. le fait de manier avec aisance les nouvelles technologies ne dit rien de ce qu'il en reste en terme de connaissances. Quant au sens de l'effort, dommage qu'il n'en parle pas...
Enfin, ce n'est que mon humble avis.
Challenge Riquiqui 2023.
Il faut s'approprier l'information pour en faire du savoir et il faut être capable de verbaliser ce savoir pour en faire de la connaissance. le fait de manier avec aisance les nouvelles technologies ne dit rien de ce qu'il en reste en terme de connaissances. Quant au sens de l'effort, dommage qu'il n'en parle pas...
Enfin, ce n'est que mon humble avis.
Challenge Riquiqui 2023.
Les élèves n'écoutent plus en classe leurs enseignants, le statut de professeur des universités ne permet pas d'obtenir l'écoute dans les amphys, et les professeurs bruissent pendant que le proviseur parle! Dans quelle société vivons nous?
Le progrès, les nouveautés technologiques qui se multiplient depuis un siècle réécrivent la société occidentale, et nous devons nous y adapter. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui, nos adolescents et les jeunes adultes qui le font le mieux, sans forcément avoir conscience de cette transition. ''Nous, adultes avons transformé notre société du spectacle en une société pédagogique dont la concurrence écrasante, vaniteusement inculte, éclipse l'école et l'université'' ( p 12).
Ces nouveautés, qui remettent en cause tous les piliers de la société ont aussi des influences sur nos neurones. Nos capacités d'intégration et de synthétisation de l'information changent, et nous voila reformatés. !!
Les anciennes générations s'y perdent, les nouvelles naissent déjà reformatées. Et nous, les entre deux, nous avons été éduqués dans '' l'ancienne pédagogie'', mais vivons aujourd'hui un nouvel accès aux connaissances, quasi instantannées Peut-être est-ce notre génération qui est la plus riche de ce passé et de ce futur, combinant les moteurs de recherche d'hier (les fichiers, les livres, les bibliothèques) et d'aujourd'hui (google, wikipédia).
Une phase de transition intéressante dans bien des domaines, que Michel Serre étudie à la loupe.
Petite Poucette analyse les rapports des jeunes d'aujourd'hui à ces nouveautés, le rôle de l'école, et l'implication sociétale de toutes ces révolutions.
C'est un ouvrage que je vais relire cet été, pour mieux le décortiquer, car je pense qu'un parcours de lecture sous forme de groupement de textes pourrait amener nos élèves d'aujourd'hui à réfléchir à leur rapport au monde et à leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont et de leur héritage.
Le progrès, les nouveautés technologiques qui se multiplient depuis un siècle réécrivent la société occidentale, et nous devons nous y adapter. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui, nos adolescents et les jeunes adultes qui le font le mieux, sans forcément avoir conscience de cette transition. ''Nous, adultes avons transformé notre société du spectacle en une société pédagogique dont la concurrence écrasante, vaniteusement inculte, éclipse l'école et l'université'' ( p 12).
Ces nouveautés, qui remettent en cause tous les piliers de la société ont aussi des influences sur nos neurones. Nos capacités d'intégration et de synthétisation de l'information changent, et nous voila reformatés. !!
Les anciennes générations s'y perdent, les nouvelles naissent déjà reformatées. Et nous, les entre deux, nous avons été éduqués dans '' l'ancienne pédagogie'', mais vivons aujourd'hui un nouvel accès aux connaissances, quasi instantannées Peut-être est-ce notre génération qui est la plus riche de ce passé et de ce futur, combinant les moteurs de recherche d'hier (les fichiers, les livres, les bibliothèques) et d'aujourd'hui (google, wikipédia).
Une phase de transition intéressante dans bien des domaines, que Michel Serre étudie à la loupe.
Petite Poucette analyse les rapports des jeunes d'aujourd'hui à ces nouveautés, le rôle de l'école, et l'implication sociétale de toutes ces révolutions.
C'est un ouvrage que je vais relire cet été, pour mieux le décortiquer, car je pense qu'un parcours de lecture sous forme de groupement de textes pourrait amener nos élèves d'aujourd'hui à réfléchir à leur rapport au monde et à leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont et de leur héritage.
Opération Masse Critique...
Merci aux éditions de L'Herne et à Babelio bien sûr.
Ce petit ouvrage de quelque 150 pages rassemble une trentaine de brèves chroniques, parues dans "Le Monde de l’Éducation" entre 1997 et 1999. C'est ce détail qui m'a décidée à choisir ce livre parmi tant d'autres. "Le Monde de l’Éducation", revue bien connue des enseignants et des étudiants : et pourtant, moi qui me destine à ce merveilleux métier de professeur des écoles, je n'ai jamais pris le temps d'en parcourir les pages.
Dans ce petit recueil, sont réunies quelques réflexions intéressantes sur l'enseignement et le savoir en général, ou du moins quelques pistes de réflexion que tout bon enseignant, à mon sens, devrait se poser un jour. Non, je ne suis pas toujours d'accord avec vous, Monsieur Michel Serres, tout philosophe, tout académicien que vous soyez, mais qu'importe ! Vous ouvrez la voie, vous m'aidez à faire quelques pas, je peux ensuite vous lâcher la main et penser par moi-même.
Non la lecture de ces petites chroniques n'apporte pas de réponses, la philosophie n'en apporte jamais, elle nous lance sur le chemin de la pensée.
Non, vous ne trouverez pas dans ces pages des solutions aux problèmes que notre école républicaine rencontre aujourd'hui. Un système remis en cause, réformé sans cesse, pour le meilleur et... Merci Monsieur Sarko, pour le pire.
Et pourtant si vous voulez bien prendre le temps de vous interroger quelques minutes, le temps d'une lecture, sur notre manière de transmettre le savoir, comment donner le goût de la connaissance aux futures générations, et prendre le temps de réfléchir à ce que notre société nous propose dans ce domaine, alors non, vous n'aurez pas perdu votre temps.
Merci aux éditions de L'Herne et à Babelio bien sûr.
Ce petit ouvrage de quelque 150 pages rassemble une trentaine de brèves chroniques, parues dans "Le Monde de l’Éducation" entre 1997 et 1999. C'est ce détail qui m'a décidée à choisir ce livre parmi tant d'autres. "Le Monde de l’Éducation", revue bien connue des enseignants et des étudiants : et pourtant, moi qui me destine à ce merveilleux métier de professeur des écoles, je n'ai jamais pris le temps d'en parcourir les pages.
Dans ce petit recueil, sont réunies quelques réflexions intéressantes sur l'enseignement et le savoir en général, ou du moins quelques pistes de réflexion que tout bon enseignant, à mon sens, devrait se poser un jour. Non, je ne suis pas toujours d'accord avec vous, Monsieur Michel Serres, tout philosophe, tout académicien que vous soyez, mais qu'importe ! Vous ouvrez la voie, vous m'aidez à faire quelques pas, je peux ensuite vous lâcher la main et penser par moi-même.
Non la lecture de ces petites chroniques n'apporte pas de réponses, la philosophie n'en apporte jamais, elle nous lance sur le chemin de la pensée.
Non, vous ne trouverez pas dans ces pages des solutions aux problèmes que notre école républicaine rencontre aujourd'hui. Un système remis en cause, réformé sans cesse, pour le meilleur et... Merci Monsieur Sarko, pour le pire.
Et pourtant si vous voulez bien prendre le temps de vous interroger quelques minutes, le temps d'une lecture, sur notre manière de transmettre le savoir, comment donner le goût de la connaissance aux futures générations, et prendre le temps de réfléchir à ce que notre société nous propose dans ce domaine, alors non, vous n'aurez pas perdu votre temps.
Le français est râleur.
C’est bien connu et c’est l’une des caractéristiques qui font sa réputation de par le monde.
Dans cet essai, le philosophe, Michel Serres (1930-2019), s’attaque donc à ces personnes d’âge mûr et aïeuls, retraité(e)s râleurs/râleuses, ces bougon(ne)s nostalgiques d’un autre temps et qui ne cessent de répéter : « C’était mieux avant ! ». Ce à quoi, l’auteur rétorque « Cela tombe bien, avant, justement, j’y étais. […] ».
Pour contrecarrer l’argument infondé de ces grands nostalgiques, Michel Serres énumère, sur un peu plus de quatre-vingts pages, les grands progrès technologiques, alimentaires, médicaux, sanitaires, sociaux, politiques, et autres avancées considérables qui ont amélioré nos conditions de vie au cours des dernières décennies. Le tout est illustré par une confrontation verbale entre deux personnages, Grand-Papa Ronchon (les anciennes générations râleuses) et Petite Poucette (la jeune génération, les milléniaux optimistes.
Il est indéniable qu’au cours du XXème siècle nous avons assisté à des progrès monumentaux. Mais, tout le long de ma lecture, j’ai eu l’impression que l’auteur était enivré par un optimisme béat. Occultant consciemment ou inconsciemment la part d’ombre de certains « progrès technologiques et alimentaires » (impacts écologiques néfastes des transports et de l’industrie agro-alimentaire sur l’environnement, impacts sociaux et émotionnels délétères des réseaux sociaux, etc…).
Le monde n’est pas binaire et est infiniment plus complexe que ne pourrait le laisser imaginer cet ouvrage. C’est en partie pour cette raison que je n’ai pas trop aimé ce plaidoyer optimiste. Bien que je considère, l’optimisme comme étant absolument nécessaire au bien-être et à la santé mentale. Mais il est important de garder un regard lucide sur les choses. De plus, à plusieurs reprises, dans ma lecture, j’ai buté sur les phrases de Michel Serres. J’ai trouvé leur tournure décatie.
Mais tout cela, n’enlève en rien tout le respect et la sympathie que j’ai pour ce grand Monsieur qu’était Michel Serres.
C’est bien connu et c’est l’une des caractéristiques qui font sa réputation de par le monde.
Dans cet essai, le philosophe, Michel Serres (1930-2019), s’attaque donc à ces personnes d’âge mûr et aïeuls, retraité(e)s râleurs/râleuses, ces bougon(ne)s nostalgiques d’un autre temps et qui ne cessent de répéter : « C’était mieux avant ! ». Ce à quoi, l’auteur rétorque « Cela tombe bien, avant, justement, j’y étais. […] ».
Pour contrecarrer l’argument infondé de ces grands nostalgiques, Michel Serres énumère, sur un peu plus de quatre-vingts pages, les grands progrès technologiques, alimentaires, médicaux, sanitaires, sociaux, politiques, et autres avancées considérables qui ont amélioré nos conditions de vie au cours des dernières décennies. Le tout est illustré par une confrontation verbale entre deux personnages, Grand-Papa Ronchon (les anciennes générations râleuses) et Petite Poucette (la jeune génération, les milléniaux optimistes.
Il est indéniable qu’au cours du XXème siècle nous avons assisté à des progrès monumentaux. Mais, tout le long de ma lecture, j’ai eu l’impression que l’auteur était enivré par un optimisme béat. Occultant consciemment ou inconsciemment la part d’ombre de certains « progrès technologiques et alimentaires » (impacts écologiques néfastes des transports et de l’industrie agro-alimentaire sur l’environnement, impacts sociaux et émotionnels délétères des réseaux sociaux, etc…).
Le monde n’est pas binaire et est infiniment plus complexe que ne pourrait le laisser imaginer cet ouvrage. C’est en partie pour cette raison que je n’ai pas trop aimé ce plaidoyer optimiste. Bien que je considère, l’optimisme comme étant absolument nécessaire au bien-être et à la santé mentale. Mais il est important de garder un regard lucide sur les choses. De plus, à plusieurs reprises, dans ma lecture, j’ai buté sur les phrases de Michel Serres. J’ai trouvé leur tournure décatie.
Mais tout cela, n’enlève en rien tout le respect et la sympathie que j’ai pour ce grand Monsieur qu’était Michel Serres.
Je n'ai pas aimé le style de ce livre, composé de dix articles parus entre 1970 et 1997, et traitant autant des rapports d'amitié entre l'illustre philosophe des sciences et l'immortel dessinateur que de l'analyse de certains de ses albums : L'Oreille cassée, Les Bijoux de la Castafiore, Tintin et les Picaros, Tintin au Tibet. Je n'apprécie pas que, parti d'une idée intéressante et à peine effleurée – qu'Hergé puisse être considéré comme « Le Jules Verne des sciences humaines » – cet hommage à l'ami disparu se transforme, par accumulation et redondances, en une espèce d'hagiographie. J'aime les analyses des œuvres au plus près du texte, et j'ai horreur que des idées intéressantes – et à peine développées – se retrouvent noyées dans une accumulation et redondance de métaphores, pour le seul plaisir de la belle phrase surprenante, de l'image poétique. C'est un reproche que je fais à des auteurs que j'aime, comme Roland Barthes, par exemple.
Je vais donc m'efforcer de retenir, et de noter en citation, uniquement ces idées intéressantes :
- Hergé, dans les voyages qu'il nous fait faire, et dont les paysages nous suivent dans notre mémoire, que nous nous rendions à « Shanghai ou au Tibet, en Écosse ou au Proche-Orient », « part du musée d'Ethnographie et non du muséum d'histoire naturelle ». Ainsi, certains de ses albums peuvent se lire comme de traités de sciences humaines, et c'est ce que Michel Serres va réaliser ici.
- Ainsi, L'Oreille cassée est considérée comme une « ethnographie du fétiche », au-delà du concept, déjà utilisé par Diderot, mais popularisé par Charles de Brosses (1709-1777) et abondamment étudié par Marx (valeur d'usage/valeur d'échange) et par Freud. Le même opus peut être lu aussi comme un voyage initiatique « à la recherche des origines », dont le retour constitue une critique de la société de la « substitution », du toc, du remplaçable, et en fin de compte de la société du spectacle.
- Les Bijoux de la Castafiore, analysé dans « Rires : les bijoux distraits ou la cantatrice sauve » - l'article le plus long (pp. 62-91) et plus abouti – constitue un petit traité de théorie de la communication, ou plutôt un catalogue des « parasites », ou défauts de communication étudiés largement par cette théorie. « Parasites » comme personnages, chacun représenté par son animal-totem (cf. cit. infra) et aussi « parasites » comme instances de communication défectueuse. Il est aussi question du théâtre classique, avec la centralité de l'escalier dans ce seul ouvrage qui se passe à huis-clos, et en conclusion, très très rapide, du rire entendu comme une « chaîne » - je pense qu'il s'agit aussi d'un concept tiré de la théorie de la communication.
- Tintin et les Picaros, se présente d'abord comme un essai sur « Le picaresque aujourd'hui ». Il s'ouvre sur une très belle analyse du personnage de Tournesol à travers l'ensemble de l’œuvre d'Hergé. On a souvent remarqué son « épaississement » au cours des années, de « petit inventeur pour concours Lépine » à physicien nucléaire. Mais Serres prend très au sérieux la grande crise d'amnésie (Objectif Lune) provoquée par l'expression du Capitaine Haddock : « faire le zouave », comme une dénonciation de la collusion de la science avec le militarisme, qui provoquerait une véritable crise de conscience chez le savant, qui, après l'expédition lunaire, se consacrera à la culture des roses et à l'invention de patins à roulettes motorisés, et en viendra enfin, dans ce dernier album terminé, aux plantes médicinales, à la pharmacopée comme remède contre l'ivresse – remplacement de l'alcool par l'opium. Cet article aborde plus que tout autre la question de la société du spectacle, même si Guy Debord n'est pas nommément cité. Il est d'abord question du factice dans la nutrition, sans doute pour développer la métaphore de l’écœurement. Ensuite sont rappelés les multiples renvois de ce dernier opus aux Sept Boules de cristal, lorsque, dans le music-hall, Alcazar est le lanceur de poignards Ramon Zarate et Haddock essaie de percer le mystère de la transsubstantiation de l'eau en vin. La société du spectacle, c'est bien sûr le coup monté par Sponsz-Esponja, le nez-à-nez Haddock-Tapioca par écran télévisé interposé, mais c'est aussi le Club Méd qui remplace les guérilleros – qui ont déjà remplacé les Arumbayas et leurs ennemis Biberos – c'est le coup d'État de carnaval, ce sont les Turlurons de Séraphin Lampion : « Le masque de ressemblance masque le masque de la différence. Haddock et Tintin sont jumeaux, ils ne sont plus que des Dupondt. » (p. 102), ce sont enfin les deux mêmes militaires, dans le même bidonville, avec juste des uniformes différents.
- Dans « La plus précieuse des raretés », au sujet de Tintin au Tibet, la découverte la plus rare, c'est l'inversion nécessaire à l'éthique du scientifique social. Le monstre, l'abominable, l'inhumain s'avère être le meilleur, le lointain s'avère être le proche et le prochain. Sont convoqués le récit biblique du Bon Samaritain et Diogène le Cynique. Enfin est supposé (cf. cit. infra) le retournement entre l'ethnologue et son « sujet » d'observation : « Dites : qui allons-nous rencontrer, en Occident, au retour de l'Himalaya ? Des bêtes abominables qui chassent les misérables » (p. 129).
Je vais donc m'efforcer de retenir, et de noter en citation, uniquement ces idées intéressantes :
- Hergé, dans les voyages qu'il nous fait faire, et dont les paysages nous suivent dans notre mémoire, que nous nous rendions à « Shanghai ou au Tibet, en Écosse ou au Proche-Orient », « part du musée d'Ethnographie et non du muséum d'histoire naturelle ». Ainsi, certains de ses albums peuvent se lire comme de traités de sciences humaines, et c'est ce que Michel Serres va réaliser ici.
- Ainsi, L'Oreille cassée est considérée comme une « ethnographie du fétiche », au-delà du concept, déjà utilisé par Diderot, mais popularisé par Charles de Brosses (1709-1777) et abondamment étudié par Marx (valeur d'usage/valeur d'échange) et par Freud. Le même opus peut être lu aussi comme un voyage initiatique « à la recherche des origines », dont le retour constitue une critique de la société de la « substitution », du toc, du remplaçable, et en fin de compte de la société du spectacle.
- Les Bijoux de la Castafiore, analysé dans « Rires : les bijoux distraits ou la cantatrice sauve » - l'article le plus long (pp. 62-91) et plus abouti – constitue un petit traité de théorie de la communication, ou plutôt un catalogue des « parasites », ou défauts de communication étudiés largement par cette théorie. « Parasites » comme personnages, chacun représenté par son animal-totem (cf. cit. infra) et aussi « parasites » comme instances de communication défectueuse. Il est aussi question du théâtre classique, avec la centralité de l'escalier dans ce seul ouvrage qui se passe à huis-clos, et en conclusion, très très rapide, du rire entendu comme une « chaîne » - je pense qu'il s'agit aussi d'un concept tiré de la théorie de la communication.
- Tintin et les Picaros, se présente d'abord comme un essai sur « Le picaresque aujourd'hui ». Il s'ouvre sur une très belle analyse du personnage de Tournesol à travers l'ensemble de l’œuvre d'Hergé. On a souvent remarqué son « épaississement » au cours des années, de « petit inventeur pour concours Lépine » à physicien nucléaire. Mais Serres prend très au sérieux la grande crise d'amnésie (Objectif Lune) provoquée par l'expression du Capitaine Haddock : « faire le zouave », comme une dénonciation de la collusion de la science avec le militarisme, qui provoquerait une véritable crise de conscience chez le savant, qui, après l'expédition lunaire, se consacrera à la culture des roses et à l'invention de patins à roulettes motorisés, et en viendra enfin, dans ce dernier album terminé, aux plantes médicinales, à la pharmacopée comme remède contre l'ivresse – remplacement de l'alcool par l'opium. Cet article aborde plus que tout autre la question de la société du spectacle, même si Guy Debord n'est pas nommément cité. Il est d'abord question du factice dans la nutrition, sans doute pour développer la métaphore de l’écœurement. Ensuite sont rappelés les multiples renvois de ce dernier opus aux Sept Boules de cristal, lorsque, dans le music-hall, Alcazar est le lanceur de poignards Ramon Zarate et Haddock essaie de percer le mystère de la transsubstantiation de l'eau en vin. La société du spectacle, c'est bien sûr le coup monté par Sponsz-Esponja, le nez-à-nez Haddock-Tapioca par écran télévisé interposé, mais c'est aussi le Club Méd qui remplace les guérilleros – qui ont déjà remplacé les Arumbayas et leurs ennemis Biberos – c'est le coup d'État de carnaval, ce sont les Turlurons de Séraphin Lampion : « Le masque de ressemblance masque le masque de la différence. Haddock et Tintin sont jumeaux, ils ne sont plus que des Dupondt. » (p. 102), ce sont enfin les deux mêmes militaires, dans le même bidonville, avec juste des uniformes différents.
- Dans « La plus précieuse des raretés », au sujet de Tintin au Tibet, la découverte la plus rare, c'est l'inversion nécessaire à l'éthique du scientifique social. Le monstre, l'abominable, l'inhumain s'avère être le meilleur, le lointain s'avère être le proche et le prochain. Sont convoqués le récit biblique du Bon Samaritain et Diogène le Cynique. Enfin est supposé (cf. cit. infra) le retournement entre l'ethnologue et son « sujet » d'observation : « Dites : qui allons-nous rencontrer, en Occident, au retour de l'Himalaya ? Des bêtes abominables qui chassent les misérables » (p. 129).
Petit Ouvrage "de fin de vie ?" écrit pas Michel Serres à la demande de ses éditrices pour l'anniversaire de leur coopération. Quelques belles pensées, des pensées de toujours, un peu comme aimaient à les écrire les Stoïciens, serait-on tenté de dire. Le style est souvent limpide mais frôle parfois l'ésotérisme comme aime à le faire Michel Serres. Un petit livre qui se lit, comme ça, sans autre forme de procès. Où l'on comprend que le vieux Monsieur qu'est l'auteur se retourne sur sa vie et sur LA vie - qui est aussi la nôtre pour le coup - avec gentillesse, avec mansuétude, avec intelligence et bonne humeur. Un livre qui fait du bien. Ce qui n'est pas un petit livre ! A lire et sans doute à relire.
Une lecture que j'avais hésité à faire quand tous mes collègues me parlait de cette Petite poucette comme une référence dans les pratiques du numérique. Mais je n'ai pas voulu le lire. Puis suite à un passage dans une émission littéraire sur France 5, j'ai été tenté. Par chance, l'ouvrage a été commandé à la médiathèque, il m'a fallu peu de temps pour l'obtenir.
Une fois en main, il passa devant toutes les lectures à faire pour le mois de juin. En plus, c'est écrit assez gros, comme pour les mal-voyants, la lecture c'est faîtes assez rapidement. La lecture se fait assez vite et débute avec beaucoup de curiosité. En effet, la société a évolué, a muté dans tous les sens du terme. Puis il s'égare pour moi à grand renfort de comparaison d'intellectuelles et de quelques mots savants comme sérendipité ou des phrases tel "Le moteur de recherche peut, parfois, remplacer l'abstraction." Encore un chercheur qui veut expliquer le monde aux autres, à ceux d'en bas.
Je ne suis pas d'accord sur le fait que l'enseignement oral devient en partie inutile car on peut avoir accès à tous le savoir partout. Ce qui n'est pas vrai. Il faut avoir envie de chercher, savoir comment chercher, comprendre ce qu'on lit, regrouper des lectures, des vidéos, des photos. On apprend beaucoup par l'écoute et par l'échange. Internet et objets interactifs ne nuisent pas à l'écoute oral et l'apprentissage, au contraire. Si les gens chuchotent pendant les cours, c'est qu'ils sont irrespectueux.
Vue les éloges de beaucoup, il faudra peut-être que je le lise avec un esprit plus tranquille. Mais j'en ai marre de ces gens qui parle du numérique sans pratiquer.
Lien : http://22h05ruedesdames.word..
Une fois en main, il passa devant toutes les lectures à faire pour le mois de juin. En plus, c'est écrit assez gros, comme pour les mal-voyants, la lecture c'est faîtes assez rapidement. La lecture se fait assez vite et débute avec beaucoup de curiosité. En effet, la société a évolué, a muté dans tous les sens du terme. Puis il s'égare pour moi à grand renfort de comparaison d'intellectuelles et de quelques mots savants comme sérendipité ou des phrases tel "Le moteur de recherche peut, parfois, remplacer l'abstraction." Encore un chercheur qui veut expliquer le monde aux autres, à ceux d'en bas.
Je ne suis pas d'accord sur le fait que l'enseignement oral devient en partie inutile car on peut avoir accès à tous le savoir partout. Ce qui n'est pas vrai. Il faut avoir envie de chercher, savoir comment chercher, comprendre ce qu'on lit, regrouper des lectures, des vidéos, des photos. On apprend beaucoup par l'écoute et par l'échange. Internet et objets interactifs ne nuisent pas à l'écoute oral et l'apprentissage, au contraire. Si les gens chuchotent pendant les cours, c'est qu'ils sont irrespectueux.
Vue les éloges de beaucoup, il faudra peut-être que je le lise avec un esprit plus tranquille. Mais j'en ai marre de ces gens qui parle du numérique sans pratiquer.
Lien : http://22h05ruedesdames.word..
Un nouvel humain est né.
Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer. Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions : le passage de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimé. Comme chacune des précédentes, la troisième, tout aussi décisive, s'accompagne de mutations politiques, sociales et cognitives. Ce sont des périodes de crises. De l'essor des nouvelles technologies, un nouvel humain est né : Michel Serres le baptise « Petite Poucette » ou « Petit Poucet » - clin d'œil à la maestria avec laquelle les messages fusent de ses pouces. « Petite Poucette » va devoir réinventer une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d'être et de connaître...
« Petite Poucette » est également le titre d'un discours académique prononcé par Michel Serres devant l'Académie française lors de la séance du mardi 1er mars 2011 au sujet des nouveaux défis de l’Éducation...
Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer. Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions : le passage de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimé. Comme chacune des précédentes, la troisième, tout aussi décisive, s'accompagne de mutations politiques, sociales et cognitives. Ce sont des périodes de crises. De l'essor des nouvelles technologies, un nouvel humain est né : Michel Serres le baptise « Petite Poucette » ou « Petit Poucet » - clin d'œil à la maestria avec laquelle les messages fusent de ses pouces. « Petite Poucette » va devoir réinventer une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d'être et de connaître...
« Petite Poucette » est également le titre d'un discours académique prononcé par Michel Serres devant l'Académie française lors de la séance du mardi 1er mars 2011 au sujet des nouveaux défis de l’Éducation...
De @Michel Serres, je ne connaissais jusque là que @Petite Poucette et les différentes chroniques radiophoniques, notamment celles tenues sur France Info.
Avec @Rameaux, on entre dans une autre dimension, toute aussi intéressante mais aussi bien plus complexe de la pensée de l'auteur ! Aussi, je me garderai bien de livrer ici une analyse exhaustive de l'ouvrage ! Et ce d'autant plus que je reconnais humblement ne pas avoir saisi toutes les implications, tous les questionnements, tous les concepts manipulés par @Michel Serres.
Toutefois, pour peu qu'on s'y attarde un peu, on retrouve dans ces lignes tout l'humanisme profond du philosophe, sa foi inébranlable en l'homme, sa confiance absolue dans un progrès respectueux de tous et de tout, réconciliant l'homme, la science, la nature.
Et ça et là, lorsque la concentration est au rendez-vous (!), on tombe sur des pépites, des lignes qui sont éclairantes et permettent d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme que ne le laisse penser l'environnement actuel. Salutaire !
Avec @Rameaux, on entre dans une autre dimension, toute aussi intéressante mais aussi bien plus complexe de la pensée de l'auteur ! Aussi, je me garderai bien de livrer ici une analyse exhaustive de l'ouvrage ! Et ce d'autant plus que je reconnais humblement ne pas avoir saisi toutes les implications, tous les questionnements, tous les concepts manipulés par @Michel Serres.
Toutefois, pour peu qu'on s'y attarde un peu, on retrouve dans ces lignes tout l'humanisme profond du philosophe, sa foi inébranlable en l'homme, sa confiance absolue dans un progrès respectueux de tous et de tout, réconciliant l'homme, la science, la nature.
Et ça et là, lorsque la concentration est au rendez-vous (!), on tombe sur des pépites, des lignes qui sont éclairantes et permettent d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme que ne le laisse penser l'environnement actuel. Salutaire !
J'ai lu ce livre quand ma fille de 13 ans se servait de son premier smartphone comme d'un jouet qu'elle maitrisait parfaitement. Rapidement sa maîtrise des codes de communication plus que l'outil lui même a rejoint la lecture de ce livre caractérisé par sa clairvoyance, son approche restant optimiste, et la clarté du propos. On est pas forcément d'accord, d'autant que de nombreux sujets (la sauvegarde de notre vie privée par exemple) ne sont pas traités, mais c'est pertinent et ça permet de nourrir notre appréciation du sujet, notamment sur la façon dont cette génération (Y à l'époque) abordera (aborde maintenant) la société, le monde du travail... du XXIème siècle.
D’accord, on connaît la chanson. Les vieux ronchons assomment régulièrement les jeunes gens avec cette rengaine. Michel Serres en prend plus ou moins le contrepied pour en conclure qu’avant était surtout différent. Ainsi, il balaie plusieurs sujets (l’hygiène, la condition féminine, les communications et les voyages…). Pour sympathique et optimiste que soit l’entreprise, elle n’en n’est pas moins mécanique, voire parfois caricaturale.
Tintin au pays des philosophes est un Petit plaisir plutôt bien pensé. Il s’agit d’une réédition – en édition de luxe – d’un numéro spécial de Philosophie magazine de l’année 2011 qui permet tout à la fois de s’initier à cette discipline de manière ludique et de relire différemment Tintin.
D’une manière ou d’une autre, une fois cette lecture achevée, plusieurs autres vont se révéler nécessaires. Il faudra s’attendre à avoir envie de relire les albums du canon, ou à l’inverse de s’intéresser davantage à la philosophie en visant des ouvrages généralistes. Le travail de coordination de Sven Ortoli aura donc fonctionné.
Il est vrai que la démarche peut laisser dubitatif. Plusieurs grands noms de la discipline produisent des articles sur des thèmes tels que la morale, la politique, l’homme, la raison, le rire, l’art. Ils prolongent ainsi une initiative de Michel Serres qui a laissé sceptique Hergé en personne. Certains articles (notamment lorsqu’il est question de Vérité, du rapport au vrai, des médias) donnent l’impression d’être le fruit d’extrapolations assez éloignées du texte. Certains développements sont parfois difficiles à assimiler, comme le recours à un jargon hermétique.
Pourtant l’on s’adapte assez facilement et c’est avec curiosité que l’on découvre cette nouvelle dimension, d’autant qu’un effort de vulgarisation a été consenti. Vous pensiez être dégoûtes de la philosophie ou lassés de Tintin et bien voilà vos certitudes remises en question ! D’autant qu’il n’est pas seulement question d’idées, mais également d’histoire, de symbolique… le propos est riche et immersif. De nombreuses insertions viennent par ailleurs égayer le texte et rappeler des souvenirs.
Tous les auteurs tentent de réhabiliter Hergé aujourd’hui largement critiqué pour plusieurs de ses albums. Ils ne s’en cachent pas et proposent des arguments pertinents, notamment lorsqu’il est question de colonialisme ou de rapport avec l’occupant. Tintin au Congo, donne lieu à une analyse intéressante. Il est regrettable de constater que Tintin en Amérique et Tintin aux pays des Soviets n’en profitent guère.
Des sélections ont été opérées avec un effort visible pour englober la totalité de la geste du reporter à la houppette. Certains albums sont plus longuement commentés que d’autres qui doivent parfois se contenter de simples références. Il est hélas regrettable que les références faites par les différents auteurs concernent également ces albums phares (L’oreille casée, Le lotus bleu, Tintin au Tibet, le cycle lunaire). La réflexion reste centrée sur les bandes dessinées occultant les autres supports (dessins animés, films) et l’exploitation commerciale faite de l’œuvre d’Hergé.
Tintin au pays des philosophes se révèle donc être une agréable surprise. Le livre permet d’initier une relecture avec un éclairage supplémentaire. Il permet également d’élargir le débat, tout en remettant à plat certaines polémiques faciles. Une belle découverte donc et surtout un agréable cadeau à faire… ou à recevoir !
D’une manière ou d’une autre, une fois cette lecture achevée, plusieurs autres vont se révéler nécessaires. Il faudra s’attendre à avoir envie de relire les albums du canon, ou à l’inverse de s’intéresser davantage à la philosophie en visant des ouvrages généralistes. Le travail de coordination de Sven Ortoli aura donc fonctionné.
Il est vrai que la démarche peut laisser dubitatif. Plusieurs grands noms de la discipline produisent des articles sur des thèmes tels que la morale, la politique, l’homme, la raison, le rire, l’art. Ils prolongent ainsi une initiative de Michel Serres qui a laissé sceptique Hergé en personne. Certains articles (notamment lorsqu’il est question de Vérité, du rapport au vrai, des médias) donnent l’impression d’être le fruit d’extrapolations assez éloignées du texte. Certains développements sont parfois difficiles à assimiler, comme le recours à un jargon hermétique.
Pourtant l’on s’adapte assez facilement et c’est avec curiosité que l’on découvre cette nouvelle dimension, d’autant qu’un effort de vulgarisation a été consenti. Vous pensiez être dégoûtes de la philosophie ou lassés de Tintin et bien voilà vos certitudes remises en question ! D’autant qu’il n’est pas seulement question d’idées, mais également d’histoire, de symbolique… le propos est riche et immersif. De nombreuses insertions viennent par ailleurs égayer le texte et rappeler des souvenirs.
Tous les auteurs tentent de réhabiliter Hergé aujourd’hui largement critiqué pour plusieurs de ses albums. Ils ne s’en cachent pas et proposent des arguments pertinents, notamment lorsqu’il est question de colonialisme ou de rapport avec l’occupant. Tintin au Congo, donne lieu à une analyse intéressante. Il est regrettable de constater que Tintin en Amérique et Tintin aux pays des Soviets n’en profitent guère.
Des sélections ont été opérées avec un effort visible pour englober la totalité de la geste du reporter à la houppette. Certains albums sont plus longuement commentés que d’autres qui doivent parfois se contenter de simples références. Il est hélas regrettable que les références faites par les différents auteurs concernent également ces albums phares (L’oreille casée, Le lotus bleu, Tintin au Tibet, le cycle lunaire). La réflexion reste centrée sur les bandes dessinées occultant les autres supports (dessins animés, films) et l’exploitation commerciale faite de l’œuvre d’Hergé.
Tintin au pays des philosophes se révèle donc être une agréable surprise. Le livre permet d’initier une relecture avec un éclairage supplémentaire. Il permet également d’élargir le débat, tout en remettant à plat certaines polémiques faciles. Une belle découverte donc et surtout un agréable cadeau à faire… ou à recevoir !
Apprendre avec les autres tout en apprenant soi méme . Voila en gros comment résumer la philosophie de Michel Serres. Cela peut paraitre simple , mais c'est bien plus compliqué a mettre en pratique . Ce livre démontre bien le fait que l'homme ne peut appendre durablement que si il est au contact d'autres desquels il apprend. Comme souvent chez cet auteur il faut y revenir a deux fois pour réelement saisir toutes les subtilités d'un discours passionnant dont l'on ne veut rien manquer .
Le temps des crises est un essai qui analyse l'origine de la crise, qui continue de toucher le monde aujourd'hui.
Michel Serre fait un rappel historique des différentes ruptures qui ont marqué les hommes. Il établit une différence entre crise et rupture, et pour sortir de cette crise, il faut plutôt la voir comme une rupture, à condition que les hommes le comprennent et s'investissent pour cela.
Au cours des siècles, des ruptures ont mis fin à de grandes périodes historiques, et la société a pris une autre chemin, intégrant ces apports. Ces changements se sont multipliés au cours du XXes, de plus en plus rapides, mais les institutions, elles, ne s'adaptent pas, il y a un décalage.
Lorsqu'il y a une crise, il ne faut pas chercher à revenir à la situation antérieure. Sinon, elle se renouvellera de façon cyclique. Il faut intégrer ces changements et prendre une autre direction. c'est pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas revenir à la situation précédente: l'économie, créée par l'homme, a pris le pas, et se conduit comme si nous ne l'avions pas produite, et le monde réel semble vouloir se venger de ce que lui avons fait subir.
Aujourd'hui, le duo hommes-société est confronté à la planète, au monde dans sa globalité (habitants, tectoniques, climats...). Le monde jusqu'à présent était considéré comme un objet dont on ne tenait pas compte. Aujourd'hui, il vient jouer les trublions pour se faire entendre, et devenir sujet des négociations à part entière. Comment la planète peut-elle se faire entendre? Qui peut parler en son nom? Le combat va être difficile car chacun avait l'habitude de voir uniquement devant sa porte, chacun défendait ses propres intérêts, même dans les négociations dites mondiales concernant le climat, l'écologie, la pollution...Des savant ''laïques, jurant de ne servir aucun intérêt militaire et économique''pourront prendre la parole. Cela rappelle les trois catégories de population: ceux qui prient, ceux qui se battent et ceux qui produisent. Ces trois instances peuvent perdurer, modernisées, mais à condition que chacune reste à sa place. L'économie ne doit surtout pas prendre le pas. Ces pourquoi des savants prêtant serment de neutralité vis à vis des lobbies pourront parler au nom de la planète. mais à chacun de s'impliquer.
La réflexion de Michel Serre est ardue, et cela nécessite la création de nouveaux concepts, pour remplacer ceux qui sont démodés. De plus, son style d'écriture, ses tournures de phrases demandent de la concentration. N'ayant pas lu les ouvrages antérieurs de cet auteur, j'ai eu un peu de mal à suivre sa pensée, lorsqu'il fait allusion à des concepts développés dans des livres précédemment publiés. Il fait un rappel de définition, mais j'ai l'impression d'être un peu passée à côté de quelque chose.
Michel Serre fait un rappel historique des différentes ruptures qui ont marqué les hommes. Il établit une différence entre crise et rupture, et pour sortir de cette crise, il faut plutôt la voir comme une rupture, à condition que les hommes le comprennent et s'investissent pour cela.
Au cours des siècles, des ruptures ont mis fin à de grandes périodes historiques, et la société a pris une autre chemin, intégrant ces apports. Ces changements se sont multipliés au cours du XXes, de plus en plus rapides, mais les institutions, elles, ne s'adaptent pas, il y a un décalage.
Lorsqu'il y a une crise, il ne faut pas chercher à revenir à la situation antérieure. Sinon, elle se renouvellera de façon cyclique. Il faut intégrer ces changements et prendre une autre direction. c'est pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas revenir à la situation précédente: l'économie, créée par l'homme, a pris le pas, et se conduit comme si nous ne l'avions pas produite, et le monde réel semble vouloir se venger de ce que lui avons fait subir.
Aujourd'hui, le duo hommes-société est confronté à la planète, au monde dans sa globalité (habitants, tectoniques, climats...). Le monde jusqu'à présent était considéré comme un objet dont on ne tenait pas compte. Aujourd'hui, il vient jouer les trublions pour se faire entendre, et devenir sujet des négociations à part entière. Comment la planète peut-elle se faire entendre? Qui peut parler en son nom? Le combat va être difficile car chacun avait l'habitude de voir uniquement devant sa porte, chacun défendait ses propres intérêts, même dans les négociations dites mondiales concernant le climat, l'écologie, la pollution...Des savant ''laïques, jurant de ne servir aucun intérêt militaire et économique''pourront prendre la parole. Cela rappelle les trois catégories de population: ceux qui prient, ceux qui se battent et ceux qui produisent. Ces trois instances peuvent perdurer, modernisées, mais à condition que chacune reste à sa place. L'économie ne doit surtout pas prendre le pas. Ces pourquoi des savants prêtant serment de neutralité vis à vis des lobbies pourront parler au nom de la planète. mais à chacun de s'impliquer.
La réflexion de Michel Serre est ardue, et cela nécessite la création de nouveaux concepts, pour remplacer ceux qui sont démodés. De plus, son style d'écriture, ses tournures de phrases demandent de la concentration. N'ayant pas lu les ouvrages antérieurs de cet auteur, j'ai eu un peu de mal à suivre sa pensée, lorsqu'il fait allusion à des concepts développés dans des livres précédemment publiés. Il fait un rappel de définition, mais j'ai l'impression d'être un peu passée à côté de quelque chose.
Est-ce que c'était vraiment mieux "avant" ? Face à tous les nostalgiques de ce passé bien fantasmé, Michel Serres parle de cet avant qu'il connaît bien pour y avoir vécu. Il nous montre tous les progrès que notre civilisation a connus dans le vingtième siècle en ce qui concerne par exemple l'hygiène, la santé, l'éducation, la condition féminine, le travail et surtout la paix en Europe.
Certaines personnes trouvent que Michel Serres fait preuve de trop d'optimisme. Peut-être, mais je suis sûr que Michel Serres aime mieux passer pour un incorrigible optimiste que pour un vieux con !
Certaines personnes trouvent que Michel Serres fait preuve de trop d'optimisme. Peut-être, mais je suis sûr que Michel Serres aime mieux passer pour un incorrigible optimiste que pour un vieux con !
Le point de départ de cet opuscule est l'essai Par-delà nature et culture, de Philippe Descola. Si vous avez un peu de temps, je vous conseillerais plutôt de lire celui-là.
En partant des données de l'ethnologie, Descola dégageait quatre grandes classes de manière de penser la relation entre l'être humain et la nature : Totémisme, Animisme, Analogisme et Naturalisme, cette dernière étant en principe notre vision « moderne ». Pour une explication, voir ma critique (pub) ou l'interview au bout du lien que je mets à la suite de cette critique.
Serres oublie l'ethnologie, mais reprend ces quatre classes pour les appliquer à notre monde, et notamment aux pensées des écrivains, savants et philosophes du titre. Il s'emploie à détecter quelle pensée est de type totémiste, laquelle est plutôt de type animiste, etc. L'analogisme semble pour lui la voie la plus féconde (avec une grosse incitation à aller découvrir Leibniz).
Arrivé au Naturalisme, Serres cale. Il n'en voit nulle part. le naturalisme servirait à « ranger » et à « transmettre » les idées, mais n'est en aucun cas une démarche féconde permettant d'en produire. En cela il rejoint, ou fait référence, je pense, à Bruno Latour et à sa démarche de « purification » (voir ma critique à venir de « nous n‘avons jamais été modernes » : deuxième pub).
A part cela, le tour du monde promis dans le titre n'a pas lieu. Serres parle longuement de lui, de son enfance, et fait de multiples références à ses autres bouquins en supposant qu'on les a lus. Est-ce un effet de la célébrité audiovisuelle ? On dirait presque le dernier livre de Nabilla, une certaine préciosité littéraire en plus, académie française oblige.
En partant des données de l'ethnologie, Descola dégageait quatre grandes classes de manière de penser la relation entre l'être humain et la nature : Totémisme, Animisme, Analogisme et Naturalisme, cette dernière étant en principe notre vision « moderne ». Pour une explication, voir ma critique (pub) ou l'interview au bout du lien que je mets à la suite de cette critique.
Serres oublie l'ethnologie, mais reprend ces quatre classes pour les appliquer à notre monde, et notamment aux pensées des écrivains, savants et philosophes du titre. Il s'emploie à détecter quelle pensée est de type totémiste, laquelle est plutôt de type animiste, etc. L'analogisme semble pour lui la voie la plus féconde (avec une grosse incitation à aller découvrir Leibniz).
Arrivé au Naturalisme, Serres cale. Il n'en voit nulle part. le naturalisme servirait à « ranger » et à « transmettre » les idées, mais n'est en aucun cas une démarche féconde permettant d'en produire. En cela il rejoint, ou fait référence, je pense, à Bruno Latour et à sa démarche de « purification » (voir ma critique à venir de « nous n‘avons jamais été modernes » : deuxième pub).
A part cela, le tour du monde promis dans le titre n'a pas lieu. Serres parle longuement de lui, de son enfance, et fait de multiples références à ses autres bouquins en supposant qu'on les a lus. Est-ce un effet de la célébrité audiovisuelle ? On dirait presque le dernier livre de Nabilla, une certaine préciosité littéraire en plus, académie française oblige.
Ce que tient à soulever Michel Serres ici, c'est que la crise actuelle n'est pas seulement économique mais générale : le monde a beaucoup changé depuis quelques années en matière d'environnement, de santé, de démographie,...
Il souligne également l'importance du rôle du "Monde" : la voix de la planète dans les prises de décisions futures, plutôt que la religion, l'armée ou ceux qui détiennent les richesses. Pour lui, les savants doivent parler au nom de la planète afin d'en faire un acteur pour le futur et rappeler que l'homme n'est pas supérieur à la nature.
Une vision intéressante qui fait un rappel sur notre histoire et présentée avec philosophie, ce qui peut rendre la lecture difficile.
Il souligne également l'importance du rôle du "Monde" : la voix de la planète dans les prises de décisions futures, plutôt que la religion, l'armée ou ceux qui détiennent les richesses. Pour lui, les savants doivent parler au nom de la planète afin d'en faire un acteur pour le futur et rappeler que l'homme n'est pas supérieur à la nature.
Une vision intéressante qui fait un rappel sur notre histoire et présentée avec philosophie, ce qui peut rendre la lecture difficile.
Petite Poucette, c'est la jeune fille qui vient d'avoir une vingtaine d'années. Derrière cette expression, Michel Serres crée un nouveau personnage conceptuel. Non pas un être réel, mais un individu représentatif d'une génération et, selon Michel Serres, le premier d'un nouveau type d'humain.
"Petite Poucette", parce que son outil c'est le pouce, celui qui envoie des SMS.
Petite Poucette, la geek, symbolise le nouveau type d'humain qui se fait jour devant nous, celui de la troisième révolution épistémologique humaine. Il y eut l'invention de l'écrit, puis le passage de cet écrit, manuscrit, à l'imprimé et nous observons, maintenant, le passage de l'imprimé à celui du numérique. D'un œil bienveillant et du haut de ses 80 ans Michel Serres reste admiratif d'une génération radicalement différente de celles qui la précède. Une génération naturellement à l'aise avec les nouvelles technologies mais toujours baignée dans un monde dont les institutions sont devenues obsolètes en quelques battements de cils.
Pour nous expliquer cette révolution mentale, Michel Serres file la métaphore de St Denis. St Denis, évêque de Paris, fut condamné à être crucifié au bien-nommé mont des martyrs (Montmartre). Victime de l'impatience du légionnaire sur son chemin de croix, il est décapité avant son arrivée. Miracle ! Il se relève, prend sa tête sous le bras et marche jusqu'à s'effondrer à l'endroit où est édifié en son honneur la basilique qui porte son nom.
En insérant la "révolution numérique" dans un continuum qui montre le changement du rapport à la connaissance, Michel Serres explique que le passage de l'écrit à l'imprimé s'est accompagné d'une transformation de la pédagogie et de la transmission entre les générations : la rareté des manuscrits médiévaux valorisait l'usage quasi exclusif de la mémoire. L'imprimé libéra peu à peu l'homme du besoin de mémoire : "il vaut mieux une tête bien faite que bien pleine" affirma Montaigne, observateur de ce changement. Michel Serres pointe la disparition des localisations physiques et institutionnelles du savoir : la page, le livre, la salle de classe, l'université et le professeur lui-même. Le savoir est désormais partout, il n'est plus besoin d'être localisé dans la tête de Petite Poucette, il est accessible partout, tout le temps, pour tous. Le savoir est en face de soi (et non plus dans la tête, d'où la métaphore de St Denis) dans l'écran, telle une tête posée.
Et Michel Serres d'analyser, au fil des trois chapitres qui composent ce court essai, toutes les inadéquations des institutions qui gouvernent notre monde au regard des réalités en œuvre, et en acte. De pointer le désarroi des enseignants qui s'échinent tels de modernes Don Quichotte à ânonner de caducs enseignements tirés de livres périmés avant même d'être secs. De relever nos réticences comme autant d'enracinements inutiles qui nous empêchent de voir le monde tel qu'il est, et nous installent dans la posture d'un "c'était mieux avant" réactionnaire et illusoire. Alors que la vie, mobile et évanescente que nous propose le monde qui vient doit nous inciter à faire confiance à ces jeunes qui le connaissent déjà presque mieux que nous.
Ce que j'aime avec le texte de Michel Serres, c'est qu'il m'aide à me libérer du "vieux con" qui sommeille en chacun de nous. Et surtout en moi.
La question du savoir et des nouvelles technologies traduit en ce sens la migration d'un débat qui a agité le monde de l'éducation il y a une quinzaine d'années : l'affrontement entre "pédagogues" (Meirieu, De Vecchi etc.) et "humanistes" (De Romilly, Finkelkraut etc.). Les premiers sont les initiateurs du mouvement qui souhaite mettre l'élève au centre de l'école, alors que les seconds critiquent vivement cette position estimant que c'est le savoir qui est au milieu de l'école. Pour ces derniers, le savoir est à conquérir et à s'approprier telle une montagne à gravir (avec tout un discours de valorisation de l'effort). Les pédagogues estiment que pour conquérir ce savoir, les inégalités de toutes natures entre les élèves imposent au système éducatif de placer l'élève et ses modes d'appropriation du savoir au centre du travail scolaire afin de permettre à tous d'apprendre. Ils reprennent en ce sens les critiques initiées par Bourdieu et Passeron qui visaient à montrer que le savoir est socialement normé, que le système scolaire est loin d'être équitable en ce qu'il favorise et institutionnalise les distinctions sociales qu'il inscrit dans le marbre scolaire.
Bien sûr les deux positions ont raison mais n'auraient jamais accepté de le reconnaitre.
Les humanistes ont toujours refusé de reconnaitre la discrimination qu'organisait le système scolaire. Il est difficile à un bon élève de reconnaitre que le fruit de sa réussite est en partie, sociologiquement et institutionnellement organisée.
Les pédagogues, dans leur grande entreprise de démolition des structures de reproduction sociale à l’œuvre au sein de l'école, ont jargonné à l'excès et ont imputé essentiellement à l'école le devoir de transformation et non plus à l'élève. Il fallait en quelque sorte que le savoir s'adapte à l'élève et surtout à l'enfant. À l'extrême cela niait le pouvoir émancipateur du savoir, l'élève étant enfermé dans les inégalités qui conditionneraient son destin scolaire.
Pourquoi cette longue explication ? Parce que le texte de Michel Serres traduit l'évolution de ce débat qui agite toujours l'éducation nationale.
Derrière un texte très écrit, elliptique et lapidaire par moment, à la fois limpide et abscons (la deuxième moitié de l'ouvrage laisse assez perplexe), Michel Serres délivre un message très ambigu.
Férocement critique envers toutes les générations qui précèdent la génération Y, Michel Serres brosse un portrait idyllique de cette génération qui n'aurait plus besoin d'apprendre vu que le savoir est déjà accessible. Que l'énervement des vieux (cons) envers eux est archaïque. Mais au delà des critiques entre générations, qui visent d'abord à déconstruire le système de pensée du lecteur (Petite Poucette lira-t-elle le livre de Michel Serres ? pas sûr...), l'auteur reprend les arguments des pédagogues. Si le débat des années 1980-1990 visait à transformer l'école dans ses orientations, les promoteurs du numérique dans la pédagogie visent directement à une dissolution des structures de l'école. Le texte de Michel Serres propose la disparition même de l'école.
Mais surtout le point qui me semble le plus problématique dans Petite Poucette est la conception du rapport au savoir que valorise Michel Serres. En plaçant le savoir à l'extérieur de l'individu, comme un étant là, bref, en le réduisant à wikipédia, dans tout son texte, Michel Serres méconnait le pouvoir transformateur du savoir. Le savoir n'est pas quelque chose d'extérieur à l'individu. Il confond data et savoir, qu'il faut probablement écrire avec une majuscule. Le savoir transforme l'individu, l'émancipe. Le savoir, c'est d'abord un savoir-être et non une collection d'information. Le savoir c'est ce qui in-forme l'individu.
En ce sens, la position de Michel Serres cumule les pires des arguments des pédagogues et des humanistes. Elle externalise le savoir comme les humanistes le faisaient. En lui enlevant son pouvoir émancipateur, elle s'attache à la valeur de l'individu comme les pédagogues mais elle lui retire l'objectif de l'appropriation du savoir (que les pédagogues gardaient toujours en ligne de mire, même si les humanistes faisaient semblaient de l'ignorer dans leurs plus virulentes critiques).
Pire, la métaphore de St Denis est somme toute assez problématique. Les jeunes sont décapités. La métaphore du martyr céphalophore est très mal trouvée (je ne suis pas sûr que Michel Serres ait réellement mesuré ce qui est avant tout un gigantesque lapsus). Qu'en sera-t-il lorsque les écrans sont éteints ? Qu'en est-il du sens critique de chacun, lorsqu'il est attaché à ses chaines numériques ?
Car Michel Serres ne propose finalement que le modèle d'un utilisateur du savoir et non d'un producteur du savoir. Il ne montre qu'un usager, un consommateur de média, telle une boite à remplir et à vider.
Mais qui contrôle les tuyaux, les accès, les péages ?
Ceux qui continueront d'aller dans les écoles les plus sélectives, où le numérique est ramené à sa juste mesure. Un outil. Un outil en plus et non pas à la place des autres comme le promeut Michel Serres. Ceux qui contrôleront iront à Stanford, là ou Michel Serres enseigne à plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. Mais pas tous les autres qui n'auront qu'une école du clic où le savoir n'est plus construit et intégré, mais des écoles numériques où la fascination de l'outil aura fait oublier le vrai sens de l’École : l'émancipation de l'individu.
Michel Serres annonce, dans un texte somme toute assez manipulateur, les pires promesses de Gérard de Sélys et Nico Hirtt dans leur Tableau noir. La numérisation avancée de l'école alors qu'elle n'était que spéculative lors de l'écriture de ce livre est devenu réalité une quinzaine d'années plus tard, elle est même l'incarnation de la continuité des objectifs de l'éducation nationale indépendamment des ministres et des majorités. Pire, le texte de Michel Serres les justifie et interdit toute critique dans son tableau idyllique d'une jeunesse que l'on doit cesser d'instruire au non de l'archaïsme supposé de toute forme d'enseignement...
A la fin, je n'aime pas ce texte.
Lien : http://leslecturesdecyril.bl..
"Petite Poucette", parce que son outil c'est le pouce, celui qui envoie des SMS.
Petite Poucette, la geek, symbolise le nouveau type d'humain qui se fait jour devant nous, celui de la troisième révolution épistémologique humaine. Il y eut l'invention de l'écrit, puis le passage de cet écrit, manuscrit, à l'imprimé et nous observons, maintenant, le passage de l'imprimé à celui du numérique. D'un œil bienveillant et du haut de ses 80 ans Michel Serres reste admiratif d'une génération radicalement différente de celles qui la précède. Une génération naturellement à l'aise avec les nouvelles technologies mais toujours baignée dans un monde dont les institutions sont devenues obsolètes en quelques battements de cils.
Pour nous expliquer cette révolution mentale, Michel Serres file la métaphore de St Denis. St Denis, évêque de Paris, fut condamné à être crucifié au bien-nommé mont des martyrs (Montmartre). Victime de l'impatience du légionnaire sur son chemin de croix, il est décapité avant son arrivée. Miracle ! Il se relève, prend sa tête sous le bras et marche jusqu'à s'effondrer à l'endroit où est édifié en son honneur la basilique qui porte son nom.
En insérant la "révolution numérique" dans un continuum qui montre le changement du rapport à la connaissance, Michel Serres explique que le passage de l'écrit à l'imprimé s'est accompagné d'une transformation de la pédagogie et de la transmission entre les générations : la rareté des manuscrits médiévaux valorisait l'usage quasi exclusif de la mémoire. L'imprimé libéra peu à peu l'homme du besoin de mémoire : "il vaut mieux une tête bien faite que bien pleine" affirma Montaigne, observateur de ce changement. Michel Serres pointe la disparition des localisations physiques et institutionnelles du savoir : la page, le livre, la salle de classe, l'université et le professeur lui-même. Le savoir est désormais partout, il n'est plus besoin d'être localisé dans la tête de Petite Poucette, il est accessible partout, tout le temps, pour tous. Le savoir est en face de soi (et non plus dans la tête, d'où la métaphore de St Denis) dans l'écran, telle une tête posée.
Et Michel Serres d'analyser, au fil des trois chapitres qui composent ce court essai, toutes les inadéquations des institutions qui gouvernent notre monde au regard des réalités en œuvre, et en acte. De pointer le désarroi des enseignants qui s'échinent tels de modernes Don Quichotte à ânonner de caducs enseignements tirés de livres périmés avant même d'être secs. De relever nos réticences comme autant d'enracinements inutiles qui nous empêchent de voir le monde tel qu'il est, et nous installent dans la posture d'un "c'était mieux avant" réactionnaire et illusoire. Alors que la vie, mobile et évanescente que nous propose le monde qui vient doit nous inciter à faire confiance à ces jeunes qui le connaissent déjà presque mieux que nous.
Ce que j'aime avec le texte de Michel Serres, c'est qu'il m'aide à me libérer du "vieux con" qui sommeille en chacun de nous. Et surtout en moi.
La question du savoir et des nouvelles technologies traduit en ce sens la migration d'un débat qui a agité le monde de l'éducation il y a une quinzaine d'années : l'affrontement entre "pédagogues" (Meirieu, De Vecchi etc.) et "humanistes" (De Romilly, Finkelkraut etc.). Les premiers sont les initiateurs du mouvement qui souhaite mettre l'élève au centre de l'école, alors que les seconds critiquent vivement cette position estimant que c'est le savoir qui est au milieu de l'école. Pour ces derniers, le savoir est à conquérir et à s'approprier telle une montagne à gravir (avec tout un discours de valorisation de l'effort). Les pédagogues estiment que pour conquérir ce savoir, les inégalités de toutes natures entre les élèves imposent au système éducatif de placer l'élève et ses modes d'appropriation du savoir au centre du travail scolaire afin de permettre à tous d'apprendre. Ils reprennent en ce sens les critiques initiées par Bourdieu et Passeron qui visaient à montrer que le savoir est socialement normé, que le système scolaire est loin d'être équitable en ce qu'il favorise et institutionnalise les distinctions sociales qu'il inscrit dans le marbre scolaire.
Bien sûr les deux positions ont raison mais n'auraient jamais accepté de le reconnaitre.
Les humanistes ont toujours refusé de reconnaitre la discrimination qu'organisait le système scolaire. Il est difficile à un bon élève de reconnaitre que le fruit de sa réussite est en partie, sociologiquement et institutionnellement organisée.
Les pédagogues, dans leur grande entreprise de démolition des structures de reproduction sociale à l’œuvre au sein de l'école, ont jargonné à l'excès et ont imputé essentiellement à l'école le devoir de transformation et non plus à l'élève. Il fallait en quelque sorte que le savoir s'adapte à l'élève et surtout à l'enfant. À l'extrême cela niait le pouvoir émancipateur du savoir, l'élève étant enfermé dans les inégalités qui conditionneraient son destin scolaire.
Pourquoi cette longue explication ? Parce que le texte de Michel Serres traduit l'évolution de ce débat qui agite toujours l'éducation nationale.
Derrière un texte très écrit, elliptique et lapidaire par moment, à la fois limpide et abscons (la deuxième moitié de l'ouvrage laisse assez perplexe), Michel Serres délivre un message très ambigu.
Férocement critique envers toutes les générations qui précèdent la génération Y, Michel Serres brosse un portrait idyllique de cette génération qui n'aurait plus besoin d'apprendre vu que le savoir est déjà accessible. Que l'énervement des vieux (cons) envers eux est archaïque. Mais au delà des critiques entre générations, qui visent d'abord à déconstruire le système de pensée du lecteur (Petite Poucette lira-t-elle le livre de Michel Serres ? pas sûr...), l'auteur reprend les arguments des pédagogues. Si le débat des années 1980-1990 visait à transformer l'école dans ses orientations, les promoteurs du numérique dans la pédagogie visent directement à une dissolution des structures de l'école. Le texte de Michel Serres propose la disparition même de l'école.
Mais surtout le point qui me semble le plus problématique dans Petite Poucette est la conception du rapport au savoir que valorise Michel Serres. En plaçant le savoir à l'extérieur de l'individu, comme un étant là, bref, en le réduisant à wikipédia, dans tout son texte, Michel Serres méconnait le pouvoir transformateur du savoir. Le savoir n'est pas quelque chose d'extérieur à l'individu. Il confond data et savoir, qu'il faut probablement écrire avec une majuscule. Le savoir transforme l'individu, l'émancipe. Le savoir, c'est d'abord un savoir-être et non une collection d'information. Le savoir c'est ce qui in-forme l'individu.
En ce sens, la position de Michel Serres cumule les pires des arguments des pédagogues et des humanistes. Elle externalise le savoir comme les humanistes le faisaient. En lui enlevant son pouvoir émancipateur, elle s'attache à la valeur de l'individu comme les pédagogues mais elle lui retire l'objectif de l'appropriation du savoir (que les pédagogues gardaient toujours en ligne de mire, même si les humanistes faisaient semblaient de l'ignorer dans leurs plus virulentes critiques).
Pire, la métaphore de St Denis est somme toute assez problématique. Les jeunes sont décapités. La métaphore du martyr céphalophore est très mal trouvée (je ne suis pas sûr que Michel Serres ait réellement mesuré ce qui est avant tout un gigantesque lapsus). Qu'en sera-t-il lorsque les écrans sont éteints ? Qu'en est-il du sens critique de chacun, lorsqu'il est attaché à ses chaines numériques ?
Car Michel Serres ne propose finalement que le modèle d'un utilisateur du savoir et non d'un producteur du savoir. Il ne montre qu'un usager, un consommateur de média, telle une boite à remplir et à vider.
Mais qui contrôle les tuyaux, les accès, les péages ?
Ceux qui continueront d'aller dans les écoles les plus sélectives, où le numérique est ramené à sa juste mesure. Un outil. Un outil en plus et non pas à la place des autres comme le promeut Michel Serres. Ceux qui contrôleront iront à Stanford, là ou Michel Serres enseigne à plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. Mais pas tous les autres qui n'auront qu'une école du clic où le savoir n'est plus construit et intégré, mais des écoles numériques où la fascination de l'outil aura fait oublier le vrai sens de l’École : l'émancipation de l'individu.
Michel Serres annonce, dans un texte somme toute assez manipulateur, les pires promesses de Gérard de Sélys et Nico Hirtt dans leur Tableau noir. La numérisation avancée de l'école alors qu'elle n'était que spéculative lors de l'écriture de ce livre est devenu réalité une quinzaine d'années plus tard, elle est même l'incarnation de la continuité des objectifs de l'éducation nationale indépendamment des ministres et des majorités. Pire, le texte de Michel Serres les justifie et interdit toute critique dans son tableau idyllique d'une jeunesse que l'on doit cesser d'instruire au non de l'archaïsme supposé de toute forme d'enseignement...
A la fin, je n'aime pas ce texte.
Lien : http://leslecturesdecyril.bl..
J'étais curieuse, j'ai lu Petite Poucette, je suis déçue, ce n'est rien... Et je rejoins nastie92 sur sa critique. Inutile de passer plus de temps, tout ce qu'elle en dit me convient parfaitement.
L'art de s'écouter parler...
.
A en croire les médias, la jeunesse actuelle semble échapper à notre compréhension. Génération Y, hyper connectée à Facebook et rivée à son smartphone, la génération des 15-25 ans est présentée comme un monstre à deux têtes effrayant car inconnu et indomptable. Alors quand un grand penseur de notre époque nous propose de la décoder, on applaudit. Avant de s’endormir, bercé par la logorrhée de Michel Serres.
.
Pourtant ça commençait bien : dans la première partie, Michel Serres est à fond dans son sujet, enthousiaste pour cette jeunesse de tous les possibles. Le monde à changé en cinquante ans, les jeunes doivent tout réinventer et ils ne s’en sortent a priori pas si mal. Nous voilà réconciliés avec la nouvelle génération, prêts à remiser aux placards nos « de mon temps, c’était pas comme ça ». L’auteur nous décrit une société pleine de perspective, et en ce sens rejoint l’analyse de Jean-Louis Servan Schreiber dans Aimer (quand même) le XXIè siècle. Ils sont en phase, c’est rassurant.
.
Qu’est-il arrivé à Michel Serres dès la deuxième partie, traitant d’un sujet sérieux : l’école? Le voilà parti dans un lyrisme complètement inapproprié qui ne le quittera plus pendant les 70 pages qui restent à lire. Et appréhender des phénomènes de société, les décrypter, les comprendre et les analyser nécessite un langage un peu plus précis et terre-à-terre que la prose incontrôlée qui s’empare de la plume de l’auteur. C’est terrible, l’essai devient illisible, l’agacement le dispute à la déception face au sentiment que Michel Serres, finalement, se gargarise de ses envolées pseudo-poétiques.
Lien : http://litteratureetchocolat..
.
A en croire les médias, la jeunesse actuelle semble échapper à notre compréhension. Génération Y, hyper connectée à Facebook et rivée à son smartphone, la génération des 15-25 ans est présentée comme un monstre à deux têtes effrayant car inconnu et indomptable. Alors quand un grand penseur de notre époque nous propose de la décoder, on applaudit. Avant de s’endormir, bercé par la logorrhée de Michel Serres.
.
Pourtant ça commençait bien : dans la première partie, Michel Serres est à fond dans son sujet, enthousiaste pour cette jeunesse de tous les possibles. Le monde à changé en cinquante ans, les jeunes doivent tout réinventer et ils ne s’en sortent a priori pas si mal. Nous voilà réconciliés avec la nouvelle génération, prêts à remiser aux placards nos « de mon temps, c’était pas comme ça ». L’auteur nous décrit une société pleine de perspective, et en ce sens rejoint l’analyse de Jean-Louis Servan Schreiber dans Aimer (quand même) le XXIè siècle. Ils sont en phase, c’est rassurant.
.
Qu’est-il arrivé à Michel Serres dès la deuxième partie, traitant d’un sujet sérieux : l’école? Le voilà parti dans un lyrisme complètement inapproprié qui ne le quittera plus pendant les 70 pages qui restent à lire. Et appréhender des phénomènes de société, les décrypter, les comprendre et les analyser nécessite un langage un peu plus précis et terre-à-terre que la prose incontrôlée qui s’empare de la plume de l’auteur. C’est terrible, l’essai devient illisible, l’agacement le dispute à la déception face au sentiment que Michel Serres, finalement, se gargarise de ses envolées pseudo-poétiques.
Lien : http://litteratureetchocolat..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Michel Serres
Quiz
Voir plus
Michel Serres nous manque déjà...
Certains les nomment génération Y ou "digital natives", les jeunes, (nouvelles ?), générations nous battent à plate couture devant un écran. Moi j'ai préféré les désigner sous le terme générique de ........?........
petite poucette
les pouces en or
petit poucet
poucez vous de là
10 questions
95 lecteurs ont répondu
Thème :
Michel SerresCréer un quiz sur cet auteur95 lecteurs ont répondu