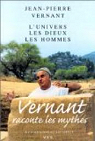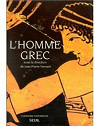Citations de Jean-Pierre Vernant (80)
La naissance de la philosophie apparaît donc solidaire de deux grandes transformations mentales: une pensée positive, excluant toute forme de surnaturel et rejetant l'assimilation implicite établie par le mythe entre phénomèmes physiques et agents divins; une pensée abstraite , dépouillant la réalité de cette puissance de changement que lui prétait le mythe, et récusant l'antique image de l'union des opposés au profit d'une formation catégorique du principe d'identité.
Aujourd’hui encore, un poème n’a d’existence que s’il est parlé : il faut le connaitre par cœur et, pour lui donner vie, le réciter avec les mots silencieux de la parole intérieure.
Le récit mythique ne relève pas de l'invention individuelle ni de la fantaisie créatrice, mais de la transmission et de la mémoire.
P.10 Avant-propos
P.10 Avant-propos
Les histoires concernant Dionysos prennent un sens un peu particulier quand on réfléchit à cette tension entre le vagabondage, l'errance, le fait d'être toujours de passage, en chemin, voyageur, et le fait de vouloir un chez-soi, où l'on soit bien à sa place, établi, où l'on ait été plus qu'accepté: choisi.
[Charles Segal, "L'homme grec, spectateur et auditeur"]
Platon suggère dans le Philèbe que la vie est comédie ou tragédie (50b), ce qui est peut-être la première formulation dans la littérature occidentale de l'analogie du monde et de la scène, rendue célèbre par les propos désabusés de Jacques dans "Comme il vous plaira" de Shakespeare (II-7) . "Chacun de nous est un théâtre suffisamment grand pour les autres", observait Epicure (cité par Sénèque, Lettres VII-11). La version la plus grandiose est celle du "Longin", qui, dans son traité "Du Sublime", datant peut-être de la fin du I°s ap. J.-C., compare l'univers entier à une vaste représentation : l'homme y assiste en spectateur privilégié, et y reconnaît la grandeur à laquelle le destine la portée infinie de son esprit (35).
Ce passage, très influencé par le stoïcisme platonisant, attribue en fait à l'humanité ce qui dans la pensée grecque archaïque et classique est la prérogative des dieux : regarder de l'extérieur les luttes et les souffrances de la vie humaine. C'est aussi ce que fait le sage, serein comme un dieu, dans la philosophie épicurienne (Lucrèce, De rerum natura, II-1-13). Tant avec l'épopée qu'avec la tragédie, le public partage un peu ce point de vue privilégié - au figuré dans le premier cas puisque le narrateur, ce tiers omniscient, nous met dans dans le secret de ce que les dieux voient et savent, plus littéralement dans le second puisque nous sommes assis au-dessus de l'action et la regardons d'en-haut d'une distance quasi-olympienne, sinon avec un détachement olympien. Dans l'épopée comme dans la tragédie, le spectacle de la souffrance humaine ne fait que renforcer notre conscience des limites qui enserrent la condition mortelle. La vision philosophique, elle, se donne préalablement pour but de transcender lesdites limites.
pp. 258-259
Platon suggère dans le Philèbe que la vie est comédie ou tragédie (50b), ce qui est peut-être la première formulation dans la littérature occidentale de l'analogie du monde et de la scène, rendue célèbre par les propos désabusés de Jacques dans "Comme il vous plaira" de Shakespeare (II-7) . "Chacun de nous est un théâtre suffisamment grand pour les autres", observait Epicure (cité par Sénèque, Lettres VII-11). La version la plus grandiose est celle du "Longin", qui, dans son traité "Du Sublime", datant peut-être de la fin du I°s ap. J.-C., compare l'univers entier à une vaste représentation : l'homme y assiste en spectateur privilégié, et y reconnaît la grandeur à laquelle le destine la portée infinie de son esprit (35).
Ce passage, très influencé par le stoïcisme platonisant, attribue en fait à l'humanité ce qui dans la pensée grecque archaïque et classique est la prérogative des dieux : regarder de l'extérieur les luttes et les souffrances de la vie humaine. C'est aussi ce que fait le sage, serein comme un dieu, dans la philosophie épicurienne (Lucrèce, De rerum natura, II-1-13). Tant avec l'épopée qu'avec la tragédie, le public partage un peu ce point de vue privilégié - au figuré dans le premier cas puisque le narrateur, ce tiers omniscient, nous met dans dans le secret de ce que les dieux voient et savent, plus littéralement dans le second puisque nous sommes assis au-dessus de l'action et la regardons d'en-haut d'une distance quasi-olympienne, sinon avec un détachement olympien. Dans l'épopée comme dans la tragédie, le spectacle de la souffrance humaine ne fait que renforcer notre conscience des limites qui enserrent la condition mortelle. La vision philosophique, elle, se donne préalablement pour but de transcender lesdites limites.
pp. 258-259
Ulysse ne résiste pas au plaisir de la vantardise et de la vanité. Il lui crie : "Cyclope, si on te demande qui a aveuglé ton œil, dis que c’est Ulysse, fils de Laërte, Ulysse d’Ithaque, le pilleur de ville, le vainqueur de Troie, Ulysse aux mille tours ?" Naturellement, quand on crache en l’air, cela vous retombe sur le nez.
" Se vouloir immortel, c'est en partie, accepter de perdre la vie avant même de l'avoir pleinement vécue."
Exemplaire, le destin d’Achille est marqué du sceau de l’ambiguïté. D’origine à moitié humaine, à moitié divine, il ne peut être entièrement ni d’un côté ni de l’autre.
Au seuil de sa vie, dès ses premiers pas, la route sur laquelle il doit s’avancer bifurque. Quelle que soit la direction qu’il va choisir de prendre, il lui faudra, en la suivant, renoncer à une part essentielle de lui-même. Il ne peut à la fois jouir de ce que l’existence à la lumière du soleil offre de plus doux aux humains, et assurer à sa personne le privilège de n’en être jamais privé, de ne pas mourir. Jouir de la vie, ce bien le plus précieux pour des créatures éphémères, ce bien unique, incomparable parce que le seul, une fois perdu, à ne pouvoir se retrouver, c’est renoncer à tout espoir d’immortalité. Se vouloir immortel, c’est, en partie, accepter de perdre la vie avant même de l’avoir pleinement vécue.
Au seuil de sa vie, dès ses premiers pas, la route sur laquelle il doit s’avancer bifurque. Quelle que soit la direction qu’il va choisir de prendre, il lui faudra, en la suivant, renoncer à une part essentielle de lui-même. Il ne peut à la fois jouir de ce que l’existence à la lumière du soleil offre de plus doux aux humains, et assurer à sa personne le privilège de n’en être jamais privé, de ne pas mourir. Jouir de la vie, ce bien le plus précieux pour des créatures éphémères, ce bien unique, incomparable parce que le seul, une fois perdu, à ne pouvoir se retrouver, c’est renoncer à tout espoir d’immortalité. Se vouloir immortel, c’est, en partie, accepter de perdre la vie avant même de l’avoir pleinement vécue.
L’un des traits de l’existence humaine c’est la dissociation entre les apparences de ce qui se laisse voir, se laisse entendre, et puis les réalités.
Un monde divin multiple, divisé par conséquent au-dedans de lui-même par la pluralité des êtres qui le composent ; des dieux dont chacun, ayant son nom propre, son corps singulier, connaît une forme d'existence limitée et particulière : cette conception n'a pas manqué de susciter, dans certains courants religieux marginaux, dans des milieux de sectes et chez des philosophes, interrogations, réserves ou refus. Ces réticences, qui se sont exprimées de façons fort diverses, procèdent d'une même conviction : la présence du mal, du malheur, de la négativité dans le monde tient au processus d'individuation auquel il a été soumis et qui a donné naissance à des êtres séparés, isolés, singuliers. La perfection, la plénitude, l'éternité sont les attributs de l'Être totalement unifié. Toute fragmentation de l'Un, tout éparpillement de l'Être, toute distinction de parties signifient que la mort entre en scène avec l'apparition conjointe d'une multiplicité d'existences individualisées et de la finitude qui nécessairement borne chacune d'elle. Pour accéder à la non-mort, pour s'accomplir dans la permanence de leur perfection, les dieux de l'Olympe devraient donc renoncer à leur corps singulier, se fondre dans l'unité d'un grand dieu cosmique ou s'absorber dans la personne du dieu morcelé, puis réunifié par Apollon, du Dionysos orphique, garant du retour à l'indistinction primordiale, de la reconquête d'une unité divine qui doit être retrouvée, après avoir été perdue.
En rejetant catégoriquement cette perspective pour placer l'accompli, le parfait, l'immuable, non dans la confusion de l'unité originelle, dans l'obscure indistinction du chaos, mais à l'inverse, dans l'ordre différencié d'un cosmos dont les parties et éléments constitutifs se sont peu à peu égarés, délimités, mis en place et où les puissances divines, d'abord incluses dans de vagues forces cosmiques, ont pris, à la troisième génération, leur forme définie et définitive de dieux célestes, vivant dans la lumière constante de l'éther, avec leur personnalité et leur figure particulières, leurs fonctions articulées les unes aux autres, leurs pouvoirs s'équilibrant et s'ajustant sous l'autorité inébranlable de Zeus, la Théogonie orthodoxe d'Hésiode donne à la nature corporelle des dieux son fondement théologique : si les dieux possèdent plénitude, perfection, inaltérabilité, c'est qu'au terme de ce progrès qui a conduit à l'émergence d'un cosmos stable, organisé, harmonieux, chaque personne divine a désormais son individualité clairement fixée.
En rejetant catégoriquement cette perspective pour placer l'accompli, le parfait, l'immuable, non dans la confusion de l'unité originelle, dans l'obscure indistinction du chaos, mais à l'inverse, dans l'ordre différencié d'un cosmos dont les parties et éléments constitutifs se sont peu à peu égarés, délimités, mis en place et où les puissances divines, d'abord incluses dans de vagues forces cosmiques, ont pris, à la troisième génération, leur forme définie et définitive de dieux célestes, vivant dans la lumière constante de l'éther, avec leur personnalité et leur figure particulières, leurs fonctions articulées les unes aux autres, leurs pouvoirs s'équilibrant et s'ajustant sous l'autorité inébranlable de Zeus, la Théogonie orthodoxe d'Hésiode donne à la nature corporelle des dieux son fondement théologique : si les dieux possèdent plénitude, perfection, inaltérabilité, c'est qu'au terme de ce progrès qui a conduit à l'émergence d'un cosmos stable, organisé, harmonieux, chaque personne divine a désormais son individualité clairement fixée.
[Le citoyen, Luciano Canfora]
Un Grec d'Asie comme Hérodote, qui avait une remarquable connaissance du monde perse, a pourtant essayé de montrer (mais, ainsi qu'il le fait remarquer, "on ne l'a pas cru") qu'en Perse aussi, à la mort de Cambyse, (à un moment donc où Athènes est encore gouvernée par les fils de Pisistrate), on prit en considération l'hypothèse démocratique consistant à "mettre la politique en commun" ( Ὀτάνης μὲν ἐκέλευε ἐς μέσον Πέρσῃσι καταθεῖναι τὰ πρήγματα - ... es meson ... katatheinai ta prègmata ) - selon ses termes (III,80). Hérodote rappelle aussi que, lorsque Darius marchait sur la Grèce en 492, Mardonios, son parent et collaborateur dans cette entreprise, "abattait les tyrans de l'Ionie et instaurait des démocraties dans les villes" (VI, 43), tandis qu'il longeait l'Ionie en direction de l'Hellespont. Hérodote craint à ce sujet également l'incrédulité des Grecs, puisque ceux-ci "n'ont pas cru que [lors de la crise qui suivit la mort de Cambyse] Otanès avait proposé aux Perses un régime démocratique."
On ne voit pas pourquoi on ne croirait pas Hérodote. Il apporte là toute une série de précieuses notions qui permettent de rapprocher largement les Grecs des Perses : deux mondes entre lesquels la représentation idéologique que les Grecs ont donnée d'eux-mêmes a creusé un abîme, mais qui étaient, dans la pratique concrète, très voisins et entremêlés, et cela jusque dans leur expérience politique. En témoigne le naturel avec lequel des hommes politiques tels que Thémistocle, Alcibiade et Lysandre sont entrés en relation avec le monde perse ; il en fut de même, avant eux, pour les Alcméonides, bien qu'Hérodote s'efforce de mettre un pudique voile patriotique sur cette affaire (V, 71-73, VI, 115 et 121-124). On peut donc sans risque penser que le langage employé par Otanès (hypothèse démocratique), Mégabyze (hypothèse oligarchique) et Darius (hypothèse monarchique, celle qui a triomphé) dans le débat constitutionnel contrasté qui les oppose dans Hérodote était également familier aux notables perses cultivés, et en relevait pas exclusivement de l'expérience politique grecque.
pp. 149-150
Un Grec d'Asie comme Hérodote, qui avait une remarquable connaissance du monde perse, a pourtant essayé de montrer (mais, ainsi qu'il le fait remarquer, "on ne l'a pas cru") qu'en Perse aussi, à la mort de Cambyse, (à un moment donc où Athènes est encore gouvernée par les fils de Pisistrate), on prit en considération l'hypothèse démocratique consistant à "mettre la politique en commun" ( Ὀτάνης μὲν ἐκέλευε ἐς μέσον Πέρσῃσι καταθεῖναι τὰ πρήγματα - ... es meson ... katatheinai ta prègmata ) - selon ses termes (III,80). Hérodote rappelle aussi que, lorsque Darius marchait sur la Grèce en 492, Mardonios, son parent et collaborateur dans cette entreprise, "abattait les tyrans de l'Ionie et instaurait des démocraties dans les villes" (VI, 43), tandis qu'il longeait l'Ionie en direction de l'Hellespont. Hérodote craint à ce sujet également l'incrédulité des Grecs, puisque ceux-ci "n'ont pas cru que [lors de la crise qui suivit la mort de Cambyse] Otanès avait proposé aux Perses un régime démocratique."
On ne voit pas pourquoi on ne croirait pas Hérodote. Il apporte là toute une série de précieuses notions qui permettent de rapprocher largement les Grecs des Perses : deux mondes entre lesquels la représentation idéologique que les Grecs ont donnée d'eux-mêmes a creusé un abîme, mais qui étaient, dans la pratique concrète, très voisins et entremêlés, et cela jusque dans leur expérience politique. En témoigne le naturel avec lequel des hommes politiques tels que Thémistocle, Alcibiade et Lysandre sont entrés en relation avec le monde perse ; il en fut de même, avant eux, pour les Alcméonides, bien qu'Hérodote s'efforce de mettre un pudique voile patriotique sur cette affaire (V, 71-73, VI, 115 et 121-124). On peut donc sans risque penser que le langage employé par Otanès (hypothèse démocratique), Mégabyze (hypothèse oligarchique) et Darius (hypothèse monarchique, celle qui a triomphé) dans le débat constitutionnel contrasté qui les oppose dans Hérodote était également familier aux notables perses cultivés, et en relevait pas exclusivement de l'expérience politique grecque.
pp. 149-150
[Guerre et paix]
... la paix n'est considérée que sous un angle personnel, hédoniste et, pourrait-on dire, existentiel, sans aucune considération de caractère proprement humanitaire et sans aucun désir de voir changer sur ce point les bases de la société ou la nature de l'homme. Elle n'est que le point d'aboutissement, particulièrement délectable, qui doit couronner les épreuves guerrières. Elle correspond au moment où le paysan a le plaisir d'engranger et de consommer les fruits de ses durs travaux. Une telle conception n'ôte donc rien à la nécessité, à la rationalité et à la grandeur de la guerre ; elle tend au contraire à la justifier en lui assignant comme fin dernière le bonheur.
Yvon Garlan, "L'homme et la guerre", p. 68.
... la paix n'est considérée que sous un angle personnel, hédoniste et, pourrait-on dire, existentiel, sans aucune considération de caractère proprement humanitaire et sans aucun désir de voir changer sur ce point les bases de la société ou la nature de l'homme. Elle n'est que le point d'aboutissement, particulièrement délectable, qui doit couronner les épreuves guerrières. Elle correspond au moment où le paysan a le plaisir d'engranger et de consommer les fruits de ses durs travaux. Une telle conception n'ôte donc rien à la nécessité, à la rationalité et à la grandeur de la guerre ; elle tend au contraire à la justifier en lui assignant comme fin dernière le bonheur.
Yvon Garlan, "L'homme et la guerre", p. 68.
J’aimerais mieux être le dernier des paysans boueux, lamentables, dans le fumier, le plus pauvre vivant à la lumière du soleil qu’être Achille dans ce monde de ténèbres qu’est l’Hadès.
Cette conception agonistique de l'homme , des relations sociales , des forces naturelles , a des racines profondes non seulement dans l'éthos héroïque propre à l'épopée , mais dans des pratiques institutionelles où nous pouvons reconnaître comme la préhistoire de cette guerre "politique " que mènent les citées .
Comme si, dans la mesure où un groupe humain refuse de reconnaître l'autre, de lui faire sa part, c'est ce groupe lui-même qui devenait monstrueusement autre
P.191 Dionysos à Thèbes.
P.191 Dionysos à Thèbes.
Le retour de Dionysos chez lui, à Thèbes, s'est heurté à l’incompréhension et a suscité le drame aussi longtemps que la cité est demeurée incapable d'établir le lien entre les gens du pays et l'étranger, entre les sédentaires et les voyageurs, entre sa volonté d'être toujours la même, de demeurer identique à soi, de se refuser à changer, et, d'autre part, l'étranger, le différent, l'autre. Tant qu'il n'y a pas possibilité d'ajuster ses contraires, une chose terrifiante se produit : ceux qui incarnaient l'attachement inconditionnel à l'immuable, qui proclamaient la nécessaire permanence de leurs valeurs traditionnelles face à ce qui est autre qu'eux, qui les met en question, qui les oblige à porter sur eux-mêmes un regard différents, ce sont ceux-là mêmes, les identitaires, les citoyens grecs sûrs de leurs supériorité, qui basculent dans l'altérité absolue, dans l'horreur et le monstrueux.
(....) Comme si, dans la mesure ou un groupe humain refuse de reconnaitre l'autre de lui faire sa part, c'est ce groupe lui même qui devenait monstrueusement autre.
Dionysos à Thèbes
(....) Comme si, dans la mesure ou un groupe humain refuse de reconnaitre l'autre de lui faire sa part, c'est ce groupe lui même qui devenait monstrueusement autre.
Dionysos à Thèbes
La grâce, la kháris qui fait briller le corps d'un éclat joyeux et qui est comme l'émanation même de la vie, le charme qui incessamment s'en dégage – la kháris, donc, en tout premier, mais avec elle la taille, la carrure, la prestance, la vélocité des jambes, la force des bras, la fraîcheur de la carnation, la détente, la souplesse, l'agilité des membres,– et encore, non plus visibles à l'œil d'autrui mais saisis par chacun au-dedans de lui-même dans son stéthos, son thumós, ses phrénes, son nóos, la fortitude, l'ardeur au combat, la frénésie guerrière, l'élan de la colère, de la crainte, du désir, la maîtrise de soi, l'intellection avisée, l'astuce subtile – telles sont quelques-unes des "puissances" dont le corps est dépositaire, qu'on peut lire sur lui comme les marques attestant ce qu'est un homme et ce qu'il vaut.
Plutôt que comme la morphologie d'un ensemble d'organes ajustés, à la façon d'une planche anatomique, ou que la figure des particularités physiques propres à chacun, comme dans un portrait, le corps grecs, aux temps anciens, se donne à voir sur le mode d'un blason faisant apparaître, en traits emblématiques, les multiples "valeurs" – de vie, de beauté, de pouvoir – dont un individu se trouve pourvu, dont il est titulaire et qui proclame sa timé : sa dignité et son rang. Pour désigner la noblesse d'âme, la générosité de cœur des hommes les meilleurs, les áristoi, le grec dit kalòs kàgathos, soulignant que beauté physique et supériorité morale n'étant pas dissociables, la seconde se peut évaluer au seul regard de la première. Par la combinaison de ces qualités, puissances, valeurs "vitales", qui comportent toujours, par leur référence au modèle divin, une dimension sacrée et dont le dosage varie suivant les cas individuels, le corps revêt la forme d'une sorte de tableau héraldique où s'inscrit et se déchiffre le statut social et personnel de chacun : l'admiration, la crainte, l'envie, le respect qu'il inspire, l'estime où il est tenu, la part d'honneurs auxquels il a droit – pour tout dire, sa valeur, son prix, sa place dans une échelle de "perfection" qui s'élève jusque vers les dieux campés en son sommet et dont les humains se répartissent, à divers niveaux, les étages inférieurs.
Plutôt que comme la morphologie d'un ensemble d'organes ajustés, à la façon d'une planche anatomique, ou que la figure des particularités physiques propres à chacun, comme dans un portrait, le corps grecs, aux temps anciens, se donne à voir sur le mode d'un blason faisant apparaître, en traits emblématiques, les multiples "valeurs" – de vie, de beauté, de pouvoir – dont un individu se trouve pourvu, dont il est titulaire et qui proclame sa timé : sa dignité et son rang. Pour désigner la noblesse d'âme, la générosité de cœur des hommes les meilleurs, les áristoi, le grec dit kalòs kàgathos, soulignant que beauté physique et supériorité morale n'étant pas dissociables, la seconde se peut évaluer au seul regard de la première. Par la combinaison de ces qualités, puissances, valeurs "vitales", qui comportent toujours, par leur référence au modèle divin, une dimension sacrée et dont le dosage varie suivant les cas individuels, le corps revêt la forme d'une sorte de tableau héraldique où s'inscrit et se déchiffre le statut social et personnel de chacun : l'admiration, la crainte, l'envie, le respect qu'il inspire, l'estime où il est tenu, la part d'honneurs auxquels il a droit – pour tout dire, sa valeur, son prix, sa place dans une échelle de "perfection" qui s'élève jusque vers les dieux campés en son sommet et dont les humains se répartissent, à divers niveaux, les étages inférieurs.
[Luciano Canfora, Le citoyen]
Le mot même qu'il utilise [Périclès selon Thucydide], dèmokratia, n'est pas un terme caractéristique du langage démocratique, qui emploie plus communément, comme nous le savons, "dèmos", dans ses significations diverses (rappelons-nous une formule typique des démocrates, luein ton dèmon, abattre, ou tenter d'abattre, la démocratie). "Dèmokratia", à l'origine, est au contraire un terme violent et polémique ("la prédominance du dèmos"), formé par les ennemis de l'organisation démocratique : ce n'est pas un terme qui évoque la cohabitation. Il exprime la prédominance d'une partie de la population : on ne peut désigner cette dernière qu'en termes de classe, de sorte qu'Aristote, pour plus de clarté, formule le paradoxal exemplum fictum selon lequel, dans une communauté de 1300 citoyens, la suprématie de 300 indigents (si tant est qu'il y en ait autant) sur tous les autres individus constitue, néanmoins, une "démocratie". Considérée sous cet angle, la démocratie finit par assumer les traits propres à la tyrannie : le "dèmos" revendique en premier lieu un privilège propre au tyran, celui d'être au-dessus des lois, "poiein ho ti bouletai" (faire ce qu'il veut).
p. 168
Le mot même qu'il utilise [Périclès selon Thucydide], dèmokratia, n'est pas un terme caractéristique du langage démocratique, qui emploie plus communément, comme nous le savons, "dèmos", dans ses significations diverses (rappelons-nous une formule typique des démocrates, luein ton dèmon, abattre, ou tenter d'abattre, la démocratie). "Dèmokratia", à l'origine, est au contraire un terme violent et polémique ("la prédominance du dèmos"), formé par les ennemis de l'organisation démocratique : ce n'est pas un terme qui évoque la cohabitation. Il exprime la prédominance d'une partie de la population : on ne peut désigner cette dernière qu'en termes de classe, de sorte qu'Aristote, pour plus de clarté, formule le paradoxal exemplum fictum selon lequel, dans une communauté de 1300 citoyens, la suprématie de 300 indigents (si tant est qu'il y en ait autant) sur tous les autres individus constitue, néanmoins, une "démocratie". Considérée sous cet angle, la démocratie finit par assumer les traits propres à la tyrannie : le "dèmos" revendique en premier lieu un privilège propre au tyran, celui d'être au-dessus des lois, "poiein ho ti bouletai" (faire ce qu'il veut).
p. 168
[Charles Segal, "L'homme grec, spectateur et auditeur", p. 248]
Dans les "Nuées", le génie parodique d'Aristophane réunit les deux formes de cette quête visionnaire du lointain et de l'invisible. Tandis que ses disciples, les yeux baissés, scrutent la terre, Socrate est suspendu dans une nacelle, ce qui lui permet d'affiner ses réflexions sur "ta météôra", les objets célestes (227-234). Il a aussi perdu "une grande pensée" quand un lézard a lâché sa fiente dans sa bouche alors qu'il "étudiait le cours suivi par la Lune dans ses révolutions et qu'il regardait en l'air la bouche ouverte" (171-173).
L'imagination sarcastique d'Aristophane saisit ici une caractéristique essentielle des philosophes présocratiques qui ont inspiré le "Socrate" des "Nuées" : leur intérêt passionné pour la clarté visuelle du monde phénoménal. Pour les "physiciens" ioniens des VI° et V°s av. J.-C., d'Anaximandre à Anaxagore et à Démocrite, l'univers lui-même devient un spectacle, une vision ordonnée que l'on comprend par l'usage systématique de la raison. Ce processus et ses résultats, les présocratiques les désignent du mot "théorein", dont la racine est "théa", la vision. "Théôria" implique la même identification du savoir à la vue que le verbe courant pour "je sais" : "oida" (de la racine vid-, voir). Ces penseurs emploient le mot "théôria" qu'il soit question d'observer les cieux, de "contempler les effets et l'essence du nombre" (Philolaos), de "voir" la qualité des vies humaines" (Démocrite), ou de "voir l'ordonnancement [taxis] de l'univers entier" (Anaxagore).
En concevant l'univers comme un tout visuellement intelligible (ce qu'implique la dernière formule), les présocratiques abandonnent ou interprètent métaphoriquement les mythes (...) Afin d'exposer la clarté synoptique de sa vision de l'univers, Anaximandre, par exemple, dessine son image du monde sur une tablette (pinax), ou même fabrique une sphère, probablement pour obtenir un modèle en trois dimensions, exactement comme le géographe Hécatée de Milet trace une carte (...) Cette démarche, décisive pour le développement de la science occidentale, ne remplace pas seulement le muthos par le logos, mais aussi l'imagerie anthropomorphique par une "théorie" plus abstraite.
Dans les "Nuées", le génie parodique d'Aristophane réunit les deux formes de cette quête visionnaire du lointain et de l'invisible. Tandis que ses disciples, les yeux baissés, scrutent la terre, Socrate est suspendu dans une nacelle, ce qui lui permet d'affiner ses réflexions sur "ta météôra", les objets célestes (227-234). Il a aussi perdu "une grande pensée" quand un lézard a lâché sa fiente dans sa bouche alors qu'il "étudiait le cours suivi par la Lune dans ses révolutions et qu'il regardait en l'air la bouche ouverte" (171-173).
L'imagination sarcastique d'Aristophane saisit ici une caractéristique essentielle des philosophes présocratiques qui ont inspiré le "Socrate" des "Nuées" : leur intérêt passionné pour la clarté visuelle du monde phénoménal. Pour les "physiciens" ioniens des VI° et V°s av. J.-C., d'Anaximandre à Anaxagore et à Démocrite, l'univers lui-même devient un spectacle, une vision ordonnée que l'on comprend par l'usage systématique de la raison. Ce processus et ses résultats, les présocratiques les désignent du mot "théorein", dont la racine est "théa", la vision. "Théôria" implique la même identification du savoir à la vue que le verbe courant pour "je sais" : "oida" (de la racine vid-, voir). Ces penseurs emploient le mot "théôria" qu'il soit question d'observer les cieux, de "contempler les effets et l'essence du nombre" (Philolaos), de "voir" la qualité des vies humaines" (Démocrite), ou de "voir l'ordonnancement [taxis] de l'univers entier" (Anaxagore).
En concevant l'univers comme un tout visuellement intelligible (ce qu'implique la dernière formule), les présocratiques abandonnent ou interprètent métaphoriquement les mythes (...) Afin d'exposer la clarté synoptique de sa vision de l'univers, Anaximandre, par exemple, dessine son image du monde sur une tablette (pinax), ou même fabrique une sphère, probablement pour obtenir un modèle en trois dimensions, exactement comme le géographe Hécatée de Milet trace une carte (...) Cette démarche, décisive pour le développement de la science occidentale, ne remplace pas seulement le muthos par le logos, mais aussi l'imagerie anthropomorphique par une "théorie" plus abstraite.
Pour les Grecs, le propre de l’homme, ce qui le définit en tant que tel, c’est le fait de manger le pain et de boire le vin, d’avoir un certain type de nourriture et de reconnaitre les lois de l’hospitalité, d’accueillir l’étranger, au lieu de le dévorer.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jean-Pierre Vernant
Lecteurs de Jean-Pierre Vernant (801)Voir plus
Quiz
Voir plus
Des fleurs pour Algernon (compte rendu 1-10)
Comment s'appelle le personnage principal ?
Jean Martin
Charlie Gorden
Jeanne Dupont
Sabrina Paulette
5 questions
248 lecteurs ont répondu
Thème : Des fleurs pour Algernon de
Daniel KeyesCréer un quiz sur cet auteur248 lecteurs ont répondu