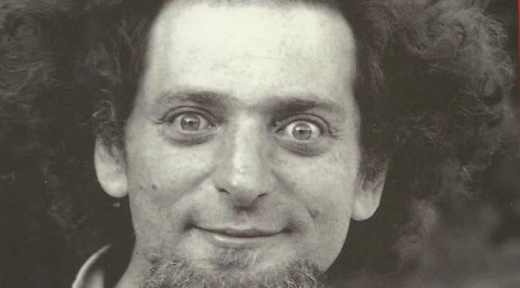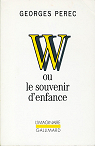Critiques de Georges Perec (686)
« L’espace de notre vie n’est ni construit, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et il se rassemble ? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction, on a parfois la vague impression que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça se cogne. » (Extrait du feuillet mobile intitulé « Prière d’insérer »)
Georges Perec se lance dans une réflexion sur l’espace, sur sa nature et sur son sens. Qu’est-ce que l’espace par rapport à soi, par rapport aux autres et par rapport au monde ? « L’objet de ce livre n’est pas exactement le vide, ce serait plutôt ce qu’il y a autour, ou dedans. Mais enfin, au départ, il n’y a pas grand-chose : du rien, de l’impalpable, du pratiquement immatériel : de l’étendue, de l’extérieur, ce qui est à l’extérieur de nous, ce au milieu de quoi nous nous déplaçons, le milieu ambiant, l’espace alentour. » (p. 13)
Partant des principes qu’« il y a plein de petits bouts d’espace » (p. 14) et que « vivre, c’est passer d’un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. » (p. 16), l’auteur passe en revue tous les lieux qu’il connaît, du plus intime au plus impersonnel. Son inventaire topologique commence par le lit et se finit par l’espace, tout en parcourant la chambre, en traversant l’appartement, en célébrant la ville et arpentant le pays.
Il fait de l’écriture un jalon dans l’espace de la page : « J’écris : j’habite ma feuille de papier, je l’investis, je la parcours. Je suscite des blancs, des espaces (sauts dans le sens : discontinuités, passages, transitions). » (p. 23) L’écriture est action et actrice : elle prend la forme de sauts de ligne, de marges griffonnées, de notes de bas de page désopilantes, d’alinéas étudiés, etc. George Perec applique à l’extrême son étude de l’espace. Il aurait été vain de prétendre parler d’espace sans aborder celui qu’il connaît le mieux.
George Perec s’impose des travaux pratiques et se livre à des exercices d’écriture que le lecteur peut reprendre. Écrire l’espace sur l’espace de la page, c’est une mise en abime sublime et infinie. Les descriptions auxquelles Perec se livre sont systématiques et peuvent sembler artificielles, mais elles découlent du besoin de fixer l’espace, de le délimiter. L’auteur est obsédé par la surface et la frontière. Où commence tel espace ? Pourquoi telle mesure plutôt que telle autre ?
Suivre Perec dans sa quête d’espace m’a tout d’abord semblé facile et très plaisant, comme une promenade en compagnie d’un doux dingue qui connaît une ville ou un quartier comme sa poche. Mais à mesure que les pages se tournaient, le malaise empirait : l’inventaire de Perec n’est pas anodin, ce n’est pas un guide de voyage. J’y vois une carte affolée, un besoin de poser des repères pour repousser l’indéfini. Si l’auteur utilise un langage factuel et un peu mécanique, la poésie et la peur sourdent des pages et se mêlent en fin de ligne.
Les Espèces d’espaces de George Perec sont un peu les nôtres, mais les avait-on déjà regardés comme l’auteur les a vus ? Ouvrez le texte de Perec et redécouvrez le monde quotidien, c’est à prendre le vertige !
Georges Perec se lance dans une réflexion sur l’espace, sur sa nature et sur son sens. Qu’est-ce que l’espace par rapport à soi, par rapport aux autres et par rapport au monde ? « L’objet de ce livre n’est pas exactement le vide, ce serait plutôt ce qu’il y a autour, ou dedans. Mais enfin, au départ, il n’y a pas grand-chose : du rien, de l’impalpable, du pratiquement immatériel : de l’étendue, de l’extérieur, ce qui est à l’extérieur de nous, ce au milieu de quoi nous nous déplaçons, le milieu ambiant, l’espace alentour. » (p. 13)
Partant des principes qu’« il y a plein de petits bouts d’espace » (p. 14) et que « vivre, c’est passer d’un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. » (p. 16), l’auteur passe en revue tous les lieux qu’il connaît, du plus intime au plus impersonnel. Son inventaire topologique commence par le lit et se finit par l’espace, tout en parcourant la chambre, en traversant l’appartement, en célébrant la ville et arpentant le pays.
Il fait de l’écriture un jalon dans l’espace de la page : « J’écris : j’habite ma feuille de papier, je l’investis, je la parcours. Je suscite des blancs, des espaces (sauts dans le sens : discontinuités, passages, transitions). » (p. 23) L’écriture est action et actrice : elle prend la forme de sauts de ligne, de marges griffonnées, de notes de bas de page désopilantes, d’alinéas étudiés, etc. George Perec applique à l’extrême son étude de l’espace. Il aurait été vain de prétendre parler d’espace sans aborder celui qu’il connaît le mieux.
George Perec s’impose des travaux pratiques et se livre à des exercices d’écriture que le lecteur peut reprendre. Écrire l’espace sur l’espace de la page, c’est une mise en abime sublime et infinie. Les descriptions auxquelles Perec se livre sont systématiques et peuvent sembler artificielles, mais elles découlent du besoin de fixer l’espace, de le délimiter. L’auteur est obsédé par la surface et la frontière. Où commence tel espace ? Pourquoi telle mesure plutôt que telle autre ?
Suivre Perec dans sa quête d’espace m’a tout d’abord semblé facile et très plaisant, comme une promenade en compagnie d’un doux dingue qui connaît une ville ou un quartier comme sa poche. Mais à mesure que les pages se tournaient, le malaise empirait : l’inventaire de Perec n’est pas anodin, ce n’est pas un guide de voyage. J’y vois une carte affolée, un besoin de poser des repères pour repousser l’indéfini. Si l’auteur utilise un langage factuel et un peu mécanique, la poésie et la peur sourdent des pages et se mêlent en fin de ligne.
Les Espèces d’espaces de George Perec sont un peu les nôtres, mais les avait-on déjà regardés comme l’auteur les a vus ? Ouvrez le texte de Perec et redécouvrez le monde quotidien, c’est à prendre le vertige !
Perec s'amuse avec les mots dans le pur esprit de l'OULIPO et c'est jouissif à souhait. Il a tenté d'intégrer à son récit un nombre incalculable de figures de style dont on trouvera un index partiel à la fin du texte. En effet, il s'est arrêté à la lettre P pour ne pas saouler le lecteur. Merci Monsieur Perec. Rien que pour la lettre A, on en trouve 47 dont l'anacoluthe, l'anaphore, l'aphorisme, l'apophtegme, l'apocope ou l'allitération et si l'on ne sait pas ce que cela veut dire ni où on peut les trouver dans son texte, eh bien il nous dit en substance : "démerdez-vous".
On y trouvera également des fautes d'orthographe comme les psychanalisses, des problèmes de concordance des temps : "ils finiraient bien par la gagner leur sale guerre et que le cessez-le-feu il sera conclu et que la paix elle est signée" et d'autres curiosités littéraires.
Perec s'amuse sous la contrainte et nous fait jouer avec lui et avec les mots. Mais derrière cette prouesse, ce texte est le reflet d'une époque et une vraie narration vient servir la contrainte d'écriture : comment faire réformer un soldat du régiment d'Henri Pollack, le propriétaire du petit vélo à guidon chromé, de manière à ce que ledit soldat puisse rester avec sa bien aimée et éviter la guerre d'Algérie, le Pollack mobilise ses potes dans un brainstorming saugrenu sur la meilleure manière de lui péter le bras en douceur !!
Un texte bien déjanté qui se déguste et qu'il faudrait relire pour mieux savourer ce roman inclassable.
Challenge Multi-Défis 2022.
Challenge riquiqui 2022.
On y trouvera également des fautes d'orthographe comme les psychanalisses, des problèmes de concordance des temps : "ils finiraient bien par la gagner leur sale guerre et que le cessez-le-feu il sera conclu et que la paix elle est signée" et d'autres curiosités littéraires.
Perec s'amuse sous la contrainte et nous fait jouer avec lui et avec les mots. Mais derrière cette prouesse, ce texte est le reflet d'une époque et une vraie narration vient servir la contrainte d'écriture : comment faire réformer un soldat du régiment d'Henri Pollack, le propriétaire du petit vélo à guidon chromé, de manière à ce que ledit soldat puisse rester avec sa bien aimée et éviter la guerre d'Algérie, le Pollack mobilise ses potes dans un brainstorming saugrenu sur la meilleure manière de lui péter le bras en douceur !!
Un texte bien déjanté qui se déguste et qu'il faudrait relire pour mieux savourer ce roman inclassable.
Challenge Multi-Défis 2022.
Challenge riquiqui 2022.
N°744 – Avril 2014.
UN HOMME QUI DORT – Georges PEREC – Denoël. (1967)
Le personnage central de ce roman est un homme qui s'éveille. Il n'a pas de nom et l'auteur s'adresse à lui en le tutoyant. Est-ce parce qu'il le connaît ou peut-être parce que cet auteur s'adresse à lui-même un peu comme ces solitaires qui soliloquent sans cesse et s'interpellent eux-mêmes ? C'est un étudiant sans importance qui habite une mansarde minable de cinq mètres carrés sans confort, sous les toits et qui décroche de plus en plus des études. Non seulement il ne va pas en cours, a abandonné tout idée de diplôme et de réussite mais il se laisse aller physiquement et moralement, ne se lave même plus, ne quitte sa chambre qu'à la nuit pour roder dans les rues désertes ou pour les gestes élémentaires de la vie. De l'extérieur, il ne perçoit plus que les ombres portées qui se dessinent sur le plafond de son galetas et les bruits étouffés de la rue. Il ne rencontre plus personne, a tourné le dos à ses copains, ne vit plus et ne veut pas de la vie qui se résume pour lui à « une bassine en matière plastique rose où croupissent six chaussettes ». Quelque chose s'est brisé en lui et il n'est pas vraiment de ces philosophes qui s'interrogent à perte de vue sur le sens de l'existence, il laisse les problèmes métaphysiques aux autres.
A vingt cinq ans, c'est un marginal qui s'est inscrit en faculté pour ne pas participer à ce monde, faire partie de cette société qu'il veut ignorer. Il a oublié (où peut-être ne les a t-il jamais connus) la fougue de la jeunesse et l’enthousiasme qui dit-on caractérise cet âge et fait qu'on veut conquérir le monde et réformer la société, il n'a même plus ni repaires, ni souvenirs, ni espoirs, ni amours, ni passé ni avenir et quand il rentre chez ses parents, des retraités qui vivent à la campagne, dans l'Yonne, il ne partage avec eux plus rien que le silence, un lien de parenté qui se distend de plus en plus et peut-être aussi un maigre pécule qu'ils lui allouent pour préparer sa vie. Comme eux il est vieux mais cette vieillesse est d'une autre nature. Eux ont fait leur parcours sur terre et lui refuse de le sien, son itinéraire est déjà tout tracé vers la mort et l’hospice de vieillards. Cette absence de dialogue se traduit par l'éloignement, lui à Paris où il est censé étudier et eux ailleurs, loin de lui, autant dire dans un autre monde. Chez eux il s'isole volontiers en forêt pour regarder les arbres qui le fascinent, peut-être simplement parce qu'ils sont muets. Dans la Capitale, il mène une vie végétative, volontairement coupée du monde. Il est ce piéton qui arpente les rues et dont les gestes habituels et répétitifs sont dérisoires. Pourtant, il suffirait qu'il accepte de correspondre au stéréotype de celui qui fait ce qu'on attend de lui, docilement, qu'il fasse partie de ces oubliés de la société dont on attend rien qu'une obéissance servile et un dévouement de tous les jours, qu'il endosse ce costume du citoyen ordinaire. A ceux-là on donne des miettes sous forme de décorations, de flatteries illusoires, de distinctions hypocrites qui ne sont que de la poudre aux yeux mais qu'ils apprécient. Lui, au contraire ne veut être que « la pièce manquante du puzzle », celui qui n'écoute pas les conseils et marche sans se retourner vers son néant quotidien. Autour de lui le monde s’agite mais il n'en a cure. Il est transparent, sans importance, invisible, limpide et sa vie ne tient qu'en quelques mots, il est« comme une goutte d'eau qui perle au robinet d'un poste d'eau sur un palier, comme six chaussettes trempées dans une bassine en matière plastique rose, comme une mouche ou comme une huître, comme une vache, comme un escargot, comme un enfant ou comme un vieillard, comme un rat ».
A la fois indifférent, inaccessible et solitaire, il marche dans la ville comme dans un labyrinthe, hantant les bars et les squares sans presque s'en rendre compte et le métro est pour lui un souterrain incertain. Ses actions sont limitées, mesquines, sans importance et surtout il néglige l'étude. Tout chez lui est illusoire et sans intérêt. Il se sent persécuté, paranoïaque et le sommeil, ce basculement dans le néant, finit par le gagner et avec lui la perte du sens du réel et même une sorte de dédoublement de lui-même. Son angoisse est réelle, il refuse de réagir, n'offre aucune prise aux événements extérieurs et semble se complaire dans cette situation pas vraiment constructive. C'est aussi un sommeil éveillé, un sorte d'état semi-comateux où il fait des gestes automatiques uniquement destinés à survivre presque comme un ectoplasme, comme un fantôme transparent. La fin laisse entrevoir une espérance possible
Pourtant cette attitude n'est pas nouvelle pour lui et ne résulte pas d'une soudaine prise de conscience ; il a toujours été comme cela, dépressif, défaitiste, indolent, à cause peut-être de l'âge de ses parents. Pourtant il ne semble pas y avoir de ressemblance avec eux. Ils ont fait leurs parcours dans cette vie et espèrent bien que leur fils fera le sien. Ils lui permettent même de faire des études pour que sa vie soit meilleure. Pourtant il n'a pas le même état d'esprit à cause peut-être du fossé des générations, des références qui ne sont pas les mêmes ou à cause des temps qui changent un peu trop vite. Peut-être aussi doit-il cet état déprimé à un lointain aïeul ? La roulette de la génétique a de ces mystères !
C’est un texte déprimant comme l'est la vie de ce jeune homme mais pourtant éminemment poétique. Je connais mal le parcours de Perec. Je ne sais pas si ce texte est autobiographique (il l'a écrit avant son adhésion à l'OULIPO), mais un livre qui est aussi un univers douloureux est souvent porté pendant de nombreuses années avant que les mots ne viennent. Son enfance a été chaotique et il a peut-être été cet étudiant paumé. C'est peut-être aussi une simple fiction (encore que ce livre ne porte pas la mention « roman ») mais je m'y retrouve un peu, il est vrai avec quelques dizaines d'années de recul. J'ai bien dû, moi aussi, avant d'entrer dans la vie active, ressentir les mêmes affres, connaître les mêmes angoisses face à une vie qui semblait vouloir se dérober devant moi. Mes réaction n'ont certes pas été semblables mais il y avait quelque chose de cette errance, dans ces questions sur l'avenir, dans cette perte de repaires qui m'a fait apprécier ce texte
©Hervé GAUTIER – Avril 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
Lien : http://hervegautier.e-monsit..
UN HOMME QUI DORT – Georges PEREC – Denoël. (1967)
Le personnage central de ce roman est un homme qui s'éveille. Il n'a pas de nom et l'auteur s'adresse à lui en le tutoyant. Est-ce parce qu'il le connaît ou peut-être parce que cet auteur s'adresse à lui-même un peu comme ces solitaires qui soliloquent sans cesse et s'interpellent eux-mêmes ? C'est un étudiant sans importance qui habite une mansarde minable de cinq mètres carrés sans confort, sous les toits et qui décroche de plus en plus des études. Non seulement il ne va pas en cours, a abandonné tout idée de diplôme et de réussite mais il se laisse aller physiquement et moralement, ne se lave même plus, ne quitte sa chambre qu'à la nuit pour roder dans les rues désertes ou pour les gestes élémentaires de la vie. De l'extérieur, il ne perçoit plus que les ombres portées qui se dessinent sur le plafond de son galetas et les bruits étouffés de la rue. Il ne rencontre plus personne, a tourné le dos à ses copains, ne vit plus et ne veut pas de la vie qui se résume pour lui à « une bassine en matière plastique rose où croupissent six chaussettes ». Quelque chose s'est brisé en lui et il n'est pas vraiment de ces philosophes qui s'interrogent à perte de vue sur le sens de l'existence, il laisse les problèmes métaphysiques aux autres.
A vingt cinq ans, c'est un marginal qui s'est inscrit en faculté pour ne pas participer à ce monde, faire partie de cette société qu'il veut ignorer. Il a oublié (où peut-être ne les a t-il jamais connus) la fougue de la jeunesse et l’enthousiasme qui dit-on caractérise cet âge et fait qu'on veut conquérir le monde et réformer la société, il n'a même plus ni repaires, ni souvenirs, ni espoirs, ni amours, ni passé ni avenir et quand il rentre chez ses parents, des retraités qui vivent à la campagne, dans l'Yonne, il ne partage avec eux plus rien que le silence, un lien de parenté qui se distend de plus en plus et peut-être aussi un maigre pécule qu'ils lui allouent pour préparer sa vie. Comme eux il est vieux mais cette vieillesse est d'une autre nature. Eux ont fait leur parcours sur terre et lui refuse de le sien, son itinéraire est déjà tout tracé vers la mort et l’hospice de vieillards. Cette absence de dialogue se traduit par l'éloignement, lui à Paris où il est censé étudier et eux ailleurs, loin de lui, autant dire dans un autre monde. Chez eux il s'isole volontiers en forêt pour regarder les arbres qui le fascinent, peut-être simplement parce qu'ils sont muets. Dans la Capitale, il mène une vie végétative, volontairement coupée du monde. Il est ce piéton qui arpente les rues et dont les gestes habituels et répétitifs sont dérisoires. Pourtant, il suffirait qu'il accepte de correspondre au stéréotype de celui qui fait ce qu'on attend de lui, docilement, qu'il fasse partie de ces oubliés de la société dont on attend rien qu'une obéissance servile et un dévouement de tous les jours, qu'il endosse ce costume du citoyen ordinaire. A ceux-là on donne des miettes sous forme de décorations, de flatteries illusoires, de distinctions hypocrites qui ne sont que de la poudre aux yeux mais qu'ils apprécient. Lui, au contraire ne veut être que « la pièce manquante du puzzle », celui qui n'écoute pas les conseils et marche sans se retourner vers son néant quotidien. Autour de lui le monde s’agite mais il n'en a cure. Il est transparent, sans importance, invisible, limpide et sa vie ne tient qu'en quelques mots, il est« comme une goutte d'eau qui perle au robinet d'un poste d'eau sur un palier, comme six chaussettes trempées dans une bassine en matière plastique rose, comme une mouche ou comme une huître, comme une vache, comme un escargot, comme un enfant ou comme un vieillard, comme un rat ».
A la fois indifférent, inaccessible et solitaire, il marche dans la ville comme dans un labyrinthe, hantant les bars et les squares sans presque s'en rendre compte et le métro est pour lui un souterrain incertain. Ses actions sont limitées, mesquines, sans importance et surtout il néglige l'étude. Tout chez lui est illusoire et sans intérêt. Il se sent persécuté, paranoïaque et le sommeil, ce basculement dans le néant, finit par le gagner et avec lui la perte du sens du réel et même une sorte de dédoublement de lui-même. Son angoisse est réelle, il refuse de réagir, n'offre aucune prise aux événements extérieurs et semble se complaire dans cette situation pas vraiment constructive. C'est aussi un sommeil éveillé, un sorte d'état semi-comateux où il fait des gestes automatiques uniquement destinés à survivre presque comme un ectoplasme, comme un fantôme transparent. La fin laisse entrevoir une espérance possible
Pourtant cette attitude n'est pas nouvelle pour lui et ne résulte pas d'une soudaine prise de conscience ; il a toujours été comme cela, dépressif, défaitiste, indolent, à cause peut-être de l'âge de ses parents. Pourtant il ne semble pas y avoir de ressemblance avec eux. Ils ont fait leurs parcours dans cette vie et espèrent bien que leur fils fera le sien. Ils lui permettent même de faire des études pour que sa vie soit meilleure. Pourtant il n'a pas le même état d'esprit à cause peut-être du fossé des générations, des références qui ne sont pas les mêmes ou à cause des temps qui changent un peu trop vite. Peut-être aussi doit-il cet état déprimé à un lointain aïeul ? La roulette de la génétique a de ces mystères !
C’est un texte déprimant comme l'est la vie de ce jeune homme mais pourtant éminemment poétique. Je connais mal le parcours de Perec. Je ne sais pas si ce texte est autobiographique (il l'a écrit avant son adhésion à l'OULIPO), mais un livre qui est aussi un univers douloureux est souvent porté pendant de nombreuses années avant que les mots ne viennent. Son enfance a été chaotique et il a peut-être été cet étudiant paumé. C'est peut-être aussi une simple fiction (encore que ce livre ne porte pas la mention « roman ») mais je m'y retrouve un peu, il est vrai avec quelques dizaines d'années de recul. J'ai bien dû, moi aussi, avant d'entrer dans la vie active, ressentir les mêmes affres, connaître les mêmes angoisses face à une vie qui semblait vouloir se dérober devant moi. Mes réaction n'ont certes pas été semblables mais il y avait quelque chose de cette errance, dans ces questions sur l'avenir, dans cette perte de repaires qui m'a fait apprécier ce texte
©Hervé GAUTIER – Avril 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
Lien : http://hervegautier.e-monsit..
C'est une belle découverte que j'ai faite en lisant W ou le souvenir d'enfant. Si j'ai été un peu désarçonné par l'alternance autobiographie/fiction dans un premier temps, j'ai fini par m'y habituer et apprécier.
C'est une sacrée prouesse que de réussir une alternance comme celle-ci sans perdre ses lecteurs, mais on se laisse facilement porter par les souvenirs que l'auteur nous raconte, et l'utopie construite par Perec produit l'effet attendu en versant petit à petit dans l'horreur.
Mon premier ouvrage de Georges Perec et probablement pas le dernier
C'est une sacrée prouesse que de réussir une alternance comme celle-ci sans perdre ses lecteurs, mais on se laisse facilement porter par les souvenirs que l'auteur nous raconte, et l'utopie construite par Perec produit l'effet attendu en versant petit à petit dans l'horreur.
Mon premier ouvrage de Georges Perec et probablement pas le dernier
Mort de Bartlebooth, hier, 1975, sur les divans verts de la salle de lecture, mort de Perec il y a précisément vingt-cinq ans, sa voix pour me réveiller ce matin, mort de Winckler, mort de Valène, et demain, ce soir peut-être, mort de marraine. L'immeuble s'écroule sous le poids de la vie. Mille romans en un, mille personnages qui se croisent et dont les destins loufoques, tragi-comiques, ridicules, toujours mus par la passion ou la folie, entrent en contact par l'immeuble, le livre et le cerveau extraordinairement fertile de Georges Perec. Qu'est-ce que c'est, lire La Vie mode d'emploi ? C'est entrer dans la joie du détail, dans le trésor de l'anodin, dans le feuilleté de l'existence. Tous les appartements débordent de fourbi dont Perec, tranquillement et malicieusement, dresse la liste que le lecteur, même s'il est distrait, parcourt sans se lasser en attendant qu'on lui raconte un destin extraordinaire, l'obsession d'un homme, culminant dans les puzzles de Bartlebooth, mais déclinée de mille manières différentes, parcourant tous les milieux possibles et imaginables, car ce qui fascine dans un tel bouquin, c'est l'imagination sans borne de l'auteur prestidigitateur qui fait sortir d'une boîte immobilière des mondes infinis, que seule la mort peut à peu près clore. Après la lecture de La Vie mode d'emploi, on ne rentre plus dans un immeuble comme avant, comme si ne s'y cachaient pas, derrière les portes fermées, les paillassons à chats ou à ramoneurs, les bottes terreuses d'enfants, les souliers vernis de cadres supérieurs en préretraite, les étagères vides et poussièreuses, les ballons crevés, les trottinettes rutilantes, les..., les..., les... (au secours, Georges, donne-moi des idées, je te plagie bien médiocrement), des hommes qui ont tous leur petit grain, leur secret, leur fétiche, des femmes passionnément amoureuses ou ennuyées, des enfants terribles ou terreux (mais peut-être justement pas là où les bottes nous auraient fait croire que...), des anciennes stars australiennes quittées par leurs cinquièmes maris, des transsexuels qui essaient d'enregistrer un disque, des..., des..., des..., des hommes qui passent dix ans à apprendre à peindre, puis dix ans à voyager dans tous les ports du monde pour y faire des aquarelles, puis le reste de leur vie à les reconstruire pour mieux les annihiler, et qui, au moment de leur mort, échouent. Malgré la disparition, et parce qu'il y a disparition, cela même qui a disparu demeure, il y a quatre "e" dans Georges Perec, il reste un W ou un souvenir d'enfance et, vingt-cinq ans après, je lis La Vie mode d'emploi.
Il y a des auteurs qui exercent sur moi un pouvoir d'envoutement par l'écriture et je dois dire que Georges Perec est un de mes préférés. C'est sans doute parce qu'il appartient à l'Oulipo (ouvroir de littérature potentielle).
C'est un écrivain qui sait décrire ce que tout le monde a sous les yeux mais ne voit pas à force d'habitudes. Il excelle pour observer et décrire des choses simples et je l'apprécie pour cela.
"Un homme qui dort" est un livre passionnant entièrement écrit à la seconde personne du singulier. Il nous plonge dans la vie d'un jeune étudiant à Paris qui perd le sens de sa vie. Seul dans une petite chambre de bonne rue Saint-Honoré, il ne va pas passer son examen. Il va se détacher petit à petit de la réalité et rester seul avec sa solitude. Il passe son temps à regarder les failles du plafond, à faire des réussites aux cartes ou à relire des livres qu'il a déjà lu. Il est comme en survie, détaché de tout et Perec se demande si c'est ça la liberté.
Cette situation a un écho particulier aujourd'hui avec le confinement qui fait débat sur la santé mentale des étudiants d’autant plus que cette solitude s'avèrera bien inutile parce que l'indifférence ne le rendra pas différent. J’ajouterai qu’"Un homme qui dort" a été publié en 1967 et à l'époque, le personnage du roman, qui vit avec une bourse, n'a ni la télévision ni le téléphone.
Le seul lien qu'il a avec le monde extérieur ce sont ses longues balades dans Paris particulièrement bien décrite par Georges Perec. D'ailleurs, il en a fait un film réalisé par Bernard Queysanne, qui a reçu le Prix Jean Vigo en 1974.
Challenge Riquiqui 2021
Challenge XXème siècle 2021
Challenge Multi-défis 2021
C'est un écrivain qui sait décrire ce que tout le monde a sous les yeux mais ne voit pas à force d'habitudes. Il excelle pour observer et décrire des choses simples et je l'apprécie pour cela.
"Un homme qui dort" est un livre passionnant entièrement écrit à la seconde personne du singulier. Il nous plonge dans la vie d'un jeune étudiant à Paris qui perd le sens de sa vie. Seul dans une petite chambre de bonne rue Saint-Honoré, il ne va pas passer son examen. Il va se détacher petit à petit de la réalité et rester seul avec sa solitude. Il passe son temps à regarder les failles du plafond, à faire des réussites aux cartes ou à relire des livres qu'il a déjà lu. Il est comme en survie, détaché de tout et Perec se demande si c'est ça la liberté.
Cette situation a un écho particulier aujourd'hui avec le confinement qui fait débat sur la santé mentale des étudiants d’autant plus que cette solitude s'avèrera bien inutile parce que l'indifférence ne le rendra pas différent. J’ajouterai qu’"Un homme qui dort" a été publié en 1967 et à l'époque, le personnage du roman, qui vit avec une bourse, n'a ni la télévision ni le téléphone.
Le seul lien qu'il a avec le monde extérieur ce sont ses longues balades dans Paris particulièrement bien décrite par Georges Perec. D'ailleurs, il en a fait un film réalisé par Bernard Queysanne, qui a reçu le Prix Jean Vigo en 1974.
Challenge Riquiqui 2021
Challenge XXème siècle 2021
Challenge Multi-défis 2021
Deux récits enchassés dont les chapitres s'alternent (l'un avec une police classique, l'autre en italique), tous deux ayant notamment un point commun, ils sont écrits à la première personne.
La première partie est largement autobiographique, elle raconte l'enfance du petit garçon que fut George Pérec qui perdit tour à tour son père en 1940 puis sa mère déportée à Auschwitz en 1943 et qui n'en reviendra pas. " Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Jusqu'à ma douzième année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes : j'ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à six " .
La deuxième histoire, qui en apparence n'a rien à voir avec la première, est une fiction décrivant l'organisation sociale sur une île imaginaire de la Terre de Feu nommée W, entièrement vouée au sport et dont les habitants soumis à une discipline de vie très stricte, participent chaque jour à des compétitions entre eux. L'idéal "olympique" de l'île W ressemble beaucoup à une transposition romanesque de certains thèmes de l'idéologie nazie.
Un roman qui mêle Histoire et fiction, une ambiance particulière et remuante. Il faut attendre la dernière page du livre pour avoir les clefs du rapport entre les deux histoires. Un roman qui ne laisse pas le lecteur indemne.
La première partie est largement autobiographique, elle raconte l'enfance du petit garçon que fut George Pérec qui perdit tour à tour son père en 1940 puis sa mère déportée à Auschwitz en 1943 et qui n'en reviendra pas. " Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Jusqu'à ma douzième année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes : j'ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à six " .
La deuxième histoire, qui en apparence n'a rien à voir avec la première, est une fiction décrivant l'organisation sociale sur une île imaginaire de la Terre de Feu nommée W, entièrement vouée au sport et dont les habitants soumis à une discipline de vie très stricte, participent chaque jour à des compétitions entre eux. L'idéal "olympique" de l'île W ressemble beaucoup à une transposition romanesque de certains thèmes de l'idéologie nazie.
Un roman qui mêle Histoire et fiction, une ambiance particulière et remuante. Il faut attendre la dernière page du livre pour avoir les clefs du rapport entre les deux histoires. Un roman qui ne laisse pas le lecteur indemne.
Pénétrer dans l'univers de Georges Perec c'est partir en voyage au pays des mots, de la langue française. C'est rester bouche-bée , c'est se dire il a osé;C'est sourire devant l'incongru c'est aussi verser une larme sur tous ceux qui... nous sommes à la fin de la guerre d'Algérie.
Quel plaisir de vous lire à nouveau Mr Perec! Il y a si longtemps que je ne vous avais rendu visite mais promis je reviens vous lire très vite.
Un texte à lire et surement à relire.
Quel plaisir de vous lire à nouveau Mr Perec! Il y a si longtemps que je ne vous avais rendu visite mais promis je reviens vous lire très vite.
Un texte à lire et surement à relire.
Georges Perec, avec ce récit à la deuxième personne du singulier, offrait une de ces gageure littéraire dont il avait le secret.
Son histoire d' un homme qui dort se situe quelque-part entre l' Enfer de Barbusse et La banlieue de Sternberg, tout en étant sensiblement différente.
Le héros de cette histoire se trouve, dirait-on actuellement, en mode pause.
Le personnage semble se recroqueviller en se réduisant à lui- même, dans une sorte d'ascèse.
Le talent de Perec, c'est de captiver le lecteur sur cette quasi-non existence.
Son histoire d' un homme qui dort se situe quelque-part entre l' Enfer de Barbusse et La banlieue de Sternberg, tout en étant sensiblement différente.
Le héros de cette histoire se trouve, dirait-on actuellement, en mode pause.
Le personnage semble se recroqueviller en se réduisant à lui- même, dans une sorte d'ascèse.
Le talent de Perec, c'est de captiver le lecteur sur cette quasi-non existence.
Un bouquin qui s’inscrit sans la cinq ( motif si ardu…si pas là)
L’illusion, ici signal d’introduction, aboutit clap à fin.
Hors sa cinq, trop fin un polar s’agrandit.
Maints quidams au cosmos citadin occupant l’opus,
Intrigants robots clamant l’intact sans la V,
Ô G.P., roi du scriptural aimant à jouir,
Distinct, hors tout scribouillard.
J’applaudis sans tintouin un art absolu,
Qui formalisait la non-cinq.
L’illusion, ici signal d’introduction, aboutit clap à fin.
Hors sa cinq, trop fin un polar s’agrandit.
Maints quidams au cosmos citadin occupant l’opus,
Intrigants robots clamant l’intact sans la V,
Ô G.P., roi du scriptural aimant à jouir,
Distinct, hors tout scribouillard.
J’applaudis sans tintouin un art absolu,
Qui formalisait la non-cinq.
Le détachement du monde d’un jeune homme, ou comment écrire pour dissoudre le réel.
En épigraphe à «Un homme qui dort», publié en 1967 juste après «Les choses», on peut lire cet extrait des Méditations sur le péché de Franz Kafka :
«Il n’est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à table et écoute. N’écoute même pas, attends seulement. N’attends même pas, sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s’offrir à toi pour que tu le démasques, il ne peut faire autrement, extasié, il se tordra devant toi.»
Alors qu’il doit aller passer un examen un matin, un jeune homme, un étudiant sans nom, ne se lève tout simplement pas. À partir de ce geste, ou de cette absence de geste, il se détache du monde, devient indifférent à ce monde qu’il ne reconnaît plus ; il veut tout accomplir sans y accorder ni la moindre valeur ou la moindre émotion, comme si chaque action - manger, s’habiller - n’avait plus qu’une visée fonctionnelle, comme si chaque geste devait être neutre, minimal. Et d’ailleurs il ne parle presque plus, sauf pour exprimer le strict nécessaire.
«La ténacité, l’initiative, le coup d’éclat, le triomphe tracent le chemin trop limpide d’une vie trop modèle, dessinent les sacro-saintes images de la lutte pour la vie. Les pieux mensonges qui bercent les rêves de tous ceux qui piétinent et s’embourbent, les illusions perdues des milliers de laissés-pour-compte, ceux qui sont arrivés trop tard, ceux qui ont posé leur valise sur le trottoir et se sont assis dessus pour s’éponger le front. Mais tu n’as plus besoin d’excuses, de regrets, de nostalgies. Tu ne rejettes rien, tu ne refuses rien. Tu as cessé d’avancer, mais c’est que tu n’avançais pas, tu ne repars pas, tu es arrivé, tu ne vois pas ce que tu irais faire plus loin : il a suffi, il a presque suffi, un jour de mai où il faisait trop chaud, de l’inopportune conjonction d’un texte dont tu avais perdu le fil, d’un bol de Nescafé au goût soudain trop amer, et d’une bassine de matière plastique rose remplie d’une eau noirâtre où flottaient six chaussettes, pour que quelque chose se casse, s’altère, se défasse, et qu’apparaisse au grand jour – mais le jour n’est jamais grand dans la chambre de bonne de la rue Saint-Honoré – cette vérité décevante, triste et ridicule comme un bonnet d’âne, lourde comme un dictionnaire Gaffiot : tu n’as pas envie de poursuivre, ni de te défendre, ni d’attaquer.»
Immobile lorsqu’il est à l’intérieur, dans sa chambre de bonne, il dort énormément, fixe la bassine rose dans laquelle trempent ses chaussettes et écoute son voisin à travers la cloison. Quand il sort dans la ville, deuxième lieu du récit, cet extérieur n’a pas plus de sens, et ses marches sans but en ville ne semblent pas davantage rattachées à la réalité que ce lieu insulaire qu’est sa chambre de bonne. Animé de mouvements mécaniques lorsqu’il marche dans les rues sans but, il est le plus souvent seul, silencieux, décroché du réel. Même la lecture du journal, qu’il fait quotidiennement et méthodiquement, sans sauter une seule ligne, a perdu tout son sens.
Dans cette vie de retrait, ses sens s’exacerbent : il regarde fixement les arbres et les rues, toutes ces choses qui n’ont plus de sens. Il est fasciné par son propre détachement qui ne débouche sur rien, un chemin sans issue.
Quel est le sens de la dissolution de ce héros apathique, cousin de Bartleby ou d’Oblomov, de cette tentative d’épuisement d’une vie où il ne se passe rien ? Est-ce le récit d’une résistance ou d’une dépression ? L’écriture de Perec, aux phrases répétitives en forme de litanie, au lieu de donner vie à une réalité nous en détache et fascine. Ce récit au ton neutre, rapidement hypnotique, comme il est rédigé à la deuxième personne, inclut le lecteur – toi -, tout autant que l’auteur et le protagoniste, dans cette indifférenciation qui touche les lieux, le passage du temps et les êtres.
Roman hors de la réalité, hors du temps, il semble que cet «Homme qui dort» ne prendra jamais une ride.
«Un homme qui dort» fut adapté en long métrage au cinéma en 1974 par Georges Perec et Bernard Queysanne.
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/09/05/note-de-lecture-un-homme-qui-dort-georges-perec/
En épigraphe à «Un homme qui dort», publié en 1967 juste après «Les choses», on peut lire cet extrait des Méditations sur le péché de Franz Kafka :
«Il n’est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à table et écoute. N’écoute même pas, attends seulement. N’attends même pas, sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s’offrir à toi pour que tu le démasques, il ne peut faire autrement, extasié, il se tordra devant toi.»
Alors qu’il doit aller passer un examen un matin, un jeune homme, un étudiant sans nom, ne se lève tout simplement pas. À partir de ce geste, ou de cette absence de geste, il se détache du monde, devient indifférent à ce monde qu’il ne reconnaît plus ; il veut tout accomplir sans y accorder ni la moindre valeur ou la moindre émotion, comme si chaque action - manger, s’habiller - n’avait plus qu’une visée fonctionnelle, comme si chaque geste devait être neutre, minimal. Et d’ailleurs il ne parle presque plus, sauf pour exprimer le strict nécessaire.
«La ténacité, l’initiative, le coup d’éclat, le triomphe tracent le chemin trop limpide d’une vie trop modèle, dessinent les sacro-saintes images de la lutte pour la vie. Les pieux mensonges qui bercent les rêves de tous ceux qui piétinent et s’embourbent, les illusions perdues des milliers de laissés-pour-compte, ceux qui sont arrivés trop tard, ceux qui ont posé leur valise sur le trottoir et se sont assis dessus pour s’éponger le front. Mais tu n’as plus besoin d’excuses, de regrets, de nostalgies. Tu ne rejettes rien, tu ne refuses rien. Tu as cessé d’avancer, mais c’est que tu n’avançais pas, tu ne repars pas, tu es arrivé, tu ne vois pas ce que tu irais faire plus loin : il a suffi, il a presque suffi, un jour de mai où il faisait trop chaud, de l’inopportune conjonction d’un texte dont tu avais perdu le fil, d’un bol de Nescafé au goût soudain trop amer, et d’une bassine de matière plastique rose remplie d’une eau noirâtre où flottaient six chaussettes, pour que quelque chose se casse, s’altère, se défasse, et qu’apparaisse au grand jour – mais le jour n’est jamais grand dans la chambre de bonne de la rue Saint-Honoré – cette vérité décevante, triste et ridicule comme un bonnet d’âne, lourde comme un dictionnaire Gaffiot : tu n’as pas envie de poursuivre, ni de te défendre, ni d’attaquer.»
Immobile lorsqu’il est à l’intérieur, dans sa chambre de bonne, il dort énormément, fixe la bassine rose dans laquelle trempent ses chaussettes et écoute son voisin à travers la cloison. Quand il sort dans la ville, deuxième lieu du récit, cet extérieur n’a pas plus de sens, et ses marches sans but en ville ne semblent pas davantage rattachées à la réalité que ce lieu insulaire qu’est sa chambre de bonne. Animé de mouvements mécaniques lorsqu’il marche dans les rues sans but, il est le plus souvent seul, silencieux, décroché du réel. Même la lecture du journal, qu’il fait quotidiennement et méthodiquement, sans sauter une seule ligne, a perdu tout son sens.
Dans cette vie de retrait, ses sens s’exacerbent : il regarde fixement les arbres et les rues, toutes ces choses qui n’ont plus de sens. Il est fasciné par son propre détachement qui ne débouche sur rien, un chemin sans issue.
Quel est le sens de la dissolution de ce héros apathique, cousin de Bartleby ou d’Oblomov, de cette tentative d’épuisement d’une vie où il ne se passe rien ? Est-ce le récit d’une résistance ou d’une dépression ? L’écriture de Perec, aux phrases répétitives en forme de litanie, au lieu de donner vie à une réalité nous en détache et fascine. Ce récit au ton neutre, rapidement hypnotique, comme il est rédigé à la deuxième personne, inclut le lecteur – toi -, tout autant que l’auteur et le protagoniste, dans cette indifférenciation qui touche les lieux, le passage du temps et les êtres.
Roman hors de la réalité, hors du temps, il semble que cet «Homme qui dort» ne prendra jamais une ride.
«Un homme qui dort» fut adapté en long métrage au cinéma en 1974 par Georges Perec et Bernard Queysanne.
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/09/05/note-de-lecture-un-homme-qui-dort-georges-perec/
J'ai essayé sérieusement et à plusieurs reprises de le lire, mais à chaque fois le livre m'est tombé des mains... et quand je lis dans un commentaire qu'il est un peu lent et fastidieux sur la fin qui présente des longueurs, ai-je à le regretter ?
Je ne doute pas qu'il présente quelque intérêt, mais m'astreindre à subir ce que j'ai ressenti personnellement comme un voyeurisme, pour trouver ici et là une petite jouissance... non. De toute façon j'ai réglé la question, je m'en suis dépossédée, ainsi il ne me narguera plus (car il sait que je déteste ne pas achever une lecture commencée).
La lecture est un plaisir alors, lorsque ça ne passe pas, pourquoi s'obstiner ?
Je ne doute pas qu'il présente quelque intérêt, mais m'astreindre à subir ce que j'ai ressenti personnellement comme un voyeurisme, pour trouver ici et là une petite jouissance... non. De toute façon j'ai réglé la question, je m'en suis dépossédée, ainsi il ne me narguera plus (car il sait que je déteste ne pas achever une lecture commencée).
La lecture est un plaisir alors, lorsque ça ne passe pas, pourquoi s'obstiner ?
Quand se sont succédées plusieurs lectures un peu sombres, j’ai plaisir et besoin de me plonger dans des lectures plus rafraîchissantes. Et le domaine de l’absurde est souvent une valeur sûre. C’est donc avec délice que je me suis jetée sur un tout petit roman d’un des maîtres de l’Oulipo (« ouvroir de littérature potentielle », mouvement littéraire qui naquit au XXe s pour ceux qui ne connaîtraient pas).
En triant les livres de ma grand-mère (qui s’appelait Berthe et qui n’avait pas de grands pieds) je tombais récemment sur ce minuscule roman (mais sans me faire mal heureusement, je vous rassure). « Super » me dis-je, un roman de Georges Perec que je ne connais pas (vous ai-je dit que j’appréciais particulièrement les écrits des membres de l’Oulipo, groupement d’auteurs qui naquit dans les années commençant par 19).
Or donc, afin de remplir les cases d’un ou plutôt de plusieurs challenges et de m'aérer les neurones un peu tristounets des précédentes lectures, voilà-t-y pas que j’me dis qu’c’est p’tète ben le moment de sortir ce p'tit bouquin de 111 pages écrit en 1966 par l’un des maîtres de ce mouvement d’écrivains du siècle dernier (vous ai-je dit à quel point je me régale du brin de folie des écrivains et écrivaines qui participent à l’Oulipo) (vous pouvez reprendre votre respiration).
Et quel plaisir que celui de lire cet ouvrage miniature écrit par celui qui réussit l’exploit d’écrire un roman de 300 pages sans que n’y apparaisse une seule fois la lettre « e », mais je m’égare, je m’égare.
Bref, n’est pas Georges Perec qui veut, (et moi la première). Aussi je clôturerai cette chronique en vous dévoilant quand même que derrière l’exercice d’écriture auquel s’est livré l’auteur (on trouve en fin de livre un « index des fleurs et ornements rhétoriques", et, plus précisément des métaboles et parataxes que l’auteur a identifié dans son texte ) se cache l’histoire d’un appelé du contingent qui est sur les listes des soldats envoyés faire la guerre en Algérie et de ses copains qui vont tenter de l’aider à échapper à ce funeste sort.
Le ton est joyeux, enlevé, l’écriture magistrale et c’est un moment de pur bonheur.
En triant les livres de ma grand-mère (qui s’appelait Berthe et qui n’avait pas de grands pieds) je tombais récemment sur ce minuscule roman (mais sans me faire mal heureusement, je vous rassure). « Super » me dis-je, un roman de Georges Perec que je ne connais pas (vous ai-je dit que j’appréciais particulièrement les écrits des membres de l’Oulipo, groupement d’auteurs qui naquit dans les années commençant par 19).
Or donc, afin de remplir les cases d’un ou plutôt de plusieurs challenges et de m'aérer les neurones un peu tristounets des précédentes lectures, voilà-t-y pas que j’me dis qu’c’est p’tète ben le moment de sortir ce p'tit bouquin de 111 pages écrit en 1966 par l’un des maîtres de ce mouvement d’écrivains du siècle dernier (vous ai-je dit à quel point je me régale du brin de folie des écrivains et écrivaines qui participent à l’Oulipo) (vous pouvez reprendre votre respiration).
Et quel plaisir que celui de lire cet ouvrage miniature écrit par celui qui réussit l’exploit d’écrire un roman de 300 pages sans que n’y apparaisse une seule fois la lettre « e », mais je m’égare, je m’égare.
Bref, n’est pas Georges Perec qui veut, (et moi la première). Aussi je clôturerai cette chronique en vous dévoilant quand même que derrière l’exercice d’écriture auquel s’est livré l’auteur (on trouve en fin de livre un « index des fleurs et ornements rhétoriques", et, plus précisément des métaboles et parataxes que l’auteur a identifié dans son texte ) se cache l’histoire d’un appelé du contingent qui est sur les listes des soldats envoyés faire la guerre en Algérie et de ses copains qui vont tenter de l’aider à échapper à ce funeste sort.
Le ton est joyeux, enlevé, l’écriture magistrale et c’est un moment de pur bonheur.
C'est le chef d'oeuvre de Perec, magicien des mots et des histoires.
Romans (!)
Avec l'histoire d'un puzzle qui s'assemble puis, d'un coup se volatilise.
Un travail d'art, consommé et intense.
Romans (!)
Avec l'histoire d'un puzzle qui s'assemble puis, d'un coup se volatilise.
Un travail d'art, consommé et intense.
Je viens de relire le roman intitulé « Les choses » et, dès les premières pages, j’ai senti la "patte" de Georges Pérec, écrivain inclassable et particulièrement original.
C’est l’histoire de deux jeunes gens, Sylvie et Jérôme. En fait, non: ce n’est pas vraiment une histoire, et le livre ne correspond pas au prototype du roman. C’est plutôt une description très minutieuse de la vie quotidienne que menaient ces deux Parisiens dans les années ’60, et de tout ce qui les préoccupait: leurs projets, leurs aspirations, leurs amis, leurs sorties au restaurant ou au bar, leurs achats, etc… et accessoirement leur métier (ils sont tous deux psychosociologues). L’argent et les soucis d’argent étaient souvent leur souci principal: « Quand ils étaient un peu riches, quand ils avaient un peu d’avance, leur bonheur était indestructible (…) Mais aux premiers signes de déficit, il n’était pas rare qu’ils se dressent l’un contre l’autre ». Vivant au jour le jour, ils étaient hédonistes, velléitaires et matérialistes. Mais leur état d’esprit se dégradait. Comme le note G. Pérec: « Ils étaient las. Ils avaient vieilli, oui. Ils avaient l’impression, certains jours, qu’ils n’avaient pas encore commencé à vivre ». Cette insatisfaction floue s’incrustait dans leur quotidien; les liens avec leurs amis se distendaient; l’ennui s’installait; ils s’étaient enfermés dans une impasse. L’auteur imagine alors une sorte de "fuite" hors de Paris, Sylvie enseignant à des jeunes Tunisiens et son conjoint étant contraint à l’oisiveté. Mais ce séjour ne fut qu’une parenthèse, avant le retour en France et l’entrée définitive dans une vie aisée et résolument conventionnelle. Ces jeunes gens, que l’on désignerait peut-être désormais sous la dénomination de "bobos", représentent une génération qui a cru inventer un nouveau mode de vie, mais qui a fini par être absorbée par la société de consommation et a été rattrapée par le conformisme ambiant.
Il faut particulièrement remarquer l’écriture de l’auteur: il évite absolument de faire la narration d’épisodes particuliers dans la vie des protagonistes; la conjugaison presque systématique des verbes à l’imparfait a pour effet d'abolir volontairement l’événementiel. G. Pérec nous propose plutôt une description générale d’un mode de vie et d’une certaine mentalité, sans empathie particulière pour les deux "héros". Le style est particulier, aussi: il favorise une prise de distance du lecteur par rapport aux personnages. Dans l’ensemble le livre est assez austère, ses références peuvent paraitre datées et cette oeuvre risque de déstabiliser les lecteurs de romans ordinaires. Il mérite pourtant d’être lu, comme un objet littéraire vraiment à part.
C’est l’histoire de deux jeunes gens, Sylvie et Jérôme. En fait, non: ce n’est pas vraiment une histoire, et le livre ne correspond pas au prototype du roman. C’est plutôt une description très minutieuse de la vie quotidienne que menaient ces deux Parisiens dans les années ’60, et de tout ce qui les préoccupait: leurs projets, leurs aspirations, leurs amis, leurs sorties au restaurant ou au bar, leurs achats, etc… et accessoirement leur métier (ils sont tous deux psychosociologues). L’argent et les soucis d’argent étaient souvent leur souci principal: « Quand ils étaient un peu riches, quand ils avaient un peu d’avance, leur bonheur était indestructible (…) Mais aux premiers signes de déficit, il n’était pas rare qu’ils se dressent l’un contre l’autre ». Vivant au jour le jour, ils étaient hédonistes, velléitaires et matérialistes. Mais leur état d’esprit se dégradait. Comme le note G. Pérec: « Ils étaient las. Ils avaient vieilli, oui. Ils avaient l’impression, certains jours, qu’ils n’avaient pas encore commencé à vivre ». Cette insatisfaction floue s’incrustait dans leur quotidien; les liens avec leurs amis se distendaient; l’ennui s’installait; ils s’étaient enfermés dans une impasse. L’auteur imagine alors une sorte de "fuite" hors de Paris, Sylvie enseignant à des jeunes Tunisiens et son conjoint étant contraint à l’oisiveté. Mais ce séjour ne fut qu’une parenthèse, avant le retour en France et l’entrée définitive dans une vie aisée et résolument conventionnelle. Ces jeunes gens, que l’on désignerait peut-être désormais sous la dénomination de "bobos", représentent une génération qui a cru inventer un nouveau mode de vie, mais qui a fini par être absorbée par la société de consommation et a été rattrapée par le conformisme ambiant.
Il faut particulièrement remarquer l’écriture de l’auteur: il évite absolument de faire la narration d’épisodes particuliers dans la vie des protagonistes; la conjugaison presque systématique des verbes à l’imparfait a pour effet d'abolir volontairement l’événementiel. G. Pérec nous propose plutôt une description générale d’un mode de vie et d’une certaine mentalité, sans empathie particulière pour les deux "héros". Le style est particulier, aussi: il favorise une prise de distance du lecteur par rapport aux personnages. Dans l’ensemble le livre est assez austère, ses références peuvent paraitre datées et cette oeuvre risque de déstabiliser les lecteurs de romans ordinaires. Il mérite pourtant d’être lu, comme un objet littéraire vraiment à part.
Le meilleur moyen de lutter contre la maladie d’Alzheimer, c'est peut-être encore d'écrire... C'est un régal que ces petites phrases riches de sens et de mémoire. Une sorte de journal intime, de mémento des moments de la vie, bons comme moins bons. J'ai essayé personnellement de pratiquer l’exercice et j'en suis ressortie enrichie d’expériences que je croyais avoir oubliées ou mal vécues. Je conseille à chacun d'essayer, cela nous emmène beaucoup plus loin qu'il n'y paraît. Et quel amour de la vie en surgit, envers et contre tout !
Plus que la simple critique de la société de consommation à laquelle on le résume parfois , ce livre est plus généralement le portrait d'éternels insatisfaits, incapable de prendre une décision et qui cherchent toujours à leur mal -être une raison extérieure: ça sera mieux quand on aura de l'argent, ça sera mieux quand on quittera Paris, ça sera mieux quand on reviendra à Paris...
Le portrait de conformistes à la vision étriquée formatée par leurs lectures, leurs présupposés, leurs fréquentations, et pour qui le bonheur est "comme on leur a dit qu'il doit être" et pas autrement, et qui passent à côté de tout à force de trop idéaliser ce bonheur. Un livre assez inconfortable en ce qu'il renvoie le lecteur à ses propres marottes, avec une écriture étouffante de détails et surchargée de descriptions qui colle parfaitement au thème de la quête du bonheur dans la surabondance, du bonheur conditionné. Bref, une "histoire des années soixante" toujours terriblement actuelle.
Le portrait de conformistes à la vision étriquée formatée par leurs lectures, leurs présupposés, leurs fréquentations, et pour qui le bonheur est "comme on leur a dit qu'il doit être" et pas autrement, et qui passent à côté de tout à force de trop idéaliser ce bonheur. Un livre assez inconfortable en ce qu'il renvoie le lecteur à ses propres marottes, avec une écriture étouffante de détails et surchargée de descriptions qui colle parfaitement au thème de la quête du bonheur dans la surabondance, du bonheur conditionné. Bref, une "histoire des années soixante" toujours terriblement actuelle.
"Je prie les choses et les choses m'ont pris
Elles me posent, elles me donnent un prix
Je prie les choses, elles comblent ma vie
C'est plus "je pense" mais "j'ai, donc je suis""
chante Jean-Jacques Goldman cinquante ans après la parution du livre de Georges Pérec. Lors de sa parution en 1965, Les choses devait être un OVNI littéraire, entre roman et essai sociologique, avec Sylvie et Jérome, des anti-héros sans grand destin, noyés sur leur envie de choses et d'autre chose, mais quoi ? Telle est la question.
Elles me posent, elles me donnent un prix
Je prie les choses, elles comblent ma vie
C'est plus "je pense" mais "j'ai, donc je suis""
chante Jean-Jacques Goldman cinquante ans après la parution du livre de Georges Pérec. Lors de sa parution en 1965, Les choses devait être un OVNI littéraire, entre roman et essai sociologique, avec Sylvie et Jérome, des anti-héros sans grand destin, noyés sur leur envie de choses et d'autre chose, mais quoi ? Telle est la question.
Un petit livre, mais une belle réflexion sur le manque de véritables projets de ces jeunes adultes des années 60. le livre, publié vers 1966, s'arrête un peu avant 68, mais ce que sont devenus une bonne partie des soixante-huitards les aurait sans doute achevés. Plus que la société de consommation, c'est l'abondance relative et les modèles, plus riches de biens matériels que d'idéaux, qui tuent l'enthousiasme de leur jeunesse. L' écriture est très originale et expressive. Comme à chaque fois qu'il ne se passe pas grand chose, on peut trouver des longueurs mais avec à peine 160 pages, le risque est limité. C'est un texte assez troublant que j'ai bien aimé. J'hésite quand même à le lancer dans la vie mode d'emploi, craignant d'avoir du mal à tenir la distance.
Dans ce roman oulipien, Georges Perec ne s'embarrasse pas de certains codes habituels du roman, notamment de l'existence d'une intrigue. Cela amuse certains lecteurs, mais pas moi ; alors j'ai vite passé mon chemin, après quelques dizaines de pages d'efforts...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Le livre qui vous a bouleversé
Mijouet
136 livres

Petits mais costauds
Gwen21
75 livres
Auteurs proches de Georges Perec
Quiz
Voir plus
Je me souviens de Georges Perec
Quel était le nom d'origine (polonaise) de Georges Perec ?
Perecki
Peretz
Peretscki
Peretzkaia
15 questions
111 lecteurs ont répondu
Thème :
Georges PerecCréer un quiz sur cet auteur111 lecteurs ont répondu