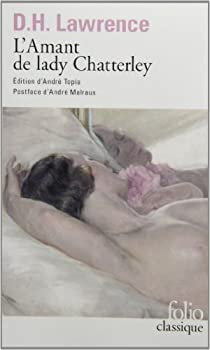>
Critique de Fabinou7
Avertissement au lecteur. Cette critique ne porte pas sur un livre du rayon jeunesse.
Pour l'anecdote, lorsque j'ai voulu acheter le roman en cadeau pour un anniversaire, je ne l'ai pas trouvé au rayon littérature anglaise, en dépit de la présence d'ouvrages moins fameux de l'auteur, et le libraire m'as répondu le plus naturellement du monde, devant quelques bibliophiles interloqués, « ah mais c'est au rayon littérature érotique ! suivez-moi » #walkofshame.
***
« We fucked a flame into being ». J'ai lu que ce roman était sulfureux. Je me suis dit bon, dans le contexte de l'époque, une cheville qui dépassait et le Parquet de Paris était saisi, attendons de lire.
Quelle ne fut pas ma surprise, en découvrant qu'effectivement le roman n'avait pas volé sa réputation. Des années plus tard, Tennessee Williams, faisait d'ailleurs hurler le personnage de la mère chrétienne, dans La « Ménagerie de Verre » à l'encontre des lectures de son fils Tom :
« TOM: Yesterday you confiscated my books! You had the nerve to—
AMANDA: I did. I took that horrible novel back to the library—That hideous book by that insane Mr. Lawrence. But I won't allow such filth brought into my house!”
Il fallut un procès dans les années soixante pour mettre fin à une censure de près de quarante ans en Angleterre. Nous ne devons ce chef-d'oeuvre de la littérature qu'à l'obstination d'un homme préférant sa liberté d'expression d'artiste à une carrière plus lucrative.
Dès 1929, un an après la parution du livre, et un an avant sa mort, David Herbert Lawrence se défendait point par point et alertait sur la vision « grise » et hypocrite de ceux qui condamnent l'érotisme, dans son essai testamentaire « Pornographie et obscénité », renvoyant du côté de la publicité la vision dégradante, dissimulée et honteuse de la sensualité. L'écrivain recommandait notamment « une attitude fraiche et naturelle, sans complexe, envers le sexe » comme « le seul remède à l'heure où nous pataugeons, plus ou moins ouvertement, dans l'inondation pornographique. ».
On pourrait ajouter, pour abonder dans le sens de l'auteur, que nous vivons dans une époque soit hypocrite, soit schizophrène : les interdits moraux de notre société (adultère, plaisirs sexuels, prostitution, libertaires, révolutionnaires, fumeurs de cannabis…) sont précisément ceux qui sont célébrés à longueur de temps par la littérature, la peinture, le cinéma, la musique, les séries télé, la publicité, les célébrités…De Madame Bovary à Pretty Woman ou Titanic, de Bob Marley à Che Guevara.
***
Le personnage, Constance Chatterley, fait montre de cette fraicheur chère à l'auteur britannique, elle cherche d'abord à prendre du plaisir d'une façon presque ingénue. Elle ne porte pas la chape de plomb morale des gens de son temps et fait peu de cas des conventions sociales, qu'elle n'ignore cependant pas. Ce n'est pas un esprit provocateur ou pervers, en réalité sa quête de plaisir, elle la mène par simple « bon sens ». C'est avec amusement que je me remémore ce mélange de candeur et de pugnacité qui fait son caractère.
Puis il y a l'amant de Lady Chatterley. Mais lequel ? Car l'histoire est un petit peu plus complexe, et heureusement, que ce que suggère le titre. Il y a l'amant d'avant le mariage de Constance avec Sir Clifford, puis l'amant de la bonne société, Michaelis, aux moyens duquel elle doit chercher son plaisir par ses propres audaces, et c'est d'ailleurs l'occasion de pages sur la jouissance féminine proprement inéditeset enfin l'Amant (il n'est pas de la Chine du nord, mais du comté de Tevershall) : Oliver Mellors le « game-keeper ».
C'est là que le second sujet se superpose à la quête de jouissance, à la naissance du sentiment amoureux, c'est la transgression seconde, l'aristocrate qui s'éprend du garde-chasse. Car là sont bien les deux transgressions du roman de Lady Chatterley. L'adultère n'en est pas un dans cette oeuvre, la proposition de Clifford, impuissant, à Constance en témoigne. Il lui propose d'être en quelque sorte en couple libre, lui souhaitant d'avoir une vie épanouie, et soulignant que la vie à deux sur le long terme ne peut être menacée par quelques relations sexuelles avec un tiers, cela ne compte pas.
La transgression de classe est reflétée par les nombreux échanges entre les personnages qui sont l'occasion pour Lawrence de livrer son analyse sociologique et sociétale de l'Angleterre d'entre-deux guerres. Sir Clifford aime faire la conversation à sa femme. de ces conversations émergent deux positions, Clifford est pour un ordre immuable, et pour la persistance des classes sociales et des apparences, on se demande d'ailleurs s'il n'a jamais vraiment aimé sa femme pour ce qu'elle est, quand Connie n'est pas seulement libérale, mais libertaire. Si elle a l'impression de dépérir à Wragby, le domaine du couple, elle reste pleine d'espoir et va se construire dans les bois, dans ce retour à la nature, loin des mineurs et de l'industrialisation des masses qui la dégoûte, où elle retrouve Mellors, comme immuable.
Le personnage n'est pas le garde-chasse du coin avec son accent à couper au couteau et son dialecte local. Sous ses faux airs sauvages, c'est un homme raffiné, qui a grandi avec les livres, mais qui est devenu narquois et un peu aigri, nous pourrions dire : nihiliste. Il est toujours celui qui contraste avec ses empressements, il la calme, sans la freiner. Connie certes est empressée et enthousiaste mais elle n'est ni capricieuse, ni immature. Elle observe les faits, elle est ingénieuse, et pour elle tout problème a une solution, c'est d'ailleurs elle qui prend le leadership de leur relation. Et quand ils ne font pas l'amour ils en parlent.
Il y a des scènes qui prêtent à sourire, quand Connie observe avec gourmandise « l'amant » – en fait elle le « mate » - en pleine toilette, torse nu dans son modeste jardin (façon « Samantha Jones ») ou encore lorsqu'elle juge son corps, face au miroir (dans une scène qui rappelle anachroniquement Meryl Streep dans « Sur la Route de Madison »).
Roman moderne et plus subtil qu'il n'y parait, pas seulement la diapo d'une Angleterre en pleine industrialisation, d'une femme assumant son plaisir, mais toute la nuance d'une rencontre loin du romantisme mielleux, une rencontre physique des corps, une rencontre des atomes, des phéromones, où l'on dit des bêtises, où l'on se contredit, où l'on doute aussi de ses sentiments, où l'on pense aussi pendant qu'on jouit, où rien n'est automatique : c'est un roman réaliste.
***
“Sex is just another form of talk, where you act the words instead of saying them » D.H Lawrence, qui inspirera la littérature libertine du XXème siècle, d'Anaïs Nin à Henry Miller, est l'exact opposé De Lamartine en ce sens que le sexe est premier alors qu'il est absent chez Lamartine. Mais ce n'est pas une vision hédoniste du sexe à la Kundera ou une vision jugée morbide, par Michel Onfray notamment (Théorie du Corps Amoureux, le Souci des Plaisirs), chez Sade ou Bataille. C'est encore autre chose, une quête du plaisir réciproque et de la jouissance commune des amants, de la découverte des corps et des sens avec pudeur mais sans crainte de nommer les choses, de donner voix au chapitre du désir. On va, comme rarement en littérature, aux confins d'une intimité, d'une altérité, sans pour cela être dans la surenchère du fantasme ou de la perversion. C'est l'intimité nue, pour ce qu'elle est, sans plus.
“I can't see I do a woman any more harm by sleeping with her than by dancing with her...or even talking to her about the weather. It's just an interchange of sensations instead of ideas, so why not?” Il y a une approche plus candide que séductrice. Quelque chose de naïf, spontané, de « normal » et un refus de toute psychanalyse autour du sexe. Tout ne tourne pas autour du « it » ou « ça » freudien.
Le style de Lawrence est plutôt simple. Il y a quelque chose de maladroit, de répétitif, parfois certains passages vous tomberont des mains, mais aussi quelque chose de direct, de fluide, on passe du monologue intérieur au dialogue ou à la relation épistolaire sans transition. Sa technique c'est la réécriture du roman dans son entier, plusieurs fois (il existe en effet plusieurs versions publiées).
Pour ces raisons-là, celles et ceux qui ont un petit niveau d'anglais ou « wordwise » sur leur liseuse, la version anglaise est assez facile à lire. J'attire votre attention sur certaines traductions qui ont fait le choix (j'ai pu le vérifier) de traduire certains mots, volontairement familiers, dans un langage plus neutre ce qui me semble dénaturer pour partie les personnages. Dans la version originale, Mellors parle un « patois » local et certains choix d'éditeurs le font s'exprimer dans une langue tout à fait courante ce qui trahit le roman car ce n'est pas un hasard si le garde-chasse s'exprime – parfois – dans ce dialecte et ce n'est pas neutre pour ses interlocuteurs.
« The world is supposed to be full of possibilities, but they narrow down to pretty few in most personal experience. » Se glisse aussi une réflexion sombre de l'auteur sur la modernité industrielle et sur les inégalités que répète la modernité, une charge contre les machines, contre une jeunesse, celle des années folles, corrompue par l'argent et le consumérisme « the young ones get mad because they've no money to spend. Their whole life depends on spending money, and now they've got none to spend […] If you could only tell them that living and spending isn't the same thing!”
C'est aussi le roman du désir féminin, tant et si bien qu'une lectrice me confiait avoir d'abord cru que l'auteur était une femme. Dans cette capacité à comprendre la femme dans ses ressorts les plus singuliers, qui en fait un auteur profondément intriguant, peut-être que D.H Lawrence « sort du bois ». Car paradoxalement, si son héroïne est une femme, c'est sur le corps de Mellors, sur son charme que s'attarde le plus l'auteur. Ce sont les descriptions des hommes, notamment Clifford et Mellors qu'il réussit le mieux, comme s'il était séduit avec Connie du corps blanc et sec, des cheveux rougeoyants et des reins sculptés du garde-chasse.
Pour ma part, j'avais condamné depuis longtemps l'éclosion de cette « flamme de pentecôte », mais c'est un roman qui va vers la lumière, alors même que son auteur vit ses derniers mois, emporté par la tuberculose à quarante-quatre ans. C'est formidablement émouvant et, en repensant à « John Thomas » et « Lady Jane » je me réjouis bien de mon erreur.
“il n'y a pas d'amour heureux” écrivit Aragon. C'est beau mais c'est faux.
***
Pour l'anecdote, lorsque j'ai voulu acheter le roman en cadeau pour un anniversaire, je ne l'ai pas trouvé au rayon littérature anglaise, en dépit de la présence d'ouvrages moins fameux de l'auteur, et le libraire m'as répondu le plus naturellement du monde, devant quelques bibliophiles interloqués, « ah mais c'est au rayon littérature érotique ! suivez-moi » #walkofshame.
***
« We fucked a flame into being ». J'ai lu que ce roman était sulfureux. Je me suis dit bon, dans le contexte de l'époque, une cheville qui dépassait et le Parquet de Paris était saisi, attendons de lire.
Quelle ne fut pas ma surprise, en découvrant qu'effectivement le roman n'avait pas volé sa réputation. Des années plus tard, Tennessee Williams, faisait d'ailleurs hurler le personnage de la mère chrétienne, dans La « Ménagerie de Verre » à l'encontre des lectures de son fils Tom :
« TOM: Yesterday you confiscated my books! You had the nerve to—
AMANDA: I did. I took that horrible novel back to the library—That hideous book by that insane Mr. Lawrence. But I won't allow such filth brought into my house!”
Il fallut un procès dans les années soixante pour mettre fin à une censure de près de quarante ans en Angleterre. Nous ne devons ce chef-d'oeuvre de la littérature qu'à l'obstination d'un homme préférant sa liberté d'expression d'artiste à une carrière plus lucrative.
Dès 1929, un an après la parution du livre, et un an avant sa mort, David Herbert Lawrence se défendait point par point et alertait sur la vision « grise » et hypocrite de ceux qui condamnent l'érotisme, dans son essai testamentaire « Pornographie et obscénité », renvoyant du côté de la publicité la vision dégradante, dissimulée et honteuse de la sensualité. L'écrivain recommandait notamment « une attitude fraiche et naturelle, sans complexe, envers le sexe » comme « le seul remède à l'heure où nous pataugeons, plus ou moins ouvertement, dans l'inondation pornographique. ».
On pourrait ajouter, pour abonder dans le sens de l'auteur, que nous vivons dans une époque soit hypocrite, soit schizophrène : les interdits moraux de notre société (adultère, plaisirs sexuels, prostitution, libertaires, révolutionnaires, fumeurs de cannabis…) sont précisément ceux qui sont célébrés à longueur de temps par la littérature, la peinture, le cinéma, la musique, les séries télé, la publicité, les célébrités…De Madame Bovary à Pretty Woman ou Titanic, de Bob Marley à Che Guevara.
***
Le personnage, Constance Chatterley, fait montre de cette fraicheur chère à l'auteur britannique, elle cherche d'abord à prendre du plaisir d'une façon presque ingénue. Elle ne porte pas la chape de plomb morale des gens de son temps et fait peu de cas des conventions sociales, qu'elle n'ignore cependant pas. Ce n'est pas un esprit provocateur ou pervers, en réalité sa quête de plaisir, elle la mène par simple « bon sens ». C'est avec amusement que je me remémore ce mélange de candeur et de pugnacité qui fait son caractère.
Puis il y a l'amant de Lady Chatterley. Mais lequel ? Car l'histoire est un petit peu plus complexe, et heureusement, que ce que suggère le titre. Il y a l'amant d'avant le mariage de Constance avec Sir Clifford, puis l'amant de la bonne société, Michaelis, aux moyens duquel elle doit chercher son plaisir par ses propres audaces, et c'est d'ailleurs l'occasion de pages sur la jouissance féminine proprement inéditeset enfin l'Amant (il n'est pas de la Chine du nord, mais du comté de Tevershall) : Oliver Mellors le « game-keeper ».
C'est là que le second sujet se superpose à la quête de jouissance, à la naissance du sentiment amoureux, c'est la transgression seconde, l'aristocrate qui s'éprend du garde-chasse. Car là sont bien les deux transgressions du roman de Lady Chatterley. L'adultère n'en est pas un dans cette oeuvre, la proposition de Clifford, impuissant, à Constance en témoigne. Il lui propose d'être en quelque sorte en couple libre, lui souhaitant d'avoir une vie épanouie, et soulignant que la vie à deux sur le long terme ne peut être menacée par quelques relations sexuelles avec un tiers, cela ne compte pas.
La transgression de classe est reflétée par les nombreux échanges entre les personnages qui sont l'occasion pour Lawrence de livrer son analyse sociologique et sociétale de l'Angleterre d'entre-deux guerres. Sir Clifford aime faire la conversation à sa femme. de ces conversations émergent deux positions, Clifford est pour un ordre immuable, et pour la persistance des classes sociales et des apparences, on se demande d'ailleurs s'il n'a jamais vraiment aimé sa femme pour ce qu'elle est, quand Connie n'est pas seulement libérale, mais libertaire. Si elle a l'impression de dépérir à Wragby, le domaine du couple, elle reste pleine d'espoir et va se construire dans les bois, dans ce retour à la nature, loin des mineurs et de l'industrialisation des masses qui la dégoûte, où elle retrouve Mellors, comme immuable.
Le personnage n'est pas le garde-chasse du coin avec son accent à couper au couteau et son dialecte local. Sous ses faux airs sauvages, c'est un homme raffiné, qui a grandi avec les livres, mais qui est devenu narquois et un peu aigri, nous pourrions dire : nihiliste. Il est toujours celui qui contraste avec ses empressements, il la calme, sans la freiner. Connie certes est empressée et enthousiaste mais elle n'est ni capricieuse, ni immature. Elle observe les faits, elle est ingénieuse, et pour elle tout problème a une solution, c'est d'ailleurs elle qui prend le leadership de leur relation. Et quand ils ne font pas l'amour ils en parlent.
Il y a des scènes qui prêtent à sourire, quand Connie observe avec gourmandise « l'amant » – en fait elle le « mate » - en pleine toilette, torse nu dans son modeste jardin (façon « Samantha Jones ») ou encore lorsqu'elle juge son corps, face au miroir (dans une scène qui rappelle anachroniquement Meryl Streep dans « Sur la Route de Madison »).
Roman moderne et plus subtil qu'il n'y parait, pas seulement la diapo d'une Angleterre en pleine industrialisation, d'une femme assumant son plaisir, mais toute la nuance d'une rencontre loin du romantisme mielleux, une rencontre physique des corps, une rencontre des atomes, des phéromones, où l'on dit des bêtises, où l'on se contredit, où l'on doute aussi de ses sentiments, où l'on pense aussi pendant qu'on jouit, où rien n'est automatique : c'est un roman réaliste.
***
“Sex is just another form of talk, where you act the words instead of saying them » D.H Lawrence, qui inspirera la littérature libertine du XXème siècle, d'Anaïs Nin à Henry Miller, est l'exact opposé De Lamartine en ce sens que le sexe est premier alors qu'il est absent chez Lamartine. Mais ce n'est pas une vision hédoniste du sexe à la Kundera ou une vision jugée morbide, par Michel Onfray notamment (Théorie du Corps Amoureux, le Souci des Plaisirs), chez Sade ou Bataille. C'est encore autre chose, une quête du plaisir réciproque et de la jouissance commune des amants, de la découverte des corps et des sens avec pudeur mais sans crainte de nommer les choses, de donner voix au chapitre du désir. On va, comme rarement en littérature, aux confins d'une intimité, d'une altérité, sans pour cela être dans la surenchère du fantasme ou de la perversion. C'est l'intimité nue, pour ce qu'elle est, sans plus.
“I can't see I do a woman any more harm by sleeping with her than by dancing with her...or even talking to her about the weather. It's just an interchange of sensations instead of ideas, so why not?” Il y a une approche plus candide que séductrice. Quelque chose de naïf, spontané, de « normal » et un refus de toute psychanalyse autour du sexe. Tout ne tourne pas autour du « it » ou « ça » freudien.
Le style de Lawrence est plutôt simple. Il y a quelque chose de maladroit, de répétitif, parfois certains passages vous tomberont des mains, mais aussi quelque chose de direct, de fluide, on passe du monologue intérieur au dialogue ou à la relation épistolaire sans transition. Sa technique c'est la réécriture du roman dans son entier, plusieurs fois (il existe en effet plusieurs versions publiées).
Pour ces raisons-là, celles et ceux qui ont un petit niveau d'anglais ou « wordwise » sur leur liseuse, la version anglaise est assez facile à lire. J'attire votre attention sur certaines traductions qui ont fait le choix (j'ai pu le vérifier) de traduire certains mots, volontairement familiers, dans un langage plus neutre ce qui me semble dénaturer pour partie les personnages. Dans la version originale, Mellors parle un « patois » local et certains choix d'éditeurs le font s'exprimer dans une langue tout à fait courante ce qui trahit le roman car ce n'est pas un hasard si le garde-chasse s'exprime – parfois – dans ce dialecte et ce n'est pas neutre pour ses interlocuteurs.
« The world is supposed to be full of possibilities, but they narrow down to pretty few in most personal experience. » Se glisse aussi une réflexion sombre de l'auteur sur la modernité industrielle et sur les inégalités que répète la modernité, une charge contre les machines, contre une jeunesse, celle des années folles, corrompue par l'argent et le consumérisme « the young ones get mad because they've no money to spend. Their whole life depends on spending money, and now they've got none to spend […] If you could only tell them that living and spending isn't the same thing!”
C'est aussi le roman du désir féminin, tant et si bien qu'une lectrice me confiait avoir d'abord cru que l'auteur était une femme. Dans cette capacité à comprendre la femme dans ses ressorts les plus singuliers, qui en fait un auteur profondément intriguant, peut-être que D.H Lawrence « sort du bois ». Car paradoxalement, si son héroïne est une femme, c'est sur le corps de Mellors, sur son charme que s'attarde le plus l'auteur. Ce sont les descriptions des hommes, notamment Clifford et Mellors qu'il réussit le mieux, comme s'il était séduit avec Connie du corps blanc et sec, des cheveux rougeoyants et des reins sculptés du garde-chasse.
Pour ma part, j'avais condamné depuis longtemps l'éclosion de cette « flamme de pentecôte », mais c'est un roman qui va vers la lumière, alors même que son auteur vit ses derniers mois, emporté par la tuberculose à quarante-quatre ans. C'est formidablement émouvant et, en repensant à « John Thomas » et « Lady Jane » je me réjouis bien de mon erreur.
“il n'y a pas d'amour heureux” écrivit Aragon. C'est beau mais c'est faux.
***