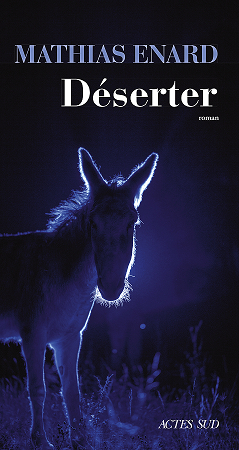>
Critique de berni_29
Aimez-vous les mathématiques ? Croyez-vous en la poésie des mathématiques ? En leur capacité de sauver le monde ?
Déserter, ce sont deux histoires qui se côtoient et s'entrelacent, chapitre après chapitre, se parlent peut-être aussi même si on ne le voit pas au premier abord : celle d'un soldat qui fuit une guerre sans nom et celle d'un mathématicien, qui, après avoir été déporté à Buchenwald, choisit de vivre en Allemagne de l'Est.
Entrant dans ce livre, je suis entré dans un premier récit de guerre. C'est une sorte de guerre, non pas intemporelle, mais une de celles qui ne disent pas leur nom, de celles qui sévirent peut-être en Europe après la seconde guerre mondiale et qui continuent aujourd'hui. On ne sait pas. le mystère demeure entier jusqu'à la fin du récit.
La guerre est ici comme ailleurs, au milieu de ce roman que nous offre Mathias Énard.
Nous découvrons dans ce premier récit un déserteur. J'ai plutôt tendance à les admirer, ces gens-là.
La figure du déserteur a longtemps été identifiée à celui qui trahit. Tout dépend du point de vue où nous nous situons. Si je vous demande, que pensez-vous d'un jeune russe mobilisé sur le front ukrainien et qui déserte comme des milliers l'ont fait, que me direz-vous ? Vous allez immédiatement rendre grâce à cet homme et le qualifier de héros !
Déserter n'est peut-être pas une faute, une lâcheté, mais un geste d'humanité, un art qui fait grandir, semble me dire Mathias Énard.
Je me souviens de cette belle et subversive chanson, celle de Boris Vian, le Déserteur, qui fut d'ailleurs longtemps interdite sur les antennes. Il existe d'ailleurs deux versions différentes du dernier couplet, modifiant sérieusement le sens du propos final.
Le déserteur c'est celui qui dit non, qui résiste et refuse la violence de la guerre.
Cet homme quitte la guerre, fuit dans les montagnes, fuit vers une possible frontière. C'est dans cet espace entre le front et la frontière, entre deux mondes, qu'il va subir une transformation. Dans ce dédale de sentiers et de rochers à flanc de montagne, il va rencontrer une femme paysanne avec son âne, qui fuit elle aussi.
Il y a l'impact de la terreur et de la barbarie sur son corps, mais aussi dans les mots sensuels de Mathias Énard pour dire la guerre, sa violence, son odeur, ses silences.
En parallèle, il raconte l'histoire plus complexe d'un autre homme, Paul Heudeber, brillant mathématicien et poète qui a survécu à son internement au camp de Buchenwald pendant la seconde guerre mondiale.
Mathias Énard nous en délivre un homme touchant dans ses certitudes aussi solides qu'une formule mathématique. Longtemps il a cru en un monde plus juste, plus humain, celui du communisme.
Lui aussi, c'est un déserteur à sa manière.
Il s'est battu toute sa vie sur une utopie, celle que le monde peut devenir meilleur. Jusqu'au bout il aura cru au devenir du communisme, il a cru qu'il fallait passer par un totalitarisme provisoire et nécessaire, tout comme les révolutionnaires de 1793 disaient que la Terreur était nécessaire pour sauver la Révolution Française.
Il est têtu comme un axiome peut l'être.
Les mathématiques sont pour lui l'autre nom de l'espoir.
Ce second récit reposant sur des temporalités très précises est traversé par une histoire d'amour, celle de Paul Heudeber et de Maja. Un enfant naîtra, une fille, Irina, - j'adore ce prénom.
Puis un mur les séparera, le mur de Berlin. Par idéal, Paul Heudeber fera le choix de rester du côté Est, de ne pas suivre celle qu'il aime pourtant et leur enfant, Irina. Mais ils échangeront de magnifiques lettres d'amour et continueront de parler de mathématiques.
Comment imaginer La beauté du monde par les mathématiques ?
Comment se perdre dans la recherche d'une inconnue et ses courbes sinusoïdales ?
Que devient une conjecture écrasée par une certitude ?
La question de l'idéal est sans cesse posée et revisitée dans ce récit à double entrée.
Devenue une femme âgée, Irina ne cesse de questionner l'histoire d'amour opaque de ses parents, opaque à travers des bribes de lettres, d'échanges, de souvenirs qui lui reviennent, de propos des autres personnes qui ont connu ses parents.
Comment peut-on vivre une histoire d'amour de part et d'autre d'un mur érigé sur le terreau de la barbarie et comment leur fille regarde-t-elle par essence quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre et dont elle est pourtant le fruit de cet amour ?
Irina a un regard plus inattendu que ses parents sur le monde et j'ai aimé ses yeux qu'elle pose sur sa vie et ce sentiment qu'elle nous partage...
J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'histoires d'amour ainsi bousculées par les affres de l'Histoires. Je ne sais pas quelle est la probabilité pour que les guerres séparent ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit... Je n'ose pas y penser.
Ce qui couture ces deux récits en apparence dissemblables, c'est peut-être l'impossibilité à sortir de la violence, celle des hommes, de sa propre violence, celle qu'on connaît à peine, qui sommeille dans le tréfond de nos âmes... C'est la fragilité de l'Histoire, de ses traces et de son impossible capacité peut-être à délivrer des injonctions d'humanité pour imaginer un futur désirable.
Ce livre est foisonnant d'érudition et d'inventivité, il convoque pour ma plus grande jubilation ce grand poète, philosophe, mathématicien et amateur d'ivresse au sens large qu'était Omar Khayyam. Quel délice !
Déserter ou ne pas déserter, telle est la question que nous pose Mathias Énard.
Déserter et rester fidèle.
C'est un texte beau, intelligent et vertigineux.
Déserter, ce sont deux histoires qui se côtoient et s'entrelacent, chapitre après chapitre, se parlent peut-être aussi même si on ne le voit pas au premier abord : celle d'un soldat qui fuit une guerre sans nom et celle d'un mathématicien, qui, après avoir été déporté à Buchenwald, choisit de vivre en Allemagne de l'Est.
Entrant dans ce livre, je suis entré dans un premier récit de guerre. C'est une sorte de guerre, non pas intemporelle, mais une de celles qui ne disent pas leur nom, de celles qui sévirent peut-être en Europe après la seconde guerre mondiale et qui continuent aujourd'hui. On ne sait pas. le mystère demeure entier jusqu'à la fin du récit.
La guerre est ici comme ailleurs, au milieu de ce roman que nous offre Mathias Énard.
Nous découvrons dans ce premier récit un déserteur. J'ai plutôt tendance à les admirer, ces gens-là.
La figure du déserteur a longtemps été identifiée à celui qui trahit. Tout dépend du point de vue où nous nous situons. Si je vous demande, que pensez-vous d'un jeune russe mobilisé sur le front ukrainien et qui déserte comme des milliers l'ont fait, que me direz-vous ? Vous allez immédiatement rendre grâce à cet homme et le qualifier de héros !
Déserter n'est peut-être pas une faute, une lâcheté, mais un geste d'humanité, un art qui fait grandir, semble me dire Mathias Énard.
Je me souviens de cette belle et subversive chanson, celle de Boris Vian, le Déserteur, qui fut d'ailleurs longtemps interdite sur les antennes. Il existe d'ailleurs deux versions différentes du dernier couplet, modifiant sérieusement le sens du propos final.
Le déserteur c'est celui qui dit non, qui résiste et refuse la violence de la guerre.
Cet homme quitte la guerre, fuit dans les montagnes, fuit vers une possible frontière. C'est dans cet espace entre le front et la frontière, entre deux mondes, qu'il va subir une transformation. Dans ce dédale de sentiers et de rochers à flanc de montagne, il va rencontrer une femme paysanne avec son âne, qui fuit elle aussi.
Il y a l'impact de la terreur et de la barbarie sur son corps, mais aussi dans les mots sensuels de Mathias Énard pour dire la guerre, sa violence, son odeur, ses silences.
En parallèle, il raconte l'histoire plus complexe d'un autre homme, Paul Heudeber, brillant mathématicien et poète qui a survécu à son internement au camp de Buchenwald pendant la seconde guerre mondiale.
Mathias Énard nous en délivre un homme touchant dans ses certitudes aussi solides qu'une formule mathématique. Longtemps il a cru en un monde plus juste, plus humain, celui du communisme.
Lui aussi, c'est un déserteur à sa manière.
Il s'est battu toute sa vie sur une utopie, celle que le monde peut devenir meilleur. Jusqu'au bout il aura cru au devenir du communisme, il a cru qu'il fallait passer par un totalitarisme provisoire et nécessaire, tout comme les révolutionnaires de 1793 disaient que la Terreur était nécessaire pour sauver la Révolution Française.
Il est têtu comme un axiome peut l'être.
Les mathématiques sont pour lui l'autre nom de l'espoir.
Ce second récit reposant sur des temporalités très précises est traversé par une histoire d'amour, celle de Paul Heudeber et de Maja. Un enfant naîtra, une fille, Irina, - j'adore ce prénom.
Puis un mur les séparera, le mur de Berlin. Par idéal, Paul Heudeber fera le choix de rester du côté Est, de ne pas suivre celle qu'il aime pourtant et leur enfant, Irina. Mais ils échangeront de magnifiques lettres d'amour et continueront de parler de mathématiques.
Comment imaginer La beauté du monde par les mathématiques ?
Comment se perdre dans la recherche d'une inconnue et ses courbes sinusoïdales ?
Que devient une conjecture écrasée par une certitude ?
La question de l'idéal est sans cesse posée et revisitée dans ce récit à double entrée.
Devenue une femme âgée, Irina ne cesse de questionner l'histoire d'amour opaque de ses parents, opaque à travers des bribes de lettres, d'échanges, de souvenirs qui lui reviennent, de propos des autres personnes qui ont connu ses parents.
Comment peut-on vivre une histoire d'amour de part et d'autre d'un mur érigé sur le terreau de la barbarie et comment leur fille regarde-t-elle par essence quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre et dont elle est pourtant le fruit de cet amour ?
Irina a un regard plus inattendu que ses parents sur le monde et j'ai aimé ses yeux qu'elle pose sur sa vie et ce sentiment qu'elle nous partage...
J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'histoires d'amour ainsi bousculées par les affres de l'Histoires. Je ne sais pas quelle est la probabilité pour que les guerres séparent ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit... Je n'ose pas y penser.
Ce qui couture ces deux récits en apparence dissemblables, c'est peut-être l'impossibilité à sortir de la violence, celle des hommes, de sa propre violence, celle qu'on connaît à peine, qui sommeille dans le tréfond de nos âmes... C'est la fragilité de l'Histoire, de ses traces et de son impossible capacité peut-être à délivrer des injonctions d'humanité pour imaginer un futur désirable.
Ce livre est foisonnant d'érudition et d'inventivité, il convoque pour ma plus grande jubilation ce grand poète, philosophe, mathématicien et amateur d'ivresse au sens large qu'était Omar Khayyam. Quel délice !
Déserter ou ne pas déserter, telle est la question que nous pose Mathias Énard.
Déserter et rester fidèle.
C'est un texte beau, intelligent et vertigineux.