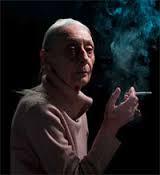Critiques de Nicole-Claude Mathieu (2)
La définition du sexe comporte toujours un aspect stratégique, c’est-à-dire politique, dans la gestion des relations entre les sexes
« La sélection de textes présentée ici recouvre une période d’une vingtaine d’années (1970-1989). »
Sommaire
Introduction
I. Le sexe, évidence fétiche ou concept sociologique ?
Chapitre 1. – Notes pour une définition sociologique des catégories de sexe
Chapitre 2. – Homme-culture et femme-nature ?
Chapitre 3. – Paternité biologique, maternité sociale : de l’avortement et de l’infanticide comme signes non reconnus du caractère culturel de la maternité
Chapitre 4. – Critiques épistémologiques de la problématique des sexes dans le discours ethno-anthropologique
II. Conscience, identités de sexe/genre et production de la connaissance
Chapitre 5. – Quand céder n’est pas consentir : des déterminants matériels et psychiques de la conscience dominée des femmes, et de quelques-unes de leurs interprétations en ethnologie
Chapitre 6. – Identité sexuelle/sexuée/de sexe ? Trois modes de conceptualisation du rapport entre sexe et genre
Tableau synoptique et Bibliographie
Je commence par une remarque sur la lecture. Nicole-Claude Mathieu revient sur des ouvrages de Maurice Godelier et en particulier « La production des Grands Hommes ; pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée », livre important, en interrogeant, entre autres, des formulations qui gomment ou ne prennent pas suffisamment en compte les asymétries dans les relations sociales. Ce faisant, elle souligne l’ancrage profond dans « nos » pensées de la biologilisation des sexes, du masculin comme forme (non-neutre) d’un neutre pourtant affirmé, et la nécessité de prendre en compte, en permanence, les rapports sociaux, les rapports de domination, etc. Ma propre lecture, ancienne, avait fait l’impasse sur bien des problèmes que l’auteure soulève. Une invitation à questionner « nos » lectures toujours trop hâtives et borgnes ou aveugles à la situation des dominé-e-s.
Dans son introduction, Nicole-Claude Mathieu indique que la première partie du livre constitue une critique interne de discours se donnant comme connaissance scientifique, « Il s’agit en quelque sorte de l’étude d’un scénario parmi d’autres, mais d’un scénario particulier de par la qualité de neutralité qu’il se confère et le pouvoir qu’on lui reconnaît puisqu’il est censé expliquer la ‘réalité’. »
La seconde partie met l’accent sur les « sujets », en particulier les ethnologues qui écrivent, les personnages qu’ils construisent (les ethnologisé-e-s), les bases des élaborations qu’ils font, « ceux qui peuvent ou ne pas connaître la pièce, mais n’en pensent et n’en agissent pas moins, avec leurs scénarios propres, sur le sujet traité ».
L’auteure aborde des questions épistémologiques, méthodologiques « portant sur les distorsions dans la conceptualisation du sexe et la catégorisation des sexes en sciences sociales », des questions de sociologie de la connaissance, des problèmes liés « à la conscience et à l’identité personnelle ».
Je souligne d’autres points abordés dans l’introduction : la non-spécification de la catégorie homme comme catégorie socio-sexuée, « une conception fondamentalement biologisante de la « féminité », en regard d’une prise en considération strictement sociale de la catégorie masculine », « la survisibilisation des femmes par les explications à tendance naturaliste et leur invisibilisation en tant qu’acteurs sociaux ». Les femmes ne sont pas invisibles mais invisibilisées, ou pour le dire comme l’auteure, « elles sont exclues de l’analyse des processus globaux internes à leur propre société, comme si elles lui étaient étrangères ». Et en même temps, les femmes sont renvoyées « à l’intérieur des frontières de leur société », lorsque sont abordés les phénomènes « transculturels ». Les femmes ne seraient que « spécifiques », les hommes définis comme « neutres représentants de l’espèce humaine ».
Ne pas prendre en compte ou marginaliser la place des femmes dans les analyses, cette « méconnaissance » a cependant une fonction sociale « le maintien en l’état de l’ordre des choses ».
Méconnaissance et/ou « dénégation de l’oppression matérielle et idéologique chez les sujets femmes » et des conséquences induites. L’auteure indique que chez les chercheurs cette dénégation « est basée sur l’établissement d’une fausse symétrie de la conscience entre dominants et domin(é)es ». Sans entrer dans le débat sur la « conscience », il me semble important de souligner, qu’en effet, dans une situation d’asymétrie sociale, il y a des intérêts antagoniques, qui ne sauraient être présentés comme communs. Il ne peut donc y avoir d’appréhension/compréhension, « conscience » commune de ces rapports sociaux. D’autant, comme le souligne l’auteure, qu’il y a « médiatisation de la conscience propre des femmes par le référent masculin » servant de référence « neutre » aux descriptions et analyses.
Le titre de cette note est extraite de la préface.
Compte tenu de la richesse de ce livre, je ne mets l’accent que sur certains points.
Chapitre 1, du coté de la sociologie. Nicole-Claude Mathieu met en évidence « le biais imposé à la connaissance en sciences sociales par une structure de pensée propre à la société qui la produit ».
Elle parle, entre autres, des rapports réciproques entre les groupes sociologiquement définis, de la dimension temporelle de l’existence sociale, de l’âge social ou de la « non-concordance entre vieillesse biologique et vieillesse sociale ». Elle interroge : « A quelles conditions historiques et conjoncturelles la constitution d’un champ d’investigation scientifique prenant comme objet les catégories de sexe est-elle soumise ? »
L’auteure analyse les catégories définies ou non de manière spécifique, les relations entre sociologie et biologie, la place de la famille, « groupe social qui exprime par excellence l’institutionnalisation du biologique », la non universalité des statuts et des rôles, etc.
Elle souligne que dans la majeure partie des écrits sociologiques « soit la dichotomie sexuelle n’est pas marquée, soit une seule des catégories sexuées est censée réorienter de façon spécifique un problème qui, dans sa description générale, n’était pas lui-même marqué par cette dichotomie ». Elle cite les exemples de la sociologie de la famille et de la sexualité. Je pourrais ajouter une bonne partie de la sociologie du travail, qui parle encore trop souvent d’un mythique travailleur neutre, ce qui permet entre autres, de ne pas aborder le travail dans toutes ses dimensions (salarié et domestique) car pour bien des sociologues, les hommes ne seraient pas concernés par ce dernier (ils se dispensent à la fois de s’en soucier et de l’effectuer). Hors le travail domestique « concerne » bien les deux catégories sexuées, et influe sur le travail salarié des un-e-s et des autres de manière asymétrique. Comme l’indique l’auteure, la double journée de travail est aujourd’hui reconnue, mais « est restée à la périphérie de la problématique d’ensemble du travail, sans y être intégrée ».
Tout cela relève d’une identification entre le général et le masculin. Il me semble que cette identification est au cœur de la reproduction du sexisme dans bien des analyses produites/construites par les sciences sociales. Ainsi il existe, et encore pas toujours, une catégorie femme plus ou moins définie, mais non une catégorie homme « sociologiquement spécifiée »
L’auteure souligne aussi la confusion entretenue entre « réalités biologiques » et « modalités sociales élaborées par une société sur la formule du schéma biologique », l’impossibilité d’étudier isolément une catégorie de sexe « du moins sans qu’elles n’aient été auparavant pleinement conceptualisées comme éléments d’un système structural ».
Le regard et les analyses portés sur les unes, les dominées, soustrait au regard et aux analyses les autres, les dominants. Les premières formeraient une sorte de « sous-culture » au sein d’une société globale, non définie et de fait dépourvue de rapports sociaux, de rapports de pouvoir.
Une remarque pour finir. Bien des critiques portées aux sociologues, dans ce texte publié en 1971 restent d’une cruelle actualité, hors les revues animées par des féministes…
Chapitre 2, du coté des ethnologues, de la division entre culture et nature. Nicole-Claude Mathieu indique que « Les sexes comme produit social de rapport sociaux ne semblent guère jusqu’à présent être un objet d’interrogation… ».
Pour les « mal-entendants » ethnologues, ceux qui évoquent la « non-verbalisation » des femmes, elle oppose une question : « dans quelle(s) société(s), dans quel système social les femmes ne parlent-elles pas ? ». Elle poursuit sur les rapports de « parlant » à « parlant dominant », sur la parole et le discours, sur le partage et l’emprunt des mots, sur le pouvoir social des hommes, sur la prétention à établir une « vérité des sociétés étudiées – inarticulateness des femmes, articulateness des hommes »
J’ai notamment apprécié la partie sur « De l’« évidence » biologique à la contradiction méthodologique », où l’auteure débute par « Penser plus ou moins implicitement le sexe en termes de catégories réifiées, closes sur elles-mêmes, refuser de voir qu’elles se définissent à chaque fois dans un système de rapports sociaux, amène d’abord à leur conférer des attributs généraux (articulateness, inarticulateness), et à parler en termes de contenu : modèles, représentations, symbolisme propres à chacune ; ensuite à fixer ces attributs et ces contenus comme différents, voire opposés, pour chacune, la réification se fondant sur la différence biologique : les hommes et les femmes auront « naturellement » des comportements, des raisonnements différents, des visions différentes de soi et du monde ».
Avec ironie, Nicole-Claude Mathieu, critique les analyses ethnologiques et écrit « Au fond, pourrait-on dire, l’homme est biologiquement culturel… La femme au contraire serait biologique naturelle », une façon comme une autre de naturaliser les rapports sociaux et d’évacuer la politique…
Comme l’accent est souvent mis sur la place de la reproduction, de surcroît limitée aux rôles des femmes dans celle-ci, comme « contrainte » de l’organisation des sociétés, l’auteure souligne « que des sociétés s’appuient sur la différence des sexes dans l’ordre de la reproduction pour créer des différences dans l’ordre social ne doit pas entraîner à penser que la cause en est dans la différence biologique ».
Parler des « hommes » et des « femmes » ne va donc jamais de soi, contrairement, aux écrits critiqués ici, et aujourd’hui aux fantasmes sur l’identité sexuelle soit-disant naturelle de « la manif pour tous », de celles et ceux qui ne veulent pas de l’enseignement du « genre » à l’école, sans oublier les autorités religieuses diverses qui prônent la « complémentarité » des sexes, soit de fait le refus de égalité réelle entre toutes et tous les êtres humains.
Et c’est avec raison, que l’auteur conclut « qu’en ce qui concerne les sexes, il ne s’agit jamais que des femmes, et que la référence immédiate à la biologie vient clore le débat avant même qu’il ne soit ouvert ».
Chapitre 3, du coté du caractère culturel e la maternité
Nicole-Claude Mathieu rappelle « l’avantage méthodologique de la formulation : « rôles des sexes » est de considérer d’emblée les faits de sexe comme un système où les deux catégories sont impliquées ». L’auteure analyse, entre autres, le traitement différentiel en termes de niveau d’analyse des deux catégories de sexe, le présupposé naturaliste de la maternité, le refus de considérer la mère comme un Ego, un sujet pleinement social, l’avortement comme « refus culturel d’un processus biologique entamé », le contrôle social toujours existant de l’enfantement, le refus de traiter socialement de la non-maternité…
Chapitre 4, du coté des discours ethno-anthropologiques
Nicole-Claude Mathieu souligne l’oubli des femmes, ou leur prise en compte « comme pures annexes des hommes » en ethnologie, comme en sociologie.
Elle livre une puissante critique épistémologique de l’androcentrisme de la pensée, des sciences. Elle souligne, une fois encore, « l’invisibilité des acteurs sociaux hommes en tant que groupe sexué ». L’auteure analyse la soit-disant « naturalité » du rapport des femmes aux enfants, la non-intégration des femmes au niveau théorique, les théorisations et les généralisations « uniquement à partir des groupes socialement dominants », l’auto-définition des hommes par les activités et valeurs masculines, les temps de travail échangés comme ceux des hommes, l’invisibilisation de l’apport économique des femmes, les vocabulaires (termes particularisant uniquement les femmes, formulations identifiant le masculin au général, termes neutres masquant le rapport social entre les sexes, etc.), « mais il faut comprendre l’enjeu véritable de cette sensibilité aux mots (sensibilité particulièrement développée chez les minoritaires) : ce qui est attaqué là, c’est l’utilisation généralisante, totalisante (pour ne pas dire totalitaire) de termes qui empêche certains faits concernant les minoritaires d’accéder à la théorisation de la société ».
A l’opposé des pratiques bien peu « scientifiques », il convient au contraire « de porter une attention égale aux deux sexes en tant qu’acteurs dans la description et la théorisation de tout phénomène social ». Une leçon toujours non-intégrée par de multiples chercheurs en sciences sociales, y compris de ceux qui se revendiquent de l’émancipation… ce qui en dit long, par ailleurs, sur leur refus de se penser comme bénéficiaire de la domination des femmes.
L’auteure traite aussi de l’effacement du féminin comme sujet, du non-animé, du biologisme attaché au seul sexe féminin, de l’élimination des rapports de pouvoir entre hommes et femmes, de l’opposition homme=culture / femme=nature, du « glissement conceptuel entre la capacité et le fait de procréer », du divorce potentiel entre sexualité et reproduction de l’espèce, de la catégorisation a-historique, atemporelle de la catégorie femme, des modes de représentation, de la sociologie de la connaissance, de ses rapports avec la catégorisation biologique, de la place des dominées pour « renouveler la problématique des sexes » (« à ce que sa position d’homme ou de femme lui permet de connaître respectivement, et de l’oppression exercée, et de l’oppression subie »), de l’absence de symétrie de la « conscience » entre oppresseurs et opprimées, « il apparaît que l’expérience concrète comme la conscience des femmes continuent d’être mal/im-pensées ».
Le chapitre 5 « Quand céder n’est pas consentir » me semble central pour (re)penser les rapports sociaux, et pas uniquement les rapports sociaux de sexe.
Après avoir rappelé que l’anthropologie fut/est fille de l’impérialisme occidental, Nicole-Claude Mathieu indique « Aux ethnologues qui se posent, à juste titre, des questions sur une certaine pratique de l’anthropologie, je peux seulement répondre que je ne saurais « défendre » aucune société, culture, option ou idéologie (fût-elle minoritaire d’un certain point de vue) dont la survie en l’état, le « progrès », la « modernisation » ou l’expansion dépendrait de l’oppression des femmes ou l’aménagerait ». Nous sommes donc ici loin des positions relativistes qui acceptent, au nom de spécificités culturelles, des pratiques sociales qui maintiennent la domination des hommes sur les femmes. Ce qui ne dit rien sur l’agenda ou les modalités choisies par les femmes pour se mobiliser sur ces sujets.
Contre « ces » ethnologues niant l’androcentrisme, partie intégrante de notre société, et modelant les catégories de la connaissance ethnologique, l’auteure souligne « Les mouvements politiques de minoritaires – constitués d’universitaires et de non-universitaires – ont parfois davantage contribué à cette « connaissance » que tous les historiens, sociologues ou anthropologues en titre au monde ». J’ajoute que les histoires, les sociologies, les anthropologies des « vainqueurs » sont souvent des négations des réalités sociales, voire de véritables « révisionnismes ». Interroger les organisations de diverses sociétés ne saurait faire l’impasse de la critique de l’organisation des rapports sociaux « ici », par exemple la non-égalité systémique entre femmes et hommes…
Nicole-Claude Mathieu argumente sur les consciences : « Il existe chez les dominés plusieurs types de conscience et de production de connaissance, fragmentés et contradictoires, dus justement aux mécanismes mêmes de l’oppression ».
L’auteure insiste, en critique à des écrits ethnologiques, sur la double morale construite pour les femmes et pour les hommes. Et en particulier, pour les femmes, sur « Ne pas céder est une norme et en même temps céder est une norme ». Elle parle du viol, de « la honte imposée à la victime », de l’argumentation donnée par les avocats « sur l’idée du consentement de la femme ».
Sur la domination, elle précise « Mais si le dominant connaît la domination, il ne connaît pas le vécu de l’oppression, c’est à dire l’autre versant ». (En contrepoint, je reviens sur un passage de ma lecture du livre de Léo Thiers-Vidal : De « L’Ennemi principal » aux principaux ennemis. Position vécue, subjectivité et conscience masculines de domination, Editions L’Harmattan, 2010, Léo Thiers-Vidal termine par des développements sur l’expertise masculine, « le fait que les hommes agissent en fonction de leurs intérêts et désirs et que ceux-ci sont conçus comme étant supérieurs à ceux des femmes », le fait que les hommes savent et sont intimement attachés à la domination. Puis, une nouvelle fois l’auteur souligne que « la subjectivité idéelle adoptée par les dominants n’est pas perçue comme partie intégrante d’une subjectivité de domination et n’est pas donc pas interrogée politiquement ». »)
En partant d’un phrase de Maurice Godelier : « … des deux composantes du pouvoir la force la plus forte n’est pas la violence des dominants mais le consentement des dominés à leur domination » et d’autres développements de cet auteur dans le livre cité en début de note, Nicole-Claude Mathieu procède à un examen détaillé de cette idée de consentement. Elle commence par analyser les rapports entre réalités matérielle et idéelle, l’agencement propre des rapports de sexe dans chaque société, l’absence de « vérités universelles », les contraintes physiques et mentales pesant sur les femmes, le travail réel des femmes, la non satisfaction de leurs besoins énergétiques, la charge physique et mentale de l’éducation et de la surveillance des jeunes enfants, « Le fait d’avoir la responsabilité constante des enfants est non seulement un travail physique – souvent non évalué – mais aussi un travail mental constant et de surcroît un travail mental aliénant, à tout le moins limitatif de la pensée (à force de tout simplifier dans les explications aux enfants, est-ce qu’on peut développer une pensée complexe, « libre »?) », la contradiction entre ce travail et celui des tâches de cuisine… et les résistances des femmes, dont celles par la fuite.
Elle revient aussi sur les liaisons entre ces taches « domestiques » et le non-pouvoir, non en termes de cause mais d’effet de la domination, sur la conscience médiatisée des femmes, leur dépersonnalisation, les conséquences de leur effacement construit derrière les rôles de mère, le rôle de la violence, de « l’assurance et la peur de la violence générale qui leur est faite », du regard (contrôle) constant des mâles, de l’intérêt économique de ces assignations pour les dominants.
Nicole-Claude Mathieu poursuit par l’analyse des conséquences des expériences vécues « de part et d’autre de la barrière » de la division sexuelle, des valeurs, de leur partage et de l’absence de symétrie, « Étant donné qu’une valeur est invoquée en situation, expérimentée dans une
Lien : http://entreleslignesentrele..
« La sélection de textes présentée ici recouvre une période d’une vingtaine d’années (1970-1989). »
Sommaire
Introduction
I. Le sexe, évidence fétiche ou concept sociologique ?
Chapitre 1. – Notes pour une définition sociologique des catégories de sexe
Chapitre 2. – Homme-culture et femme-nature ?
Chapitre 3. – Paternité biologique, maternité sociale : de l’avortement et de l’infanticide comme signes non reconnus du caractère culturel de la maternité
Chapitre 4. – Critiques épistémologiques de la problématique des sexes dans le discours ethno-anthropologique
II. Conscience, identités de sexe/genre et production de la connaissance
Chapitre 5. – Quand céder n’est pas consentir : des déterminants matériels et psychiques de la conscience dominée des femmes, et de quelques-unes de leurs interprétations en ethnologie
Chapitre 6. – Identité sexuelle/sexuée/de sexe ? Trois modes de conceptualisation du rapport entre sexe et genre
Tableau synoptique et Bibliographie
Je commence par une remarque sur la lecture. Nicole-Claude Mathieu revient sur des ouvrages de Maurice Godelier et en particulier « La production des Grands Hommes ; pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée », livre important, en interrogeant, entre autres, des formulations qui gomment ou ne prennent pas suffisamment en compte les asymétries dans les relations sociales. Ce faisant, elle souligne l’ancrage profond dans « nos » pensées de la biologilisation des sexes, du masculin comme forme (non-neutre) d’un neutre pourtant affirmé, et la nécessité de prendre en compte, en permanence, les rapports sociaux, les rapports de domination, etc. Ma propre lecture, ancienne, avait fait l’impasse sur bien des problèmes que l’auteure soulève. Une invitation à questionner « nos » lectures toujours trop hâtives et borgnes ou aveugles à la situation des dominé-e-s.
Dans son introduction, Nicole-Claude Mathieu indique que la première partie du livre constitue une critique interne de discours se donnant comme connaissance scientifique, « Il s’agit en quelque sorte de l’étude d’un scénario parmi d’autres, mais d’un scénario particulier de par la qualité de neutralité qu’il se confère et le pouvoir qu’on lui reconnaît puisqu’il est censé expliquer la ‘réalité’. »
La seconde partie met l’accent sur les « sujets », en particulier les ethnologues qui écrivent, les personnages qu’ils construisent (les ethnologisé-e-s), les bases des élaborations qu’ils font, « ceux qui peuvent ou ne pas connaître la pièce, mais n’en pensent et n’en agissent pas moins, avec leurs scénarios propres, sur le sujet traité ».
L’auteure aborde des questions épistémologiques, méthodologiques « portant sur les distorsions dans la conceptualisation du sexe et la catégorisation des sexes en sciences sociales », des questions de sociologie de la connaissance, des problèmes liés « à la conscience et à l’identité personnelle ».
Je souligne d’autres points abordés dans l’introduction : la non-spécification de la catégorie homme comme catégorie socio-sexuée, « une conception fondamentalement biologisante de la « féminité », en regard d’une prise en considération strictement sociale de la catégorie masculine », « la survisibilisation des femmes par les explications à tendance naturaliste et leur invisibilisation en tant qu’acteurs sociaux ». Les femmes ne sont pas invisibles mais invisibilisées, ou pour le dire comme l’auteure, « elles sont exclues de l’analyse des processus globaux internes à leur propre société, comme si elles lui étaient étrangères ». Et en même temps, les femmes sont renvoyées « à l’intérieur des frontières de leur société », lorsque sont abordés les phénomènes « transculturels ». Les femmes ne seraient que « spécifiques », les hommes définis comme « neutres représentants de l’espèce humaine ».
Ne pas prendre en compte ou marginaliser la place des femmes dans les analyses, cette « méconnaissance » a cependant une fonction sociale « le maintien en l’état de l’ordre des choses ».
Méconnaissance et/ou « dénégation de l’oppression matérielle et idéologique chez les sujets femmes » et des conséquences induites. L’auteure indique que chez les chercheurs cette dénégation « est basée sur l’établissement d’une fausse symétrie de la conscience entre dominants et domin(é)es ». Sans entrer dans le débat sur la « conscience », il me semble important de souligner, qu’en effet, dans une situation d’asymétrie sociale, il y a des intérêts antagoniques, qui ne sauraient être présentés comme communs. Il ne peut donc y avoir d’appréhension/compréhension, « conscience » commune de ces rapports sociaux. D’autant, comme le souligne l’auteure, qu’il y a « médiatisation de la conscience propre des femmes par le référent masculin » servant de référence « neutre » aux descriptions et analyses.
Le titre de cette note est extraite de la préface.
Compte tenu de la richesse de ce livre, je ne mets l’accent que sur certains points.
Chapitre 1, du coté de la sociologie. Nicole-Claude Mathieu met en évidence « le biais imposé à la connaissance en sciences sociales par une structure de pensée propre à la société qui la produit ».
Elle parle, entre autres, des rapports réciproques entre les groupes sociologiquement définis, de la dimension temporelle de l’existence sociale, de l’âge social ou de la « non-concordance entre vieillesse biologique et vieillesse sociale ». Elle interroge : « A quelles conditions historiques et conjoncturelles la constitution d’un champ d’investigation scientifique prenant comme objet les catégories de sexe est-elle soumise ? »
L’auteure analyse les catégories définies ou non de manière spécifique, les relations entre sociologie et biologie, la place de la famille, « groupe social qui exprime par excellence l’institutionnalisation du biologique », la non universalité des statuts et des rôles, etc.
Elle souligne que dans la majeure partie des écrits sociologiques « soit la dichotomie sexuelle n’est pas marquée, soit une seule des catégories sexuées est censée réorienter de façon spécifique un problème qui, dans sa description générale, n’était pas lui-même marqué par cette dichotomie ». Elle cite les exemples de la sociologie de la famille et de la sexualité. Je pourrais ajouter une bonne partie de la sociologie du travail, qui parle encore trop souvent d’un mythique travailleur neutre, ce qui permet entre autres, de ne pas aborder le travail dans toutes ses dimensions (salarié et domestique) car pour bien des sociologues, les hommes ne seraient pas concernés par ce dernier (ils se dispensent à la fois de s’en soucier et de l’effectuer). Hors le travail domestique « concerne » bien les deux catégories sexuées, et influe sur le travail salarié des un-e-s et des autres de manière asymétrique. Comme l’indique l’auteure, la double journée de travail est aujourd’hui reconnue, mais « est restée à la périphérie de la problématique d’ensemble du travail, sans y être intégrée ».
Tout cela relève d’une identification entre le général et le masculin. Il me semble que cette identification est au cœur de la reproduction du sexisme dans bien des analyses produites/construites par les sciences sociales. Ainsi il existe, et encore pas toujours, une catégorie femme plus ou moins définie, mais non une catégorie homme « sociologiquement spécifiée »
L’auteure souligne aussi la confusion entretenue entre « réalités biologiques » et « modalités sociales élaborées par une société sur la formule du schéma biologique », l’impossibilité d’étudier isolément une catégorie de sexe « du moins sans qu’elles n’aient été auparavant pleinement conceptualisées comme éléments d’un système structural ».
Le regard et les analyses portés sur les unes, les dominées, soustrait au regard et aux analyses les autres, les dominants. Les premières formeraient une sorte de « sous-culture » au sein d’une société globale, non définie et de fait dépourvue de rapports sociaux, de rapports de pouvoir.
Une remarque pour finir. Bien des critiques portées aux sociologues, dans ce texte publié en 1971 restent d’une cruelle actualité, hors les revues animées par des féministes…
Chapitre 2, du coté des ethnologues, de la division entre culture et nature. Nicole-Claude Mathieu indique que « Les sexes comme produit social de rapport sociaux ne semblent guère jusqu’à présent être un objet d’interrogation… ».
Pour les « mal-entendants » ethnologues, ceux qui évoquent la « non-verbalisation » des femmes, elle oppose une question : « dans quelle(s) société(s), dans quel système social les femmes ne parlent-elles pas ? ». Elle poursuit sur les rapports de « parlant » à « parlant dominant », sur la parole et le discours, sur le partage et l’emprunt des mots, sur le pouvoir social des hommes, sur la prétention à établir une « vérité des sociétés étudiées – inarticulateness des femmes, articulateness des hommes »
J’ai notamment apprécié la partie sur « De l’« évidence » biologique à la contradiction méthodologique », où l’auteure débute par « Penser plus ou moins implicitement le sexe en termes de catégories réifiées, closes sur elles-mêmes, refuser de voir qu’elles se définissent à chaque fois dans un système de rapports sociaux, amène d’abord à leur conférer des attributs généraux (articulateness, inarticulateness), et à parler en termes de contenu : modèles, représentations, symbolisme propres à chacune ; ensuite à fixer ces attributs et ces contenus comme différents, voire opposés, pour chacune, la réification se fondant sur la différence biologique : les hommes et les femmes auront « naturellement » des comportements, des raisonnements différents, des visions différentes de soi et du monde ».
Avec ironie, Nicole-Claude Mathieu, critique les analyses ethnologiques et écrit « Au fond, pourrait-on dire, l’homme est biologiquement culturel… La femme au contraire serait biologique naturelle », une façon comme une autre de naturaliser les rapports sociaux et d’évacuer la politique…
Comme l’accent est souvent mis sur la place de la reproduction, de surcroît limitée aux rôles des femmes dans celle-ci, comme « contrainte » de l’organisation des sociétés, l’auteure souligne « que des sociétés s’appuient sur la différence des sexes dans l’ordre de la reproduction pour créer des différences dans l’ordre social ne doit pas entraîner à penser que la cause en est dans la différence biologique ».
Parler des « hommes » et des « femmes » ne va donc jamais de soi, contrairement, aux écrits critiqués ici, et aujourd’hui aux fantasmes sur l’identité sexuelle soit-disant naturelle de « la manif pour tous », de celles et ceux qui ne veulent pas de l’enseignement du « genre » à l’école, sans oublier les autorités religieuses diverses qui prônent la « complémentarité » des sexes, soit de fait le refus de égalité réelle entre toutes et tous les êtres humains.
Et c’est avec raison, que l’auteur conclut « qu’en ce qui concerne les sexes, il ne s’agit jamais que des femmes, et que la référence immédiate à la biologie vient clore le débat avant même qu’il ne soit ouvert ».
Chapitre 3, du coté du caractère culturel e la maternité
Nicole-Claude Mathieu rappelle « l’avantage méthodologique de la formulation : « rôles des sexes » est de considérer d’emblée les faits de sexe comme un système où les deux catégories sont impliquées ». L’auteure analyse, entre autres, le traitement différentiel en termes de niveau d’analyse des deux catégories de sexe, le présupposé naturaliste de la maternité, le refus de considérer la mère comme un Ego, un sujet pleinement social, l’avortement comme « refus culturel d’un processus biologique entamé », le contrôle social toujours existant de l’enfantement, le refus de traiter socialement de la non-maternité…
Chapitre 4, du coté des discours ethno-anthropologiques
Nicole-Claude Mathieu souligne l’oubli des femmes, ou leur prise en compte « comme pures annexes des hommes » en ethnologie, comme en sociologie.
Elle livre une puissante critique épistémologique de l’androcentrisme de la pensée, des sciences. Elle souligne, une fois encore, « l’invisibilité des acteurs sociaux hommes en tant que groupe sexué ». L’auteure analyse la soit-disant « naturalité » du rapport des femmes aux enfants, la non-intégration des femmes au niveau théorique, les théorisations et les généralisations « uniquement à partir des groupes socialement dominants », l’auto-définition des hommes par les activités et valeurs masculines, les temps de travail échangés comme ceux des hommes, l’invisibilisation de l’apport économique des femmes, les vocabulaires (termes particularisant uniquement les femmes, formulations identifiant le masculin au général, termes neutres masquant le rapport social entre les sexes, etc.), « mais il faut comprendre l’enjeu véritable de cette sensibilité aux mots (sensibilité particulièrement développée chez les minoritaires) : ce qui est attaqué là, c’est l’utilisation généralisante, totalisante (pour ne pas dire totalitaire) de termes qui empêche certains faits concernant les minoritaires d’accéder à la théorisation de la société ».
A l’opposé des pratiques bien peu « scientifiques », il convient au contraire « de porter une attention égale aux deux sexes en tant qu’acteurs dans la description et la théorisation de tout phénomène social ». Une leçon toujours non-intégrée par de multiples chercheurs en sciences sociales, y compris de ceux qui se revendiquent de l’émancipation… ce qui en dit long, par ailleurs, sur leur refus de se penser comme bénéficiaire de la domination des femmes.
L’auteure traite aussi de l’effacement du féminin comme sujet, du non-animé, du biologisme attaché au seul sexe féminin, de l’élimination des rapports de pouvoir entre hommes et femmes, de l’opposition homme=culture / femme=nature, du « glissement conceptuel entre la capacité et le fait de procréer », du divorce potentiel entre sexualité et reproduction de l’espèce, de la catégorisation a-historique, atemporelle de la catégorie femme, des modes de représentation, de la sociologie de la connaissance, de ses rapports avec la catégorisation biologique, de la place des dominées pour « renouveler la problématique des sexes » (« à ce que sa position d’homme ou de femme lui permet de connaître respectivement, et de l’oppression exercée, et de l’oppression subie »), de l’absence de symétrie de la « conscience » entre oppresseurs et opprimées, « il apparaît que l’expérience concrète comme la conscience des femmes continuent d’être mal/im-pensées ».
Le chapitre 5 « Quand céder n’est pas consentir » me semble central pour (re)penser les rapports sociaux, et pas uniquement les rapports sociaux de sexe.
Après avoir rappelé que l’anthropologie fut/est fille de l’impérialisme occidental, Nicole-Claude Mathieu indique « Aux ethnologues qui se posent, à juste titre, des questions sur une certaine pratique de l’anthropologie, je peux seulement répondre que je ne saurais « défendre » aucune société, culture, option ou idéologie (fût-elle minoritaire d’un certain point de vue) dont la survie en l’état, le « progrès », la « modernisation » ou l’expansion dépendrait de l’oppression des femmes ou l’aménagerait ». Nous sommes donc ici loin des positions relativistes qui acceptent, au nom de spécificités culturelles, des pratiques sociales qui maintiennent la domination des hommes sur les femmes. Ce qui ne dit rien sur l’agenda ou les modalités choisies par les femmes pour se mobiliser sur ces sujets.
Contre « ces » ethnologues niant l’androcentrisme, partie intégrante de notre société, et modelant les catégories de la connaissance ethnologique, l’auteure souligne « Les mouvements politiques de minoritaires – constitués d’universitaires et de non-universitaires – ont parfois davantage contribué à cette « connaissance » que tous les historiens, sociologues ou anthropologues en titre au monde ». J’ajoute que les histoires, les sociologies, les anthropologies des « vainqueurs » sont souvent des négations des réalités sociales, voire de véritables « révisionnismes ». Interroger les organisations de diverses sociétés ne saurait faire l’impasse de la critique de l’organisation des rapports sociaux « ici », par exemple la non-égalité systémique entre femmes et hommes…
Nicole-Claude Mathieu argumente sur les consciences : « Il existe chez les dominés plusieurs types de conscience et de production de connaissance, fragmentés et contradictoires, dus justement aux mécanismes mêmes de l’oppression ».
L’auteure insiste, en critique à des écrits ethnologiques, sur la double morale construite pour les femmes et pour les hommes. Et en particulier, pour les femmes, sur « Ne pas céder est une norme et en même temps céder est une norme ». Elle parle du viol, de « la honte imposée à la victime », de l’argumentation donnée par les avocats « sur l’idée du consentement de la femme ».
Sur la domination, elle précise « Mais si le dominant connaît la domination, il ne connaît pas le vécu de l’oppression, c’est à dire l’autre versant ». (En contrepoint, je reviens sur un passage de ma lecture du livre de Léo Thiers-Vidal : De « L’Ennemi principal » aux principaux ennemis. Position vécue, subjectivité et conscience masculines de domination, Editions L’Harmattan, 2010, Léo Thiers-Vidal termine par des développements sur l’expertise masculine, « le fait que les hommes agissent en fonction de leurs intérêts et désirs et que ceux-ci sont conçus comme étant supérieurs à ceux des femmes », le fait que les hommes savent et sont intimement attachés à la domination. Puis, une nouvelle fois l’auteur souligne que « la subjectivité idéelle adoptée par les dominants n’est pas perçue comme partie intégrante d’une subjectivité de domination et n’est pas donc pas interrogée politiquement ». »)
En partant d’un phrase de Maurice Godelier : « … des deux composantes du pouvoir la force la plus forte n’est pas la violence des dominants mais le consentement des dominés à leur domination » et d’autres développements de cet auteur dans le livre cité en début de note, Nicole-Claude Mathieu procède à un examen détaillé de cette idée de consentement. Elle commence par analyser les rapports entre réalités matérielle et idéelle, l’agencement propre des rapports de sexe dans chaque société, l’absence de « vérités universelles », les contraintes physiques et mentales pesant sur les femmes, le travail réel des femmes, la non satisfaction de leurs besoins énergétiques, la charge physique et mentale de l’éducation et de la surveillance des jeunes enfants, « Le fait d’avoir la responsabilité constante des enfants est non seulement un travail physique – souvent non évalué – mais aussi un travail mental constant et de surcroît un travail mental aliénant, à tout le moins limitatif de la pensée (à force de tout simplifier dans les explications aux enfants, est-ce qu’on peut développer une pensée complexe, « libre »?) », la contradiction entre ce travail et celui des tâches de cuisine… et les résistances des femmes, dont celles par la fuite.
Elle revient aussi sur les liaisons entre ces taches « domestiques » et le non-pouvoir, non en termes de cause mais d’effet de la domination, sur la conscience médiatisée des femmes, leur dépersonnalisation, les conséquences de leur effacement construit derrière les rôles de mère, le rôle de la violence, de « l’assurance et la peur de la violence générale qui leur est faite », du regard (contrôle) constant des mâles, de l’intérêt économique de ces assignations pour les dominants.
Nicole-Claude Mathieu poursuit par l’analyse des conséquences des expériences vécues « de part et d’autre de la barrière » de la division sexuelle, des valeurs, de leur partage et de l’absence de symétrie, « Étant donné qu’une valeur est invoquée en situation, expérimentée dans une
Lien : http://entreleslignesentrele..
Rendre visible l’oppression des femmes à travers la construction même de la différenciation sociale des sexes
Le premier texte du recueil « Ma vie » est une courte auto-présentation de l’auteure. Comment ne pas en souligner le dernier membre de phrase sur « l’observation hallucinée de l’amplitude de l’oppression des femmes »…
Dans le prologue, Nicole-Claude Mathieu parle, entre autres, d’antiféminisme, du féminisme matérialiste, du sexisme, d’exploitation « concrète, matérielle – par les hommes – du corps, de l’esprit et des activités des femmes, dans le travail professionnel, la sexualité et, ne l’oublions pas, dans le travail familial/ménager/domestique ».
Sommaire
Première partie : Entrées de dictionnaires, pour gens pressés
Chapitre I : Différenciation des sexes (Les représentations du sexe et du genre, La construction sociale de la différence des sexes et de l’inégalité)
Chapitre II : Sexe et genre (Différenciation biologique, différenciation sociale, Autres sexes et autres genres, Différentes analyses du rapport entre sexe et genre, Dérives de la notion de genre, Trois débats autour des catégories de genre et de sexe)
Chapitre III : Études féministes et anthropologie
Chapitre IV : Corps féminin et masculin (Le corps construit et l’appropriation des femmes, Le corps producteur et l’exploitation du travail des femmes, Le corps reproducteur et l’exploitation des capacités procréatives des femmes, Le corps sexuel et l’expropriation d’une sexualité autonome chez les femmes)
Deuxième partie : Lectures critiques sur la domination masculine… au masculin
Chapitre V : Bourdieu ou le pouvoir auto-hypnotique de la domination masculine (Candidat Bourdieu : recalé à l’examen de DEA (1re année de thèse). Aux motifs de : Du symbolique et de sa « révolution », Du lourd fardeau de l’homme, Symbolique, conscience, résistance, De l’a-a-mour)
Chapitre VI : Beauvoir et les « hordes primitives » (Des sociétés « sans institutions », La femme procrée, l’homme crée, La femme met bas, l’homme se bat, Conclusion)
Chapitre VII : Lévi-Strauss et (toujours) l’échange des femmes avec Martine Gestin (Analyses formelles, discours, réalités empiriques, Du genre humain aux femmes : l’articulation culture/nature, Modèles versus réalités statistiques, empiriques, sociologiques, La question des sociétés matrilinéaires et matrilocales, Repenser l’échange matrimonial, Un androcentrisme bien partagé et fort ancien)
Troisième partie : Une Internationale de la violence
Chapitre VIII : Les mutilations du sexe des femmes avec Nicole Échard
Chapitre IX : Relativisme culturel, excision et violences contre les femmes
Chapitre X : Banalité du mal et « consentement » : des non-droits humains des femmes (Parias et parvenues, « Consentement » ou anesthésie de la conscience de Soi ?, L’oppression des femmes en tant que mal politique, Banalité, banalisation, trivialité de la domination masculine)
Chapitre XI : Clair/Voyances lesbiennes
Chapitre XII : « Origines » ou mécanismes de l’oppression des femmes ?
Chapitre XIII : Questions à l’éco-féminisme
Quatrième partie : Autour des « matriarcats »
Chapitre XIV : « Matriarcat » ou résistance ? Mythes et réalités (Les mythes d’un matriarcat primitif, Les mythes modernes d’un matriarcat actuel, Réalités diverses et résistances)
Chapitre XV : Circulation des hommes, permanence des femmes, matriarcats imaginaires et autres curiosités… (Les sociétés matrilinéaires et matrilocales dans le monde, Des matriarcats imaginaires, passés et actuels, La personne et le corps des femmes, La maison, espace dit « domestique » des femmes, mais aussi politique et religieux, Domestications…, Circulation des hommes, uxorilocalité et « puzzle matrilinéaire », La division sexuée du travail, Un « puzzle matrilinéaire » pour les femmes ?, Épilogue en forme de questions)
Cinquième partie : Le sexe social, le genre et la personne
Chapitre XVI : Femmes du Soi, femmes de l’Autre (Frontières externes incluant l’autre-femme, Limites internes excluant l’autre-femme, L’autre-femme et les femmes des autres)
Chapitre XVII : Remarques sur la personne, le sexe et le genre (La nature humaine, La personne humaine, La personne sexuée, La personne en sa qualité, La personne clivée, La personne effacée, La personne dépersonnifiée, La personne éphémère)
Chapitre XVIII : Dérive du genre/stabilité des sexes (Sexualités multiples…, Travestissements, transvestismes, troisièmes genres…)
Chapitre XIX : Les transgressions du sexe et du genre à la lumière de données ethnographiques (Représentations du sexe et du genre, Cadre général de la recherche, Genre ou sexe social ?)
Le livre se termine par un texte lu par Danielle Kergoat lors des obsèques de Nicole-Claude Mathieu « Vendredi 14 mars 2014 »
De cet ensemble de textes, je ne saurai rendre compte, aussi je me contente de souligner certaines analyses et d’en discuter un point.
Nicole-Claude Mathieu s’attache à « rendre visible l’oppression des femmes à travers la construction même de la différence sociale des sexes ». Il ne s’agit pas de simple différenciation « mais de hiérarchisation des sexes, avec affirmation de la prévalence masculine ».
L’auteure analyse « la division sexuelle du travail de reproduction », la relative infertilité des femmes, la dissociation « entre pulsion sexuelle et mécanismes hormonaux de la procréation », l’organisation sociale de la reproduction, la division socio-sexuée du travail (modalités, hiérarchisation, taches interdites aux femmes…). Elle parle de différenciation sociale, d’assignation de fonctions différentes « dans le corps social en entier », de normes hétérosexuelles, de rapports entre sexe et genre, de naturalisation de la catégorie « femme », d’occultation des rapport de pouvoirs. Elle critique aussi les dérives de la notion de genre, l’oubli des femmes, de l’oppression, la survalorisation des dimensions discursives… « l’inversion de sexe n’est pas obligatoirement une subversion du genre » et l’auteure préfère « clarifier l’économie politique du genre que le « troubler » à l’économie ».
Les textes au « croisement » des études féministes et de l’anthropologie sont d’un apport considérable. Nicole-Claude Mathieu critique les biais sexistes des scientifiques, leur andocentrisme, et souligne à la fois les « mécanismes d’invisibilisation des femmes » et « leur sur-visibilisation comme êtres pensés plus naturels que les hommes ». L’auteure revient sur Lévi-Strauss et « L’échange des femmes », les sociétés matrilinéaires et matrilocales, les mythes du matriarcat, leur construction et pour reprendre, comme l’auteure, une formule de Cynthia Eller « Un passé inventé ne donnera pas aux femmes un futur ».
Je souligne l’importance du texte « Circulation des hommes, permanence des femmes, matriarcats imaginaires et autres curiosités… » paru en introduction d’un ouvrage dirigé par l’auteure : « Une maison sans fille est une maison morte. La personne et le genre en sociétés matrilinéaires et/ou uxorilocales ». Nicole-Claude Mathieu y aborde, entre autres, les sociétés matrilinéaires et matrilocales dans le monde, le statut DE Sujet social (la femme en tant que sujet), les matriarcats imaginaires, la personne et le corps des femmes, la maison les espaces domestiques, politique et religieux, le « puzzle matrilinéaire », la division sexuée du travail…
L’auteure parle aussi des corps, « parler des corps féminin ou masculin n’est pas la même chose que de parler de corps de femme ou d’homme ». Elle souligne « la différenciation sociale des sexes », « les traitements asymétriques des corps féminins et masculins ». Nicole-Claude Mathieu analyse le corps reproducteur, son contrôle, l’appropriation des femmes, les mutilations du sexe, « il faut s’élever contre la mise en équivalence des mutilations sexuelles réalisées sur les corps mâles et femelles ». Il n’y a en effet rien de comparable entre circoncision et excision, infibulation. L’auteure souligne la « transformation de la sexualité des femmes en sexualité de service au bénéfice de l’homme » et dénonce le relativisme culturel qui permet de justifier les violences contre les femmes. Relativisme qui conduit certain-e-s à nier la domination et les violences exercées sur les femmes, sans oublier leur manque de soutien aux luttes des femmes pour leur autonomie.
Nicole-Claude Mathieu revient sur la notion de consentement, largement traité dans le volume précédent de ses textes. Elle discute de la « conscience de soi », souligne le travail à la fois continu et dispersé des femmes, leur sous-nutrition, la fatigue physique et mentale liée à la responsabilité des enfants, leur dés-armement, l’entrave à l’utilisation de l’espace public, les sévices physiques et verbaux, les contraintes sexuelles… L’auteure parle de la « banalité, banalisation, trivialité de la domination masculine ».
Je souligne l’intérêt du texte « Remarques sur la personne, le sexe et le genre », les analyses sur la personne humaine, la personne sexuée, la personne en sa qualité, la personne clivée, la personne effacée, la personne dépersonnifiée, la personne éphémère…
J’ai particulièrement apprécié la critique pleine d’humour, que fait l’auteure de Pierre Bourdieu et de sa « Domination masculine », une critique tant de la méthode que des argumentaires. Texte se terminant par deux phrases de Christiane Rochefort : « L’oppresseur n’entend pas ce que dit son opprimé comme un langage mais comme un bruit. C’est dans la définition de l’oppression »
Un point me semble très discutable. Partant de l’organisation sociale de la reproduction, des mécanismes visant à augmenter la fécondité des femmes, Nicole-Claude Mathieu indique que « la reproduction est un travail, socialement organisé comme tout travail ». Je souscrit à la formulation, contre la plupart des lectures « marxistes ». Cependant, je ne pense que l’on puisse en déduire que « l’instrument de production est le corps de la femme, le produit, c’est l’enfant ». Le corps des femmes n’est jamais réductible, séparable de leur être, il n’est donc jamais un outil. Corps et force de travail ne sont pas assimilables. « Engendrer » est toujours une activité sociale, non une simple production d’enfants suite à une « location d’utérus ». L’auteure évacue les contradictions qu’elle souligne ailleurs. Derrière des formulations pour le moins inadéquates, que l’auteure rattache de manière très simplificatrice à des analyses marxistes, il s’agit à mes yeux d’extrapolations plus qu’hasardeuses. Sans oublier que d’autres y trouve des argumentaires pour justifier aujourd’hui la GPA, le système prostitueur, etc…
Au delà du désaccord, il me semble nécessaire de poursuivre les débats sur la « production du vivre », pour utiliser une formule de Danielle Kergoat et répondre à la question posée aussi par l’auteure « pourquoi une apparence de permanence sociale serait-indépassable ? » Dépasser des rapport sociaux, le système de genre et non les entériner en faisant de chacun-e des marchandises.
Et pour finir, une petite histoire et cette question proposée en fin du chapitre « Banalité du mal et « consentement » : des non-droits humains des femmes » : « Dans un café parisien, début 1997. Deux hommes au comptoir ; L’un lance à la ronde une bonne histoire : « Savez-vous la différence entre une femme et une poubelle ? Non ? Eh bien, il n’y en a pas. On les remplit pendant la semaine et on les sort le week-end. » Réaction d’une cliente, qui ne « consentait » pas à ce qu’on place les femmes hors des limites de l’humain : « Oui… et c’est quoi, les ordures ? » Silence stupéfait de l’orateur. Il n’y avait pas pensé… »
Lien : https://entreleslignesentrel..
Le premier texte du recueil « Ma vie » est une courte auto-présentation de l’auteure. Comment ne pas en souligner le dernier membre de phrase sur « l’observation hallucinée de l’amplitude de l’oppression des femmes »…
Dans le prologue, Nicole-Claude Mathieu parle, entre autres, d’antiféminisme, du féminisme matérialiste, du sexisme, d’exploitation « concrète, matérielle – par les hommes – du corps, de l’esprit et des activités des femmes, dans le travail professionnel, la sexualité et, ne l’oublions pas, dans le travail familial/ménager/domestique ».
Sommaire
Première partie : Entrées de dictionnaires, pour gens pressés
Chapitre I : Différenciation des sexes (Les représentations du sexe et du genre, La construction sociale de la différence des sexes et de l’inégalité)
Chapitre II : Sexe et genre (Différenciation biologique, différenciation sociale, Autres sexes et autres genres, Différentes analyses du rapport entre sexe et genre, Dérives de la notion de genre, Trois débats autour des catégories de genre et de sexe)
Chapitre III : Études féministes et anthropologie
Chapitre IV : Corps féminin et masculin (Le corps construit et l’appropriation des femmes, Le corps producteur et l’exploitation du travail des femmes, Le corps reproducteur et l’exploitation des capacités procréatives des femmes, Le corps sexuel et l’expropriation d’une sexualité autonome chez les femmes)
Deuxième partie : Lectures critiques sur la domination masculine… au masculin
Chapitre V : Bourdieu ou le pouvoir auto-hypnotique de la domination masculine (Candidat Bourdieu : recalé à l’examen de DEA (1re année de thèse). Aux motifs de : Du symbolique et de sa « révolution », Du lourd fardeau de l’homme, Symbolique, conscience, résistance, De l’a-a-mour)
Chapitre VI : Beauvoir et les « hordes primitives » (Des sociétés « sans institutions », La femme procrée, l’homme crée, La femme met bas, l’homme se bat, Conclusion)
Chapitre VII : Lévi-Strauss et (toujours) l’échange des femmes avec Martine Gestin (Analyses formelles, discours, réalités empiriques, Du genre humain aux femmes : l’articulation culture/nature, Modèles versus réalités statistiques, empiriques, sociologiques, La question des sociétés matrilinéaires et matrilocales, Repenser l’échange matrimonial, Un androcentrisme bien partagé et fort ancien)
Troisième partie : Une Internationale de la violence
Chapitre VIII : Les mutilations du sexe des femmes avec Nicole Échard
Chapitre IX : Relativisme culturel, excision et violences contre les femmes
Chapitre X : Banalité du mal et « consentement » : des non-droits humains des femmes (Parias et parvenues, « Consentement » ou anesthésie de la conscience de Soi ?, L’oppression des femmes en tant que mal politique, Banalité, banalisation, trivialité de la domination masculine)
Chapitre XI : Clair/Voyances lesbiennes
Chapitre XII : « Origines » ou mécanismes de l’oppression des femmes ?
Chapitre XIII : Questions à l’éco-féminisme
Quatrième partie : Autour des « matriarcats »
Chapitre XIV : « Matriarcat » ou résistance ? Mythes et réalités (Les mythes d’un matriarcat primitif, Les mythes modernes d’un matriarcat actuel, Réalités diverses et résistances)
Chapitre XV : Circulation des hommes, permanence des femmes, matriarcats imaginaires et autres curiosités… (Les sociétés matrilinéaires et matrilocales dans le monde, Des matriarcats imaginaires, passés et actuels, La personne et le corps des femmes, La maison, espace dit « domestique » des femmes, mais aussi politique et religieux, Domestications…, Circulation des hommes, uxorilocalité et « puzzle matrilinéaire », La division sexuée du travail, Un « puzzle matrilinéaire » pour les femmes ?, Épilogue en forme de questions)
Cinquième partie : Le sexe social, le genre et la personne
Chapitre XVI : Femmes du Soi, femmes de l’Autre (Frontières externes incluant l’autre-femme, Limites internes excluant l’autre-femme, L’autre-femme et les femmes des autres)
Chapitre XVII : Remarques sur la personne, le sexe et le genre (La nature humaine, La personne humaine, La personne sexuée, La personne en sa qualité, La personne clivée, La personne effacée, La personne dépersonnifiée, La personne éphémère)
Chapitre XVIII : Dérive du genre/stabilité des sexes (Sexualités multiples…, Travestissements, transvestismes, troisièmes genres…)
Chapitre XIX : Les transgressions du sexe et du genre à la lumière de données ethnographiques (Représentations du sexe et du genre, Cadre général de la recherche, Genre ou sexe social ?)
Le livre se termine par un texte lu par Danielle Kergoat lors des obsèques de Nicole-Claude Mathieu « Vendredi 14 mars 2014 »
De cet ensemble de textes, je ne saurai rendre compte, aussi je me contente de souligner certaines analyses et d’en discuter un point.
Nicole-Claude Mathieu s’attache à « rendre visible l’oppression des femmes à travers la construction même de la différence sociale des sexes ». Il ne s’agit pas de simple différenciation « mais de hiérarchisation des sexes, avec affirmation de la prévalence masculine ».
L’auteure analyse « la division sexuelle du travail de reproduction », la relative infertilité des femmes, la dissociation « entre pulsion sexuelle et mécanismes hormonaux de la procréation », l’organisation sociale de la reproduction, la division socio-sexuée du travail (modalités, hiérarchisation, taches interdites aux femmes…). Elle parle de différenciation sociale, d’assignation de fonctions différentes « dans le corps social en entier », de normes hétérosexuelles, de rapports entre sexe et genre, de naturalisation de la catégorie « femme », d’occultation des rapport de pouvoirs. Elle critique aussi les dérives de la notion de genre, l’oubli des femmes, de l’oppression, la survalorisation des dimensions discursives… « l’inversion de sexe n’est pas obligatoirement une subversion du genre » et l’auteure préfère « clarifier l’économie politique du genre que le « troubler » à l’économie ».
Les textes au « croisement » des études féministes et de l’anthropologie sont d’un apport considérable. Nicole-Claude Mathieu critique les biais sexistes des scientifiques, leur andocentrisme, et souligne à la fois les « mécanismes d’invisibilisation des femmes » et « leur sur-visibilisation comme êtres pensés plus naturels que les hommes ». L’auteure revient sur Lévi-Strauss et « L’échange des femmes », les sociétés matrilinéaires et matrilocales, les mythes du matriarcat, leur construction et pour reprendre, comme l’auteure, une formule de Cynthia Eller « Un passé inventé ne donnera pas aux femmes un futur ».
Je souligne l’importance du texte « Circulation des hommes, permanence des femmes, matriarcats imaginaires et autres curiosités… » paru en introduction d’un ouvrage dirigé par l’auteure : « Une maison sans fille est une maison morte. La personne et le genre en sociétés matrilinéaires et/ou uxorilocales ». Nicole-Claude Mathieu y aborde, entre autres, les sociétés matrilinéaires et matrilocales dans le monde, le statut DE Sujet social (la femme en tant que sujet), les matriarcats imaginaires, la personne et le corps des femmes, la maison les espaces domestiques, politique et religieux, le « puzzle matrilinéaire », la division sexuée du travail…
L’auteure parle aussi des corps, « parler des corps féminin ou masculin n’est pas la même chose que de parler de corps de femme ou d’homme ». Elle souligne « la différenciation sociale des sexes », « les traitements asymétriques des corps féminins et masculins ». Nicole-Claude Mathieu analyse le corps reproducteur, son contrôle, l’appropriation des femmes, les mutilations du sexe, « il faut s’élever contre la mise en équivalence des mutilations sexuelles réalisées sur les corps mâles et femelles ». Il n’y a en effet rien de comparable entre circoncision et excision, infibulation. L’auteure souligne la « transformation de la sexualité des femmes en sexualité de service au bénéfice de l’homme » et dénonce le relativisme culturel qui permet de justifier les violences contre les femmes. Relativisme qui conduit certain-e-s à nier la domination et les violences exercées sur les femmes, sans oublier leur manque de soutien aux luttes des femmes pour leur autonomie.
Nicole-Claude Mathieu revient sur la notion de consentement, largement traité dans le volume précédent de ses textes. Elle discute de la « conscience de soi », souligne le travail à la fois continu et dispersé des femmes, leur sous-nutrition, la fatigue physique et mentale liée à la responsabilité des enfants, leur dés-armement, l’entrave à l’utilisation de l’espace public, les sévices physiques et verbaux, les contraintes sexuelles… L’auteure parle de la « banalité, banalisation, trivialité de la domination masculine ».
Je souligne l’intérêt du texte « Remarques sur la personne, le sexe et le genre », les analyses sur la personne humaine, la personne sexuée, la personne en sa qualité, la personne clivée, la personne effacée, la personne dépersonnifiée, la personne éphémère…
J’ai particulièrement apprécié la critique pleine d’humour, que fait l’auteure de Pierre Bourdieu et de sa « Domination masculine », une critique tant de la méthode que des argumentaires. Texte se terminant par deux phrases de Christiane Rochefort : « L’oppresseur n’entend pas ce que dit son opprimé comme un langage mais comme un bruit. C’est dans la définition de l’oppression »
Un point me semble très discutable. Partant de l’organisation sociale de la reproduction, des mécanismes visant à augmenter la fécondité des femmes, Nicole-Claude Mathieu indique que « la reproduction est un travail, socialement organisé comme tout travail ». Je souscrit à la formulation, contre la plupart des lectures « marxistes ». Cependant, je ne pense que l’on puisse en déduire que « l’instrument de production est le corps de la femme, le produit, c’est l’enfant ». Le corps des femmes n’est jamais réductible, séparable de leur être, il n’est donc jamais un outil. Corps et force de travail ne sont pas assimilables. « Engendrer » est toujours une activité sociale, non une simple production d’enfants suite à une « location d’utérus ». L’auteure évacue les contradictions qu’elle souligne ailleurs. Derrière des formulations pour le moins inadéquates, que l’auteure rattache de manière très simplificatrice à des analyses marxistes, il s’agit à mes yeux d’extrapolations plus qu’hasardeuses. Sans oublier que d’autres y trouve des argumentaires pour justifier aujourd’hui la GPA, le système prostitueur, etc…
Au delà du désaccord, il me semble nécessaire de poursuivre les débats sur la « production du vivre », pour utiliser une formule de Danielle Kergoat et répondre à la question posée aussi par l’auteure « pourquoi une apparence de permanence sociale serait-indépassable ? » Dépasser des rapport sociaux, le système de genre et non les entériner en faisant de chacun-e des marchandises.
Et pour finir, une petite histoire et cette question proposée en fin du chapitre « Banalité du mal et « consentement » : des non-droits humains des femmes » : « Dans un café parisien, début 1997. Deux hommes au comptoir ; L’un lance à la ronde une bonne histoire : « Savez-vous la différence entre une femme et une poubelle ? Non ? Eh bien, il n’y en a pas. On les remplit pendant la semaine et on les sort le week-end. » Réaction d’une cliente, qui ne « consentait » pas à ce qu’on place les femmes hors des limites de l’humain : « Oui… et c’est quoi, les ordures ? » Silence stupéfait de l’orateur. Il n’y avait pas pensé… »
Lien : https://entreleslignesentrel..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Lecteurs de Nicole-Claude Mathieu (6)Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz saga Haikyuu
Quel est le personnage principal de cette saga?
Daichi Sawamura
Tobio Kageyama
Tooru Oikawa
Shoyo Hinata
21 questions
23 lecteurs ont répondu
Thème : Haikyu, tome 1 de
Haruichi FurudateCréer un quiz sur cet auteur23 lecteurs ont répondu