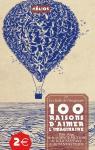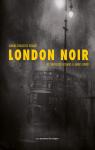Critiques de André-François Ruaud (131)
On aurait pu intituler ce livre : "Comment l'Angleterre vola à la France un de ses talentueux jeunes artistes". Mais ça, c'est la version chauvine. Un titre plus approprié serait probablement : "Comment la France fut incapable de reconnaître l'un de ses talents prometteurs par manque d'ouverture d'esprit". Non pas que je considère l'Angleterre comme un modèle absolu, très loin s'en faut. Mais le fait est qu'au début du XXème siècle, nous étions (et ce malgré l'émergence de mouvements comme le symbolisme et l'Art Nouveau) très frileux et peu ouverts aux arts décoratifs, dont nous faisions fort peu de cas. Résultat : la plupart des grands illustrateurs de l'époque sont anglais, voire russes, suédois, allemands, américains, et que sais-je encore. Edmund, ou plus exactement Edmond Dulac (car c'était son véritable nom), était, lui, français, mais est devenu, tout jeune artiste encore, un expatrié. Il a compris que ce qu'il aimait peindre ne convenait pas au goût français. Et il ne s'est pas raté sur ce coup-là, vu qu'il a rapidement trouvé des commandes auprès de revues anglaises : l'illustration y était alors en plein essor, notamment grâce à Arthur Rackham.
Je me suis vite rendu compte à la lecture que je connaissais mal, voire très mal, voire très très mal, Edmund Dulac. Je le confondais avec à peu près tous les illustrateurs anglais du début du XXème... Et que dire des nombreux noms de ses confrères cités ? Bon, il n'est jamais trop tard pour combler ses lacunes. J'aurais évidemment été incapable de dire en quoi il se distinguait d'Untel ou d'Untel. À présent, je pense avoir compris : c'est son usage de la couleur, et spécialement du bleu, qui fait sa marque. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec André-François Ruaud sur l'influence de l'Art Nouveau plus prégnante chez Rackham que chez Dulac : c'est sensible chez les deux artistes. Mais il faut bien avouer que les nocturnes de Dulac, c'est quelque chose. Quant à son goût pour l'Orient, il serait difficile de passer à côté, ne serait-ce que parce qu'il a beaucoup illustré les Mille et Une Nuits.
Le gros point fort de la collection des Artbooks féériques des Moutons électriques, c'est bien entendu le grand nombre de reproductions de bonne qualité, pour un prix correct (15 euros). le texte n'est pas très long, mais suffisant pour une première approche de l'artiste, et bien documenté. On appréciera notamment la remise en contexte de l'illustration en Angleterre à l'époque de Dulac. Les points faibles - et là je vais me répéter, car j'avais dit la même chose pour l'opus sur Arthur Rackham -, ce sont la mise en page (texte coupé en plein milieu par de nombreuses pages de reproductions) et le manque d'informations sur les oeuvres. Et pas de bibliographie, ce qui commence à sérieusement m'agacer !
Si vous n'aimez pas pas vous farcir la tête de textes dans les livres d'art et que vous souhaitez faire un petit pas de côté, n'hésitez pas à tenter le coup avec ce titre ! C'est tout plein de belles images qui font rêver...
Je me suis vite rendu compte à la lecture que je connaissais mal, voire très mal, voire très très mal, Edmund Dulac. Je le confondais avec à peu près tous les illustrateurs anglais du début du XXème... Et que dire des nombreux noms de ses confrères cités ? Bon, il n'est jamais trop tard pour combler ses lacunes. J'aurais évidemment été incapable de dire en quoi il se distinguait d'Untel ou d'Untel. À présent, je pense avoir compris : c'est son usage de la couleur, et spécialement du bleu, qui fait sa marque. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec André-François Ruaud sur l'influence de l'Art Nouveau plus prégnante chez Rackham que chez Dulac : c'est sensible chez les deux artistes. Mais il faut bien avouer que les nocturnes de Dulac, c'est quelque chose. Quant à son goût pour l'Orient, il serait difficile de passer à côté, ne serait-ce que parce qu'il a beaucoup illustré les Mille et Une Nuits.
Le gros point fort de la collection des Artbooks féériques des Moutons électriques, c'est bien entendu le grand nombre de reproductions de bonne qualité, pour un prix correct (15 euros). le texte n'est pas très long, mais suffisant pour une première approche de l'artiste, et bien documenté. On appréciera notamment la remise en contexte de l'illustration en Angleterre à l'époque de Dulac. Les points faibles - et là je vais me répéter, car j'avais dit la même chose pour l'opus sur Arthur Rackham -, ce sont la mise en page (texte coupé en plein milieu par de nombreuses pages de reproductions) et le manque d'informations sur les oeuvres. Et pas de bibliographie, ce qui commence à sérieusement m'agacer !
Si vous n'aimez pas pas vous farcir la tête de textes dans les livres d'art et que vous souhaitez faire un petit pas de côté, n'hésitez pas à tenter le coup avec ce titre ! C'est tout plein de belles images qui font rêver...
Une amie avait, trainant dans sa bibliothèque, cette histoire du space opera. Je le lui ai emprunté et j’y ai fait pas mal de découvertes intéressantes.
Les auteurs établissent d’abord quelques limites. Le sujet se limite au space opera avant 1977, date de la sortie du premier Star Wars, considéré comme un résumé de tout ce qui a été imaginé avant – un peu comme le roman Hypérion de Dan Simmons des années plus tard. Bref, les auteurs y voient une rupture.
Ensuite ils limitent le genre aux aventures vraiment spatiales. Tout ce qui se rapporte au planet opera – dans lequel sont intégrés Jack Vance ou Ursula Le Guin – est éliminé. Malgré cela, il reste de quoi causer.
Les divers supports médiatiques sont évoqués, et surtout le papier et la pellicule. J’ai appris des de choses sur les comic strips, ces bandes dessinées de quelques cases. Flash Gordon et Buck Rogers ont commencé ainsi. Côté télé il y eut les production bas prix appelées serials, et là aussi Flash Gordon et Buck Rogers brillèrent. On parle aussi de Valerian. Il y a un long et intéressant chapitre sur Docteur Who (présent sur les écrans anglais depuis 1963 avec seulement quelques éclipses, un record) et un autre, bien sûr, sur Star Trek (surtout la série avec Kirk et celle avec Picard).
Mais le gros morceau reste la littérature. De nombreux auteurs, très connus ou presque pas (en France), pionniers des années 30 ou rénovateurs des années 70, ont leur chapitre ou sont groupés à deux ou trois dans un chapitre. Point faible : le spoil ; nombre de leurs œuvres sont creusées dans les moindres détails, et il faut une mémoire de poisson rouge comme la mienne pour n’en retenir qu’une sensation globale, une envie (ou pas) d’aller voir de plus près.
Ainsi si je suis curieux, sans plus, de lire un récit du vieux E. E. doc Smith, j’ai tout de suite voulu tester l’humour de Eric Frank Russell (j’ai adoré Le Chioff). Question d’opportunité aussi. Pas forcément évident de trouver des occasions ou du numérique sur les vieux auteurs. J’aimerais redécouvrir l’univers survolté de Charles Harness et découvrir tout court Colin Kapp et Alexei Panshin.
Poul Anderson a droit à un dithyrambe de son traducteur Jean-Daniel Brèque. Mais d’autres auteurs se font carrément défoncer et là je ne suis pas. C’est Isaac Asimov qui prend le plus cher : incompétence stylistique, froideur cérébrale. C’est limite si André François Ruaud et Vivian Amalric ne disent pas qu’il a volé son succès à des auteurs moins connus et plus brillants. Ils voient des défauts partout où je ne vois que des choix qui m’ont plu. Le seul argument sur lequel je ne peux rien dire concerne ce style « atroce » en anglais, qui aurait été largement gommé par les traducteurs français.
Si j’oublie cet écart détestable, l’ensemble m’a rappelé aux belles images de combats spatiaux que j’adorais ado et que j’aime encore beaucoup. Il m’a aussi fourni une petite liste d’auteurs à tester, et tant pis si c’est daté.
Bref je ne regrette pas.
Les auteurs établissent d’abord quelques limites. Le sujet se limite au space opera avant 1977, date de la sortie du premier Star Wars, considéré comme un résumé de tout ce qui a été imaginé avant – un peu comme le roman Hypérion de Dan Simmons des années plus tard. Bref, les auteurs y voient une rupture.
Ensuite ils limitent le genre aux aventures vraiment spatiales. Tout ce qui se rapporte au planet opera – dans lequel sont intégrés Jack Vance ou Ursula Le Guin – est éliminé. Malgré cela, il reste de quoi causer.
Les divers supports médiatiques sont évoqués, et surtout le papier et la pellicule. J’ai appris des de choses sur les comic strips, ces bandes dessinées de quelques cases. Flash Gordon et Buck Rogers ont commencé ainsi. Côté télé il y eut les production bas prix appelées serials, et là aussi Flash Gordon et Buck Rogers brillèrent. On parle aussi de Valerian. Il y a un long et intéressant chapitre sur Docteur Who (présent sur les écrans anglais depuis 1963 avec seulement quelques éclipses, un record) et un autre, bien sûr, sur Star Trek (surtout la série avec Kirk et celle avec Picard).
Mais le gros morceau reste la littérature. De nombreux auteurs, très connus ou presque pas (en France), pionniers des années 30 ou rénovateurs des années 70, ont leur chapitre ou sont groupés à deux ou trois dans un chapitre. Point faible : le spoil ; nombre de leurs œuvres sont creusées dans les moindres détails, et il faut une mémoire de poisson rouge comme la mienne pour n’en retenir qu’une sensation globale, une envie (ou pas) d’aller voir de plus près.
Ainsi si je suis curieux, sans plus, de lire un récit du vieux E. E. doc Smith, j’ai tout de suite voulu tester l’humour de Eric Frank Russell (j’ai adoré Le Chioff). Question d’opportunité aussi. Pas forcément évident de trouver des occasions ou du numérique sur les vieux auteurs. J’aimerais redécouvrir l’univers survolté de Charles Harness et découvrir tout court Colin Kapp et Alexei Panshin.
Poul Anderson a droit à un dithyrambe de son traducteur Jean-Daniel Brèque. Mais d’autres auteurs se font carrément défoncer et là je ne suis pas. C’est Isaac Asimov qui prend le plus cher : incompétence stylistique, froideur cérébrale. C’est limite si André François Ruaud et Vivian Amalric ne disent pas qu’il a volé son succès à des auteurs moins connus et plus brillants. Ils voient des défauts partout où je ne vois que des choix qui m’ont plu. Le seul argument sur lequel je ne peux rien dire concerne ce style « atroce » en anglais, qui aurait été largement gommé par les traducteurs français.
Si j’oublie cet écart détestable, l’ensemble m’a rappelé aux belles images de combats spatiaux que j’adorais ado et que j’aime encore beaucoup. Il m’a aussi fourni une petite liste d’auteurs à tester, et tant pis si c’est daté.
Bref je ne regrette pas.
Vous me pardonnerez si ma critique d'aujourd'hui n'est pas des meilleures : je me suis vautrée lamentablement dans la rue il y a trois heures de ça, affolant presque tout le quartier, mais réconciliée avec l'humanité grâce à deux femmes qui se sont occupé de moi avec beaucoup de gentillesse - en fait, j'ai rien, ou pas grand-chose à première vue. Je suis juste assez peu réactive (j'ai pris des décontracturants) et j'ai du mal à me concentrer ; mais je m'étais engagée auprès de Kikujiro afin de mener une lecture commune avec lui (c'est même moi qui l'y ai poussé fortement), et comme il a honoré sa part du marché, je me vois mal lui faire faux bond.
J'avais choisi ce livre parce que je sais que Kikujiro adore (tout comme moi) l'illustrateur N.C. Wyeth, qui a en partie influencé Arthur Rackham, et que nous sommes tous deux très attachés aux travaux des illustrateurs et artistes pratiquant les arts décoratifs. Il faut dire que, pour ma part, j'ai grandi avec des éditions de contes russes illustrés par le divin Bilibine, alors forcément....
Nous allons donc parler d'Arthur Rackham, un des ces illustrateurs à la fois connus et méconnus, tel N.C. Wyeth, déjà cité, mais aussi John Bauer, Kay Nielsen, Edmund Dulac et d'autres. Souvent considérés comme les illustrateurs attitrés des contes de fées ou de la légende arthurienne, ils sont connus parce que nous avons tous vu des reproductions de leurs oeuvres, et méconnus parce, souvent, nous ne connaissons même pas leurs noms. C'est tout le problème de l'art de l'illustration, vu comme commercial, voire industriel, et donc un chouïa méprisé. J'aurai sans doute l'occasion de parler plus tard de N.C. Wyeth en particulier, mais pour avoir vu une expo qui lui était dédiée (ainsi qu'à son fils et à son petit-fils), je peux vous assurer que ses peintures, de grand format, n'ont rien à envier à d'autres artistes non illustrateurs.
Arthur Rackham entre parfaitement dans ce cercle des illustrateurs qui ont connu la célébrité en leur temps, dont on ne se prive pas d'utiliser les oeuvres à tout-va de nos jours, mais auxquels les historiens de l'art s'intéressent assez peu. Il existe bien sûr une bibliographie, essentiellement anglophone, sur Rackham. Mais pas tellement en français. J'ai donc sauté sur l'occasion quand la divine bibliothèque d'étude de ma ville (le lieu est superbe) a choisi de mettre en lumière ce livre publié chez Les Moutons électriques. Que ce soit clair sur le principe du livre : il est d'un format relativement modeste, donc il est délicat de le qualifier de "beau livre", et son texte n' a pas été écrit par un historien de l'art, mais par un éditeur, André-François Ruaud, qui s'intéresse visiblement beaucoup aux illustrateurs anglais de la fin du XIXème et du début du XXème (et qui est accessoirement le directeur des Moutons électriques).
Donc pas d'analyse poussée sur l'oeuvre de Rackham, mais on sent bien que ce n'est pas le but, et qu'il s'agit davantage de faire découvrir Arthur Rackham à un grand public. Ruaud est bien renseigné sur Rackham, pas de souci là-dessus. le revers de la médaille, c'est qu'une méconnaissance des publications en histoire de l'art a conduit la maison d'édition à complètement oublier de préciser, en légende des reproductions, les dimensions des oeuvres originales, les techniques utilisées et quelques autres détails (qui ne me reviennent pas en mémoire à l'instant, désolée). Et quel besoin avait Ruaud de citer deux fois son grand ami Fabrice Colin, comme s'il était une référence sur Rackham (ce qui n'est pas le cas) ? On en revient à ce qui m'agace chez Mnémos, Actu-SF, Bragelonne et, maintenant, Les Moutons électriques (des maisons d'édition très proches) : cette habitude qu'ont les auteurs de ramener leur potes sur le devant de la scène, systématiquement, dans leurs essais et documentaires, même lorsque ces derniers n'ont pas grand-chose à dire (alors que ça ne me gêne pas, bien au contraire, si c'est un Christophe Thill qui est cité, voire sollicité, car c'est à bon escient pour ce que j'en ai vu).
Il fallait que je le dise (encore une fois, argh !) Cela dit, si c'est très agaçant, ça n'enlève pas grand-chose à l'ensemble de l'ouvrage. Car non seulement celui-ci est bien documenté, mais permet, notamment grâce à moult illustrations, d'approcher Arthur Rackham de plus près, sinon au plus près. J'avais complètement oublié qu'il avait illustré le vent dans les saules, j'ai découvert qu'il avait illustré Washington Irving aussi bien que Lewis Carroll ou les frères Grimm. Je me doutais bien qu'il avait illustré Shakespeare, mais sans en savoir davantage. Bon, j'étais quand même au courant pour les illustrations des Nibelungen, vu que j'ai un livre dessus (qu'il faudrait peut-être que je lise, tiens). Mieux, j'ignorais totalement qu'il avait débuté avec des dessins humoristiques pour la presse, humour qu'on retrouve dans d'autres oeuvres plus personnelles. Et André-François Ruaud fait bien d'attirer notre attention sur les multitudes de détails qui fourmillent dans les oeuvres de Rackham, qui contrastent avec les illustrations plus épurées de ses confrères cités plus haut. On pourrait presque passer des heures à les regarder... mais ça donne surtout envie de voir les originaux !
Allez donc à la découverte d'Arthur Rackham, avec ce livre ou un autre, ou bien encore en vous aventurant sur le web. Continuez avec Nielsen, Dulac, et le divin John Bauer (oui, "divin" est l'adjectif du jour, vous avez remarqué), ainsi qu'avec Lefler et Urban (que j'ai découvert tout récemment, pour le coup). Et on se retrouvera un de ces jours pour parler sérieusement de N.C. Wyeth (et peut-être bien de toute la famille Wyeth, en fait)...
Ah, j'allais oublier : la mise en page n'est pas terrible. Autant c'est bien d'avoir droit à des reproductions en pleine page, autant c'est fatigant de lire des paragraphes coupés en plein milieu d'une phrase, interrompus par une farandole de reproductions, pour reprendre sept ou huit pages plus loin l'air de rien. C'est une erreur de débutants, et c'est franchement pénible pour le lecteur.
Lien : https://musardises-en-depit-..
J'avais choisi ce livre parce que je sais que Kikujiro adore (tout comme moi) l'illustrateur N.C. Wyeth, qui a en partie influencé Arthur Rackham, et que nous sommes tous deux très attachés aux travaux des illustrateurs et artistes pratiquant les arts décoratifs. Il faut dire que, pour ma part, j'ai grandi avec des éditions de contes russes illustrés par le divin Bilibine, alors forcément....
Nous allons donc parler d'Arthur Rackham, un des ces illustrateurs à la fois connus et méconnus, tel N.C. Wyeth, déjà cité, mais aussi John Bauer, Kay Nielsen, Edmund Dulac et d'autres. Souvent considérés comme les illustrateurs attitrés des contes de fées ou de la légende arthurienne, ils sont connus parce que nous avons tous vu des reproductions de leurs oeuvres, et méconnus parce, souvent, nous ne connaissons même pas leurs noms. C'est tout le problème de l'art de l'illustration, vu comme commercial, voire industriel, et donc un chouïa méprisé. J'aurai sans doute l'occasion de parler plus tard de N.C. Wyeth en particulier, mais pour avoir vu une expo qui lui était dédiée (ainsi qu'à son fils et à son petit-fils), je peux vous assurer que ses peintures, de grand format, n'ont rien à envier à d'autres artistes non illustrateurs.
Arthur Rackham entre parfaitement dans ce cercle des illustrateurs qui ont connu la célébrité en leur temps, dont on ne se prive pas d'utiliser les oeuvres à tout-va de nos jours, mais auxquels les historiens de l'art s'intéressent assez peu. Il existe bien sûr une bibliographie, essentiellement anglophone, sur Rackham. Mais pas tellement en français. J'ai donc sauté sur l'occasion quand la divine bibliothèque d'étude de ma ville (le lieu est superbe) a choisi de mettre en lumière ce livre publié chez Les Moutons électriques. Que ce soit clair sur le principe du livre : il est d'un format relativement modeste, donc il est délicat de le qualifier de "beau livre", et son texte n' a pas été écrit par un historien de l'art, mais par un éditeur, André-François Ruaud, qui s'intéresse visiblement beaucoup aux illustrateurs anglais de la fin du XIXème et du début du XXème (et qui est accessoirement le directeur des Moutons électriques).
Donc pas d'analyse poussée sur l'oeuvre de Rackham, mais on sent bien que ce n'est pas le but, et qu'il s'agit davantage de faire découvrir Arthur Rackham à un grand public. Ruaud est bien renseigné sur Rackham, pas de souci là-dessus. le revers de la médaille, c'est qu'une méconnaissance des publications en histoire de l'art a conduit la maison d'édition à complètement oublier de préciser, en légende des reproductions, les dimensions des oeuvres originales, les techniques utilisées et quelques autres détails (qui ne me reviennent pas en mémoire à l'instant, désolée). Et quel besoin avait Ruaud de citer deux fois son grand ami Fabrice Colin, comme s'il était une référence sur Rackham (ce qui n'est pas le cas) ? On en revient à ce qui m'agace chez Mnémos, Actu-SF, Bragelonne et, maintenant, Les Moutons électriques (des maisons d'édition très proches) : cette habitude qu'ont les auteurs de ramener leur potes sur le devant de la scène, systématiquement, dans leurs essais et documentaires, même lorsque ces derniers n'ont pas grand-chose à dire (alors que ça ne me gêne pas, bien au contraire, si c'est un Christophe Thill qui est cité, voire sollicité, car c'est à bon escient pour ce que j'en ai vu).
Il fallait que je le dise (encore une fois, argh !) Cela dit, si c'est très agaçant, ça n'enlève pas grand-chose à l'ensemble de l'ouvrage. Car non seulement celui-ci est bien documenté, mais permet, notamment grâce à moult illustrations, d'approcher Arthur Rackham de plus près, sinon au plus près. J'avais complètement oublié qu'il avait illustré le vent dans les saules, j'ai découvert qu'il avait illustré Washington Irving aussi bien que Lewis Carroll ou les frères Grimm. Je me doutais bien qu'il avait illustré Shakespeare, mais sans en savoir davantage. Bon, j'étais quand même au courant pour les illustrations des Nibelungen, vu que j'ai un livre dessus (qu'il faudrait peut-être que je lise, tiens). Mieux, j'ignorais totalement qu'il avait débuté avec des dessins humoristiques pour la presse, humour qu'on retrouve dans d'autres oeuvres plus personnelles. Et André-François Ruaud fait bien d'attirer notre attention sur les multitudes de détails qui fourmillent dans les oeuvres de Rackham, qui contrastent avec les illustrations plus épurées de ses confrères cités plus haut. On pourrait presque passer des heures à les regarder... mais ça donne surtout envie de voir les originaux !
Allez donc à la découverte d'Arthur Rackham, avec ce livre ou un autre, ou bien encore en vous aventurant sur le web. Continuez avec Nielsen, Dulac, et le divin John Bauer (oui, "divin" est l'adjectif du jour, vous avez remarqué), ainsi qu'avec Lefler et Urban (que j'ai découvert tout récemment, pour le coup). Et on se retrouvera un de ces jours pour parler sérieusement de N.C. Wyeth (et peut-être bien de toute la famille Wyeth, en fait)...
Ah, j'allais oublier : la mise en page n'est pas terrible. Autant c'est bien d'avoir droit à des reproductions en pleine page, autant c'est fatigant de lire des paragraphes coupés en plein milieu d'une phrase, interrompus par une farandole de reproductions, pour reprendre sept ou huit pages plus loin l'air de rien. C'est une erreur de débutants, et c'est franchement pénible pour le lecteur.
Lien : https://musardises-en-depit-..
J'ai découvert ce livre à la bibliothèque. Je l'avais emprunté mais après l'avoir feuilleté j'ai eu envie de l'acheter pour pouvoir le garder ^_^
Cet essai, retrace l'histoire de la science-fiction depuis le 16ème siècle (axé France-Angleterre-US-Japon). Dans l'ensemble, il est plutôt intéressant et j'y ai fait quelques découvertes (j'ai fait gonfler ma pal et mon pense-bête).
L'histoire de la littérature de science-fiction est intimement liée à l'histoire des sciences et techniques, à l'histoire universelle, à l'histoire du livre, etc. Il y a donc des loooongs passages de “mise en contexte” historico-socio-culturels. C'est envisager la SF sous un autre angle... mais parfois j'ai eu du mal à garder les yeux ouverts.
Mes petites remarques en passant...
* Ils évoquent le livre d'Alexeï Tolstoï, Aélita, et pour l'avoir lu je sais qu'ils n'étaient pas trois dans la fusée à partir pour Mars mais deux. Cela étant dit, je ne suis pas du tout d'accord sur leur interprétation de la fin
* Une fois ils trouvent Edmond Hamilton amusant et une autre fois lire ses livres “peut endorlorir des cervelles sensibles à la médiocrité stylistique (...)”. Je trouve la critique quand même exagérée.
* Pas un mot sur l'oeuvre de Pierre Bordage qui pourtant semble être une figure incontournable de la SF française.
* J'ai découvert un livre sur l'oeuvre de Poul Anderson qui s'intitule “Orphée aux étoiles, les voyages de Poul Anderson” de Jean-Daniel Brèque (Les moutons électriques, 2007).
J'ai un peu décroché sur la dernière partie... que j'ai lu en diagonale. Quelle idée de faire débuter le 21ème siècle en 1992?
Il n'y a pas de conclusion juste une réponse à la préface de Gérard Klein.
Je dis cela, je ne dis rien mais cela aurait été bien pratique d'avoir un index de toutes les oeuvres citées.
Avis mitigé mais plein de “nouveaux” livres à lire... une vie ne sera pas suffisante! Damned!
Cet essai, retrace l'histoire de la science-fiction depuis le 16ème siècle (axé France-Angleterre-US-Japon). Dans l'ensemble, il est plutôt intéressant et j'y ai fait quelques découvertes (j'ai fait gonfler ma pal et mon pense-bête).
L'histoire de la littérature de science-fiction est intimement liée à l'histoire des sciences et techniques, à l'histoire universelle, à l'histoire du livre, etc. Il y a donc des loooongs passages de “mise en contexte” historico-socio-culturels. C'est envisager la SF sous un autre angle... mais parfois j'ai eu du mal à garder les yeux ouverts.
Mes petites remarques en passant...
* Ils évoquent le livre d'Alexeï Tolstoï, Aélita, et pour l'avoir lu je sais qu'ils n'étaient pas trois dans la fusée à partir pour Mars mais deux. Cela étant dit, je ne suis pas du tout d'accord sur leur interprétation de la fin
* Une fois ils trouvent Edmond Hamilton amusant et une autre fois lire ses livres “peut endorlorir des cervelles sensibles à la médiocrité stylistique (...)”. Je trouve la critique quand même exagérée.
* Pas un mot sur l'oeuvre de Pierre Bordage qui pourtant semble être une figure incontournable de la SF française.
* J'ai découvert un livre sur l'oeuvre de Poul Anderson qui s'intitule “Orphée aux étoiles, les voyages de Poul Anderson” de Jean-Daniel Brèque (Les moutons électriques, 2007).
J'ai un peu décroché sur la dernière partie... que j'ai lu en diagonale. Quelle idée de faire débuter le 21ème siècle en 1992?
Il n'y a pas de conclusion juste une réponse à la préface de Gérard Klein.
Je dis cela, je ne dis rien mais cela aurait été bien pratique d'avoir un index de toutes les oeuvres citées.
Avis mitigé mais plein de “nouveaux” livres à lire... une vie ne sera pas suffisante! Damned!
100 raisons d'aimer l'imaginaire me tentait beaucoup, moi qui était déjà convaincue par avance des bienfaits de la littérature de l'imaginaire. Je remercie donc Babelio (via Facebook) et les éditions Hélios pour cet envoi : j'y ai trouvé plein de choses intéressantes !
D'abord, mine de rien, une définition de la SFFF à travers différentes entrées. Le panorama est très vaste, il y en a pour tous les goûts : steampunk, dystopie, dark fantasy, cyberpunk, uchronie et j'en passe (voir l'entrée n°63 qui donne une idée assez exhaustive de ce qui existe en la matière). Difficile de n'être tenté par rien...
J'y ai donc trouvé surtout un tas d'idées de lectures. Car à chaque chapitre/raison, le lecteur se verra offrir des pistes de lectures, toutes époques et nationalités confondues. Vaste et beau programme !
Mais pas seulement, car l'imaginaire ne se cantonne pas à la littérature. Vous trouverez donc de nombreux liens vers des films, des jeux, des festivals, de la musique !
Un petit livre (par sa taille et son prix très modique) pourtant très complet qui ravira les convaincus. Et nul doute que ceux-ci, pris d'une envie irrépressible de partager leur passion, n'hésiteront pas à l'offrir aux réfractaires de leur entourage !
D'abord, mine de rien, une définition de la SFFF à travers différentes entrées. Le panorama est très vaste, il y en a pour tous les goûts : steampunk, dystopie, dark fantasy, cyberpunk, uchronie et j'en passe (voir l'entrée n°63 qui donne une idée assez exhaustive de ce qui existe en la matière). Difficile de n'être tenté par rien...
J'y ai donc trouvé surtout un tas d'idées de lectures. Car à chaque chapitre/raison, le lecteur se verra offrir des pistes de lectures, toutes époques et nationalités confondues. Vaste et beau programme !
Mais pas seulement, car l'imaginaire ne se cantonne pas à la littérature. Vous trouverez donc de nombreux liens vers des films, des jeux, des festivals, de la musique !
Un petit livre (par sa taille et son prix très modique) pourtant très complet qui ravira les convaincus. Et nul doute que ceux-ci, pris d'une envie irrépressible de partager leur passion, n'hésiteront pas à l'offrir aux réfractaires de leur entourage !
Cet ouvrage est absolument passionnant et réjouira tous les fans d’Hercule Poirot.
La partie biographie est en effet tout à fait passionnante et écrite dans un style très agréable agrémenté d’un peu d’humour .
Ensuite, l’auteur aurait sans doute pu se passer de la partie historique dont on se demande un peu ce qu’elle vient faire à cet endroit, mais ce n’est pas bien grave car ensuite il revient sur des chapitres passionnants et érudits bien qu’un peu anecdotiques (par exemple les hôtels d’Hercule Poirot).
Enfin, cerise sur le gâteau, l’auteur analyse et questionne la thèse du livre de Pierre Bayard sur le meurtre de Roger Ackroyd, et comme je l’avais lu, cela m’a beaucoup intéressée.
Bon, j’avoue, il faut être un peu fan du petit détective belge pour apprécier tout cet ouvrage, mais vu que je le suis, je salue vraiment le travail de l’auteur.
La partie biographie est en effet tout à fait passionnante et écrite dans un style très agréable agrémenté d’un peu d’humour .
Ensuite, l’auteur aurait sans doute pu se passer de la partie historique dont on se demande un peu ce qu’elle vient faire à cet endroit, mais ce n’est pas bien grave car ensuite il revient sur des chapitres passionnants et érudits bien qu’un peu anecdotiques (par exemple les hôtels d’Hercule Poirot).
Enfin, cerise sur le gâteau, l’auteur analyse et questionne la thèse du livre de Pierre Bayard sur le meurtre de Roger Ackroyd, et comme je l’avais lu, cela m’a beaucoup intéressée.
Bon, j’avoue, il faut être un peu fan du petit détective belge pour apprécier tout cet ouvrage, mais vu que je le suis, je salue vraiment le travail de l’auteur.
"Ce petit guide nous offre en quatre-vingt-dix neuf romans et recueils (plus un essai), un tour d'horizon de certaines des œuvres les plus attachantes dans tous les styles de ce vaste domaine qu'est, aujourd'hui, la "Fantasy".
La balade est tentante.
Elle commencera, pour moi avec Barjavel et son classique petit ouvrage "L'enchanteur. "La matière de Bretagne", très présente dans ce genre littéraire, fournit aussi l'inspiration à Marion Zimmer Bradley pour sa formidable trilogie : "Les dames du lac". La légende d'Arthur et des chevaliers de la table ronde est, ici, vue à travers les yeux des trois femmes du cycle. La profondeur, le féminisme et le réalisme historique ajoutés à l'épopée en firent un énorme succès.
Rédigé en 1471, "Le Morte d'Arthur" est le texte refondateur anglo-saxon de la tradition arthurienne. On suppose que son auteur était Sir Thomas Malory de Newbold Revel qui l'aurait rédigé alors qu'il croupissait en prison. En France, on se réfère plutôt à Chrétien de Troyes.
Puis vient l'un des premiers chefs d’œuvre du genre "Terremer" d'Ursula K. Le Guin. c'est le récit de la vie de Ged, depuis son enfance sur l'une des îles de l'archipel jusqu'à son avènement à la fonction de grand mage de ce monde.
Ursula K. Le Guin fut, peut-être, la première intellectuelle à s'intéresser à la fantasy et travailla, à travers ses essais, ses fictions et ses romans,depuis les années 70, à en faire un genre adulte.
La matière de ce petit guide, offert à une certaine époque, pour l'achat de deux volumes de la collection où il parut, est abondante.
Les titres, les noms d'auteurs sont nombreux. S'il manque cruellement d'illustration, il est, cependant, très bien réalisé et balaie le genre assez largement.
La balade est tentante.
Elle commencera, pour moi avec Barjavel et son classique petit ouvrage "L'enchanteur. "La matière de Bretagne", très présente dans ce genre littéraire, fournit aussi l'inspiration à Marion Zimmer Bradley pour sa formidable trilogie : "Les dames du lac". La légende d'Arthur et des chevaliers de la table ronde est, ici, vue à travers les yeux des trois femmes du cycle. La profondeur, le féminisme et le réalisme historique ajoutés à l'épopée en firent un énorme succès.
Rédigé en 1471, "Le Morte d'Arthur" est le texte refondateur anglo-saxon de la tradition arthurienne. On suppose que son auteur était Sir Thomas Malory de Newbold Revel qui l'aurait rédigé alors qu'il croupissait en prison. En France, on se réfère plutôt à Chrétien de Troyes.
Puis vient l'un des premiers chefs d’œuvre du genre "Terremer" d'Ursula K. Le Guin. c'est le récit de la vie de Ged, depuis son enfance sur l'une des îles de l'archipel jusqu'à son avènement à la fonction de grand mage de ce monde.
Ursula K. Le Guin fut, peut-être, la première intellectuelle à s'intéresser à la fantasy et travailla, à travers ses essais, ses fictions et ses romans,depuis les années 70, à en faire un genre adulte.
La matière de ce petit guide, offert à une certaine époque, pour l'achat de deux volumes de la collection où il parut, est abondante.
Les titres, les noms d'auteurs sont nombreux. S'il manque cruellement d'illustration, il est, cependant, très bien réalisé et balaie le genre assez largement.
Londres, esquissée au travers de son Histoire et de sa littérature policière, tout un programme.
Programme ambitieux que de réunir l’Histoire d’une ville, son urbanisme, ses squares, ses quartiers, ses frontières entre le West et l’East End et de les mélanger avec les grandes figures de la littérature policière.
Et ça marche plutôt bien (pour ne pas dire que ça marche super bien) car en ouvrant ce livre, non seulement on découvre Londres d’une autre manière, mais en plus, on s’instruit (ok, faudra retenir tout ça ensuite).
Vous l’aurez deviné, ma partie préférée fut celle consacrée à la Londres victorienne où en plus d’avoir enrichi mon savoir, j’ai exploré le tout en compagnie de Holmes.
Petit carton rouge à l’auteur qui aurait dû, à mon sens, se contenter des références canoniques pour Sherlock Holmes et ne pas introduire, sans le préciser, des théories holmésiennes que l’on retrouve dans son autre recueil, "Sherlock Holmes, une vie".
C’est une supputation d’holmésiens que la mère de Sherlock se nomme Violet ! Les études qu’il a faites sont aussi l’objet de théories mais personne ne peut dire s’il a fait Oxford ou Cambridge (ou aucune des deux) et encore moins que c’est sa maman qui lui a payé son premier logement à Montague Street.
L’auteur aborde autant les beaux quartiers du West End que les taudis de l’East End, parlant de la frontière entre les deux, de cette société rigide qui pensait que la pauvreté était une mauvaise chose et qu’elle était surtout de la faute des gens qui la subissaient.
On est allé sur les docks où des pauvres hères embauchaient à la journée, se ruant l’un sur l’autre pour obtenir un boulot mal payé, éreintant et qui ne leur remplirait pas le ventre.
Quand je vous disais que c’était un véritable roman noir qui explore toutes les facettes de la ville de Londres.
Anybref, ce livre est instructif, un mélange habile des grandes figures du roman policier et de cette ville de Londres qu’ils ont tous et toutes arpentées, en long et en large, de l’époque victorienne, édouardienne, sous le blitz de 1914, sous celui de 1940 et qui ont vu Londres s’agrandir, certains quartiers devenir encore plus pauvre ou qui ont vécu dans le Londres des guerres mondiales.
À déguster avec ou sans modération mais je conseillerais une lecture étalée sur le temps, grignoter ce recueil au soir, avec une bonne tasse de thé.
Lien : https://thecanniballecteur.w..
Programme ambitieux que de réunir l’Histoire d’une ville, son urbanisme, ses squares, ses quartiers, ses frontières entre le West et l’East End et de les mélanger avec les grandes figures de la littérature policière.
Et ça marche plutôt bien (pour ne pas dire que ça marche super bien) car en ouvrant ce livre, non seulement on découvre Londres d’une autre manière, mais en plus, on s’instruit (ok, faudra retenir tout ça ensuite).
Vous l’aurez deviné, ma partie préférée fut celle consacrée à la Londres victorienne où en plus d’avoir enrichi mon savoir, j’ai exploré le tout en compagnie de Holmes.
Petit carton rouge à l’auteur qui aurait dû, à mon sens, se contenter des références canoniques pour Sherlock Holmes et ne pas introduire, sans le préciser, des théories holmésiennes que l’on retrouve dans son autre recueil, "Sherlock Holmes, une vie".
C’est une supputation d’holmésiens que la mère de Sherlock se nomme Violet ! Les études qu’il a faites sont aussi l’objet de théories mais personne ne peut dire s’il a fait Oxford ou Cambridge (ou aucune des deux) et encore moins que c’est sa maman qui lui a payé son premier logement à Montague Street.
L’auteur aborde autant les beaux quartiers du West End que les taudis de l’East End, parlant de la frontière entre les deux, de cette société rigide qui pensait que la pauvreté était une mauvaise chose et qu’elle était surtout de la faute des gens qui la subissaient.
On est allé sur les docks où des pauvres hères embauchaient à la journée, se ruant l’un sur l’autre pour obtenir un boulot mal payé, éreintant et qui ne leur remplirait pas le ventre.
Quand je vous disais que c’était un véritable roman noir qui explore toutes les facettes de la ville de Londres.
Anybref, ce livre est instructif, un mélange habile des grandes figures du roman policier et de cette ville de Londres qu’ils ont tous et toutes arpentées, en long et en large, de l’époque victorienne, édouardienne, sous le blitz de 1914, sous celui de 1940 et qui ont vu Londres s’agrandir, certains quartiers devenir encore plus pauvre ou qui ont vécu dans le Londres des guerres mondiales.
À déguster avec ou sans modération mais je conseillerais une lecture étalée sur le temps, grignoter ce recueil au soir, avec une bonne tasse de thé.
Lien : https://thecanniballecteur.w..
Qui n’a jamais rêvé de suivre les pas de Sherlock Holmes dans le Londres de la reine Victoria ?
Qui n’a jamais rêvé de tomber sur un plan original de l’époque ? Ou un Baedeker original comme Holmes aurait pu en posséder un dans sa bibliothèque, juste à côté de l’indicateur de chemin de fer ?
J’eusse aimé tomber sur un ouvrage qui m’aurait entrainé dans les lieux mythiques foulés par les pieds de Holmes…
Hors ce bien beau livre n’est pas tout à fait ce que je pensais qu’il serait.
Certes, nous suivons des lieux importants, classés par ordre alphabétique, avec des belles représentations de ce qu’ils devaient être à l’époque et quelques menues explications, mais de plan pour situer tout cela dans Londres ou dans l’Angleterre, il n’y en a point.
De plus, certains lieux du glossaire ne sont pas des lieux géographiques à proprement parler, mais des noms communs tels que fiacres, bow-windows, université, smog,… et même pas un index pour les retrouver plus facilement, crénom !
Malgré cette petite déception, j’ai toujours pris plaisir à feuilleter l’ouvrage, à regarder les images reproduites, à relire les textes accompagnant les lieux, qui, à défaut d’être importants font dans la concision (et pas dans la cir) et la précision.
On aurait sans doute aimé en apprendre plus, mais je pense que c’est aussi un choix des auteurs de faire dans le court et le bref, de se focaliser sur le plus important et d’éviter le superflu qui aurait pu lasser le lecteur.
Évidemment, des personnes comme moi en voudraient toujours plus, je reste sur ma faim, un peu comme un Hannibal Lecter au régime salade verte…
Yapuka se mettre en chasse pour combler sa dent creuse et s’instruire sur ces lieux ô combien holmésiens.
Sans compter que vous pouvez aussi vous mettre en chasse pour d’autres lieux, d’autres personnages, puisqu’ici, le réel Oscar Wilde côtoie, comme s’ils avaient réellement existé, les Darcy, les Holmes ou les James Bond.
Mais au fait, qui a dit qu’ils n’étaient pas réels ??
Si le titre de l’ouvrage est un peu surfait à mon goût et que j’aurais aimé en avoir plus, je n’ai jamais regretté cet achat, je prends toujours plaisir à me replonger dedans, à rafraichir ma mémoire, à admirer les anciens lieux (zut, on n’a pas les lieux comme ils sont maintenant) et il serait parfait pour un petit voyage à Londres sur les traces de Sherlock Holmes.
Allez, cherche mon chien, cherche !
Lien : https://thecanniballecteur.w..
Qui n’a jamais rêvé de tomber sur un plan original de l’époque ? Ou un Baedeker original comme Holmes aurait pu en posséder un dans sa bibliothèque, juste à côté de l’indicateur de chemin de fer ?
J’eusse aimé tomber sur un ouvrage qui m’aurait entrainé dans les lieux mythiques foulés par les pieds de Holmes…
Hors ce bien beau livre n’est pas tout à fait ce que je pensais qu’il serait.
Certes, nous suivons des lieux importants, classés par ordre alphabétique, avec des belles représentations de ce qu’ils devaient être à l’époque et quelques menues explications, mais de plan pour situer tout cela dans Londres ou dans l’Angleterre, il n’y en a point.
De plus, certains lieux du glossaire ne sont pas des lieux géographiques à proprement parler, mais des noms communs tels que fiacres, bow-windows, université, smog,… et même pas un index pour les retrouver plus facilement, crénom !
Malgré cette petite déception, j’ai toujours pris plaisir à feuilleter l’ouvrage, à regarder les images reproduites, à relire les textes accompagnant les lieux, qui, à défaut d’être importants font dans la concision (et pas dans la cir) et la précision.
On aurait sans doute aimé en apprendre plus, mais je pense que c’est aussi un choix des auteurs de faire dans le court et le bref, de se focaliser sur le plus important et d’éviter le superflu qui aurait pu lasser le lecteur.
Évidemment, des personnes comme moi en voudraient toujours plus, je reste sur ma faim, un peu comme un Hannibal Lecter au régime salade verte…
Yapuka se mettre en chasse pour combler sa dent creuse et s’instruire sur ces lieux ô combien holmésiens.
Sans compter que vous pouvez aussi vous mettre en chasse pour d’autres lieux, d’autres personnages, puisqu’ici, le réel Oscar Wilde côtoie, comme s’ils avaient réellement existé, les Darcy, les Holmes ou les James Bond.
Mais au fait, qui a dit qu’ils n’étaient pas réels ??
Si le titre de l’ouvrage est un peu surfait à mon goût et que j’aurais aimé en avoir plus, je n’ai jamais regretté cet achat, je prends toujours plaisir à me replonger dedans, à rafraichir ma mémoire, à admirer les anciens lieux (zut, on n’a pas les lieux comme ils sont maintenant) et il serait parfait pour un petit voyage à Londres sur les traces de Sherlock Holmes.
Allez, cherche mon chien, cherche !
Lien : https://thecanniballecteur.w..
Musardise m'a mis le couteau sous la gorge pour que nous nous lancions dans une lecture commune. Heureusement pour elle, car elle ne fait pas le poids physiquement, elle a utilisé beaucoup d'autres arguments que la force. Ce sont bien sûr les illustrations d'Arthur Rackham qui m'ont décidé à collaborer. Et le fait que je n'aurais pas à lire des centaines de pages, aussi.
Je connaissais Arthur Rackham sans le connaître, comme c'est le cas pour beaucoup trop d'illustrateurs de son époque. J'avais vu souvent ses illustrations, mais j'aurais été incapable de mettre un nom dessus. C'est au moins une chose réparée aujourd'hui.
Arthur Rackham est né dans la seconde partie du 19ème siècle en Angleterre, et sa carrière a démarré dans la presse avec des dessins comiques, puis a pris son envol avec une commande pour la nouvelle de Washington Irving, Rip van Winkle. Il a alors connu la célébrité, illustré Peter Pan, Alice au pays des merveilles, les contes des frères Grimm, la version de L'anneau des Nibelungen de Wagner, Shakespeare et beaucoup d'autres. La première guerre mondiale a beaucoup freiné sa carrière, il est tombé très malade au moment de la seconde et ses derniers travaux d'illustrations furent pour le vent dans les saules en 1940.
Si le texte de ce livre sur Arthur Rackham m'a intéressé, ça a été sans plus. Mais l'auteur a noté quelque chose qui me paraît très juste : le fait que les illustrateurs ne soient pas considérés comme de vrais artistes. Or ils sont bien des artistes et travaillent à la manière de tous les autres artistes.
Ce sont donc les peintures et dessins de l'artiste qui m'ont captivé. Arthur Rackham a été un des grands illustrateurs de la féérie et c'est un bonheur de regarder toutes les illustrations, avec attention de préférence, parce qu'il s'est échiné à travailler avec soin les détails de ses œuvres, souvent monochromes, qui font rêver et nous emmènent dans des univers de fantaisie.
Il n'éclipsera pas pour moi le grand N.C. Wyeth. Pourtant, je suis heureux d'avoir pu faire plus ample connaissance avec cet artiste qui mérite d'être plus et mieux connu, et qui a excellé dans les illustrations de mondes imaginaires.
Je connaissais Arthur Rackham sans le connaître, comme c'est le cas pour beaucoup trop d'illustrateurs de son époque. J'avais vu souvent ses illustrations, mais j'aurais été incapable de mettre un nom dessus. C'est au moins une chose réparée aujourd'hui.
Arthur Rackham est né dans la seconde partie du 19ème siècle en Angleterre, et sa carrière a démarré dans la presse avec des dessins comiques, puis a pris son envol avec une commande pour la nouvelle de Washington Irving, Rip van Winkle. Il a alors connu la célébrité, illustré Peter Pan, Alice au pays des merveilles, les contes des frères Grimm, la version de L'anneau des Nibelungen de Wagner, Shakespeare et beaucoup d'autres. La première guerre mondiale a beaucoup freiné sa carrière, il est tombé très malade au moment de la seconde et ses derniers travaux d'illustrations furent pour le vent dans les saules en 1940.
Si le texte de ce livre sur Arthur Rackham m'a intéressé, ça a été sans plus. Mais l'auteur a noté quelque chose qui me paraît très juste : le fait que les illustrateurs ne soient pas considérés comme de vrais artistes. Or ils sont bien des artistes et travaillent à la manière de tous les autres artistes.
Ce sont donc les peintures et dessins de l'artiste qui m'ont captivé. Arthur Rackham a été un des grands illustrateurs de la féérie et c'est un bonheur de regarder toutes les illustrations, avec attention de préférence, parce qu'il s'est échiné à travailler avec soin les détails de ses œuvres, souvent monochromes, qui font rêver et nous emmènent dans des univers de fantaisie.
Il n'éclipsera pas pour moi le grand N.C. Wyeth. Pourtant, je suis heureux d'avoir pu faire plus ample connaissance avec cet artiste qui mérite d'être plus et mieux connu, et qui a excellé dans les illustrations de mondes imaginaires.
C est le bouquin oublié depuis des années sur une étagère et qu' a cause ( grâce ? ) à un retard de livraison chez ma libraire j ai déconfiné, libéré, délivré ou plus romantiquement réveiller d un profond sommeil comme une belle aux bois dormant .Hé ho pas avec un baiser! covid 19 oblige et surtout trop de poussière Brèfle 15 nouvelles policières dont 13 originales de fin XIX° à 1913 . J étais un peu (beaucoup !) sceptique car souvent le style a mal vieilli ou parait désuet et poussiéreux , comme les romans à tiroirs de cette époque .Hé bien non après un temps d adaptation j ai été charmé par ces historiettes plus ou moins crédibles ou bien ficelées . j ai dis 13 nouvelles car la 1° et la dernière ont été écrites par deux auteurs contemporains M.s Mauméjean et Rey Ben non , quand on veut faire " à la manière de "on essaie de coller au style de ces temps ou alors on veut faire "farce " mais on l insinue si l on ne veut pas le dire . Ce sont ces 2 pastiches qui détonnent à la limite ( dépassée ) du ridicule, prétentieux .Mais pour le reste si vous croisez ce " mouton électrique " laissez vous tenter par ses côtelettes
Ce petit livre de 180 pages m'a déjà été bien utile dans le choix des mes livres de science-fiction.
En 50 questions (comme la collection de l'éditeur l'indique) les auteurs retracent l'histoire de la SF (surtout anglophone, mais les auteurs français ne sont pas oubliés !) de 1818 à 2005. L'histoire de la SF éclairée dans le contexte politico-social (et économique) de chaque époque : tournant du 19ème siècle, l'entre-deux-guerres, l'après seconde guerre mondiale, la guerre froide, la période "Vietnam", les années 80.... Les pensées et écrits des différents ("grands") auteurs SF traversant ces décennies trouvent ainsi leurs places et une explication de leurs idées. Je pense p.e. (!) à Heinlein, souvent contesté pour ses ressentis politiques ; il ne peut en être autrement quand on considère qu'il a connu une jeunesse bigote, les "Marines", l'effroi de la 1e bombe nucléaire, la guerre froide...etc., mais il en va de même pour beaucoup d'autres écrivains SF qui transposent leurs remontrances dans une littérature, dite, spéculative et conceptuelle.
Les auteurs de cet ouvrage privilégient assurément certains écrivains et/ou leurs oeuvres (l'auteur n'étant qu'un être humain est forcément exempt d'objectivité pure), mais l'ensemble permet de mieux comprendre le paysage de la science-fiction du 20ème siècle... d'en tirer profit pour se présélectionner les livres qu'on souhaite lire....et il y a des références à profusion.
En 50 questions (comme la collection de l'éditeur l'indique) les auteurs retracent l'histoire de la SF (surtout anglophone, mais les auteurs français ne sont pas oubliés !) de 1818 à 2005. L'histoire de la SF éclairée dans le contexte politico-social (et économique) de chaque époque : tournant du 19ème siècle, l'entre-deux-guerres, l'après seconde guerre mondiale, la guerre froide, la période "Vietnam", les années 80.... Les pensées et écrits des différents ("grands") auteurs SF traversant ces décennies trouvent ainsi leurs places et une explication de leurs idées. Je pense p.e. (!) à Heinlein, souvent contesté pour ses ressentis politiques ; il ne peut en être autrement quand on considère qu'il a connu une jeunesse bigote, les "Marines", l'effroi de la 1e bombe nucléaire, la guerre froide...etc., mais il en va de même pour beaucoup d'autres écrivains SF qui transposent leurs remontrances dans une littérature, dite, spéculative et conceptuelle.
Les auteurs de cet ouvrage privilégient assurément certains écrivains et/ou leurs oeuvres (l'auteur n'étant qu'un être humain est forcément exempt d'objectivité pure), mais l'ensemble permet de mieux comprendre le paysage de la science-fiction du 20ème siècle... d'en tirer profit pour se présélectionner les livres qu'on souhaite lire....et il y a des références à profusion.
En compagnie de La Guerre des trois rois, L’Hypothèse du lézard est le deuxième opus des ActuSF Graphic sortis à partir de mai 2020. Il s’agit d’une nouvelle d’Alan Moore de 1987, illustrée dans cette édition par Cindy Canévet.
Plongée dans un bordel de Liavek
L’Hypothèse du Lézard est une assez longue nouvelle d’Alan Moore, qu’il a écrite dans le cadre de l’univers nommé « Liavek ». Il s’agit d’une ville de fiction partagée à la fin des années 1980 par de nombreux auteurs (à commencer par Megan Lindholm alias Robin Hobb, mais également Gene Wolfe, Steven Brust, etc.), où la magie est inhérente à la vie quotidienne et où l’ambiance donne à penser qu’on se trouve dans un lieu orientalisant digne de la Renaissance du XVIe siècle. Dans ce contexte potentiellement troublé, Alan Moore nous présente la jeune Som-Som, toute jeune fille (puis femme) venue par sa mère à la fameuse Maison sans Horloges. C’est un lieu de prostitution très renommé à Liavek, car s’y trouvent de nombreuses curiosités (physiques et/ou mentales) attirant des personnes très influentes dans la cité. Une fois présentée la protagoniste, l’auteur passe assez abruptement à ce que Som-Som découvre dans ce lieu étrange, empli de réactions bizarres, d’autant plus mystérieuses pour elle que la spécialité qu’on lui a attribué fausse toute sa réalité. Elle ne peut que très difficilement communiquer (ce qui la rend impropre à relater ce que pourraient lui confier ses clients) ; or, deux comédiens font également partie de la Maison sans Horloges : Foral Yatt et Raura Chin s’aiment, mais ce dernier veut tenter l’aventure de la carrière de comédien public, au risque de perdre son amour.
Bizarre autant qu’étrange
L’ambiance de L’Hypothèse du Lézard est volontairement « malaisante ». La protagoniste ne peut pas transcrire tout ce qui se passe pour des raisons psychomotrices et tout autour d’elle semble être fait d’onirisme et de mystère. Alan Moore aime assez nous perdre, parfois dans des passages qui peuvent apparaître assez floues dans leur description. À l’image de l’ensemble de la nouvelle, la fin pourra décevoir, car elle laisse un peu le lecteur en suspens. C’est d’ailleurs souvent le cas avec Alan Moore : dans ses comics les plus connus (par exemple The Killing Joke sur la relation Batman – Le Joker), dans ses romans ou recueils de nouvelles (comme La Voix du Feu), il met en place une ambiance tellement étrange que les repères habituels ne sont pas là, la différenciation entre personnages s’évapore parfois, et il termine sur une fin sans véritable conclusion, nous laissant sur plein d’interprétations possibles. Ici, il ajoute à tout cela un jeu dont il est difficile de saisir l’intérêt : il surnomme l’un des deux comédiens Elle, ce qui, forcément, trouble un brin la dynamique des pronoms. Ce mystère constant qui plane sans trop savoir en quoi il résulte vraiment du genre fantastique (mais ce flou n’est-il pas en soi ce qui tient lieu de « fantastique » chez lui ?) risque de rebuter certains lecteurs.
Travail graphique
L’Hypothèse du Lézard est une nouvelle qui a déjà été publiée, il s’agit donc ici d’une réédition dans une collection portée sur l’adéquation entre le texte et le dessin. Le premier opus de la collection ActuSF Graphic, La Guerre des trois rois, mettait cela parfaitement en pratique. Dans le cas de cette nouvelle d’Alan Moore, c’est forcément beaucoup plus compliqué de parler d’un travail entre l’auteur et l’illustratrice. Dès le départ, on peut tout à fait comprendre que publier du Alan Moore est toujours une occasion à saisir, le lecteur peut lire une édition réactualisée d’un écrit peu connu (un peu comme La Voix du Feu, recueil plutôt passé sous le radar). Ici, cela consiste surtout en l’interprétation d’une nouvelle par une jeune dessinatrice, Cindy Canévet. Autant le dire tout de suite, ce n’est pas un vain mot de souligner qu’elle a eu la liberté de très largement illustrer le texte : bien souvent, c’est une page de texte, une page dessinée. Et nous ne sommes pas dans un petit dessin de coin de page, ce sont souvent des planches entières mettant en scène le personnage principal ou l’un de ceux qu’elle rencontre. Ces dessins très (très) nombreux font que nous avons affaire à un véritable carnet de dessins, qui a dû demander un gros travail éditorial pour en insérer autant sans surcharger l’objet, d’autant que certaines phrases de la nouvelle d’Alan Moore sont mises en exergue en parallèle de certains dessins. Ces illustrations sont bien immersives et font vivre différemment cette histoire si particulière.
L’Hypothèse du Lézard est donc un objet ravissant, qui bénéficie d’un graphisme jeune et d’une écriture reconnue, même cette entrée dans le bizarre est toujours particulière quand il s’agit d’Alan Moore.
Plongée dans un bordel de Liavek
L’Hypothèse du Lézard est une assez longue nouvelle d’Alan Moore, qu’il a écrite dans le cadre de l’univers nommé « Liavek ». Il s’agit d’une ville de fiction partagée à la fin des années 1980 par de nombreux auteurs (à commencer par Megan Lindholm alias Robin Hobb, mais également Gene Wolfe, Steven Brust, etc.), où la magie est inhérente à la vie quotidienne et où l’ambiance donne à penser qu’on se trouve dans un lieu orientalisant digne de la Renaissance du XVIe siècle. Dans ce contexte potentiellement troublé, Alan Moore nous présente la jeune Som-Som, toute jeune fille (puis femme) venue par sa mère à la fameuse Maison sans Horloges. C’est un lieu de prostitution très renommé à Liavek, car s’y trouvent de nombreuses curiosités (physiques et/ou mentales) attirant des personnes très influentes dans la cité. Une fois présentée la protagoniste, l’auteur passe assez abruptement à ce que Som-Som découvre dans ce lieu étrange, empli de réactions bizarres, d’autant plus mystérieuses pour elle que la spécialité qu’on lui a attribué fausse toute sa réalité. Elle ne peut que très difficilement communiquer (ce qui la rend impropre à relater ce que pourraient lui confier ses clients) ; or, deux comédiens font également partie de la Maison sans Horloges : Foral Yatt et Raura Chin s’aiment, mais ce dernier veut tenter l’aventure de la carrière de comédien public, au risque de perdre son amour.
Bizarre autant qu’étrange
L’ambiance de L’Hypothèse du Lézard est volontairement « malaisante ». La protagoniste ne peut pas transcrire tout ce qui se passe pour des raisons psychomotrices et tout autour d’elle semble être fait d’onirisme et de mystère. Alan Moore aime assez nous perdre, parfois dans des passages qui peuvent apparaître assez floues dans leur description. À l’image de l’ensemble de la nouvelle, la fin pourra décevoir, car elle laisse un peu le lecteur en suspens. C’est d’ailleurs souvent le cas avec Alan Moore : dans ses comics les plus connus (par exemple The Killing Joke sur la relation Batman – Le Joker), dans ses romans ou recueils de nouvelles (comme La Voix du Feu), il met en place une ambiance tellement étrange que les repères habituels ne sont pas là, la différenciation entre personnages s’évapore parfois, et il termine sur une fin sans véritable conclusion, nous laissant sur plein d’interprétations possibles. Ici, il ajoute à tout cela un jeu dont il est difficile de saisir l’intérêt : il surnomme l’un des deux comédiens Elle, ce qui, forcément, trouble un brin la dynamique des pronoms. Ce mystère constant qui plane sans trop savoir en quoi il résulte vraiment du genre fantastique (mais ce flou n’est-il pas en soi ce qui tient lieu de « fantastique » chez lui ?) risque de rebuter certains lecteurs.
Travail graphique
L’Hypothèse du Lézard est une nouvelle qui a déjà été publiée, il s’agit donc ici d’une réédition dans une collection portée sur l’adéquation entre le texte et le dessin. Le premier opus de la collection ActuSF Graphic, La Guerre des trois rois, mettait cela parfaitement en pratique. Dans le cas de cette nouvelle d’Alan Moore, c’est forcément beaucoup plus compliqué de parler d’un travail entre l’auteur et l’illustratrice. Dès le départ, on peut tout à fait comprendre que publier du Alan Moore est toujours une occasion à saisir, le lecteur peut lire une édition réactualisée d’un écrit peu connu (un peu comme La Voix du Feu, recueil plutôt passé sous le radar). Ici, cela consiste surtout en l’interprétation d’une nouvelle par une jeune dessinatrice, Cindy Canévet. Autant le dire tout de suite, ce n’est pas un vain mot de souligner qu’elle a eu la liberté de très largement illustrer le texte : bien souvent, c’est une page de texte, une page dessinée. Et nous ne sommes pas dans un petit dessin de coin de page, ce sont souvent des planches entières mettant en scène le personnage principal ou l’un de ceux qu’elle rencontre. Ces dessins très (très) nombreux font que nous avons affaire à un véritable carnet de dessins, qui a dû demander un gros travail éditorial pour en insérer autant sans surcharger l’objet, d’autant que certaines phrases de la nouvelle d’Alan Moore sont mises en exergue en parallèle de certains dessins. Ces illustrations sont bien immersives et font vivre différemment cette histoire si particulière.
L’Hypothèse du Lézard est donc un objet ravissant, qui bénéficie d’un graphisme jeune et d’une écriture reconnue, même cette entrée dans le bizarre est toujours particulière quand il s’agit d’Alan Moore.
Dernier numéro d'Étoiles vives, anthologie périodique inégale mais pleine de bonnes surprises. Ce volume est paru en 2002, toujours sous la houlette d'André-François Ruaud qui explique dans la préface pourquoi il arrête : faillite de distributeurs et autres joyeusetés, et volonté du sus-dit André-François Ruaud de consacrer davantage de temps à l'écriture. Ce numéro ne comporte que des nouvelles, pas de critique ou autre rubrique.
Sept nouvelles, donc.
« Le roi des aulnes » (1993), d'Elizabeth Hand : L'histoire se déroule à Kamensic Village, le lieu fétiche de cette autrice. Deux jeunes amies : Haley, la tête sur les épaules, et Linette, plus évaporée, plus rêveuse. Un peu dans le même monde que sa mère, Aurora, ancienne membre de la Factory, ce rassemblement autour de Warhol et d'autres artistes (plus ou moins), tous tombés, alors, dans l'oubli, la vieillesse ou la mort. Aurora passe beaucoup de temps à boire et vivre dans le passé. Linette et Haley vont aller chez leur voisin, qui vient d'arriver, chercher un animal de compagnie évadé. Un kinkajou (très mignons, les kinkajous, mais passent leur temps à dormir). Et elles vont rencontrer Lie Vagal, figure inquiétante venue du passé d'Aurora. Et avec lui, une malédiction.
Texte intéressant mais dans lequel j'ai eu du mal à entrer. Je ne sais si cela vient de moi, de l'autrice ou de la traductrice. Ou, peut-être, du temps qui a passé. Les références sont parfois tombées à plat. Les descriptions étaient un peu trop précieuses. Mais l'accélération sur la fin de la nouvelle, avec ce côté agressif de la nature, du décor, ces interrogations qui s'accroissent, m'a bien raccroché à l'histoire pour en sortir, finalement, plutôt satisfait.
« Au mois d'Athyr » (1992), d'Elizabeth Hand : nouvelle de science-fiction, cette fois-ci, toujours d'Elizabeth Hand. Elle était plus familière du fantastique que de la SF, et cela se ressent dans ce texte, poétique encore, mélancolique. Sur une station spatiale en orbite autour de la Terre vit une colonie proche d'une secte où les genres sont malmenés. Les femmes se transforment, volontairement, en hommes. Donc, plus de nouveaux bébés. Les derniers enfants ont droit à une éducation stricte, sous la férule du sévère père Dorothy. Pour assouvir les besoins sexuels, on a inventé des êtres plus ou moins humanoïdes, avec des côtés aviaires (marabout, essentiellement), très attirants. Parait-il, parce qu'en lisant les descriptions de cet être, j'ai eu du mal à me sentir émoustillé. le jeune héros, Paul, lui, en rencontre un et se prend d'affection pour cet « argala ».
Comme pour la nouvelle précédente, j'ai eu du mal à accepter le style de l'autrice et le monde qu'elle décrit. Je suis sans doute trop éloigné de sa vision de l'autre, des sociétés. Donc, thème intéressant, mais trop peu d'implication.
« Xolotl » (2002), de Léa Silhol : une jeune fille a perdu sa mère. Son père lui offre, pour l'aider à remonter la pente, un animal venu d'une autre planète. Un monstre, dangereux selon certains. Mais la jeune fille se prend d'affection pour elle.
Une belle histoire, qui m'a touché. le dénouement, surprenant, éclaire sous un autre jour tout ce court texte. L'autrice se montre sensible aux sentiments, aussi bien de la jeune humaine que de la créature extra-terrestre. On passe d'une pensée à l'autre, naturellement. Et cette dualité enrichit la nouvelle, la rend plus complète. Une belle lecture.
« Filles du voyage » (1998), d'Ellen Klages : première nouvelle d'Ellen Klages et succès immédiat, puisque nomination pour les prix Hugo et Nebula. Mais pas première publication, parce qu'auparavant, cette autrice avait écrit et publié des ouvrages de vulgarisation scientifique. Et je comprends les nominations. « Filles de voyage » est une histoire de voyage temporel gay friendly (avec quelques coups de pied bien sentis dans le patriarcat bienveillant), bien construite, bien menée, agréable à lire et que j'ai dévorée. Je connaissais l'autrice de nom mais n'avais rien lu d'elle. Cela va changer dès que je pourrai mettre la main sur un de ses ouvrages.
« Danse avec les morts » (2002), Marie-Pierre Najman : court texte très sensible. Et en même temps effrayant quant à son propos. Une jeune fille, amoureuse de son amie depuis toujours, ne supporte pas l'irruption de David, jeune handicapé que sa mère a finalement équipé d'une prothèse qui lui permet de parler. Bizarrement, mais cela lui permet de communiquer. Peu à peu, la jeune narratrice va comprendre comment fonctionne cette « prothèse » et en concevoir un immense malaise. À juste titre.
« La Mirotte » (2002), Sylvie Lainé : un homme, aveugle, va se faire implanter la mirotte, dispositif composé de caméras et d'une interface permettant au cerveau de traiter les images. Par contre, cette mirotte ne permet pas de recouvrer la vue. Selon les individus, elle crée des visions fantastiques, permet des effets de zoom. Elle aurait même permis à une femme de disparaître à la vue d'un expérimentateur pendant quelques instants. L'aveugle va tenter l'expérience et aller loin. Texte court, plus divertissant que prenant. Mais avec de belles images et des inventions intéressantes.
« Une autre façon de faire » (196), Molly Brown : nouvelle surprenante mais très efficace que j'ai bien appréciée et qui clôt agréablement cette anthologie. Un homme accepte d'aller, aidé par une I.A. bienveillante, sur une planète afin de la préparer et de la terraformer pour accueillir ensuite des milliers de colons. Mais tout ne va pas se passer comme prévu : finalement, il n'est pas seul sur la planète et les habitants vont avoir une réaction pour le moins traumatisante. Distrayant et en même temps, plein d'interrogations plutôt sensées.
C'est le premier Étoiles vives que je lis (je sais, j'ai commencé par le dernier numéro, mais pourquoi pas ?) et cela m'a donné envie de continuer. C'est plutôt chouette de découvrir comme cela quelques bonnes surprises venues du passé (pas si lointain, mais quand même, le début du siècle), surtout quand on aime la SF !
Challenge multi-auteures SFFF
Sept nouvelles, donc.
« Le roi des aulnes » (1993), d'Elizabeth Hand : L'histoire se déroule à Kamensic Village, le lieu fétiche de cette autrice. Deux jeunes amies : Haley, la tête sur les épaules, et Linette, plus évaporée, plus rêveuse. Un peu dans le même monde que sa mère, Aurora, ancienne membre de la Factory, ce rassemblement autour de Warhol et d'autres artistes (plus ou moins), tous tombés, alors, dans l'oubli, la vieillesse ou la mort. Aurora passe beaucoup de temps à boire et vivre dans le passé. Linette et Haley vont aller chez leur voisin, qui vient d'arriver, chercher un animal de compagnie évadé. Un kinkajou (très mignons, les kinkajous, mais passent leur temps à dormir). Et elles vont rencontrer Lie Vagal, figure inquiétante venue du passé d'Aurora. Et avec lui, une malédiction.
Texte intéressant mais dans lequel j'ai eu du mal à entrer. Je ne sais si cela vient de moi, de l'autrice ou de la traductrice. Ou, peut-être, du temps qui a passé. Les références sont parfois tombées à plat. Les descriptions étaient un peu trop précieuses. Mais l'accélération sur la fin de la nouvelle, avec ce côté agressif de la nature, du décor, ces interrogations qui s'accroissent, m'a bien raccroché à l'histoire pour en sortir, finalement, plutôt satisfait.
« Au mois d'Athyr » (1992), d'Elizabeth Hand : nouvelle de science-fiction, cette fois-ci, toujours d'Elizabeth Hand. Elle était plus familière du fantastique que de la SF, et cela se ressent dans ce texte, poétique encore, mélancolique. Sur une station spatiale en orbite autour de la Terre vit une colonie proche d'une secte où les genres sont malmenés. Les femmes se transforment, volontairement, en hommes. Donc, plus de nouveaux bébés. Les derniers enfants ont droit à une éducation stricte, sous la férule du sévère père Dorothy. Pour assouvir les besoins sexuels, on a inventé des êtres plus ou moins humanoïdes, avec des côtés aviaires (marabout, essentiellement), très attirants. Parait-il, parce qu'en lisant les descriptions de cet être, j'ai eu du mal à me sentir émoustillé. le jeune héros, Paul, lui, en rencontre un et se prend d'affection pour cet « argala ».
Comme pour la nouvelle précédente, j'ai eu du mal à accepter le style de l'autrice et le monde qu'elle décrit. Je suis sans doute trop éloigné de sa vision de l'autre, des sociétés. Donc, thème intéressant, mais trop peu d'implication.
« Xolotl » (2002), de Léa Silhol : une jeune fille a perdu sa mère. Son père lui offre, pour l'aider à remonter la pente, un animal venu d'une autre planète. Un monstre, dangereux selon certains. Mais la jeune fille se prend d'affection pour elle.
Une belle histoire, qui m'a touché. le dénouement, surprenant, éclaire sous un autre jour tout ce court texte. L'autrice se montre sensible aux sentiments, aussi bien de la jeune humaine que de la créature extra-terrestre. On passe d'une pensée à l'autre, naturellement. Et cette dualité enrichit la nouvelle, la rend plus complète. Une belle lecture.
« Filles du voyage » (1998), d'Ellen Klages : première nouvelle d'Ellen Klages et succès immédiat, puisque nomination pour les prix Hugo et Nebula. Mais pas première publication, parce qu'auparavant, cette autrice avait écrit et publié des ouvrages de vulgarisation scientifique. Et je comprends les nominations. « Filles de voyage » est une histoire de voyage temporel gay friendly (avec quelques coups de pied bien sentis dans le patriarcat bienveillant), bien construite, bien menée, agréable à lire et que j'ai dévorée. Je connaissais l'autrice de nom mais n'avais rien lu d'elle. Cela va changer dès que je pourrai mettre la main sur un de ses ouvrages.
« Danse avec les morts » (2002), Marie-Pierre Najman : court texte très sensible. Et en même temps effrayant quant à son propos. Une jeune fille, amoureuse de son amie depuis toujours, ne supporte pas l'irruption de David, jeune handicapé que sa mère a finalement équipé d'une prothèse qui lui permet de parler. Bizarrement, mais cela lui permet de communiquer. Peu à peu, la jeune narratrice va comprendre comment fonctionne cette « prothèse » et en concevoir un immense malaise. À juste titre.
« La Mirotte » (2002), Sylvie Lainé : un homme, aveugle, va se faire implanter la mirotte, dispositif composé de caméras et d'une interface permettant au cerveau de traiter les images. Par contre, cette mirotte ne permet pas de recouvrer la vue. Selon les individus, elle crée des visions fantastiques, permet des effets de zoom. Elle aurait même permis à une femme de disparaître à la vue d'un expérimentateur pendant quelques instants. L'aveugle va tenter l'expérience et aller loin. Texte court, plus divertissant que prenant. Mais avec de belles images et des inventions intéressantes.
« Une autre façon de faire » (196), Molly Brown : nouvelle surprenante mais très efficace que j'ai bien appréciée et qui clôt agréablement cette anthologie. Un homme accepte d'aller, aidé par une I.A. bienveillante, sur une planète afin de la préparer et de la terraformer pour accueillir ensuite des milliers de colons. Mais tout ne va pas se passer comme prévu : finalement, il n'est pas seul sur la planète et les habitants vont avoir une réaction pour le moins traumatisante. Distrayant et en même temps, plein d'interrogations plutôt sensées.
C'est le premier Étoiles vives que je lis (je sais, j'ai commencé par le dernier numéro, mais pourquoi pas ?) et cela m'a donné envie de continuer. C'est plutôt chouette de découvrir comme cela quelques bonnes surprises venues du passé (pas si lointain, mais quand même, le début du siècle), surtout quand on aime la SF !
Challenge multi-auteures SFFF
Le résumé éditeur dit presque tout de l'ouvrage.
Il est proposé au lecteur de découvrir tous les sites des enquêtes du célèbre détective privé avec des photos ou illustrations d'époque.
C'est un bel objet, bien documenté, grand format, avec de belles illustrations, des explications en relation avec une des enquêtes. Le tout sur papier glacé de qualité.
Un must have pour tous les amoureux de Sherlock.
Il est proposé au lecteur de découvrir tous les sites des enquêtes du célèbre détective privé avec des photos ou illustrations d'époque.
C'est un bel objet, bien documenté, grand format, avec de belles illustrations, des explications en relation avec une des enquêtes. Le tout sur papier glacé de qualité.
Un must have pour tous les amoureux de Sherlock.
Des théories sur l’identité de Jack The Ripper, j’en ai lu de toutes les sortes : des farfelues, des capillotractées, des dirigées, des plus sérieuses, des intéressantes, des intrigantes, des complotistes, des abusées, des holmésiennes…
Mais celle d’un criminel appartenant à la légende urbaine, on ne me l’avait pas encore faite !
Les auteurs, avant de nous parler des crimes vont nous faire visiter Londres, mais attention, pas celle des jolies cartes postales, pas celle des beaux quartiers : l’East End, le négatif du West End.
La misère, la crasse, le dénuement, la pauvreté, les conditions de travail inhumaines, bref, l’East End. On ajoutera une dose de smog, celui qui puait fort et qui tua bien des gens et le décor plus vrai que nature est planté.
Notons que les nuits des différents meurtres, il n’y avait pas de brouillard ! Ni de haut-de-forme dans les témoignages…
Petit inconvénient lorsque, sur le même mois, on a lu "London Noir", "Sherlock Holmes une vie" et qu’on enchaîne avec "Jack L’Éventreur, les morts", c’est qu’on retrouve des redites. Oui, des copiés-collés qui se trouvaient dans les autres ouvrages, notamment dans celui consacré à Londres ou Holmes.
Pas de plagiat puisque c’est le même auteur, mais ça donne cette horrible impression de déjà-lu. Bon, voyons le bon côté de la chose, à force de lire les même infos, je pourrais les retenir dans ma mémoire passoire.
C’est une étude complète et copieuse que les auteurs nous proposent car ils ne se contentent pas d’égrainer les dates, les lieux, noms des victimes mais ils dissèquent aussi la société victorienne et Londres.
L’autopsie est puante mais ça vaut le coup d’y mettre son nez afin de ne pas aller se coucher bête. Beaucoup de sujets passeront sur la table : les docks, la politique, les débuts de la police (son Histoire), le climat, l’industrie, la prostitution, la misère, le tueur au torse, la presse qui cherche le scoop…
Pour ceux qui aiment voir le Londres victorien sous un autre visage que celui du thé et des scones, c’est le pied.
Ensuite, maintenant que le décor est planté et que vous en savez plus sur l’East End, on va commencer à vous parler des victimes de 1888 en commençant par Emma Smith, juste avant Martha Tabram. Il est à noter qu’elles ne font pas partie des victimes canoniques mais il faut en tenir compte quand même.
Notez aussi que les auteurs ne vous proposeront pas un nom à la fin de leur ouvrage ! Mais le florilège des suspects est bien présent et les théories loufoques et farfelues seront passées au crible rapidement.
Leur but est de faire la biographie d’une grande figure populaire mythique, en dégageant les grands faites d’une vie de la gangue de la fiction. En essayant, comme pour leur autres ouvrages, de révéler une présence derrière le mythe littéraire, ils n’ont pu découvrir qu’une terrifiante absence.
Une fois de plus, c’est un ouvrage copieux qui se lit sur plusieurs jours, mais pas de trop car c’est addictif, sans pour autant avoir un scénario puisqu’il s’agit d’une étude. Peut-être devrait-il publier "Comment rendre des études intéressantes et addictives pour les lecteurs" pour en inspirer certains.
Un excellent ouvrage qui traînait depuis trop longtemps sur mes étagères et une fois de plus, shame on me, car là, cet ouvrage va dans le trio de tête, aux côtés du "Le livre rouge de Jack L’éventreur" de Bourgouin (la polémique sur l’auteur et ses mensonges et un autre débat) et de "Jack l’éventreur démasqué – L’enquête définitive" de Sophie Herfort (la partie Historique consacrée aux meurtres, pour sa théorie, on valide ou pas).
PS : je n’ai pas pu découvrir pourquoi dans les autres ouvrages, l’auteur transformait le nom de Mary-Ann Nichols en Mary-Ann Nicholson.
Lien : https://thecanniballecteur.w..
Mais celle d’un criminel appartenant à la légende urbaine, on ne me l’avait pas encore faite !
Les auteurs, avant de nous parler des crimes vont nous faire visiter Londres, mais attention, pas celle des jolies cartes postales, pas celle des beaux quartiers : l’East End, le négatif du West End.
La misère, la crasse, le dénuement, la pauvreté, les conditions de travail inhumaines, bref, l’East End. On ajoutera une dose de smog, celui qui puait fort et qui tua bien des gens et le décor plus vrai que nature est planté.
Notons que les nuits des différents meurtres, il n’y avait pas de brouillard ! Ni de haut-de-forme dans les témoignages…
Petit inconvénient lorsque, sur le même mois, on a lu "London Noir", "Sherlock Holmes une vie" et qu’on enchaîne avec "Jack L’Éventreur, les morts", c’est qu’on retrouve des redites. Oui, des copiés-collés qui se trouvaient dans les autres ouvrages, notamment dans celui consacré à Londres ou Holmes.
Pas de plagiat puisque c’est le même auteur, mais ça donne cette horrible impression de déjà-lu. Bon, voyons le bon côté de la chose, à force de lire les même infos, je pourrais les retenir dans ma mémoire passoire.
C’est une étude complète et copieuse que les auteurs nous proposent car ils ne se contentent pas d’égrainer les dates, les lieux, noms des victimes mais ils dissèquent aussi la société victorienne et Londres.
L’autopsie est puante mais ça vaut le coup d’y mettre son nez afin de ne pas aller se coucher bête. Beaucoup de sujets passeront sur la table : les docks, la politique, les débuts de la police (son Histoire), le climat, l’industrie, la prostitution, la misère, le tueur au torse, la presse qui cherche le scoop…
Pour ceux qui aiment voir le Londres victorien sous un autre visage que celui du thé et des scones, c’est le pied.
Ensuite, maintenant que le décor est planté et que vous en savez plus sur l’East End, on va commencer à vous parler des victimes de 1888 en commençant par Emma Smith, juste avant Martha Tabram. Il est à noter qu’elles ne font pas partie des victimes canoniques mais il faut en tenir compte quand même.
Notez aussi que les auteurs ne vous proposeront pas un nom à la fin de leur ouvrage ! Mais le florilège des suspects est bien présent et les théories loufoques et farfelues seront passées au crible rapidement.
Leur but est de faire la biographie d’une grande figure populaire mythique, en dégageant les grands faites d’une vie de la gangue de la fiction. En essayant, comme pour leur autres ouvrages, de révéler une présence derrière le mythe littéraire, ils n’ont pu découvrir qu’une terrifiante absence.
Une fois de plus, c’est un ouvrage copieux qui se lit sur plusieurs jours, mais pas de trop car c’est addictif, sans pour autant avoir un scénario puisqu’il s’agit d’une étude. Peut-être devrait-il publier "Comment rendre des études intéressantes et addictives pour les lecteurs" pour en inspirer certains.
Un excellent ouvrage qui traînait depuis trop longtemps sur mes étagères et une fois de plus, shame on me, car là, cet ouvrage va dans le trio de tête, aux côtés du "Le livre rouge de Jack L’éventreur" de Bourgouin (la polémique sur l’auteur et ses mensonges et un autre débat) et de "Jack l’éventreur démasqué – L’enquête définitive" de Sophie Herfort (la partie Historique consacrée aux meurtres, pour sa théorie, on valide ou pas).
PS : je n’ai pas pu découvrir pourquoi dans les autres ouvrages, l’auteur transformait le nom de Mary-Ann Nichols en Mary-Ann Nicholson.
Lien : https://thecanniballecteur.w..
On croyait que tout avait été dit sur Arsène Lupin malgré le mystère qui l'entoure.
Et puis vient ce bel ouvrage, édité par une maison au drôle de nom : "Les moutons électriques", qui contient, en ouverture, une longue biographie, complète et précise, écrite d'une manière vivante et agréable.
Il faudra, au séduisant personnage, vivre une existence si pleine d'aventure que nombre de ses contemporains ne savaient plus s'il était réel ou, simplement, le fruit de l'imagination d'un auteur génial, pour entrer dans la légende.
Il lui faudra être Raoul d'Andrésy entre 1874 et 1899, Arsène Lupin entre 1900 et 1909, Paul Sernine entre 1910 et 1913, Luis Perenna entre 1914 et 1920 et vivre de dernières aventures jusqu'à 1939, date à laquelle on perd sa trace.
Puis, dans une deuxième partie moins convaincante, cet élégant volume tente de tout dire sur Arsène Lupin, sur son époque, sur ses vies parallèles et sur les enfants qu'il laissa à la littérature policière.
Pourtant, malgré la qualité de l'ouvrage, son côté soigné et sa connaissance réelle du sujet, le lecteur que je suis, amateur depuis ma lointaine adolescence des romans de Maurice Leblanc et des aventures du gentleman-cambrioleur, est resté sur sa faim avec comme une impression de manque.
Et même si sa lecture m'a, au final, procuré beaucoup de plaisir, je lui préfère, tout de même, "Arsène Lupin et le sept de cœur", un autre volume, plus petit, édité dans la collection "10/18" en 1988 et préfacé par Francis Lacassin et qui rendait lui aussi hommage au fameux cambrioleur.
Et puis vient ce bel ouvrage, édité par une maison au drôle de nom : "Les moutons électriques", qui contient, en ouverture, une longue biographie, complète et précise, écrite d'une manière vivante et agréable.
Il faudra, au séduisant personnage, vivre une existence si pleine d'aventure que nombre de ses contemporains ne savaient plus s'il était réel ou, simplement, le fruit de l'imagination d'un auteur génial, pour entrer dans la légende.
Il lui faudra être Raoul d'Andrésy entre 1874 et 1899, Arsène Lupin entre 1900 et 1909, Paul Sernine entre 1910 et 1913, Luis Perenna entre 1914 et 1920 et vivre de dernières aventures jusqu'à 1939, date à laquelle on perd sa trace.
Puis, dans une deuxième partie moins convaincante, cet élégant volume tente de tout dire sur Arsène Lupin, sur son époque, sur ses vies parallèles et sur les enfants qu'il laissa à la littérature policière.
Pourtant, malgré la qualité de l'ouvrage, son côté soigné et sa connaissance réelle du sujet, le lecteur que je suis, amateur depuis ma lointaine adolescence des romans de Maurice Leblanc et des aventures du gentleman-cambrioleur, est resté sur sa faim avec comme une impression de manque.
Et même si sa lecture m'a, au final, procuré beaucoup de plaisir, je lui préfère, tout de même, "Arsène Lupin et le sept de cœur", un autre volume, plus petit, édité dans la collection "10/18" en 1988 et préfacé par Francis Lacassin et qui rendait lui aussi hommage au fameux cambrioleur.
Suite à une partie endiablée de « London 1888 » avec des amis (un jeu fort réjouissant où l’on a le douteux plaisir d’endosser le manteau du tueur le plus sanguinairement célèbre du XIXe siècle – ou celui d’un de ses nombreux poursuivants, soyons moraux – pour écumer les rues du Londres victorien), j’ai connu un petit pic d’intérêt pour ce bon vieux Jack. D’où la lecture de cet ouvrage édité par « les Moutons électriques » et ayant pour objectif d’étudier, non pas l’affaire elle-même, mais l’assassin en tant que mythe urbain. En effet, Jack l’Eventreur a ceci de fascinant que, si ses meurtres sont on-ne-peut-plus réels, la figure de l’assassin est entièrement fictive. La silhouette obscure en grand manteau luxueux et haut-de-forme, le dandy tueur, le monstre raffiné : rien de tout cela n’a le moindre fondement historique. Jack n’est pas un homme, Jack n’est pas un tueur, Jack est le Meurtre personnifié, le Mal sous enveloppe humaine !
L’approche des « Nombreuses morts de Jack l’Eventreur » a donc le mérite de l’originalité – privilégier la légende à la réalité – mais le livre ne tient pas toutes ses promesses. Ses principaux défauts sont, à mon sens, de ne pas avoir poussé son concept jusqu’au bout et de manquer d’homogénéité. L’ouvrage présente une dizaine d’articles, tous intéressants individuellement et abordant des sujets variés (les superstitions urbaines à Londres, les conditions de vie à Whitechapel, certaines œuvres littéraires ou cinévisuelles mettant en scène Jack…), mais qui semblent rassemblés au petit bonheur la chance et sans soucis de cohérence. Pas de plan, ni de véritable analyse en profondeur du sujet : l’ensemble est donc agréable et intéressant à lire, mais donne une décevante impression de superficialité. Les trois nouvelles ajoutées en fin de livre constituent également une petite déception : de qualité littéraire assez moyenne, elles ne laissent pas un souvenir impérissable, loin s’en faut. Dommage.
Le tableau n’est pas complétement noir pour autant. Malgré ses défauts, « Les nombreuses vies de Jack l’Eventreur » a su éveiller mon intérêt pour certains écrivains adeptes du tueur victorien, notamment Robert Bloch dont j’avais déjà lu le très stressant « Psychose ». Je suis également fort curieuse de découvrir les autres tomes de la collection « la Bibliothèque Rouge » des « Moutons Electriques », consacrée aux grandes figures de la littérature populaire. En espérant que ceux-ci bénéficieront d’une meilleure construction... Je suis particulièrement tentée par ceux sur Arsène Lupin, Sherlock Holmes et Dracula, mais c’est qu’ils coutent la peau des fesses, ces bouquins-là !
L’approche des « Nombreuses morts de Jack l’Eventreur » a donc le mérite de l’originalité – privilégier la légende à la réalité – mais le livre ne tient pas toutes ses promesses. Ses principaux défauts sont, à mon sens, de ne pas avoir poussé son concept jusqu’au bout et de manquer d’homogénéité. L’ouvrage présente une dizaine d’articles, tous intéressants individuellement et abordant des sujets variés (les superstitions urbaines à Londres, les conditions de vie à Whitechapel, certaines œuvres littéraires ou cinévisuelles mettant en scène Jack…), mais qui semblent rassemblés au petit bonheur la chance et sans soucis de cohérence. Pas de plan, ni de véritable analyse en profondeur du sujet : l’ensemble est donc agréable et intéressant à lire, mais donne une décevante impression de superficialité. Les trois nouvelles ajoutées en fin de livre constituent également une petite déception : de qualité littéraire assez moyenne, elles ne laissent pas un souvenir impérissable, loin s’en faut. Dommage.
Le tableau n’est pas complétement noir pour autant. Malgré ses défauts, « Les nombreuses vies de Jack l’Eventreur » a su éveiller mon intérêt pour certains écrivains adeptes du tueur victorien, notamment Robert Bloch dont j’avais déjà lu le très stressant « Psychose ». Je suis également fort curieuse de découvrir les autres tomes de la collection « la Bibliothèque Rouge » des « Moutons Electriques », consacrée aux grandes figures de la littérature populaire. En espérant que ceux-ci bénéficieront d’une meilleure construction... Je suis particulièrement tentée par ceux sur Arsène Lupin, Sherlock Holmes et Dracula, mais c’est qu’ils coutent la peau des fesses, ces bouquins-là !
Sherlock Holmes est une légende ! Mais dans quel sens du terme faut-il prendre ce mot ?
Par la représentation, embellie, de la vie et des exploits de Holmes, qui se conserve dans la mémoire collective ou dans le sens que Holmes est devenu un détective célèbre, talentueux, qui a atteint le succès et une notoriété certaine dans son domaine ?
Ou est-ce un peu des deux à la fois à tel point que l’on ne sait plus où commence la fiction et où se termine la réalité (ou le contraire) ?
De toute façon, comme tout bon holmésien, on est d’accord sur le fait que Holmes a vraiment existé et qu’il n’est pas mort, sa chronique mortuaire n’étant pas parue dans le Times (celle d’Hercule Poirot, oui – mes excuses).
C’est le postulat que pose les deux auteurs : Et si Sherlock Holmes avait réellement existé, arpentant un Londres réel, Watson étant son biographe et Conan Doyle son agent littéraire en lieu et place d’être son père littéraire ? Mais alors, ça change tout…
Oui, le fait de poser le postulat d’un Sherlock Holmes réel permet d’aller beaucoup plus loin dans sa biographie que ne l’autorise les écrits canoniques (peu bavards) et de creuser plus loin en essayant de deviner les identités cachées sous certains personnages comme le roi de Bohême ou le duc Holderness…
Attention, gardez bien à l’esprit, en entamant ce pavé de plus de 500 pages, que les auteurs puisent aussi bien dans les récits canoniques que dans les apocryphes.
Holmes n’a jamais rencontré Lupin dans les récits de Conan Doyle, mais dans ceux de Leblanc, oui. Quant au recueil de nouvelles "Les exploits de Sherlock Holmes", ils sont de la main d’Adrian Conan Doyle et Dickson Carr et n’appartiennent pas au canon.
Passant en revue un large éventail des aventures de Holmes, des personnages, s’attachant à nous démontrer que Mary Morstan n’était peut-être pas l’oie blanche que l’on pense, qu’Irene Adler était sans doute sous la coupe de Moriarty et que Watson ne s’est pas marié deux fois mais qu’il est juste retourne vivre avec Mary, après une séparation, ce guide vous fera sans doute voir d’autres choses dans le canon, lorsque vous le lirez (ou le relirez).
Holmes dit lui-même dans "L’aventure du soldat blanchi" que Watson l’avait abandonné pour se marier et que c’était l’unique action égoïste qu’il avait à lui reprocher… L’aventure est datée de janvier 1903 et Watson avait épousé Mary Morstan à la fin du "Signe des quatre" qui se déroule en septembre 1888. Sauf si Holmes considère que le mariage avec Mary n’était pas un acte égoïste…
"Le brave Watson m’avait à l’époque abandonné pour se marier : c’est l’unique action égoïste que j’aie à lui reprocher tout au long de notre association. J’étais seul."
C’est un essai copieux, rempli de conjectures, d’hypothèses, de supputations qu’un non initié pourrait prendre pour argent comptant.
Malgré tout, ils se basent sur des études sérieuses, sur des enquêtes, sur des travaux, sur l’Histoire, la politique, la sociologie, pour reconstituer les chaînons manquants, pour construire les pièces manquantes au puzzle et nous donner une vision plus large de ce que le canon nous offre.
Maintenant que je l’ai enfin lu, je comprends pourquoi dans "London Noir" (pas encore chroniqué), André-François Ruaud parlait de la mère de Holmes qui aurait loué un appartement au 24 Montague Street.
C’est dû au fait qu’une véritable Mrs Holmes a vécu à cette adresse et que les auteurs ont repris ce fait véridique pour en faire une extrapolation en la déclarant mère de Sherlock.
Véritable pavé consacré à Sherlock Holmes, au docteur Watson, à Conan Doyle mais pas que… Londres est aussi très présente, avec ses brumes, ainsi que la société victorienne, qui est passée à la moulinette, le tout au travers du prisme des enquêtes de Holmes et des faits qui se passèrent à son époque.
À noter que dans les "annexes", vous avez l’intégralité des aventures canoniques et d’autres, une ligne du temps intitulée "Sherlock Holmes et son temps, une chronologie" et, dans cette édition augmentée, des nouvelles plus une étude du Scandale en Bohême. Sans oublier des illustrations après chaque chapitre.
C’était copieux et cette lecture fut une belle découverte. Shame on me, cette biographie fait partie de ma PAL depuis juin 2011 ! Je ne m’y étais jamais attaquée et c’est bête car cette lecture était un vrai plaisir. Il m’a fallu 9 ans pour me décider, on a connu plus rapide…
Maintenant, deux questions ? La fiction devient partie intégrante de la réalité ou est-ce la réalité qui se fond dans la fiction ?
Tout dépend de votre point de vue, si vous considérez Holmes comme un personnage ayant réellement existé (et vous vous prêtez au jeu – The Game) ou si vous pensez qu’un personnage de fiction n’a pas à devenir réel. Dans le second cas, cette biographie vous semblera indigeste, sinon, régalez-vous !
PS : mais pourquoi les auteurs parlent de Mary Ann Nicholson alors que c’est Mary Ann Nichols, une des victimes de Jack The Ripper. Je le saurais sans doute en lisant "Les nombreuses morts de Jack L’Éventreur" puisque les auteurs ont établis des biographies sur plein de gens (Hercule Poirot, Nero Wolfe, Arsène Lupin, Jack The Ripper, Frankenstein, Harry Potter, Miss Marple et Dracula).
Lien : https://thecanniballecteur.w..
Par la représentation, embellie, de la vie et des exploits de Holmes, qui se conserve dans la mémoire collective ou dans le sens que Holmes est devenu un détective célèbre, talentueux, qui a atteint le succès et une notoriété certaine dans son domaine ?
Ou est-ce un peu des deux à la fois à tel point que l’on ne sait plus où commence la fiction et où se termine la réalité (ou le contraire) ?
De toute façon, comme tout bon holmésien, on est d’accord sur le fait que Holmes a vraiment existé et qu’il n’est pas mort, sa chronique mortuaire n’étant pas parue dans le Times (celle d’Hercule Poirot, oui – mes excuses).
C’est le postulat que pose les deux auteurs : Et si Sherlock Holmes avait réellement existé, arpentant un Londres réel, Watson étant son biographe et Conan Doyle son agent littéraire en lieu et place d’être son père littéraire ? Mais alors, ça change tout…
Oui, le fait de poser le postulat d’un Sherlock Holmes réel permet d’aller beaucoup plus loin dans sa biographie que ne l’autorise les écrits canoniques (peu bavards) et de creuser plus loin en essayant de deviner les identités cachées sous certains personnages comme le roi de Bohême ou le duc Holderness…
Attention, gardez bien à l’esprit, en entamant ce pavé de plus de 500 pages, que les auteurs puisent aussi bien dans les récits canoniques que dans les apocryphes.
Holmes n’a jamais rencontré Lupin dans les récits de Conan Doyle, mais dans ceux de Leblanc, oui. Quant au recueil de nouvelles "Les exploits de Sherlock Holmes", ils sont de la main d’Adrian Conan Doyle et Dickson Carr et n’appartiennent pas au canon.
Passant en revue un large éventail des aventures de Holmes, des personnages, s’attachant à nous démontrer que Mary Morstan n’était peut-être pas l’oie blanche que l’on pense, qu’Irene Adler était sans doute sous la coupe de Moriarty et que Watson ne s’est pas marié deux fois mais qu’il est juste retourne vivre avec Mary, après une séparation, ce guide vous fera sans doute voir d’autres choses dans le canon, lorsque vous le lirez (ou le relirez).
Holmes dit lui-même dans "L’aventure du soldat blanchi" que Watson l’avait abandonné pour se marier et que c’était l’unique action égoïste qu’il avait à lui reprocher… L’aventure est datée de janvier 1903 et Watson avait épousé Mary Morstan à la fin du "Signe des quatre" qui se déroule en septembre 1888. Sauf si Holmes considère que le mariage avec Mary n’était pas un acte égoïste…
"Le brave Watson m’avait à l’époque abandonné pour se marier : c’est l’unique action égoïste que j’aie à lui reprocher tout au long de notre association. J’étais seul."
C’est un essai copieux, rempli de conjectures, d’hypothèses, de supputations qu’un non initié pourrait prendre pour argent comptant.
Malgré tout, ils se basent sur des études sérieuses, sur des enquêtes, sur des travaux, sur l’Histoire, la politique, la sociologie, pour reconstituer les chaînons manquants, pour construire les pièces manquantes au puzzle et nous donner une vision plus large de ce que le canon nous offre.
Maintenant que je l’ai enfin lu, je comprends pourquoi dans "London Noir" (pas encore chroniqué), André-François Ruaud parlait de la mère de Holmes qui aurait loué un appartement au 24 Montague Street.
C’est dû au fait qu’une véritable Mrs Holmes a vécu à cette adresse et que les auteurs ont repris ce fait véridique pour en faire une extrapolation en la déclarant mère de Sherlock.
Véritable pavé consacré à Sherlock Holmes, au docteur Watson, à Conan Doyle mais pas que… Londres est aussi très présente, avec ses brumes, ainsi que la société victorienne, qui est passée à la moulinette, le tout au travers du prisme des enquêtes de Holmes et des faits qui se passèrent à son époque.
À noter que dans les "annexes", vous avez l’intégralité des aventures canoniques et d’autres, une ligne du temps intitulée "Sherlock Holmes et son temps, une chronologie" et, dans cette édition augmentée, des nouvelles plus une étude du Scandale en Bohême. Sans oublier des illustrations après chaque chapitre.
C’était copieux et cette lecture fut une belle découverte. Shame on me, cette biographie fait partie de ma PAL depuis juin 2011 ! Je ne m’y étais jamais attaquée et c’est bête car cette lecture était un vrai plaisir. Il m’a fallu 9 ans pour me décider, on a connu plus rapide…
Maintenant, deux questions ? La fiction devient partie intégrante de la réalité ou est-ce la réalité qui se fond dans la fiction ?
Tout dépend de votre point de vue, si vous considérez Holmes comme un personnage ayant réellement existé (et vous vous prêtez au jeu – The Game) ou si vous pensez qu’un personnage de fiction n’a pas à devenir réel. Dans le second cas, cette biographie vous semblera indigeste, sinon, régalez-vous !
PS : mais pourquoi les auteurs parlent de Mary Ann Nicholson alors que c’est Mary Ann Nichols, une des victimes de Jack The Ripper. Je le saurais sans doute en lisant "Les nombreuses morts de Jack L’Éventreur" puisque les auteurs ont établis des biographies sur plein de gens (Hercule Poirot, Nero Wolfe, Arsène Lupin, Jack The Ripper, Frankenstein, Harry Potter, Miss Marple et Dracula).
Lien : https://thecanniballecteur.w..
Challenge ABC 2018-2019
11/26
Tour d'horizon des vampires : d'où viennent-ils ? Qui est vraiment Dracula ? A quoi ressemblent-ils ? Comment vivent-ils leur célébrité (nous n'avons pas d'info de première main pour répondre à cette question...)
Les auteurs traitent autant des racines mythologiques et historiques du personnages que géographiques (avec une forte présence en Europe centrale tout de même) que de leur présence littéraire , télévisuelle ou cinématographique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont tout fait, tout vu et que c'est un personnage protéiforme, qui embrasse les problématique de l'époque où il apparait.
Elisabeth campos étant criminologue (selon la 4è de couverture), les auteurs ont également fait une incursion dans le monde de tueurs se revendiquant ou se comportant comme des vampires. Bienvenue aux serial killers et aux personnages étranges, parfois sans doute relevant de la psychiatrie (mais pas tous).
L'essai est vraiment intéressant, parfois un peu faible stylistiquement et il y a quelques redondances. Il reste clair et accessible, une porte d'entrée sur ce monde.
Il y a une chose que je reproche aux éditions le mouton électrique, que j'avais déjà remarqué dans le livre sur Jack l'éventreur : il manque un peu de travail éditorial. Il n'y a pas de sommaire, pas de bibliographie et un travail de relecture n'aurait pas été superflu. C'est dommage, parce que je ne suis pas certaine que d'autres maisons d'édition traitent de ces thématiques et que pour moi, ce sont des freins.
11/26
Tour d'horizon des vampires : d'où viennent-ils ? Qui est vraiment Dracula ? A quoi ressemblent-ils ? Comment vivent-ils leur célébrité (nous n'avons pas d'info de première main pour répondre à cette question...)
Les auteurs traitent autant des racines mythologiques et historiques du personnages que géographiques (avec une forte présence en Europe centrale tout de même) que de leur présence littéraire , télévisuelle ou cinématographique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont tout fait, tout vu et que c'est un personnage protéiforme, qui embrasse les problématique de l'époque où il apparait.
Elisabeth campos étant criminologue (selon la 4è de couverture), les auteurs ont également fait une incursion dans le monde de tueurs se revendiquant ou se comportant comme des vampires. Bienvenue aux serial killers et aux personnages étranges, parfois sans doute relevant de la psychiatrie (mais pas tous).
L'essai est vraiment intéressant, parfois un peu faible stylistiquement et il y a quelques redondances. Il reste clair et accessible, une porte d'entrée sur ce monde.
Il y a une chose que je reproche aux éditions le mouton électrique, que j'avais déjà remarqué dans le livre sur Jack l'éventreur : il manque un peu de travail éditorial. Il n'y a pas de sommaire, pas de bibliographie et un travail de relecture n'aurait pas été superflu. C'est dommage, parce que je ne suis pas certaine que d'autres maisons d'édition traitent de ces thématiques et que pour moi, ce sont des freins.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de André-François Ruaud
Lecteurs de André-François Ruaud (569)Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz saga Haikyuu
Quel est le personnage principal de cette saga?
Daichi Sawamura
Tobio Kageyama
Tooru Oikawa
Shoyo Hinata
21 questions
23 lecteurs ont répondu
Thème : Haikyu, tome 1 de
Haruichi FurudateCréer un quiz sur cet auteur23 lecteurs ont répondu