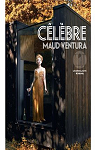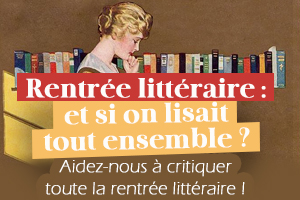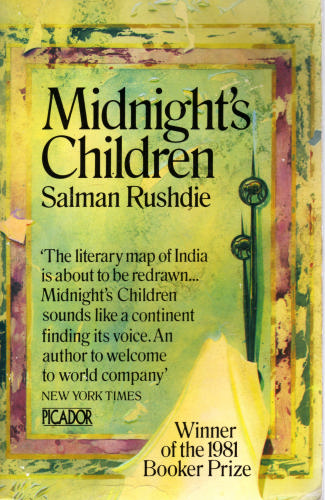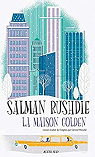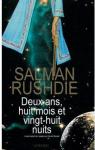Salman Rushdie
Gérard Meudal (Traducteur)
Gérard Meudal (Traducteur)
EAN : 9782330181222
Actes Sud (06/09/2023)
/5
27 notes
Actes Sud (06/09/2023)
Résumé :
Dans le Sud de l’Inde au xive siècle, à la suite d’une bataille quelconque entre deux royaumes aujourd’hui oubliés, une fillette de neuf ans fait une rencontre
divine qui va changer le cours de l’histoire. Après avoir assisté à la mort de sa mère, la petite Pampa Kampana, accablée de chagrin, devient le véhicule de la Déesse, qui se met à parler par la bouche de l’orpheline. Lui accordant des pouvoirs qui dépassent l’entendement de Pampa Kampana, la déesse lu... >Voir plus
divine qui va changer le cours de l’histoire. Après avoir assisté à la mort de sa mère, la petite Pampa Kampana, accablée de chagrin, devient le véhicule de la Déesse, qui se met à parler par la bouche de l’orpheline. Lui accordant des pouvoirs qui dépassent l’entendement de Pampa Kampana, la déesse lu... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Victory CityVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (8)
Voir plus
Ajouter une critique
Ce livre est ce que certains appelleront un roman historique dans lequel la véritable histoire de l'empire hindouiste de Vijayanagara est suivie depuis Krishna Deva Raya (1509-1529), en fait légèrement antérieur à cette date pour les personnages principaux, et l'empereur en premier lieu, et les introduire dans la vraie vie avant la date concernée. Elle dure jusqu'au dernier empereur et à la destruction de l'empire sous Sriranga III (1642-1646). le personnage principal est Pampa Kampana, et elle meurt peu après la chute de l'empire en 1646, mais à l'âge de 247 ans, elle est donc née en 1399 ou vers 1400. C'est elle qui a fondé, en semant des graines magiques, la capitale Bisnaga, finalement nommée après sa création par un visiteur portugais de passage, Domingo Nunes, en déformant le nom local choisi par Pampa Campana, de Vidyanagar et Vijaya à Bisnaga. Ce nom est censé signifier Victory City, La Ville (de la) Victoire. le passage du V initial à un B initial n'est pas typique du portugais mais de l'espagnol. Au Portugal, sauf dans la partie nord du pays, V et B sont deux consonnes différentes. Mais l'idée est drôle. Pampa Campana crée une toute nouvelle ville, et elle lui donne un nom dans la langue locale, on ne sait pas laquelle, mais ce n'est pas le portugais, et elle laisse un marin portugais imposer une prétendue difficulté dans sa propre langue pour changer le nom. sans aucune position d'identification. Et elle tombe même amoureuse du marin portugais.
Nous sommes dans la moitié sud de l'Inde. La langue locale n'est pas claire. Aujourd'hui, dans ce territoire, il existe quatre langues communes. kannada, telugu, tamoul, sanskrit. le kannada est une langue dravidienne. le telugu est la plus importante langue dravidienne. le tamoul est une langue dravidienne. le sanskrit est une langue de la branche indo-aryenne des langues indo-européennes, dit-on à tort sur Wikipédia. Cette dernière langue est bien entendu mal représentée par ce que l'on trouve sur Wikipédia. le sanskrit n'était parlé, lu et connu que par l'élite instruite du sous-continent indien de traditions hindouistes et bouddhistes. Mais ce n'est PAS une branche des langues indo-européennes. Les langues indo-aryennes dont leur forme reconnue la plus ancienne est le sanskrit védique ou même pré-védique, et elles proviennent toutes du plateau iranien où elles ont mûri pendant environ 30 000 ans après avoir quitté l'Afrique noire. Mais ces langues indo-aryennes faisaient partie des langues indo-iraniennes qui ont unifié pendant longtemps sur le Plateau les langues indo-aryennes et indo-européennes en une seule matrice, les langues indo-iraniennes. Lorsque celles-ci sont descendues du plateau, vers l'est pour se rendre dans le sous-continent indien et devenir les langues indo-aryennes, et vers l'ouest vers l'Europe via la Mésopotamie, le Caucase et l'Anatolie pour devenir les langues indo-européennes, la plus ancienne d'entre elles étant le sumérien. Mais Salman Rushdie ne donne pas de détails sur la ou les langues qu'il utilise de temps en temps pour nommer des lieux ou des personnes. Nous supposerons qu'il s'agit de langues dravidiennes, ce qui nous amène à un débat sur la question de savoir si ces langues sont liées à l'Asie du Sud-Est, et si elles isolent ensuite les langues du groupe tibéto-birman établi en Asie depuis au moins 90 000 ans avant notre ère, ou si elles ont été fortement influencées, voire fusionnées ou créolisées, par les langues turkiques agglutinantes arrivées dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan, qui s'étendent très rapidement vers le sous-continent indien, et à travers l'Asie centrale jusqu'en Sibérie et dans l'Oural. Cette migration turkique avait une autre route vers l'Europe via le Caucase et l'Anatolie, et ils se sont installés en Europe vers 45 000 avant notre ère.
Mais Salman Rushdie ne traite pas de cette situation ancienne. Il ne considère que la moitié sud de la péninsule indienne lorsque les musulmans d'Iran ou d'ailleurs ont conquis le reste de l'Inde afin de convertir le peuple hindouiste ou bouddhiste à l'islam. Ce roman reste enfermé dans cette pointe sud ou moitié de l'Inde, mais l'empire moghol, par exemple, a été fondé en 1526, exactement au milieu de la période concernée par ce livre. Pourtant, il n'en est même pas question, et l'influence de l'Islam se réduit à cinq sultanats au nord de l'empire Bisnaga. Lorsque ces musulmans sont arrivés d'Iran, parlant le farsi et l'arabe, la religion dominante était l'hindouisme, le bouddhisme étant dominant au Népal, au Tibet et au Sri Lanka. Ils n'ont trouvé la population indo-aryenne que dans la moitié nord du sous-continent, parlant toutes des langues indo-aryennes, ainsi que la population dravidienne, et les deux moitiés pratiquaient principalement l'hindouisme. On parle peu du système de castes de cette religion, refusé par les bouddhistes. La principale langue parlée par les bouddhistes, hormis leurs langues indo-aryennes locales (les Dravidiens ne sont pas du côté bouddhiste), était le Pāli et non le sanskrit, bien que le sanskrit aurait pu être utilisé par les hindous. Quand on lit les articles largement mal informés de Wikipédia, on pense que l'auteur de ce livre aurait dû être un peu plus précis sur les langues parlées dans cet Empire et dans les Sultanats.
Il faut comprendre que l'histoire moderne de l'Inde (les six ou sept derniers siècles) est la conséquence directe de cinq vastes mouvements de population, sans oublier le plus ancien d'Homo Erectus. L'Asie a d'abord été occupée par les Denisovans qui ont évolué à partir d'Homo Erectus, ou d'un groupe Homininé descendant déjà évolué. Les Denisovans sont peu connus car très récents dans nos connaissances archéologiques. Ensuite, la première migration hors d'Afrique (la deuxième migration hors d'Afrique Noire, 140 000 avant notre ère) est arrivée et s'est déplacée vers le nord, l'Asie centrale, l'Asie continentale et l'Asie du Sud-Est. Ils se sont croisés avec les Denisovans, modérément, mais néanmoins significativement, dans toute l'Asie continentale, mais de manière intensive, probablement jusqu'à une intégration complète en Asie du Sud-Est et une éventuelle extension à l'Inde. le prochain mouvement de population se situe vers 70 000 avant notre ère, avec l'arrivée de la première vague de la troisième migration hors d'Afrique Noire (la deuxième hors d'Afrique) parlant des langues agglutinantes turkiques. Ils se sont déplacés vite et loin, jusqu'en Asie centrale, et c'est à ce moment-là qu'ils ont dû rencontrer la population de la migration précédente qui parlait des langues isolantes, mais il faut tenir compte de l'intégration des Denisovans. Nous ne connaissons pas la ou les langues, les croyances religieuses ou la culture de ces Denisovans, nous ne pouvons donc pas connaître leur impact sur les langues et les cultures des langues isolantes mentionnées précédemment, en particulier en Asie du Sud-Est où l'intégration des Denisovans a été deux à trois fois plus importante qu'en Chine continentale. Il semble raisonnable de dire que cela doit être considéré comme un élément essentiel dans la genèse des langues dravidiennes avant la rencontre avec les langues agglutinantes turkiques qui ont dû influencer ces langues dravidiennes.
Ensuite, le mouvement de population suivant fut la deuxième vague de la troisième migration hors d'Afrique Noire (deuxième hors d'Afrique), juste derrière la vague précédente vers 50-40 000 avant notre ère. Ils sont restés sur le plateau iranien jusqu'à après l'apogée de la période glaciaire qui a duré jusqu'à 15 000 avant notre ère. Ils n'en sont descendus qu'après 15 000 avant notre ère. Ils sont allés vers l'est, au Pakistan, en Asie centrale et en Inde, où ils ont rencontré la population précédente et ont dû s'intégrer dans les deux sens : s'intégrer à la population précédente qu'ils ont rencontrée et intégrer la population précédente qu'ils ont rencontrée dans leur propre communauté. C'est pourquoi le sanskrit peut être considéré comme une langue de cette Inde dravidienne, car le sanskrit est la langue normale – et sacrée – de l'hindouisme qui se propage très rapidement au peuple dravidien. Les langues de cette nouvelle population étaient des langues indo-aryennes, et elles furent confrontées aux langues dravidiennes (pas complètement évoluées puisque la migration indo-aryenne a dû avoir un certain impact sur leurs langues, et au-delà, les langues isolantes d'Asie du Sud-Est à forte influence des langues denisovanes.
Les langues dravidiennes et les langues indo-aryennes n'ont pas fusionné. Pourtant, une certaine créolisation a pu – et probablement du – se produire ici et là, mais il faut garder à l'esprit que le sanskrit n'est pas une langue dravidienne. Ce chaudron a dû mijoter depuis longtemps, et le prochain mouvement linguistique, démographique et culturel est venu avec l'Islam d'Iran, mais pas seulement parce qu'à l'époque, remontant à l'Empire romain et à la connexion des peuples méditerranéens (Phéniciens, Grecs , Romains, et bien d'autres) avaient fait le tour de l'Océan Indien – pour une certaine traite des esclaves attestée dès 7 000 à 6 000 avant notre ère ou même avant. L'Islam est venu avec l'arabe, une langue sémitique issue de la première migration hors d'Afrique Noire vers au moins 200 000 avant notre ère. (et cette migration ne quittera l'Afrique que vers 30 000 avant notre ère. On imagine à l'époque de l'Empire Moghol (en même temps que l'histoire du livre) le phénoménal puzzle linguistique en Inde et les conséquences sur les religions, la culture, les relations sociales. classes (et n'oublions jamais les castes, notamment les Dalits, les Intouchables). Tout cela nous manque dans le livre, et cela réduit l'histoire à quelques croyances religieuses hautement improbables, comme les 247 ans de la vie de Pampa Kampana et de ses pouvoirs magiques que lui a donnés une déesse. Une ville, qui plus est, un empire, et plus tard les sept murs, ou remparts défensifs de la capitale, tous poussant à partir de graines magiques et divines de simples légumes qui ne le sont finalement pas, simples.
Que reste-t-il alors ? Une fiction politique sur l'humanité et NOTRE avenir. Ce vieil empire est ainsi réécrit en termes modernes comme s'il s'agissait de l'histoire moderne. Mais l'histoire a ses propres règles et dynamiques. Ainsi, Pampa Campana développe la société de ce nouvel empire magique selon des principes simples. Tout d'abord, la tolérance permet à toutes les religions de vivre ensemble sans aucune difficulté. Vous serez surpris que dans cet empire florissant, il n'y ait pas un seul juif, ou juif converti (avec la présence de marchands portugais, il aurait été possible d'introduire un juif converti, au catholicisme bien sûr, pour pouvoir faire ce commerce maritime avec l'Inde). La présence de chrétiens est également très limitée et les commerçants portugais ne semblent avoir aucune foi ou religion. Deuxièmement, l'éducation est largement développée, notamment pour les filles, y compris pour toutes sortes de combats, y compris militaires. elles doivent être traitées de la même manière que les garçons dans toutes les professions et dans toutes les formations professionnelles. Heureusement, ce n'est pas de la science-fiction, sinon ces femmes auraient un gadget #METOO ou une application inter-cosmique de ce genre. Troisièmement, les droits des femmes après l'éducation doivent être tous. reconnus et acceptés, même si Pampa Kampana nous fait savoir que ce n'est pas toujours facile à mettre en oeuvre. Qui plus est, le premier empereur Krishna Deva Raya portait le nom du pire dieu hindou misogyne qu'on puisse imaginer, Krishna, avec une évocation poétique et pathétique qu'il a de lui-même. il court après et conquiert – pas toujours avec tendresse – toutes les femmes sur lesquelles il peut mettre la main pour rendre jalouse celle qu'il aime vraiment – s'il aime vraiment quelqu'un – pour qu'elle accepte de l'épouser, d'être sa première épouse bien sûr, avec toutes les autres avec lesquelles il joue de temps en temps. Comment une société peut-elle parler des droits des femmes alors que les hommes, du moins l'élite masculine, peuvent avoir autant d'« épouses » qu'ils le souhaitent ? Quatrièmement, de la même manière, cet empire est imaginé comme étant respectueux du genre et que toutes les relations sexuelles sont acceptables pour tout le monde, et que personne ne semble être exclusif de quelque manière que ce soit, favorisant un sexe et rejetant l'autre. Heureusement encore, que ce n'est pas de la science-fiction. Sinon, nous aurions eu une version de trans-peu-importe-quoi. Peu importe le ou la trans pourvu qu'on ait des transes transgressantes. Cinquièmement, l'affirmation selon laquelle cet empire était pacifique et non violent est l'affirmation la plus drôle et la plus hypocrite que l'on puisse imaginer, car ces empereurs menaient constamment une guerre ici ou là, et ils avaient une armée d'un demi-million, voire d'un million de fantassins, et des centaines, voire des milliers d'éléphants et leurs soldats, ou de chevaux et leur cavalerie. Ceci nous amène à la Sixième caractéristique de cet empire. Liberté d'expression absolue, un Premier Amendement Constitutionnel trois siècles seulement avant le véritable Premier Amendement Constitutionnel. de toute façon, c'est une pure illusion car il n'existe de véritable liberté d'expression absolue nulle part dans aucun monde humain. Dès que la liberté d'expression est accordée quelque part, elle est immédiatement limitée par des exceptions et des limites à ne pas franchir. On les appelle lignes rouges, mais il peut y avoir tellement de lignes rouges que cela ressemble à un réseau ou même à un filet de pêcheur. Ah ! Les pêcheurs ! Les pauvres pécheurs ! Surtout si ce sont des pêcheuses ou des pécheresses !
Mais la conclusion dominante à laquelle on peut arriver après ces longues et nombreuses pages est que toute tentative humaine est vouée à être victime de la fatalité humaine, et le destin humain est toujours le simple cycle « dukkha » du bouddhisme : tout émerge de quelque chose qui existait auparavant. , puis il vit ou se développe pendant un certain temps et finalement, il arrive à sa décadence et à sa fin qui laissera finalement émerger quelque chose de « nouveau » de cette faillite historique. le livre insiste encore et encore sur ce cycle. Cet Empire Vijayanagara a finalement été conquis et donc détruit par les musulmans de ce qui ne peut être que l'Empire Moghol, fondé en 1556. Je ne sais pas s'il y a un ou plusieurs versets sataniques dans un quelconque livre sacré, mais ce livre est définitivement humain dans son sens de la manière la plus sombre et la plus satanique. Il n'y a aucun espoir, sauf celui de souffrir sous les caprices d'un chef royal autoproclamé et d'attendre patiemment la fin qui devra venir avec la souffrance de la plupart des gens qui considèrent leur mort comme une liberté d'existence au-delà de la souffrance quotidienne de la vie.
Dr Jacques COULARDEAU
Lien : https://jacquescoulardeau.me..
Nous sommes dans la moitié sud de l'Inde. La langue locale n'est pas claire. Aujourd'hui, dans ce territoire, il existe quatre langues communes. kannada, telugu, tamoul, sanskrit. le kannada est une langue dravidienne. le telugu est la plus importante langue dravidienne. le tamoul est une langue dravidienne. le sanskrit est une langue de la branche indo-aryenne des langues indo-européennes, dit-on à tort sur Wikipédia. Cette dernière langue est bien entendu mal représentée par ce que l'on trouve sur Wikipédia. le sanskrit n'était parlé, lu et connu que par l'élite instruite du sous-continent indien de traditions hindouistes et bouddhistes. Mais ce n'est PAS une branche des langues indo-européennes. Les langues indo-aryennes dont leur forme reconnue la plus ancienne est le sanskrit védique ou même pré-védique, et elles proviennent toutes du plateau iranien où elles ont mûri pendant environ 30 000 ans après avoir quitté l'Afrique noire. Mais ces langues indo-aryennes faisaient partie des langues indo-iraniennes qui ont unifié pendant longtemps sur le Plateau les langues indo-aryennes et indo-européennes en une seule matrice, les langues indo-iraniennes. Lorsque celles-ci sont descendues du plateau, vers l'est pour se rendre dans le sous-continent indien et devenir les langues indo-aryennes, et vers l'ouest vers l'Europe via la Mésopotamie, le Caucase et l'Anatolie pour devenir les langues indo-européennes, la plus ancienne d'entre elles étant le sumérien. Mais Salman Rushdie ne donne pas de détails sur la ou les langues qu'il utilise de temps en temps pour nommer des lieux ou des personnes. Nous supposerons qu'il s'agit de langues dravidiennes, ce qui nous amène à un débat sur la question de savoir si ces langues sont liées à l'Asie du Sud-Est, et si elles isolent ensuite les langues du groupe tibéto-birman établi en Asie depuis au moins 90 000 ans avant notre ère, ou si elles ont été fortement influencées, voire fusionnées ou créolisées, par les langues turkiques agglutinantes arrivées dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan, qui s'étendent très rapidement vers le sous-continent indien, et à travers l'Asie centrale jusqu'en Sibérie et dans l'Oural. Cette migration turkique avait une autre route vers l'Europe via le Caucase et l'Anatolie, et ils se sont installés en Europe vers 45 000 avant notre ère.
Mais Salman Rushdie ne traite pas de cette situation ancienne. Il ne considère que la moitié sud de la péninsule indienne lorsque les musulmans d'Iran ou d'ailleurs ont conquis le reste de l'Inde afin de convertir le peuple hindouiste ou bouddhiste à l'islam. Ce roman reste enfermé dans cette pointe sud ou moitié de l'Inde, mais l'empire moghol, par exemple, a été fondé en 1526, exactement au milieu de la période concernée par ce livre. Pourtant, il n'en est même pas question, et l'influence de l'Islam se réduit à cinq sultanats au nord de l'empire Bisnaga. Lorsque ces musulmans sont arrivés d'Iran, parlant le farsi et l'arabe, la religion dominante était l'hindouisme, le bouddhisme étant dominant au Népal, au Tibet et au Sri Lanka. Ils n'ont trouvé la population indo-aryenne que dans la moitié nord du sous-continent, parlant toutes des langues indo-aryennes, ainsi que la population dravidienne, et les deux moitiés pratiquaient principalement l'hindouisme. On parle peu du système de castes de cette religion, refusé par les bouddhistes. La principale langue parlée par les bouddhistes, hormis leurs langues indo-aryennes locales (les Dravidiens ne sont pas du côté bouddhiste), était le Pāli et non le sanskrit, bien que le sanskrit aurait pu être utilisé par les hindous. Quand on lit les articles largement mal informés de Wikipédia, on pense que l'auteur de ce livre aurait dû être un peu plus précis sur les langues parlées dans cet Empire et dans les Sultanats.
Il faut comprendre que l'histoire moderne de l'Inde (les six ou sept derniers siècles) est la conséquence directe de cinq vastes mouvements de population, sans oublier le plus ancien d'Homo Erectus. L'Asie a d'abord été occupée par les Denisovans qui ont évolué à partir d'Homo Erectus, ou d'un groupe Homininé descendant déjà évolué. Les Denisovans sont peu connus car très récents dans nos connaissances archéologiques. Ensuite, la première migration hors d'Afrique (la deuxième migration hors d'Afrique Noire, 140 000 avant notre ère) est arrivée et s'est déplacée vers le nord, l'Asie centrale, l'Asie continentale et l'Asie du Sud-Est. Ils se sont croisés avec les Denisovans, modérément, mais néanmoins significativement, dans toute l'Asie continentale, mais de manière intensive, probablement jusqu'à une intégration complète en Asie du Sud-Est et une éventuelle extension à l'Inde. le prochain mouvement de population se situe vers 70 000 avant notre ère, avec l'arrivée de la première vague de la troisième migration hors d'Afrique Noire (la deuxième hors d'Afrique) parlant des langues agglutinantes turkiques. Ils se sont déplacés vite et loin, jusqu'en Asie centrale, et c'est à ce moment-là qu'ils ont dû rencontrer la population de la migration précédente qui parlait des langues isolantes, mais il faut tenir compte de l'intégration des Denisovans. Nous ne connaissons pas la ou les langues, les croyances religieuses ou la culture de ces Denisovans, nous ne pouvons donc pas connaître leur impact sur les langues et les cultures des langues isolantes mentionnées précédemment, en particulier en Asie du Sud-Est où l'intégration des Denisovans a été deux à trois fois plus importante qu'en Chine continentale. Il semble raisonnable de dire que cela doit être considéré comme un élément essentiel dans la genèse des langues dravidiennes avant la rencontre avec les langues agglutinantes turkiques qui ont dû influencer ces langues dravidiennes.
Ensuite, le mouvement de population suivant fut la deuxième vague de la troisième migration hors d'Afrique Noire (deuxième hors d'Afrique), juste derrière la vague précédente vers 50-40 000 avant notre ère. Ils sont restés sur le plateau iranien jusqu'à après l'apogée de la période glaciaire qui a duré jusqu'à 15 000 avant notre ère. Ils n'en sont descendus qu'après 15 000 avant notre ère. Ils sont allés vers l'est, au Pakistan, en Asie centrale et en Inde, où ils ont rencontré la population précédente et ont dû s'intégrer dans les deux sens : s'intégrer à la population précédente qu'ils ont rencontrée et intégrer la population précédente qu'ils ont rencontrée dans leur propre communauté. C'est pourquoi le sanskrit peut être considéré comme une langue de cette Inde dravidienne, car le sanskrit est la langue normale – et sacrée – de l'hindouisme qui se propage très rapidement au peuple dravidien. Les langues de cette nouvelle population étaient des langues indo-aryennes, et elles furent confrontées aux langues dravidiennes (pas complètement évoluées puisque la migration indo-aryenne a dû avoir un certain impact sur leurs langues, et au-delà, les langues isolantes d'Asie du Sud-Est à forte influence des langues denisovanes.
Les langues dravidiennes et les langues indo-aryennes n'ont pas fusionné. Pourtant, une certaine créolisation a pu – et probablement du – se produire ici et là, mais il faut garder à l'esprit que le sanskrit n'est pas une langue dravidienne. Ce chaudron a dû mijoter depuis longtemps, et le prochain mouvement linguistique, démographique et culturel est venu avec l'Islam d'Iran, mais pas seulement parce qu'à l'époque, remontant à l'Empire romain et à la connexion des peuples méditerranéens (Phéniciens, Grecs , Romains, et bien d'autres) avaient fait le tour de l'Océan Indien – pour une certaine traite des esclaves attestée dès 7 000 à 6 000 avant notre ère ou même avant. L'Islam est venu avec l'arabe, une langue sémitique issue de la première migration hors d'Afrique Noire vers au moins 200 000 avant notre ère. (et cette migration ne quittera l'Afrique que vers 30 000 avant notre ère. On imagine à l'époque de l'Empire Moghol (en même temps que l'histoire du livre) le phénoménal puzzle linguistique en Inde et les conséquences sur les religions, la culture, les relations sociales. classes (et n'oublions jamais les castes, notamment les Dalits, les Intouchables). Tout cela nous manque dans le livre, et cela réduit l'histoire à quelques croyances religieuses hautement improbables, comme les 247 ans de la vie de Pampa Kampana et de ses pouvoirs magiques que lui a donnés une déesse. Une ville, qui plus est, un empire, et plus tard les sept murs, ou remparts défensifs de la capitale, tous poussant à partir de graines magiques et divines de simples légumes qui ne le sont finalement pas, simples.
Que reste-t-il alors ? Une fiction politique sur l'humanité et NOTRE avenir. Ce vieil empire est ainsi réécrit en termes modernes comme s'il s'agissait de l'histoire moderne. Mais l'histoire a ses propres règles et dynamiques. Ainsi, Pampa Campana développe la société de ce nouvel empire magique selon des principes simples. Tout d'abord, la tolérance permet à toutes les religions de vivre ensemble sans aucune difficulté. Vous serez surpris que dans cet empire florissant, il n'y ait pas un seul juif, ou juif converti (avec la présence de marchands portugais, il aurait été possible d'introduire un juif converti, au catholicisme bien sûr, pour pouvoir faire ce commerce maritime avec l'Inde). La présence de chrétiens est également très limitée et les commerçants portugais ne semblent avoir aucune foi ou religion. Deuxièmement, l'éducation est largement développée, notamment pour les filles, y compris pour toutes sortes de combats, y compris militaires. elles doivent être traitées de la même manière que les garçons dans toutes les professions et dans toutes les formations professionnelles. Heureusement, ce n'est pas de la science-fiction, sinon ces femmes auraient un gadget #METOO ou une application inter-cosmique de ce genre. Troisièmement, les droits des femmes après l'éducation doivent être tous. reconnus et acceptés, même si Pampa Kampana nous fait savoir que ce n'est pas toujours facile à mettre en oeuvre. Qui plus est, le premier empereur Krishna Deva Raya portait le nom du pire dieu hindou misogyne qu'on puisse imaginer, Krishna, avec une évocation poétique et pathétique qu'il a de lui-même. il court après et conquiert – pas toujours avec tendresse – toutes les femmes sur lesquelles il peut mettre la main pour rendre jalouse celle qu'il aime vraiment – s'il aime vraiment quelqu'un – pour qu'elle accepte de l'épouser, d'être sa première épouse bien sûr, avec toutes les autres avec lesquelles il joue de temps en temps. Comment une société peut-elle parler des droits des femmes alors que les hommes, du moins l'élite masculine, peuvent avoir autant d'« épouses » qu'ils le souhaitent ? Quatrièmement, de la même manière, cet empire est imaginé comme étant respectueux du genre et que toutes les relations sexuelles sont acceptables pour tout le monde, et que personne ne semble être exclusif de quelque manière que ce soit, favorisant un sexe et rejetant l'autre. Heureusement encore, que ce n'est pas de la science-fiction. Sinon, nous aurions eu une version de trans-peu-importe-quoi. Peu importe le ou la trans pourvu qu'on ait des transes transgressantes. Cinquièmement, l'affirmation selon laquelle cet empire était pacifique et non violent est l'affirmation la plus drôle et la plus hypocrite que l'on puisse imaginer, car ces empereurs menaient constamment une guerre ici ou là, et ils avaient une armée d'un demi-million, voire d'un million de fantassins, et des centaines, voire des milliers d'éléphants et leurs soldats, ou de chevaux et leur cavalerie. Ceci nous amène à la Sixième caractéristique de cet empire. Liberté d'expression absolue, un Premier Amendement Constitutionnel trois siècles seulement avant le véritable Premier Amendement Constitutionnel. de toute façon, c'est une pure illusion car il n'existe de véritable liberté d'expression absolue nulle part dans aucun monde humain. Dès que la liberté d'expression est accordée quelque part, elle est immédiatement limitée par des exceptions et des limites à ne pas franchir. On les appelle lignes rouges, mais il peut y avoir tellement de lignes rouges que cela ressemble à un réseau ou même à un filet de pêcheur. Ah ! Les pêcheurs ! Les pauvres pécheurs ! Surtout si ce sont des pêcheuses ou des pécheresses !
Mais la conclusion dominante à laquelle on peut arriver après ces longues et nombreuses pages est que toute tentative humaine est vouée à être victime de la fatalité humaine, et le destin humain est toujours le simple cycle « dukkha » du bouddhisme : tout émerge de quelque chose qui existait auparavant. , puis il vit ou se développe pendant un certain temps et finalement, il arrive à sa décadence et à sa fin qui laissera finalement émerger quelque chose de « nouveau » de cette faillite historique. le livre insiste encore et encore sur ce cycle. Cet Empire Vijayanagara a finalement été conquis et donc détruit par les musulmans de ce qui ne peut être que l'Empire Moghol, fondé en 1556. Je ne sais pas s'il y a un ou plusieurs versets sataniques dans un quelconque livre sacré, mais ce livre est définitivement humain dans son sens de la manière la plus sombre et la plus satanique. Il n'y a aucun espoir, sauf celui de souffrir sous les caprices d'un chef royal autoproclamé et d'attendre patiemment la fin qui devra venir avec la souffrance de la plupart des gens qui considèrent leur mort comme une liberté d'existence au-delà de la souffrance quotidienne de la vie.
Dr Jacques COULARDEAU
Lien : https://jacquescoulardeau.me..
Il était une fois….
Pampa Kampana a 9 ans lorsqu'elle devient orpheline et devant le sacrifice de sa mère, la déesse Pampa va se mettre à parler par sa bouche d'enfant.
C'est ainsi que la destinée de prophétesse et faiseuse de miracles de Pampa va débuter.
Après 9 ans dans une grotte aux côtés d'un moine, 9 ans dans le silence, Pampa va effectuer son premier miracle, donnant un sachet de graines magiques à 2 frères, Hukka et Bukka Sangama, bouviers de leur état, afin qu'ils fassent sortir de terre un royaume à l'emplacement du sacrifice de sa mère et des femmes de son village d'enfance.
Ainsi naquit au XIVeme s. dans le sud de l'Inde, Bisnaga, la cité de la victoire avec à sa tête Hukka Raya 1er.
Pampa Kampana veillera sur ce royaume durant plus de 200 ans, influençant les décisions, assistant aux victoires comme aux défaites, au développement comme à la décadence du royaume, restant seule et perdant tous ceux qu'elle chérissait.
Le seul but de toute sa longue vie : former des gens cultivés et larges d'esprit, hommes et femmes pareillement, toujours au fait de la beauté du savoir en lui même, de la responsabilité des citoyens de coexister et d'un engagement à oeuvrer pour le bien-être de tous.
Nombreuses sont les questions posées par ce conte : qu'est ce que l'être humain? Qu'est ce qui fait de lui ce qu'il est? Quelle place doivent avoir les femmes dans la société? Quel rapport religion et pouvoir doivent ils entretenir?
L'histoire a quelque chose d'envoûtant… certes la complexité des noms coupe parfois la fluidité de la lecture mais l'écriture est belle, prenante, imagée.
Un beau plongeon qui n'a de dangereux que la forte probabilité d'aspirer le lecteur dans un autre temps, un autre monde.
Pampa Kampana a 9 ans lorsqu'elle devient orpheline et devant le sacrifice de sa mère, la déesse Pampa va se mettre à parler par sa bouche d'enfant.
C'est ainsi que la destinée de prophétesse et faiseuse de miracles de Pampa va débuter.
Après 9 ans dans une grotte aux côtés d'un moine, 9 ans dans le silence, Pampa va effectuer son premier miracle, donnant un sachet de graines magiques à 2 frères, Hukka et Bukka Sangama, bouviers de leur état, afin qu'ils fassent sortir de terre un royaume à l'emplacement du sacrifice de sa mère et des femmes de son village d'enfance.
Ainsi naquit au XIVeme s. dans le sud de l'Inde, Bisnaga, la cité de la victoire avec à sa tête Hukka Raya 1er.
Pampa Kampana veillera sur ce royaume durant plus de 200 ans, influençant les décisions, assistant aux victoires comme aux défaites, au développement comme à la décadence du royaume, restant seule et perdant tous ceux qu'elle chérissait.
Le seul but de toute sa longue vie : former des gens cultivés et larges d'esprit, hommes et femmes pareillement, toujours au fait de la beauté du savoir en lui même, de la responsabilité des citoyens de coexister et d'un engagement à oeuvrer pour le bien-être de tous.
Nombreuses sont les questions posées par ce conte : qu'est ce que l'être humain? Qu'est ce qui fait de lui ce qu'il est? Quelle place doivent avoir les femmes dans la société? Quel rapport religion et pouvoir doivent ils entretenir?
L'histoire a quelque chose d'envoûtant… certes la complexité des noms coupe parfois la fluidité de la lecture mais l'écriture est belle, prenante, imagée.
Un beau plongeon qui n'a de dangereux que la forte probabilité d'aspirer le lecteur dans un autre temps, un autre monde.
[RUSHDIE ZEN] L'événement dans le milieu littéraire est important : LA CITE DE LA VICTOIRE (VICTORY CITY pour le titre original) signe le retour de Salman Rushdie après l'attaque dont il a été la cible le 12 août 2022, attaque qui lui a valu l'usage d'un oeil. Impossible pour autant de trouver des liens entre le destin de Pampa Kampana (à part peut-être la fin ?), l'héroïne du livre, et la vie de l'auteur, puisque ce dernier avait fini de corriger les épreuves du livre avant son attaque. Reste que le livre n'en est pas moins passionnant, et brasse assez large pour nous intéresser sur plus de 300 pages.
LA CITE DE LA VICTOIRE pourrait commencer par « Il était une fois… », tant le roman se rapproche du conte, ou plutôt de l'épopée. Il pourrait également débuter comme le célèbre incipit du CONTE DES DEUX CITES de Dickens : « It was the best of times, it was the worst of times… ». Car le roman de Rushdie se décline avant tout comme le portrait d'une ville, Bisnaga (littéralement « la ville de la victoire »), fondée dans le sud de l'Inde au XIVème siècle par la jeune Pampa Kampana aidée par la déesse Pampa. Profondément ébranlée par le suicide de sa mère, immolée par le feu, Pampa Kampana se met à entendre la voix de la déesse, et se fait réceptacle de la parole divine. Dotée de quelques pouvoirs divins et d'une capacité à vivre deux cent quarante-sept ans, Pampa Kampana veille sur la cité, influence les décisions des différents régents, assiste aux victoires et aux défaites, aux âges d'or et aux décadences.
LA CITE DE LA VICTOIRE est un épais roman, sans pour autant qu'il soit lourd. Salman Rushdie a le chic de nous guider au sein d'une intrigue tortueuse et longue d'un quart de siècle. Si le nombre de personnages impressionne, l'auteur parvient toujours à nous rappeler leur fonction, et ne nous perd jamais, parvenant même à créer une psychologie propre à chacun de ses êtres de papier (le roi Hukka et son frère Bukka, le portugais Domingo Nunes, le religieux Haleya Kote…). Présentée comme la traduction et la simplification d'une ancienne épopée, le Jayaparajaya, découverte dans une jarre, cette saga se présente avant tout comme un tour de force romanesque.
Ici, peu de philosophie et de réflexions, mais avant tout la description et le roman d'une ville. Pour autant, Rushdie parsème son histoire de thèmes revenant de façon cyclique : la place des femmes au sein de la société (« Dans l'empire de Bisnaga, dit-elle dans son adresse au conseil, les femmes ne sont pas traitées comme des sujets de seconde zone. Nous ne sommes ni voilées ni cachées. ») et celle des relations entre politique et religion (adoption d'une religion d'Etat, liberté de culte, tolérance des prières collectives…). Solidement documenté (une bibliographie fournie se trouve à la fin du livre), LA CITE DE LA VICTOIRE brasse une part importante de l'histoire de l'Inde du Sud, entre fiction et réalité : « soit tout est vrai, soit rien ne l'est, et nous préférons croire en la vérité d'une histoire bien racontée ».
LA CITE DE LA VICTOIRE pourrait commencer par « Il était une fois… », tant le roman se rapproche du conte, ou plutôt de l'épopée. Il pourrait également débuter comme le célèbre incipit du CONTE DES DEUX CITES de Dickens : « It was the best of times, it was the worst of times… ». Car le roman de Rushdie se décline avant tout comme le portrait d'une ville, Bisnaga (littéralement « la ville de la victoire »), fondée dans le sud de l'Inde au XIVème siècle par la jeune Pampa Kampana aidée par la déesse Pampa. Profondément ébranlée par le suicide de sa mère, immolée par le feu, Pampa Kampana se met à entendre la voix de la déesse, et se fait réceptacle de la parole divine. Dotée de quelques pouvoirs divins et d'une capacité à vivre deux cent quarante-sept ans, Pampa Kampana veille sur la cité, influence les décisions des différents régents, assiste aux victoires et aux défaites, aux âges d'or et aux décadences.
LA CITE DE LA VICTOIRE est un épais roman, sans pour autant qu'il soit lourd. Salman Rushdie a le chic de nous guider au sein d'une intrigue tortueuse et longue d'un quart de siècle. Si le nombre de personnages impressionne, l'auteur parvient toujours à nous rappeler leur fonction, et ne nous perd jamais, parvenant même à créer une psychologie propre à chacun de ses êtres de papier (le roi Hukka et son frère Bukka, le portugais Domingo Nunes, le religieux Haleya Kote…). Présentée comme la traduction et la simplification d'une ancienne épopée, le Jayaparajaya, découverte dans une jarre, cette saga se présente avant tout comme un tour de force romanesque.
Ici, peu de philosophie et de réflexions, mais avant tout la description et le roman d'une ville. Pour autant, Rushdie parsème son histoire de thèmes revenant de façon cyclique : la place des femmes au sein de la société (« Dans l'empire de Bisnaga, dit-elle dans son adresse au conseil, les femmes ne sont pas traitées comme des sujets de seconde zone. Nous ne sommes ni voilées ni cachées. ») et celle des relations entre politique et religion (adoption d'une religion d'Etat, liberté de culte, tolérance des prières collectives…). Solidement documenté (une bibliographie fournie se trouve à la fin du livre), LA CITE DE LA VICTOIRE brasse une part importante de l'histoire de l'Inde du Sud, entre fiction et réalité : « soit tout est vrai, soit rien ne l'est, et nous préférons croire en la vérité d'une histoire bien racontée ».
Comme souvent avec Salman Rushdie, nous avons un récit qui mélange de façon brillante réalité historique et fantaisie. L'une pénètre l'autre pour mieux nous émerveiller, mais aussi pour que l'on puisse toujours rester près de la parabole et de ses valeurs intemporelles. En effet en démarrant le récit dès sa première phrase par un personnage qui a 247 ans, en faisant parler les animaux, ou en faisant se transformer les femmes en oiseaux, on oublierait presque qu'il est en train de nous raconter la véritable histoire de l'Inde médiévale. Et dès lors que l'on adhère à cette forme exubérante, pleine d'humour et d'aventures picaresques, on est ébloui par la modernité des réformes féministes d'alors, les luttes contres les intolérances religieuses et les combats contre les dictatures aveuglées par leurs propres pouvoirs : tout finit par se transposer aisément d'une Inde médiévale étonnante et légendaire à nos sociétés contemporaines.
Au XIVème dans le Sud de l'Inde, une ville fut subitement construite sur les cendres de la précédente mais surtout grâce à des graines semées par deux frères mais surtout grâce au pouvoir de Pampa Kampana reçu par une bénédiction céleste.
Pendant 300 ans, une succession de rois gouvernèrent à Bisnaga sous l'oeil de Pampa Kampana qui livra son histoire dans le "Jayaparajaya" et qui sera découvert lors de fouilles archéologiques.
"La Cité de la Victoire" n'est autre que le récit du "Jayaparajaya" conté par un narrateur que le lecteur peut aisément imaginer être Salman Rushdie. Ecrit sous forme d'épopée, il reprend les grands moments de cette cité fictive, que l'on peut bien imaginer qu'elle a existé.
Salman Rushdie signe un roman où il mélange de façon brillante, réalité et fantastique. Dès les premières pages, vous êtes happés par cette magnifique histoire rapidement prenante.
Lien : https://www.inde-en-livres.f..
Pendant 300 ans, une succession de rois gouvernèrent à Bisnaga sous l'oeil de Pampa Kampana qui livra son histoire dans le "Jayaparajaya" et qui sera découvert lors de fouilles archéologiques.
"La Cité de la Victoire" n'est autre que le récit du "Jayaparajaya" conté par un narrateur que le lecteur peut aisément imaginer être Salman Rushdie. Ecrit sous forme d'épopée, il reprend les grands moments de cette cité fictive, que l'on peut bien imaginer qu'elle a existé.
Salman Rushdie signe un roman où il mélange de façon brillante, réalité et fantastique. Dès les premières pages, vous êtes happés par cette magnifique histoire rapidement prenante.
Lien : https://www.inde-en-livres.f..
critiques presse (4)
Ce formidable conteur qu'est Salman Rushdie élève un mémorial à un royaume perdu de l’Inde du Sud.
Lire la critique sur le site : Marianne_
Une grande fresque politique et philosophique où le merveilleux permet à l’écrivain de dénoncer la folie des hommes dès qu’ils ont le pouvoir.
Lire la critique sur le site : LesInrocks
Une de ces fables qui font la marque de fabrique de l’écrivain.
Lire la critique sur le site : LesInrocks
Dans « Victory City », qui vient de paraître en anglais, l’écrivain célèbre la liberté dominée par une héroïne vibrante, Pampa Kampana.
Lire la critique sur le site : LePoint
Citations et extraits (1)
Ajouter une citation
Pampa apprit la leçon que tout créateur devrait connaître, y compris Dieu. Une fois que vous avez créé vos personnages, vous êtes lié par leurs choix. Vous ne pouvez plus les refaire en fonction de vos désirs. Ils sont ce qu’ils sont et ils feront ce qu’ils voudront.
Cela s’appelle le libre arbitre.
Elles ne pouvait pas les transformer s’ils ne voulaient pas l’être.
Cela s’appelle le libre arbitre.
Elles ne pouvait pas les transformer s’ils ne voulaient pas l’être.
Videos de Salman Rushdie (95)
Voir plusAjouter une vidéo
La romancière Leïla Slimani vient rendre hommage sur le plateau à Salman Rushdie. Plus qu'un écrivain qu'elle admire, elle considère celui qu'elle a rencontré il y a plusieurs années sur le plateau de "La grande librairie" comme un ami. Une amitié dont elle est fière de parler, et qui est la preuve que les écrivains se rencontrent et échangent sur leurs idées. La romancière explique qu'elle admire cet homme qu'elle a découvert pour la première fois à la télévision à l'âge de 8 ans et qui lui a fait changer sa vision de la littérature. C'est ce jour-là qu'elle a compris que les écrivains étaient des êtres bien réels grâce à celui qu'elle qualifie de "héros de la pensée". Elle a également pris conscience que les livres n'étaient pas seulement un objet décoratif mais pouvait créer "du débat, du scandale, de la violence, mais aussi de l'émerveillement".
Retrouvez l'intégralité de l'interview ci-dessous: https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
Retrouvez l'intégralité de l'interview ci-dessous: https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
+ Lire la suite
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Livres les plus populaires de la semaine
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Salman Rushdie (34)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Oyez le parler médiéval !
Un destrier...
une catapulte
un cheval de bataille
un étendard
10 questions
1576 lecteurs ont répondu
Thèmes :
moyen-âge
, vocabulaire
, littérature
, culture générale
, challenge
, définitions
, histoireCréer un quiz sur ce livre1576 lecteurs ont répondu