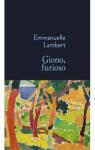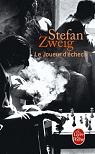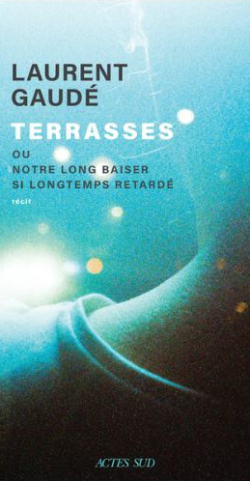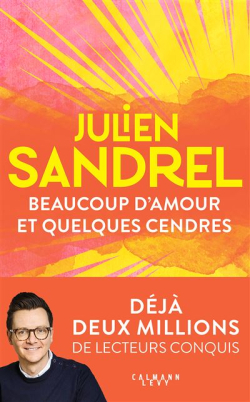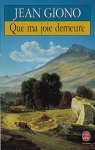Jean Giono/5
119 notes
Résumé :
« Viens, suis-moi. J'ai ici ma vigne et mon vin ; mes oliviers, et je vais surveiller l'huile moi-même au vieux moulin... Tu as vu l'amour de mon chien ? Ca ne te fait pas réfléchir, ça ?... Viens, venez tous, il n'y aura de bonheur pour vous que le jour où les grands arbres crèveront les rues, où le poids des lianes fera crouler l'obélisque et courber la Tour Eiffel ; où, devant les guichets du Louvre, on n'entendra plus que le léger bruit des cosses mûres qui s'ou... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Solitude de la pitiéVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (20)
Voir plus
Ajouter une critique
À la faveur d'un été près de Manosque, je découvre dans la maison de vacances, ici, quelques livres de Jean Giono, la propriétaire du lieu en est une grande lectrice, l'occasion de poursuivre mon chemin dans l'univers flamboyant de cet écrivain. L'un d'eux, que je ne connais pas, me tend la main, Solitude de la pitié. C'est un recueil de vingt nouvelles de tailles inégales, certaines ne dépassant pas deux pages et la plus importante, vingt-neuf pages, Prélude de Pan, ayant la dimension d'un récit antique, gothique, m'a fait un peu penser à ce conte d'Europe du nord, le joueur de flûte de Hamelin...
Les grands amateurs de Giono distinguent clairement deux périodes dans son oeuvre, Une frontière temporelle les sépare : la seconde guerre mondiale. Les grandes chroniques qui l'ont rendues célèbres figurent dans la seconde période. Certains peuvent préférer l'une plutôt que l'autre. Mais ce n'est pas non plus la seule frontière qui sépare ces deux courants de l'auteur.... Ainsi, hier, j'ai rencontré dans un village tout près d'ici l'écrivain René Frégni dont nous sommes plusieurs ici à apprécier les livres. Il adore Giono, m'avouant préférer sa seconde période, m'encourageant à lire Les Grands chemins, et qui, ô belle surprise, figure dans la bibliothèque de la propriétaire...! Aurai-je le temps de le lire ? Dans deux jours, le séjour touchera à sa fin... René Frégni m'a aussi donné quelques clefs de lecture intéressantes pour comprendre les deux périodes de cet écrivain, leurs articulations, Giono qui renia plus tard certains de ses premiers livres, comme Que ma joie demeure, trouvant la fin trop naïve. En effet entre temps, la guerre était venue et son cortège de barbarie... Je pense qu'il faut tout lire Giono et je n'en suis qu'au commencement...
Ici, on se situe aux prémices de son oeuvre, au frémissement. Les thèmes fondateurs sont déjà là. Ce pourrait être d'ailleurs une porte d'entrée idéale pour venir à la rencontre de son univers...
Il y a dans chacune de ces nouvelles une chronique familière, scène de la vie quotidienne, même dans ce conte étrange qui effleure les vertiges fantastiques.
Les vendanges.
Cueillir des olives.
Tuer le cochon noir.
Un mariage de campagne.
Une bergère solitaire qu'un garçon empli de désir observe.
L'ingratitude d'un curé à l'égard de deux vagabonds solidaires qui l'aident à rétablir le cours de l'eau d'un puits.
La pitié incomprise d'une hase qui va mourir...
Il y a quasiment toujours un narrateur qui se souvient, qui vient rapporter une histoire comme on ramène une grappe de raisins cueillie à l'arrachée.
Il y a cette terre de Provence, le soleil et le vent se mêlent dans le même cri de la terre. Ce sont des femmes et des hommes faits pour cette terre gorgée de soleil, de pierres et d'enchantement.
Les bêtes dans les pâtures sont pareilles à eux. Les arbres aussi. J'ai aimé entendre ici la musique des cyprès.
L'amour est souvent là, une tendresse infinie aussi, parfois la douleur sourd comme une source prête à jaillir.
Ici, les chemins des collines parviennent souvent à se rejoindre au même point, passant du versant du jour à celui de la nuit. C'est beau.
Et brusquement la terre s'ouvre en deux comme une coque de noix qu'on casse, elle laisse s'envoler tous ses sortilèges...
Ici de temps en temps un berger qui sait parler le langage des mésanges vient, traverse les pages comme sortis des genévriers, avec encore en lui une odeur mêlée de pluie, de vent et de ciel... Un autre, ce sera le langage d'une colombe des bois à l'aile blessée par la main épaisse d'un bûcheron plus idiot que méchant...
J'ai beaucoup aimé la nouvelle qui s'intitule La main, cette histoire touchante d'un aveugle qui sait reconnaître l'heure en se penchant pour guetter le comportement d'un ver de terre... Il se souvient de ses premiers émois amoureux lorsqu'une jeune couturière guida sa main encore novice vers des rivages insoupçonnés....
Il y a aussi cette nouvelle tragique que j'ai beaucoup aimée, Jofroi de la Maussan, cet homme qui vend sa maison en viager et vend totalement les terres attenantes. Il devient fou lorsque l'acquéreur décide d'arracher un à un tous les arbres fruitiers présents...
La nature ici est un personnage à part entière. Elle est sans cesse au coeur des pages, tantôt chantante, tantôt ondulante, tantôt criante...
Il y a souvent un ciel qui coule dans la solitude et l'errance du paysage. C'est juste un théâtre d'ombres et de lumières pour mettre en scène des femmes et des hommes saisis par une joie pure comme de l'eau vive, épris d'amour, brûlés de désir, touchés par la compassion, parfois meurtris par les rencontres qui ne se sont pas faites... Souvent, ils sont abimés par le passé, par le souvenir de la chair qui bat encore dans leurs veines, d'un chagrin d'amour qui revient comme un écho, écorchés par la vie... ici le désir enlève les forces et fait chavirer les têtes, cogne dans le sang...
J'ai aimé entendre ici la voix de Giono, chantante comme un torrent. Elle n'est pas lisse, elle est rugueuse comme la pierre. Elle n'est pas prête de s'éteindre dans mon coeur... Un autre livre m'attend déjà, Les Grands chemins, je vais passer d'une rive à l'autre dans l'oeuvre de Giono.
Les grands amateurs de Giono distinguent clairement deux périodes dans son oeuvre, Une frontière temporelle les sépare : la seconde guerre mondiale. Les grandes chroniques qui l'ont rendues célèbres figurent dans la seconde période. Certains peuvent préférer l'une plutôt que l'autre. Mais ce n'est pas non plus la seule frontière qui sépare ces deux courants de l'auteur.... Ainsi, hier, j'ai rencontré dans un village tout près d'ici l'écrivain René Frégni dont nous sommes plusieurs ici à apprécier les livres. Il adore Giono, m'avouant préférer sa seconde période, m'encourageant à lire Les Grands chemins, et qui, ô belle surprise, figure dans la bibliothèque de la propriétaire...! Aurai-je le temps de le lire ? Dans deux jours, le séjour touchera à sa fin... René Frégni m'a aussi donné quelques clefs de lecture intéressantes pour comprendre les deux périodes de cet écrivain, leurs articulations, Giono qui renia plus tard certains de ses premiers livres, comme Que ma joie demeure, trouvant la fin trop naïve. En effet entre temps, la guerre était venue et son cortège de barbarie... Je pense qu'il faut tout lire Giono et je n'en suis qu'au commencement...
Ici, on se situe aux prémices de son oeuvre, au frémissement. Les thèmes fondateurs sont déjà là. Ce pourrait être d'ailleurs une porte d'entrée idéale pour venir à la rencontre de son univers...
Il y a dans chacune de ces nouvelles une chronique familière, scène de la vie quotidienne, même dans ce conte étrange qui effleure les vertiges fantastiques.
Les vendanges.
Cueillir des olives.
Tuer le cochon noir.
Un mariage de campagne.
Une bergère solitaire qu'un garçon empli de désir observe.
L'ingratitude d'un curé à l'égard de deux vagabonds solidaires qui l'aident à rétablir le cours de l'eau d'un puits.
La pitié incomprise d'une hase qui va mourir...
Il y a quasiment toujours un narrateur qui se souvient, qui vient rapporter une histoire comme on ramène une grappe de raisins cueillie à l'arrachée.
Il y a cette terre de Provence, le soleil et le vent se mêlent dans le même cri de la terre. Ce sont des femmes et des hommes faits pour cette terre gorgée de soleil, de pierres et d'enchantement.
Les bêtes dans les pâtures sont pareilles à eux. Les arbres aussi. J'ai aimé entendre ici la musique des cyprès.
L'amour est souvent là, une tendresse infinie aussi, parfois la douleur sourd comme une source prête à jaillir.
Ici, les chemins des collines parviennent souvent à se rejoindre au même point, passant du versant du jour à celui de la nuit. C'est beau.
Et brusquement la terre s'ouvre en deux comme une coque de noix qu'on casse, elle laisse s'envoler tous ses sortilèges...
Ici de temps en temps un berger qui sait parler le langage des mésanges vient, traverse les pages comme sortis des genévriers, avec encore en lui une odeur mêlée de pluie, de vent et de ciel... Un autre, ce sera le langage d'une colombe des bois à l'aile blessée par la main épaisse d'un bûcheron plus idiot que méchant...
J'ai beaucoup aimé la nouvelle qui s'intitule La main, cette histoire touchante d'un aveugle qui sait reconnaître l'heure en se penchant pour guetter le comportement d'un ver de terre... Il se souvient de ses premiers émois amoureux lorsqu'une jeune couturière guida sa main encore novice vers des rivages insoupçonnés....
Il y a aussi cette nouvelle tragique que j'ai beaucoup aimée, Jofroi de la Maussan, cet homme qui vend sa maison en viager et vend totalement les terres attenantes. Il devient fou lorsque l'acquéreur décide d'arracher un à un tous les arbres fruitiers présents...
La nature ici est un personnage à part entière. Elle est sans cesse au coeur des pages, tantôt chantante, tantôt ondulante, tantôt criante...
Il y a souvent un ciel qui coule dans la solitude et l'errance du paysage. C'est juste un théâtre d'ombres et de lumières pour mettre en scène des femmes et des hommes saisis par une joie pure comme de l'eau vive, épris d'amour, brûlés de désir, touchés par la compassion, parfois meurtris par les rencontres qui ne se sont pas faites... Souvent, ils sont abimés par le passé, par le souvenir de la chair qui bat encore dans leurs veines, d'un chagrin d'amour qui revient comme un écho, écorchés par la vie... ici le désir enlève les forces et fait chavirer les têtes, cogne dans le sang...
J'ai aimé entendre ici la voix de Giono, chantante comme un torrent. Elle n'est pas lisse, elle est rugueuse comme la pierre. Elle n'est pas prête de s'éteindre dans mon coeur... Un autre livre m'attend déjà, Les Grands chemins, je vais passer d'une rive à l'autre dans l'oeuvre de Giono.
« Solitude de la pitié », un recueil de vingt nouvelles qui paraîtront d'abord dans le journal « l'Intransigeant » avant d'être publiées par Gallimard ; une série de textes courts rédigés alors que Jean Giono travaillait à son premier roman « La naissance de l'odyssée » :
-« Solitude de la pitié », un prêtre bien ingrat
-« Prélude de Pan », tout un village en transes
-« Champs », une femme succombe au charme d'un bel homme au désespoir de son mari
-« Ivan Ivanovitch Kossakioff », une amitié virile dans les tranchées de 14
-« La main », les amours d'un aveugle
-« Annette ou Une affaire de famille », l'abandon d'un enfant à l'orphelinat
-« Au bord des routes », une conversation autour d'un verre : deux hommes se racontent
-« Jofroi de la Maussan », le vieux Jofroi vend son verger dont on a abattu les arbres …et meurt
-« Philémon », le cochon est malade, il faut l'égorger… mais c'est la noce de la fille de la maison
-« Joselet », un homme explique sa conception de la vie à un inconnu
-« Sylvie », une fille de ferme reviens au pays après une escapade amoureuse à la ville
-« Babeau », Favre se suicide sous les yeux de la bergère de Babeau
-« le Mouton », une histoire de domination de l'animal par l'homme dans un cadre somptueux
-« Au pays des coupeurs d'arbres », la narration de la vie passée d'un village qui se meurt
-« La grande barrière », la mort d'une hase
-« Destruction de Paris », un terreux raconte un Parisien
-« Magnétisme », un bistrot, des habitués…
-« Peur de la terre », la petitesse de l'homme confronté à la nature
-« Radeaux perdus », la mort dans les villages oubliés
-« le chant du monde », comment écrire un livre ou l'homme ne serait pas isolé de son environnement ?
Comme on peut le constater, une bonne partie des thèmes chers à Giono sont déjà présents : la nature, les arbres, les villages désertés, l'Amour avec un Grand A, la mort…
Quasiment tous écrits à la première personne, vingt textes (plutôt que vingt nouvelles) dont le « je » est difficile à attribuer à quiquonque autre que Jean Giono lui-même…
Et puis, il y a ce style si particulier…délicieusement poétique.
-« Solitude de la pitié », un prêtre bien ingrat
-« Prélude de Pan », tout un village en transes
-« Champs », une femme succombe au charme d'un bel homme au désespoir de son mari
-« Ivan Ivanovitch Kossakioff », une amitié virile dans les tranchées de 14
-« La main », les amours d'un aveugle
-« Annette ou Une affaire de famille », l'abandon d'un enfant à l'orphelinat
-« Au bord des routes », une conversation autour d'un verre : deux hommes se racontent
-« Jofroi de la Maussan », le vieux Jofroi vend son verger dont on a abattu les arbres …et meurt
-« Philémon », le cochon est malade, il faut l'égorger… mais c'est la noce de la fille de la maison
-« Joselet », un homme explique sa conception de la vie à un inconnu
-« Sylvie », une fille de ferme reviens au pays après une escapade amoureuse à la ville
-« Babeau », Favre se suicide sous les yeux de la bergère de Babeau
-« le Mouton », une histoire de domination de l'animal par l'homme dans un cadre somptueux
-« Au pays des coupeurs d'arbres », la narration de la vie passée d'un village qui se meurt
-« La grande barrière », la mort d'une hase
-« Destruction de Paris », un terreux raconte un Parisien
-« Magnétisme », un bistrot, des habitués…
-« Peur de la terre », la petitesse de l'homme confronté à la nature
-« Radeaux perdus », la mort dans les villages oubliés
-« le chant du monde », comment écrire un livre ou l'homme ne serait pas isolé de son environnement ?
Comme on peut le constater, une bonne partie des thèmes chers à Giono sont déjà présents : la nature, les arbres, les villages désertés, l'Amour avec un Grand A, la mort…
Quasiment tous écrits à la première personne, vingt textes (plutôt que vingt nouvelles) dont le « je » est difficile à attribuer à quiquonque autre que Jean Giono lui-même…
Et puis, il y a ce style si particulier…délicieusement poétique.
Pas étonnant qu'Henry Miller ait préfacé l'édition américaine The Solitude of Compassion, Miller qui a chanté le "Gospel de Jean Giono" pendant de longues années. Il le considérait comme Emerson, Tolstoy et Thoreau. A raison. Giono c'est un auteur qui surplombe, qui envoie ses phrases comme des prises de judo imparables. "un haut pigeonnier qui crache en silence des pigeons blancs et pointus comme des pépins de coing." Et le lecteur, l'homme de lettres se couche, il tape sur le tatami pour demander grâce et Giono commence un nouveau paragraphe comme s'il disait "Alors t'en veux encore?" Et tu dis oui, et il te colle au tapis encore et encore. Manosque, la Haute Provence, on est loin de Marseille et du jaloux natif d'Aubagne que Giono a attaqué pour pillage. Dans Solitude de la Pitié, il y a une nouvelle, objet du litige: Jofroi de la Maussan. Pas la meilleure. Il y a bien mieux dans ce court livre incroyablement riche: Joselet, le rebouteux sorcier magicien; La main, l'histoire de l'aveugle qui sait qu'il est 5 heures le matin en touchant l'herbe, parce que c'est l'heure à laquelle sortent les vers de terre; la grande barrière et l'agonie de la hase et de ses lapereaux. Et puis il y a Ivan Ivanovitch Kossiakoff, une amitié sans paroles dans les tranchées, entre un français et un russe; et bien sûr le mythique Prélude de Pan; un des plus grands textes que j'ai pu lire, et si vous avez la flemme de le lire vous pouvez l'écouter ici:
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-samedi-noir/prelude-de-pan-de-jean-giono.
Une nouvelle gothique parce qu'elle raconte l'avènement surnaturel des forces obscures parmi les hommes, de la violence qui éclate parmi les travailleurs de la terre, de la violence d'une divinité qui sème la panique, gothique parce qu'elle révèle des mystères inouïs à un narrateur abasourdi. du pur réalisme magique.
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-samedi-noir/prelude-de-pan-de-jean-giono.
Une nouvelle gothique parce qu'elle raconte l'avènement surnaturel des forces obscures parmi les hommes, de la violence qui éclate parmi les travailleurs de la terre, de la violence d'une divinité qui sème la panique, gothique parce qu'elle révèle des mystères inouïs à un narrateur abasourdi. du pur réalisme magique.
Ce livre, paru en 1932, n'est pas un roman mais un recueil d'une vingtaine de textes courts et de nouvelles, parus dans la presse entre 1928 et 1931. Bien que sa première émotion littéraire ait été « le Livre de la jungle » de Kipling, et que Maupassant, Tchekhov et Edgar Poe figurent parmi ses auteurs de nouvelles favoris, Giono a du mal avec l'écriture de ce genre si particulier : « Je n'ai jamais été très à mon aise dans la nouvelle. Il me faut courir un peu plus longtemps. Comme coureur je fais plutôt le 1500 m que le 110m haies. » (Propos recueillis par Pierre Citron en 1969).
A part « Ivan Ivanovitch Kossiakov », qui a pour cadre la Grande Guerre, dans le sillage du « Grand Troupeau » ces vingt textes disparates et de longueur inégale ont tous pour cadre la Provence de Giono, celle qui a déjà été célébrée et mise en scène dans la Trilogie de Pan et les romans qui ont suivi.
Un autre point commun semble être ce regard sur ces paysans frustes et taiseux (le contraire des provençaux de la plaine et du bord de mer) : un regard compatissant et complice, un regard de « partage » : excepté le premier récit qui donne son titre au recueil (« Solitude de la pitié »), toutes les nouvelles sont écrites à la première personne « je » : c'est donc un livre « personnel », où l'auteur-narrateur se donne un rôle. Les nouvelles se suivent, certaines banales et simples, d'autres tragiques : Jofroi de la Maussan (dont Marcel Pagnol tira un beau film (méconnu) en 1933 avec Vincent Scotto dans le rôle-titre) trace le portrait d'un paysan en guerre avec un voisin qui veut arracher ses abricotiers pour y planter des céréales. Cette obsession le mène au bord de la folie. « Ivan Ivanovitch Kossiakov » raconte l'histoire d'un soldat russe qui croise la route du romancier pendant la Grande Guerre. Il n'en reviendra pas.
L'amitié semble être aussi un des leit-motiv de ce recueil. Comme Albin et Amédée dans « Un de Baumugnes », des couples se forment en communion fraternelle.
Mais ce qui couvre tout, ici et dans toute l'oeuvre, c'est la nature. La nature des végétaux avec surtout les arbres (Chez Giono, l'arbre a toujours été un grand symbole de vie, de puissance et de pérennité) et les cours d'eaux. La vie animale, à travers la vie des bêtes (et leur mort) et la vie des humains avec leurs peines et leurs joies leurs amours et leurs haines, leurs petits plaisirs et leurs grandes douleurs. Et au-delà il y a cette connexion qui se fait entre l'homme et la nature, depuis la nuit des temps, au travers de rites séculaires, comme des forces vivent qui s'échangent entre eux : « J'ai rencontré, en bloc, ces hommes chargés de grosses forces » (« Magnétisme ») Ces forces qui leur donnent une sorte de privilège magique : « Ce qu'ils respirent, ça n'a pas le goût du déjà respiré. L'air qu'ils avalent ne sort pas du boyau des autres. Il est pur et à la source » (Ibid.). Ces forces d'ailleurs ne sont pas toujours maîtrisables, il arrive qu'elles se défoulent dans une danse orgiaque et bachique. Giono est fidèle à ses sources Pan et Dionysos.
Cette vision « panique » de la vie, est indissociable d'une vision humaniste : les paysans de Giono peuvent ses montrer égoïste et généreux : la nature elle-même peut se montrer égoïste et généreuse.
Et puis toujours chez Giono, cette langue, riche, évocatrice, éminemment poétique :
« Joselet s'est assis en face du soleil.
L'autre est en train de descendre en plein feu. Il a allumé tous les nuages ; il fait saigner le ciel sur le bois. Il vendange tout ce maquis d'arbres, il le piétine, il en fait sortir un jus doré et tout chaud qui coule dans les chemins… »
A part « Ivan Ivanovitch Kossiakov », qui a pour cadre la Grande Guerre, dans le sillage du « Grand Troupeau » ces vingt textes disparates et de longueur inégale ont tous pour cadre la Provence de Giono, celle qui a déjà été célébrée et mise en scène dans la Trilogie de Pan et les romans qui ont suivi.
Un autre point commun semble être ce regard sur ces paysans frustes et taiseux (le contraire des provençaux de la plaine et du bord de mer) : un regard compatissant et complice, un regard de « partage » : excepté le premier récit qui donne son titre au recueil (« Solitude de la pitié »), toutes les nouvelles sont écrites à la première personne « je » : c'est donc un livre « personnel », où l'auteur-narrateur se donne un rôle. Les nouvelles se suivent, certaines banales et simples, d'autres tragiques : Jofroi de la Maussan (dont Marcel Pagnol tira un beau film (méconnu) en 1933 avec Vincent Scotto dans le rôle-titre) trace le portrait d'un paysan en guerre avec un voisin qui veut arracher ses abricotiers pour y planter des céréales. Cette obsession le mène au bord de la folie. « Ivan Ivanovitch Kossiakov » raconte l'histoire d'un soldat russe qui croise la route du romancier pendant la Grande Guerre. Il n'en reviendra pas.
L'amitié semble être aussi un des leit-motiv de ce recueil. Comme Albin et Amédée dans « Un de Baumugnes », des couples se forment en communion fraternelle.
Mais ce qui couvre tout, ici et dans toute l'oeuvre, c'est la nature. La nature des végétaux avec surtout les arbres (Chez Giono, l'arbre a toujours été un grand symbole de vie, de puissance et de pérennité) et les cours d'eaux. La vie animale, à travers la vie des bêtes (et leur mort) et la vie des humains avec leurs peines et leurs joies leurs amours et leurs haines, leurs petits plaisirs et leurs grandes douleurs. Et au-delà il y a cette connexion qui se fait entre l'homme et la nature, depuis la nuit des temps, au travers de rites séculaires, comme des forces vivent qui s'échangent entre eux : « J'ai rencontré, en bloc, ces hommes chargés de grosses forces » (« Magnétisme ») Ces forces qui leur donnent une sorte de privilège magique : « Ce qu'ils respirent, ça n'a pas le goût du déjà respiré. L'air qu'ils avalent ne sort pas du boyau des autres. Il est pur et à la source » (Ibid.). Ces forces d'ailleurs ne sont pas toujours maîtrisables, il arrive qu'elles se défoulent dans une danse orgiaque et bachique. Giono est fidèle à ses sources Pan et Dionysos.
Cette vision « panique » de la vie, est indissociable d'une vision humaniste : les paysans de Giono peuvent ses montrer égoïste et généreux : la nature elle-même peut se montrer égoïste et généreuse.
Et puis toujours chez Giono, cette langue, riche, évocatrice, éminemment poétique :
« Joselet s'est assis en face du soleil.
L'autre est en train de descendre en plein feu. Il a allumé tous les nuages ; il fait saigner le ciel sur le bois. Il vendange tout ce maquis d'arbres, il le piétine, il en fait sortir un jus doré et tout chaud qui coule dans les chemins… »
Ce recueil de nouvelles constitue quelque part un roman d'auto-apprentissage pour l'écrivain-narrateur lequel apparaît dans la plupart des récits sous les traits d'un jeune homme à l'écoute de ceux qu'il rencontre, à l'école du pays et de ses paysans, premières expériences qui l'ont amené à ses premières écritures. Nombre de pièces peuvent être considérées comme des travaux préparatoires sur des thèmes qui se déploieront dans ses romans à venir ("Le chant du monde" est clairement l'esquisse du roman du même nom qui sera publié en 1934 ; "Le Prélude de Pan" annonce bien-sûr les trois premiers romans de Giono, dite trilogie de Pan ; "Ivan Kossiakoff" annonce le Grand Troupeau publié en 1931...). Les premières nouvelles plus longues semblent porter tout un manifeste littéraire, constituant les codes et lignes de force de sa sensibilité d'écrivain. Placée en entrée avec son titre magnifique, la "Solitude de la pitié" exprime à partir d'un récit sec, dénué de toute fonction laudative de l'auteur, toute l'injustice qui est faite aux hommes du peuple, ces travailleurs volontaires, humains, simples, qui tombent malades et meurent dans le mépris. Une injustice telle que c'est précisément par le silence, par un récit réaliste, sec, par la description objective, que Giono renforce l'inacceptabilité des faits racontés. Ce recours important au non-dit (Giono laisse le lecteur deviner les pensées et sentiments qui motivent les mouvements décrits, et ceux qui motivent le récit) se retrouve dans de nombreux récits, comme "Babeau" où une jeune fille rapporte sur un ton enjoué les dernières paroles d'un suicidé... Cela rappelle clairement la manière De Maupassant, où l'on sent derrière le silence du narrateur, derrière l'humour cruel même, une colère sourde et une pitié profonde. L'injustice faite aux faibles se retrouve dans presque toutes les nouvelles, l'oiseau martyrisé du « Prélude de Pan », les arbres menacés de « Jaufroi de la Maussan », l'orpheline d'« Annette », ou même dans « Ivan Ivanovitch Kossiakoff » où la guerre et sa bêtise détruisent l'amitié et presque punissent la générosité humaine du personnage. le mari trompé de "Champs" ne prête pas à rire... c'est un homme volontaire, généreux, aimant, mais qui n'est aucunement récompensé. Il est broyé non seulement par l'humain, sa femme et l'homme qu'il a hébergé, mais également par la nature qui semble lutter contre lui et défait chaque jour son travail.
L'amour de Giono pour la forêt, la montagne et les paysans, n'a rien de la naïveté du roman pastoral, ni du lyrisme romantique ou de l'idéalisation régionaliste : la nature a quelque chose d'inquiétant, de résistant, qui s'exprime de manière quasi mystique dans "Peur de la terre". C'est comme si l'homme du pays était piégé entre une humanité vicieuse, malveillante (la civilisation corruptrice de Rousseau), et une nature réticente et presque inaccessible, à l'image de cet animal mourant dans "La Grande Barrière", que le narrateur ne peut consoler. Comme si la culture (l'esprit d'abstraction) avait rendu les hommes incompatibles avec la nature, des hommes déchus comme Les Animaux dénaturés de Vercors. Ainsi l'homme des "Radeaux perdus", dont on ne sait plus trop s'il commet un crime parce qu'il est isolé dans la nature ou parce que la civilisation de l'égoïsme et de l'enrichissement le regagnent, même là en pleine nature… Ce qui fait la modernité de Giono, c'est que ses paysans sont en fait déjà des déracinés, des rejetés de la civilisation comme l'aubergiste de "Au bord des routes", des néo-ruraux avant l'âge, qui tentent de revenir vers la terre alors que toute l'humanité semble s'en détourner, dérivant dans un mouvement irrépressible d'éloignement (cette séparation artificielle entre culture et nature, typique de la civilisation occidentale, décrite et critiquée par Philippe Descola).
C'est pourquoi le choix de Giono de défendre le pays, de faire l'éloge des paysans, de rechercher poétiquement à exprimer la nature, et de dénoncer les méfaits de la civilisation, relève de l'engagement politique et existentiel, à l'instar des décroissants (engagement nettement exprimé dans la Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, en 1938)... Défense de la nature (écologie donc), ne va pas sans le déboulonnement de la civilisation. Ainsi Giono adresse ainsi une diatribe terrible contre le parisien pressé, son urbanité et son journal - symbole du faux progrès de l'intelligence humaine - dans "Destruction de Paris" : son humanité civilisée est d'une fragilité et d'une faiblesse totales. Paris n'aura de sens que lorsque les cochons prendront le métro ! retrouvant une place de co-existant à l'homme (on pense là aux espèces compagnes Donna Haraway). En conséquence, l'harmonie perdue avec la nature ne semble pouvoir se trouver que par delà la raison et la logique, tel ce "Magnétisme" mystique qui semble se dégager du travail manuel de l'artisan et du paysan (il est amusant de voir ici Giono rejoindre l'anarchiste Jules Vallès, s'exprimant pareillement dans L'Enfant...). Attention à ne pas confondre cependant, cette sorte de conversation sensuelle avec la nature, cet émerveillement simple "Le mouton", avec l'illumination de "Joselet" qui continue de voir le monde comme une machine dont il pourrait comprendre les rouages et les actionner (vision de la nature mécanisée venant de Descartes mais se retrouvant tout autant dans l'alchimie... il y a peut-être déjà un danger, une hybris, à trop vouloir démystifier le monde par la science, prévenait Épicure).
La réconciliation semble se faire par le corps, par les sens, dans l'abandon de la conscience, dans la transe chamanique décrite dans le « Prélude de Pan », lors de la fête votive du village (en l'honneur de la divinité protectrice du village), espèce d'orgie carnavalesque où toutes les normes sont oubliés, les rôles sociaux, où s'opère un grand nettoyage des certitudes et des égos... le personnage mystérieux, humble sortant de la forêt et se réfugiant quelques temps auprès des hommes. Qui est-il ? Son dénuement et sa défense ferme de l'animal persécuté font de lui une espèce de Jésus de la nature. Il s'agit de Pan, divinité mi-animal / mi-homme des populations ancestrales à croyances chamaniques, jouant le médiateur entre une tribu et son environnement, entre l'homme, les animaux, les plantes, les éléments... Puis il disparaît. A-t-on rêvé ? Est-ce un mensonge de paysan malicieux pour expliquer ce qu'il n'a pas envie ou pas moyen d'expliquer ? Une légende que l'on raconte aux enfants pour emplir leur imaginaire de merveilles ? N'est-ce pas là simplement le rôle de l'écrivain, comme un chamane, de rétablir par la fiction le lien entre l'intellect humain et les autres formes d'existence, monde des sens, monde des morts, monde du possible... ?
Lien : https://leluronum.art.blog/2..
L'amour de Giono pour la forêt, la montagne et les paysans, n'a rien de la naïveté du roman pastoral, ni du lyrisme romantique ou de l'idéalisation régionaliste : la nature a quelque chose d'inquiétant, de résistant, qui s'exprime de manière quasi mystique dans "Peur de la terre". C'est comme si l'homme du pays était piégé entre une humanité vicieuse, malveillante (la civilisation corruptrice de Rousseau), et une nature réticente et presque inaccessible, à l'image de cet animal mourant dans "La Grande Barrière", que le narrateur ne peut consoler. Comme si la culture (l'esprit d'abstraction) avait rendu les hommes incompatibles avec la nature, des hommes déchus comme Les Animaux dénaturés de Vercors. Ainsi l'homme des "Radeaux perdus", dont on ne sait plus trop s'il commet un crime parce qu'il est isolé dans la nature ou parce que la civilisation de l'égoïsme et de l'enrichissement le regagnent, même là en pleine nature… Ce qui fait la modernité de Giono, c'est que ses paysans sont en fait déjà des déracinés, des rejetés de la civilisation comme l'aubergiste de "Au bord des routes", des néo-ruraux avant l'âge, qui tentent de revenir vers la terre alors que toute l'humanité semble s'en détourner, dérivant dans un mouvement irrépressible d'éloignement (cette séparation artificielle entre culture et nature, typique de la civilisation occidentale, décrite et critiquée par Philippe Descola).
C'est pourquoi le choix de Giono de défendre le pays, de faire l'éloge des paysans, de rechercher poétiquement à exprimer la nature, et de dénoncer les méfaits de la civilisation, relève de l'engagement politique et existentiel, à l'instar des décroissants (engagement nettement exprimé dans la Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, en 1938)... Défense de la nature (écologie donc), ne va pas sans le déboulonnement de la civilisation. Ainsi Giono adresse ainsi une diatribe terrible contre le parisien pressé, son urbanité et son journal - symbole du faux progrès de l'intelligence humaine - dans "Destruction de Paris" : son humanité civilisée est d'une fragilité et d'une faiblesse totales. Paris n'aura de sens que lorsque les cochons prendront le métro ! retrouvant une place de co-existant à l'homme (on pense là aux espèces compagnes Donna Haraway). En conséquence, l'harmonie perdue avec la nature ne semble pouvoir se trouver que par delà la raison et la logique, tel ce "Magnétisme" mystique qui semble se dégager du travail manuel de l'artisan et du paysan (il est amusant de voir ici Giono rejoindre l'anarchiste Jules Vallès, s'exprimant pareillement dans L'Enfant...). Attention à ne pas confondre cependant, cette sorte de conversation sensuelle avec la nature, cet émerveillement simple "Le mouton", avec l'illumination de "Joselet" qui continue de voir le monde comme une machine dont il pourrait comprendre les rouages et les actionner (vision de la nature mécanisée venant de Descartes mais se retrouvant tout autant dans l'alchimie... il y a peut-être déjà un danger, une hybris, à trop vouloir démystifier le monde par la science, prévenait Épicure).
La réconciliation semble se faire par le corps, par les sens, dans l'abandon de la conscience, dans la transe chamanique décrite dans le « Prélude de Pan », lors de la fête votive du village (en l'honneur de la divinité protectrice du village), espèce d'orgie carnavalesque où toutes les normes sont oubliés, les rôles sociaux, où s'opère un grand nettoyage des certitudes et des égos... le personnage mystérieux, humble sortant de la forêt et se réfugiant quelques temps auprès des hommes. Qui est-il ? Son dénuement et sa défense ferme de l'animal persécuté font de lui une espèce de Jésus de la nature. Il s'agit de Pan, divinité mi-animal / mi-homme des populations ancestrales à croyances chamaniques, jouant le médiateur entre une tribu et son environnement, entre l'homme, les animaux, les plantes, les éléments... Puis il disparaît. A-t-on rêvé ? Est-ce un mensonge de paysan malicieux pour expliquer ce qu'il n'a pas envie ou pas moyen d'expliquer ? Une légende que l'on raconte aux enfants pour emplir leur imaginaire de merveilles ? N'est-ce pas là simplement le rôle de l'écrivain, comme un chamane, de rétablir par la fiction le lien entre l'intellect humain et les autres formes d'existence, monde des sens, monde des morts, monde du possible... ?
Lien : https://leluronum.art.blog/2..
Citations et extraits (65)
Voir plus
Ajouter une citation
[Reprise, car à l'enregistrement ma citation ci-dessous a bogué : je souhaitais compléter les extraits de ce très beau texte qui ont déjà été publiés ici. Dans son récit "La grande barrière", extrait du recueil de nouvelles "Solitude de la pitié", pp. 156-160 (1932), Jean Giono raconte comment, entendant lors d’une promenade des gémissements dans un fourré, il s’était approché d’une hase qui venait d’être blessée à mort par des freux, avec ses deux petits. Il avait essayé (en vain, et même pire…) de la réconforter de son mieux, avec toute la pitié venant du plus profond de son cœur meurtri. (La hase est la femelle du lièvre et le freux est un grand corbeau)] :
Je viens de voir un des drames de la terre. J’ai fait les gestes qu’il fallait. Entendons-nous : pas n’importe lesquels, pas ceux de quelqu’un qui ne sait pas ; des gestes que j’ai appris lentement, avec tout le tendre de mon cœur, des gestes qui sont venus dans mes nerfs et mes muscles, petit à petit, gouttes à gouttes on pourrait dire, bien appris, bien dans mon sang, des gestes exacts. C’étaient de pauvres gestes d’homme. Je ne le croyais pas. Je l’ai su parce que, malgré eux, j’ai été arrêté par la grande barrière.
Depuis je me dis : « pourtant, toi… »
Eh, oui, même moi. […]
[…] C’était une hase. Une magnifique bête toute dolente et toute éperdue. Elle venait d’avoir ses petits, tout neufs. C’étaient deux éponges sanglantes, crevées de coups de bec, déchirées par le croc du freux. La pauvre. Elle était couchée sur le flanc. Elle aussi blessée et déchirée dans sa chair vive. La douleur était visible comme une grande chose vivante. Elle était cramponnée dans cette large plaie du ventre et on la voyait bouger là-dedans comme une bête qui se vautre dans la boue.
La hase ne gémissait plus.
À genoux, à côté d’elle, je caressais doucement l’épais pelage brûlant de fièvre et surtout là, sur l’épine du cou où la caresse est la plus douce. Il n’y avait qu’à donner de la pitié, c’était la seule chose à faire : de la pitié, tout un plein cœur de pitié, pour adoucir, pour dire à la bête :
― Non, tu vois, quelqu'un souffre de ta souffrance, tu n’es pas seule. Je ne peux pas te guérir, mais je peux encore te garder.
Je caressais ; la bête ne se plaignait plus.
Et alors, regardant la hase dans les yeux, j’ai vu qu’elle ne se plaignait plus parce que j’étais pour elle plus terrible que les corbeaux.
Ce n’était pas apaisement que j’avais porté là, près de cette agonie, mais terreur, terreur si grande qu’il était désormais inutile de se plaindre, inutile d’appeler à l’aide. Il n’y avait plus qu’à mourir.
J’étais l’homme et j’avais tué tout espoir. La bête mourait de peur sous ma pitié incomprise ; ma main qui caressait était plus cruelle que le bec du freux.
Une grande barrière nous séparait…
Oui, en commençant, j’ai dit : « Et pourtant, moi… » Ce n’est pas de la fatuité, c’est de la surprise, c’est de la naïveté.
Moi qui sais parler la langue des mésanges, et les voilà dans l’escalier des branches, jusque sur la terre, jusqu’à mes pieds ; moi que les lagremuses* approchent jusqu’à m’avoir peint à l’envers sur les globes d’or de leurs yeux ; moi que les renards regardent ; et puis d’un coup ils savent qui je suis et ils passent doucement ; moi qui ne fait pas lever les perdreaux, mais ils picorent sans lever le bec ; moi qui suis une bête d’entre elles toutes par ce grand poids de collines, de genévriers, de thym, d’air sauvage, d’herbes, de ciel, de vent, de pluie que j’ai en moi ; moi qui ai plus de pitié pour elles que pour les hommes, s’il en est un pour qui la grande barrière devait tomber…
Non, elle est là. Il en a fallu de nos méchancetés entassées pendant des siècles pour la rendre aussi solide.
*
Je crois que voilà d’utiles réflexions pour le temps de Pâques.
____________________________________________
* "Lagremuse" était le nom courant en Provence qu'on donnait au petit lézard gris des murailles (Podarcis muralis), si commun et familier. Le mot vient du provençal "lagramuso" qu'on trouve chez Frédéric Mistral ("Mirèio", Chant II). On trouve aussi "larmeuse" chez Marcel Pagnol dans "La Gloire de mon Père" pour le même petit lézard, tout près de son étymologie latine (ou ligure) "lacrimusa", rapprochée traditionnellement mais à tort du "lacrima" (larme) latin. [Voir à ce sujet "mon" article sur le lézard des murailles dans Wikipédia].
▄
Je viens de voir un des drames de la terre. J’ai fait les gestes qu’il fallait. Entendons-nous : pas n’importe lesquels, pas ceux de quelqu’un qui ne sait pas ; des gestes que j’ai appris lentement, avec tout le tendre de mon cœur, des gestes qui sont venus dans mes nerfs et mes muscles, petit à petit, gouttes à gouttes on pourrait dire, bien appris, bien dans mon sang, des gestes exacts. C’étaient de pauvres gestes d’homme. Je ne le croyais pas. Je l’ai su parce que, malgré eux, j’ai été arrêté par la grande barrière.
Depuis je me dis : « pourtant, toi… »
Eh, oui, même moi. […]
[…] C’était une hase. Une magnifique bête toute dolente et toute éperdue. Elle venait d’avoir ses petits, tout neufs. C’étaient deux éponges sanglantes, crevées de coups de bec, déchirées par le croc du freux. La pauvre. Elle était couchée sur le flanc. Elle aussi blessée et déchirée dans sa chair vive. La douleur était visible comme une grande chose vivante. Elle était cramponnée dans cette large plaie du ventre et on la voyait bouger là-dedans comme une bête qui se vautre dans la boue.
La hase ne gémissait plus.
À genoux, à côté d’elle, je caressais doucement l’épais pelage brûlant de fièvre et surtout là, sur l’épine du cou où la caresse est la plus douce. Il n’y avait qu’à donner de la pitié, c’était la seule chose à faire : de la pitié, tout un plein cœur de pitié, pour adoucir, pour dire à la bête :
― Non, tu vois, quelqu'un souffre de ta souffrance, tu n’es pas seule. Je ne peux pas te guérir, mais je peux encore te garder.
Je caressais ; la bête ne se plaignait plus.
Et alors, regardant la hase dans les yeux, j’ai vu qu’elle ne se plaignait plus parce que j’étais pour elle plus terrible que les corbeaux.
Ce n’était pas apaisement que j’avais porté là, près de cette agonie, mais terreur, terreur si grande qu’il était désormais inutile de se plaindre, inutile d’appeler à l’aide. Il n’y avait plus qu’à mourir.
J’étais l’homme et j’avais tué tout espoir. La bête mourait de peur sous ma pitié incomprise ; ma main qui caressait était plus cruelle que le bec du freux.
Une grande barrière nous séparait…
Oui, en commençant, j’ai dit : « Et pourtant, moi… » Ce n’est pas de la fatuité, c’est de la surprise, c’est de la naïveté.
Moi qui sais parler la langue des mésanges, et les voilà dans l’escalier des branches, jusque sur la terre, jusqu’à mes pieds ; moi que les lagremuses* approchent jusqu’à m’avoir peint à l’envers sur les globes d’or de leurs yeux ; moi que les renards regardent ; et puis d’un coup ils savent qui je suis et ils passent doucement ; moi qui ne fait pas lever les perdreaux, mais ils picorent sans lever le bec ; moi qui suis une bête d’entre elles toutes par ce grand poids de collines, de genévriers, de thym, d’air sauvage, d’herbes, de ciel, de vent, de pluie que j’ai en moi ; moi qui ai plus de pitié pour elles que pour les hommes, s’il en est un pour qui la grande barrière devait tomber…
Non, elle est là. Il en a fallu de nos méchancetés entassées pendant des siècles pour la rendre aussi solide.
*
Je crois que voilà d’utiles réflexions pour le temps de Pâques.
____________________________________________
* "Lagremuse" était le nom courant en Provence qu'on donnait au petit lézard gris des murailles (Podarcis muralis), si commun et familier. Le mot vient du provençal "lagramuso" qu'on trouve chez Frédéric Mistral ("Mirèio", Chant II). On trouve aussi "larmeuse" chez Marcel Pagnol dans "La Gloire de mon Père" pour le même petit lézard, tout près de son étymologie latine (ou ligure) "lacrimusa", rapprochée traditionnellement mais à tort du "lacrima" (larme) latin. [Voir à ce sujet "mon" article sur le lézard des murailles dans Wikipédia].
▄
C'est au milieu de ce silence qu'un homme arriva, par le chemin de la forêt. Il venait dans l'ombre des maisons. Il avait l'air de se musser sous cette ombre. Il allait deux pas, puis il épiait, puis il faisait encore quelques pas légers en rasant les murs. Il vit notre peuplier. Alors il osa traverser une grande plaque de soleil et il vint vers l'arbre. Il resta là un moment à renifler. Il prenait le vent. Il avait le dos rond, comme les bêtes chassées. De sa main il caressait la vieille peau de notre arbre. À un moment il abaissa une branche et il mit sa tête dans les feuilles pour les sentir.
La hase ne gémissait plus.
À genoux à côté d’elle, je caressais doucement l’épais pelage brûlant de fièvre et surtout là, sur l’épine du cou où la caresse est la plus douce. Il n’y avait qu’à donner de la pitié, c’était la seule chose à faire : de la pitié, tout un plein cœur de pitié, pour adoucir, pour dire à la bête :
- Non, tu vois, quelqu'un souffre de ta souffrance, tu n’es pas seule. Je ne peux pas te guérir, mais je peux encore te garder.
Je caressais ; la bête ne se plaignait plus.
Et alors, en regardant la hase dans les yeux, j’ai vu qu’elle ne se plaignait plus parce que j’étais pour elle encore plus terrible que les corbeaux.
Ce n’était pas apaisement ce que j’avais porté là, près de cette agonie, mais terreur, terreur si grande qu’il était désormais inutile de se plaindre, inutile d’appeler à l’aide. Il n’y avait plus qu’à mourir.
À genoux à côté d’elle, je caressais doucement l’épais pelage brûlant de fièvre et surtout là, sur l’épine du cou où la caresse est la plus douce. Il n’y avait qu’à donner de la pitié, c’était la seule chose à faire : de la pitié, tout un plein cœur de pitié, pour adoucir, pour dire à la bête :
- Non, tu vois, quelqu'un souffre de ta souffrance, tu n’es pas seule. Je ne peux pas te guérir, mais je peux encore te garder.
Je caressais ; la bête ne se plaignait plus.
Et alors, en regardant la hase dans les yeux, j’ai vu qu’elle ne se plaignait plus parce que j’étais pour elle encore plus terrible que les corbeaux.
Ce n’était pas apaisement ce que j’avais porté là, près de cette agonie, mais terreur, terreur si grande qu’il était désormais inutile de se plaindre, inutile d’appeler à l’aide. Il n’y avait plus qu’à mourir.
- L’arbre ? [...] On voit que vous ne les connaissez pas. Si on y était pas, ça ferait tout à sa fantaisie. L’arbre, c’est tout en fantaisie. C’est intelligent, je dis pas ; ça comprend des choses… mais c’est comme des bêtes, ça passe son temps à l’amusement. Je vais vous dire. Vous savez où il est mon verger ? Là, au bout du plat. Le vent froid, ça le reçoit en plein. Alors, depuis la Noël, vous avez vu comme il faisait doux ? Bon, eh ! bien, vous verrez. Il y en a deux ou trois qui sont fleuris ; si c’était des jeunes encore, ça va, ils auraient l’excuse, mais des vieux ! Et alors, ils ont l’air de trouver ça très bien. Ils ne le font pas en cachette, non, mais ils font comme ça, pour la gloire, pour dire : vous voyez, moi, si je suis fort ! Je suis le premier. Ils sont comme ça, vous savez, les arbres. Et puis, dès que le mistral commencera, ils feront Jésus. Les autres, avec leurs fleurs pliées, ça leur sera facile : ils bomberont le dos puisqu’il est comme ça, ce vent, qu’il veut qu’on bombe le dos, qu’on n’ait pas de fleurs ; ça leur sera facile. Ceux-là, pour avoir voulu faire de la fantaisie, d’abord ça les gèlera, et puis comme c’est de l’orgueil, ces fleurs, ça tiendra les branches raides, ça voudra faire les malins et ça se fera casser les branches. J’en ai vu qui en sont morts de ça.
Dans une émission de France Inter de 2012 (lien : [https://www.radiofrance.fr/franceinter/caresser-un-animal-5864092], pour lire le texte complet), Elisabeth de Fontenay cite et commente cette nouvelle de Giono, extraite de "Solitude de la pitié" : "La grande barrière", dont j'ai recopié ici un large extrait. Dans ce beau texte intitulé "Caresser un animal", elle met ainsi en perspective le tendre désespoir exprimé par Giono dans sa nouvelle, en montrant que parfois cette grande barrière (entre les animaux et ce super prédateur terminal que représente pour eux l'homme) peut s'abaisser un peu grâce à une confiance patiemment tissée, digne de l'apprivoisement enseigné par le Renard au Petit Prince de St Exupéry. Cette (rare) tendresse entre espèces différentes (et aussi - on l'espère... - intraspécifique), est un grand sujet de réflexion, ainsi qu'une merveille de la nature d'un grand réconfort pour l'avenir et le sens du monde (et peut : être de l'humanité...). Voici donc un extrait de ce texte d'Elisabeth de Fontenay partant de Jean Giono :
« Caresser un animal :
Dans son texte "La grande barrière", l’écrivain Jean Giono raconte comment, entendant lors d’une promenade des gémissements dans un fourré, il s’était approché d’une hase qui venait d’être blessée à mort par des freux. (La hase est la femelle du lièvre et le freux est un corbeau). Je lis :
« A genoux, à côté d’elle, je caressais doucement l’épais pelage brûlant de fièvre (…) Il n’y avait qu’à donner de la pitié, c’était la seule chose à faire : de la pitié, tout un plein cœur de pitié, pour adoucir, pour dire à la bête : Non, tu vois, tu n’es pas seule, quelqu’un souffre de ta souffrance.
Je caressais ; la bête ne se plaignait plus.
Et alors, regardant la hase dans les yeux, j’ai vu qu’elle ne se plaignait plus parce que j’étais pour elle plus terrible que les corbeaux.
Ce n’était pas apaisement que j’avais porté là près de cette agonie mais terreur, terreur si grande qu’il était désormais inutile de se plaindre, inutile d’appeler à l’aide. Il n’y avait plus qu’à mourir.
J’étais l’homme et j’avais tué tout espoir. La bête mourait de peur sous ma pitié incomprise, ma main qui caressait était plus cruelle que le bec des freux.
Une barrière nous séparait… ».
Cette grande barrière entre les humains et les autres espèces, la domestication l’a supprimée en partie, l’apprivoisement l’a parfois ébranlée, la contagion entre les espèces peut la faire tomber. Mais il reste une barrière de solitude que la tendre caresse du chasseur n’a pas pu lever et les mots de Giono témoignent de ce désespérant constat. L’empathie, qui va jusqu’à brouiller, même si c’est dans de très rares cas, la frontière entre chasseur et chassé, était absente au rendez-vous de la hase et du conteur. La caresse de l’homme terrorisait la bête. C’est tout…
Ce dont je vais vous parler, c’est de caresses acceptées, de ces caresses d’hommes et de femmes ordinaires que nous prodiguons à nos animaux domestiques. Il faut peut-être l’expérience de toute une vie ou alors l’innocence du jeune enfant pour accéder vraiment à cette tendresse à la fois physique, désintéressée et chaste, pour parvenir à cette sorte de contemplation que rend possible le toucher. Il faut se dégager du souci de l’utile et même de celui de l’agréable pour comprendre ce qu’il y a, dans la caresse, de communication intense entre deux êtres vulnérables et mortels, et tout ce qu’il y a d’espérance accordée à une rédemption de la main humaine. Car c’est tout sauf une main mise, cette main qui ne prend, ni ne désire, ni ne garde et qui, dans la caresse, devient comme un regard aimant. Vous avez vu à la télévision, lors des marées noires, le travail de ces mains douces et adroites qui retiennent fermement les malheureux oiseaux marins, pour nettoyer le mazout qui mutile et profane leurs plumes et pour les rendre à l’air, à la mer, à la terre, à leur migration. C’est de cette piété-là envers les animaux que je parle.
Caresser les bêtes familières, qui vivent dans la maison ou dans sa proximité, les chiens, les chats, les chevaux, les ânes nous console un peu du terrible échec raconté par Giono. L’animal peut être plus ou moins présent sous la caresse de son compagnon humain. Si le chat, apprivoisé mais non domestiqué, reste souvent soucieux d’autre chose, prêt à bondir ailleurs [pourtant il nous caresse aussi souvent, à sa façon, car il y a toute la tendresse mammifère, enseignée par sa maman, chez lui aussi], le chien, lui, s’y abandonne, pleinement heureux et ne demandant rien d’autre sinon un peu de gratouille en plus. Le cheval, pour sa part, préfère les soins de l’étrillage, du pansage et du jet d’eau froide sur les pieds et les jambes, rudes caresses que réclame le contrat domestique.
Et je ne compte pas toutes ces caresses de langage que sont les paroles que nous leur adressons et qu’ils comprennent ; ou, si du moins nous leur parlons vraiment [avec toutes les intonations du cœur], sinon ils ne comprennent pas. « Nous devons la justice aux hommes, et la bienveillance et la douceur aux autres créatures qui peuvent les ressentir », écrit Montaigne, qui ajoute : « Je ne crains pas d'avouer la tendresse due à ma nature si puérile qui fait que je ne peux guère refuser la fête que mon chien me fait, ou qu'il me réclame, même quand ce n'est pas le moment. » Car l’animal qui nous rend notre tendresse quand il nous lèche les mains et quand il nous fait la fête, nous caresse à sa façon, et il le fait aussi en remuant la queue et en tressaillant de tout son corps, comme le chien d’Ulysse, Argus, qui a attendu pour mourir que son maître rentre à Ithaque. […] » Lire la suite sur le site de France Inter, où Élisabeth de Fontenay aborde, sur les plans juridique et philosophique les thèmes plus douloureux encore de la zoophilie et de la maltraitance contre les animaux : https://www.radiofrance.fr/franceintesr/caresser-un-animal-5864092 .
Pour conclure (?) sur ce sujet, [conclusion empruntée à la fin de "mon" article sur Wikipédia consacré au poète mystique Angelus Silesius, que je ne saurais trop vous recommander {clin d’œil et sourire}], voici le magnifique texte de l'épitaphe gravée sur la tombe de Marguerite Yourcenar à Mount Desert (dans le Maine aux États-Unis), et qui est extraite de son roman "L'œuvre au noir" (page 19) :
« Plaise à Celui qui Est peut-être
de dilater le cœur de l'homme
à la mesure de toute la vie... »
Que dire de plus ? Le cœur de Giono, celui de Fontenay et celui de Yourcenar ont bien su se dilater, eux... Ils sont grands !
« Caresser un animal :
Dans son texte "La grande barrière", l’écrivain Jean Giono raconte comment, entendant lors d’une promenade des gémissements dans un fourré, il s’était approché d’une hase qui venait d’être blessée à mort par des freux. (La hase est la femelle du lièvre et le freux est un corbeau). Je lis :
« A genoux, à côté d’elle, je caressais doucement l’épais pelage brûlant de fièvre (…) Il n’y avait qu’à donner de la pitié, c’était la seule chose à faire : de la pitié, tout un plein cœur de pitié, pour adoucir, pour dire à la bête : Non, tu vois, tu n’es pas seule, quelqu’un souffre de ta souffrance.
Je caressais ; la bête ne se plaignait plus.
Et alors, regardant la hase dans les yeux, j’ai vu qu’elle ne se plaignait plus parce que j’étais pour elle plus terrible que les corbeaux.
Ce n’était pas apaisement que j’avais porté là près de cette agonie mais terreur, terreur si grande qu’il était désormais inutile de se plaindre, inutile d’appeler à l’aide. Il n’y avait plus qu’à mourir.
J’étais l’homme et j’avais tué tout espoir. La bête mourait de peur sous ma pitié incomprise, ma main qui caressait était plus cruelle que le bec des freux.
Une barrière nous séparait… ».
Cette grande barrière entre les humains et les autres espèces, la domestication l’a supprimée en partie, l’apprivoisement l’a parfois ébranlée, la contagion entre les espèces peut la faire tomber. Mais il reste une barrière de solitude que la tendre caresse du chasseur n’a pas pu lever et les mots de Giono témoignent de ce désespérant constat. L’empathie, qui va jusqu’à brouiller, même si c’est dans de très rares cas, la frontière entre chasseur et chassé, était absente au rendez-vous de la hase et du conteur. La caresse de l’homme terrorisait la bête. C’est tout…
Ce dont je vais vous parler, c’est de caresses acceptées, de ces caresses d’hommes et de femmes ordinaires que nous prodiguons à nos animaux domestiques. Il faut peut-être l’expérience de toute une vie ou alors l’innocence du jeune enfant pour accéder vraiment à cette tendresse à la fois physique, désintéressée et chaste, pour parvenir à cette sorte de contemplation que rend possible le toucher. Il faut se dégager du souci de l’utile et même de celui de l’agréable pour comprendre ce qu’il y a, dans la caresse, de communication intense entre deux êtres vulnérables et mortels, et tout ce qu’il y a d’espérance accordée à une rédemption de la main humaine. Car c’est tout sauf une main mise, cette main qui ne prend, ni ne désire, ni ne garde et qui, dans la caresse, devient comme un regard aimant. Vous avez vu à la télévision, lors des marées noires, le travail de ces mains douces et adroites qui retiennent fermement les malheureux oiseaux marins, pour nettoyer le mazout qui mutile et profane leurs plumes et pour les rendre à l’air, à la mer, à la terre, à leur migration. C’est de cette piété-là envers les animaux que je parle.
Caresser les bêtes familières, qui vivent dans la maison ou dans sa proximité, les chiens, les chats, les chevaux, les ânes nous console un peu du terrible échec raconté par Giono. L’animal peut être plus ou moins présent sous la caresse de son compagnon humain. Si le chat, apprivoisé mais non domestiqué, reste souvent soucieux d’autre chose, prêt à bondir ailleurs [pourtant il nous caresse aussi souvent, à sa façon, car il y a toute la tendresse mammifère, enseignée par sa maman, chez lui aussi], le chien, lui, s’y abandonne, pleinement heureux et ne demandant rien d’autre sinon un peu de gratouille en plus. Le cheval, pour sa part, préfère les soins de l’étrillage, du pansage et du jet d’eau froide sur les pieds et les jambes, rudes caresses que réclame le contrat domestique.
Et je ne compte pas toutes ces caresses de langage que sont les paroles que nous leur adressons et qu’ils comprennent ; ou, si du moins nous leur parlons vraiment [avec toutes les intonations du cœur], sinon ils ne comprennent pas. « Nous devons la justice aux hommes, et la bienveillance et la douceur aux autres créatures qui peuvent les ressentir », écrit Montaigne, qui ajoute : « Je ne crains pas d'avouer la tendresse due à ma nature si puérile qui fait que je ne peux guère refuser la fête que mon chien me fait, ou qu'il me réclame, même quand ce n'est pas le moment. » Car l’animal qui nous rend notre tendresse quand il nous lèche les mains et quand il nous fait la fête, nous caresse à sa façon, et il le fait aussi en remuant la queue et en tressaillant de tout son corps, comme le chien d’Ulysse, Argus, qui a attendu pour mourir que son maître rentre à Ithaque. […] » Lire la suite sur le site de France Inter, où Élisabeth de Fontenay aborde, sur les plans juridique et philosophique les thèmes plus douloureux encore de la zoophilie et de la maltraitance contre les animaux : https://www.radiofrance.fr/franceintesr/caresser-un-animal-5864092 .
Pour conclure (?) sur ce sujet, [conclusion empruntée à la fin de "mon" article sur Wikipédia consacré au poète mystique Angelus Silesius, que je ne saurais trop vous recommander {clin d’œil et sourire}], voici le magnifique texte de l'épitaphe gravée sur la tombe de Marguerite Yourcenar à Mount Desert (dans le Maine aux États-Unis), et qui est extraite de son roman "L'œuvre au noir" (page 19) :
« Plaise à Celui qui Est peut-être
de dilater le cœur de l'homme
à la mesure de toute la vie... »
Que dire de plus ? Le cœur de Giono, celui de Fontenay et celui de Yourcenar ont bien su se dilater, eux... Ils sont grands !
Videos de Jean Giono (61)
Voir plusAjouter une vidéo
Denis Infante a publié son premier roman Rousse publié aux éditions Tristram le 4 janvier 2024. Il raconte l'épopée d'une renarde qui souhaite découvrir le monde. Un ouvrage déroutant par sa singularité. Son histoire possède la clarté d'une fable et la puissance d'une odyssée et qui ne laissera personne indifférent. L'exergue, emprunté à Jean Giono, dit tout de l'ambition poétique et métaphysique de ce roman splendide : "Dans tous les livres actuels on donne à mon avis une trop grande place aux êtres mesquins et l'on néglige de nous faire percevoir le halètement des beaux habitants de l'univers."
+ Lire la suite
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean Giono (124)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Jean Giono
Né à Manosque en ...
1875
1885
1895
1905
12 questions
403 lecteurs ont répondu
Thème :
Jean GionoCréer un quiz sur ce livre403 lecteurs ont répondu