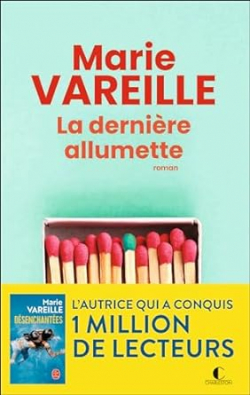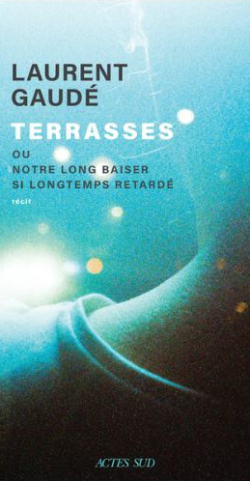Nathalie Azoulai
EAN : 9782818058664
P.O.L. (04/01/2024)
/5
53 notesP.O.L. (04/01/2024)
Résumé :
« Les machines du monde tournent grâce à des programmes informatiques qu’on appelle le code. Cette révolution technique ressemble à celle de l’électricité à la différence près qu’elle se compose de langages, de grammaires, de traductions, toutes choses qui devraient nous concerner mais dont nous ignorons tout. Je suis une femme, j’ai plus de cinquante ans, je suis écrivain et, malgré tous ces handicaps, je veux apprendre à coder. Je veux comprendre ce qui se passe s... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après PythonVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (18)
Voir plus
Ajouter une critique
Loin de la langue littéraire, une nouvelle élite réécrit le monde en différents langages, informatiques ceux-là, qui ne supportent pas non plus le moindre écart de virgule, mais, contrairement à elle, impactent désormais si bien le quotidien du monde que rien ne semblerait pouvoir encore fonctionner sans eux. Interpellée par cette puissance nouvelle en complet contraste avec la déshérence littéraire moderne – bientôt seules les vieilles dames liront des livres, écrivait récemment Luc Chomarat –, l'auteur est partie à la rencontre de l'univers du code, dans une enquête en territoire inconnu qui, paradoxalement, va la ramener au roman.
Décidée, à cause de son nom et parce qu'il est réputé abordable, à apprendre à coder en langage Python, la narratrice quinquagénaire, alter ego de l'auteur, se cherche des professeurs dans le monde très jeune et masculin des geeks, dos voûtés et capuches rabattues sur le mystère de leurs claviers. Mais, malgré ses efforts pour cadrer son esprit dans la logique binaire de la condition et de la négation censée transcrire en numérique tous les champs possibles du réel, cette apprentie codeuse décalée ne fait que de piètres progrès dans la maîtrise du code. de façon inattendue, ses rendez-vous avec ces jeunes gens bien décidés à impacter le futur la renvoient en fait vers le passé et le souvenir d'une autre attraction contrariée, vécue au temps de sa jeunesse auprès d'un homme qui préférait les hommes.
C'est ainsi que, partie explorer de nouveaux territoires langagiers dénués d'émotion et de poésie, l'auteur frappée par la rigueur extrême de la grammaire du code en même temps que replongée dans ses réminiscences au contact de la jeunesse, voit son récit bifurquer vers l'intimité de l'introspection et de la libido. Possiblement déconcerté, voire un tantinet frustré, par ce changement de pied inattendu, opéré sans préméditation, qui le propulse soudain dans un registre très personnel et bien peu connecté au sujet initial, le lecteur aura pour consolation l'intelligence de réflexions enrichies par cette confrontation ouverte et curieuse à la codification numérique du monde et aux impacts possibles de l'intelligence artificielle sur le langage et l'écriture au sens large.
Entre le monde construit par « le langage informatique, sa précision, sa clarté univoque » et celui, pluriel, « de la littérature qui ne tranche pas », pourquoi ne faudrait-il voir qu'opposition et obligation de choisir ? Ce roman se fait la preuve que le second peut se nourrir du premier, que la poésie peut fleurir partout et que la littérature se doit de se nourrir de la multiplicité des angles et des points de vue.
Indéniablement intelligente et talentueuse, la plume de Nathalie Azoulai suffira-t-elle à convaincre de la complémentarité entre la complexité humaine et l'efficacité de la machine en matière de littérature et d'écriture ? Il faudra pour cela au lecteur beaucoup de souplesse pour l'accompagner sans broncher dans la construction d'un récit faisant si bien le grand écart entre deux sujets - l'un intime, l'autre général - d'intérêt quand même très inégal.
Lien : https://leslecturesdecanneti..
Décidée, à cause de son nom et parce qu'il est réputé abordable, à apprendre à coder en langage Python, la narratrice quinquagénaire, alter ego de l'auteur, se cherche des professeurs dans le monde très jeune et masculin des geeks, dos voûtés et capuches rabattues sur le mystère de leurs claviers. Mais, malgré ses efforts pour cadrer son esprit dans la logique binaire de la condition et de la négation censée transcrire en numérique tous les champs possibles du réel, cette apprentie codeuse décalée ne fait que de piètres progrès dans la maîtrise du code. de façon inattendue, ses rendez-vous avec ces jeunes gens bien décidés à impacter le futur la renvoient en fait vers le passé et le souvenir d'une autre attraction contrariée, vécue au temps de sa jeunesse auprès d'un homme qui préférait les hommes.
C'est ainsi que, partie explorer de nouveaux territoires langagiers dénués d'émotion et de poésie, l'auteur frappée par la rigueur extrême de la grammaire du code en même temps que replongée dans ses réminiscences au contact de la jeunesse, voit son récit bifurquer vers l'intimité de l'introspection et de la libido. Possiblement déconcerté, voire un tantinet frustré, par ce changement de pied inattendu, opéré sans préméditation, qui le propulse soudain dans un registre très personnel et bien peu connecté au sujet initial, le lecteur aura pour consolation l'intelligence de réflexions enrichies par cette confrontation ouverte et curieuse à la codification numérique du monde et aux impacts possibles de l'intelligence artificielle sur le langage et l'écriture au sens large.
Entre le monde construit par « le langage informatique, sa précision, sa clarté univoque » et celui, pluriel, « de la littérature qui ne tranche pas », pourquoi ne faudrait-il voir qu'opposition et obligation de choisir ? Ce roman se fait la preuve que le second peut se nourrir du premier, que la poésie peut fleurir partout et que la littérature se doit de se nourrir de la multiplicité des angles et des points de vue.
Indéniablement intelligente et talentueuse, la plume de Nathalie Azoulai suffira-t-elle à convaincre de la complémentarité entre la complexité humaine et l'efficacité de la machine en matière de littérature et d'écriture ? Il faudra pour cela au lecteur beaucoup de souplesse pour l'accompagner sans broncher dans la construction d'un récit faisant si bien le grand écart entre deux sujets - l'un intime, l'autre général - d'intérêt quand même très inégal.
Lien : https://leslecturesdecanneti..
Lors d'un déjeuner avec des amis, l'autrice remarque Boris, le fils de la maison, à l'écart, penché sur son ordinateur, un casque sur les oreilles. Son père explique qu'il code, code, code de jour comme de nuit. Interloquée, l'autrice va chercher à en savoir plus. Les explications fournies par internet sur le code et les langages de programmation se révèlent vite trop complexes et réservées à des initiés. Elle comprend qu'il s'agit d'un monde jeune, à majorité masculine. Elle se sent dépassée, en tant que femme d'une cinquantaine d'année, mais souhaite relever le défi. Elle va rencontrer des spécialistes du langage informatique pour en savoir plus sur l'un d'entre eux : Python, un nom qui lui plaît. Plus que le monde des ophidiens, il évoque pour elle tout un imaginaire, et surtout de belles références cinématographiques. Elle découvre, étonnée, que le langage Python a été ainsi nommé par son inventeur, Guido van Rossum, en référence aux Monty Python, acteurs emblématiques des années 1970 à l'humour surréaliste….Les découvertes vont se succéder.
Python est un roman qui m'a intéressée en raison des thèmes qu'il développe : celui de langages informatiques qui s'écrivent et disposent, tout comme les langues humaines, de syntaxe et de lexique précis, et de questions : peut-on établir des liens entre ces sortes de langages ? Et où se situe la création artistique ? Peut-on vraiment écrire un roman en ayant recours à l'intelligence artificielle ? L'autrice va s'y employer, et reconnaître très vite les limites d'un tel ouvrage. « En fait, c'est un vrai métier d'écrire, c'est comme le code », reconnaît finalement Enzo, un des jeunes codeurs qui apporte une aide précieuse à l'autrice.
La forme du roman est quelquefois déroutante : difficile de mêler l'histoire d'une autrice à la recherche d'un sujet de roman, de renseignements sur le code et les codeurs ainsi que des exemples précis de codes avec le récit de rencontres avec de jeunes spécialistes et une ébauche de roman écrit grâce à l'Intelligence Artificielle. On a quelquefois du mal à s'y retrouver. Par ailleurs, le recours excessif aux parenthèses alourdit le texte.
C'est un vrai roman, écrit par une intelligence bien humaine, qui se construit sous nos yeux, grâce à un tableau magnétique qui rassemble les divers éléments du récit. Ce tableau permet de mettre en lumière les liens qui unissent les différents personnages. C'est l'amitié qui l'emporte, bien plus puissante que l'amour à bien des égards.
Une lecture un peu exigeante, qui ouvre vers d'autres horizons, d'autres langages !
Python est un roman qui m'a intéressée en raison des thèmes qu'il développe : celui de langages informatiques qui s'écrivent et disposent, tout comme les langues humaines, de syntaxe et de lexique précis, et de questions : peut-on établir des liens entre ces sortes de langages ? Et où se situe la création artistique ? Peut-on vraiment écrire un roman en ayant recours à l'intelligence artificielle ? L'autrice va s'y employer, et reconnaître très vite les limites d'un tel ouvrage. « En fait, c'est un vrai métier d'écrire, c'est comme le code », reconnaît finalement Enzo, un des jeunes codeurs qui apporte une aide précieuse à l'autrice.
La forme du roman est quelquefois déroutante : difficile de mêler l'histoire d'une autrice à la recherche d'un sujet de roman, de renseignements sur le code et les codeurs ainsi que des exemples précis de codes avec le récit de rencontres avec de jeunes spécialistes et une ébauche de roman écrit grâce à l'Intelligence Artificielle. On a quelquefois du mal à s'y retrouver. Par ailleurs, le recours excessif aux parenthèses alourdit le texte.
C'est un vrai roman, écrit par une intelligence bien humaine, qui se construit sous nos yeux, grâce à un tableau magnétique qui rassemble les divers éléments du récit. Ce tableau permet de mettre en lumière les liens qui unissent les différents personnages. C'est l'amitié qui l'emporte, bien plus puissante que l'amour à bien des égards.
Une lecture un peu exigeante, qui ouvre vers d'autres horizons, d'autres langages !
Premier livre de Nathalie Azoulai sur lequel je mets la main, qui ne donne certainement pas envie de lire les précédents.
Pourtant, au premier abord, le concept est intéressant : l'autrice, une femme d'une cinquantaine d'années, décide d'apprendre à coder en Python sans rien connaître à l'informatique, après avoir aperçu le fils d'un de ses amis assis derrière son écran, visiblement plongé dans son code. Premier malaise : ce garçon, Boris, va être un personnage récurrent au fil du récit, objet de tous les fantasmes de l'autrice sur les programmeurs, ces mystérieux jeunes hommes qui, plongés dans le noir, façonnent le monde derrière leur écran... Merci pour le cliché.
Passons ; Nathalie veut apprendre à coder et contacte donc Xavier Niel, dont elle avait l'adresse mail personnelle (?), qui la met en contact avec la directrice de l'école 42 - rien que ça ! Problème, Nathalie veut coder en Python et à l'école 42, on fait du C. de toutes façons, elle échoue à tous les tests préliminaires ; elle se met donc plutôt en quête de professeurs particuliers. Ce sont deux jeunes femmes qui vont avoir la dure tâche de l'initier au Python, même si elle aurait préféré des hommes (pour mieux coller à son fantasme, j'imagine). Là, on pourrait se dire que ça va enfin être intéressant - va-t-elle décrire son progrès dans le langage informatique ? Va-t-elle se rendre compte que son monde de clichés est en train de s'effondrer ? Eh bien non. Nathalie fait crise existentielle sur crise existentielle lorsque sa première professeure tente de lui apprendre les bases du Python, puis avec sa seconde enseignante, elle parle plus de littérature que d'informatique (ah oui : elle mentionne Proust au moins une fois toutes les cinq pages). Puis finalement elle se retrouve à prendre un cours avec Boris, l'objet de tous ses fantasmes ; j'espère qu'il ne lira jamais ce livre, parce que même moi qui était extérieure à cette histoire j'ai été mal à l'aise pour lui, il n'a rien demandé et le voilà qui essaie d'enseigner le Python à une cinquantenaire au bord de la syncope quand elle doit taper sur un clavier et qui le regarde avec des yeux débordants de sexe.
Puis vers la moitié du livre, Nathalie Azoulai abandonne complètement son idée de base. Elle disserte sur l'importance de la littérature et de la création, part dans des délires mystiques, utilise le terme "Python" pour désigner le code en général - c'est à ce moment que tous les programmeurs ont mal. Ses personnages féminins (ses enseignantes, et même la directrice de l'école 42) sont systématiquement torpillées quand les personnages masculins sont adulés (encore une fois Boris, je suis désolée pour toi).
Elle finit par retourner à l'école 42 mais plus pour apprendre, pour mener une enquête "journalistique" - on comprend vite qu'elle veut trouver un jeune homme à se mettre sous la dent, et pas de chance, le seul qu'elle arrive à attraper est gay. Elle se dit aussi que les jeunes femmes qui sont là sont bien tombées car elles ont tout un choix de partenaires à leur disposition - parce que c'est bien connu, quand on est une femme, on fait des études pour trouver un mari ou pour coucher facilement, hein, voilà.
Bref, Nathalie Azoulai n'a jamais appris à coder en Python et moi, j'ai perdu quelques heures de ma vie.
Pourtant, au premier abord, le concept est intéressant : l'autrice, une femme d'une cinquantaine d'années, décide d'apprendre à coder en Python sans rien connaître à l'informatique, après avoir aperçu le fils d'un de ses amis assis derrière son écran, visiblement plongé dans son code. Premier malaise : ce garçon, Boris, va être un personnage récurrent au fil du récit, objet de tous les fantasmes de l'autrice sur les programmeurs, ces mystérieux jeunes hommes qui, plongés dans le noir, façonnent le monde derrière leur écran... Merci pour le cliché.
Passons ; Nathalie veut apprendre à coder et contacte donc Xavier Niel, dont elle avait l'adresse mail personnelle (?), qui la met en contact avec la directrice de l'école 42 - rien que ça ! Problème, Nathalie veut coder en Python et à l'école 42, on fait du C. de toutes façons, elle échoue à tous les tests préliminaires ; elle se met donc plutôt en quête de professeurs particuliers. Ce sont deux jeunes femmes qui vont avoir la dure tâche de l'initier au Python, même si elle aurait préféré des hommes (pour mieux coller à son fantasme, j'imagine). Là, on pourrait se dire que ça va enfin être intéressant - va-t-elle décrire son progrès dans le langage informatique ? Va-t-elle se rendre compte que son monde de clichés est en train de s'effondrer ? Eh bien non. Nathalie fait crise existentielle sur crise existentielle lorsque sa première professeure tente de lui apprendre les bases du Python, puis avec sa seconde enseignante, elle parle plus de littérature que d'informatique (ah oui : elle mentionne Proust au moins une fois toutes les cinq pages). Puis finalement elle se retrouve à prendre un cours avec Boris, l'objet de tous ses fantasmes ; j'espère qu'il ne lira jamais ce livre, parce que même moi qui était extérieure à cette histoire j'ai été mal à l'aise pour lui, il n'a rien demandé et le voilà qui essaie d'enseigner le Python à une cinquantenaire au bord de la syncope quand elle doit taper sur un clavier et qui le regarde avec des yeux débordants de sexe.
Puis vers la moitié du livre, Nathalie Azoulai abandonne complètement son idée de base. Elle disserte sur l'importance de la littérature et de la création, part dans des délires mystiques, utilise le terme "Python" pour désigner le code en général - c'est à ce moment que tous les programmeurs ont mal. Ses personnages féminins (ses enseignantes, et même la directrice de l'école 42) sont systématiquement torpillées quand les personnages masculins sont adulés (encore une fois Boris, je suis désolée pour toi).
Elle finit par retourner à l'école 42 mais plus pour apprendre, pour mener une enquête "journalistique" - on comprend vite qu'elle veut trouver un jeune homme à se mettre sous la dent, et pas de chance, le seul qu'elle arrive à attraper est gay. Elle se dit aussi que les jeunes femmes qui sont là sont bien tombées car elles ont tout un choix de partenaires à leur disposition - parce que c'est bien connu, quand on est une femme, on fait des études pour trouver un mari ou pour coucher facilement, hein, voilà.
Bref, Nathalie Azoulai n'a jamais appris à coder en Python et moi, j'ai perdu quelques heures de ma vie.
Nos textes quand ils s'affichent sur l'ordinateur s'écrivent sur un millefeuille d'autres textes écrits par d'autres mains. L'idée de palimpseste a toujours enchanté les écrivains, mais de ce palimpseste-là, ils ne parlent pas."
Lorsqu'on est une écrivaine fascinée par le langage, habituée à étudier et travailler la langue peut-être est-il naturel un jour de s'intéresser à d'autres langages, façonnés par les mains agiles de jeunes geeks absorbés par leur écran ? Cela devient l'obsession de la narratrice, une cinquantenaire qui ressemble beaucoup à l'autrice, bien décidée à explorer les mystères de l'élaboration des lignes de code destinées à remplacer celles tracées délicatement par une plume sur le papier, et surtout qui régissent désormais la moindre de nos activités. La voici donc telle une enquêtrice traquant les liens, les sources, les indices et les coupables, engagée sur le chemin qui mène aux algorithmes, discutant, expérimentant, séchant et digressant à chaque nouvelle étape. de tous les langages informatiques, c'est le Python qui l'attire, non pour ses caractéristiques qu'elle ne connaît pas mais pour ce qu'il évoque de matière ou de symboles. Chez l'écrivaine, l'imagination s'emballe vite. D'images en associations d'idées, l'exploration à laquelle elle nous invite mêle habilement les signes et les lettres, déborde joyeusement du langage binaire auquel on voudrait la cantonner. Il est question de littérature bien sûr, et Proust, Virginia Woolf ou Madame de Lafayette font partie du voyage sur le tableau magnétique de l'écrivaine-enquêtrice aux côtés de tous les inventeurs-défricheurs qui ont permis ces nouveaux langages. de cours particuliers en sessions à l'école 42 où l'écrivaine préfère observer voire fantasmer sur un ou deux codeurs à l'oeuvre, le champ d'exploration semble infini et on y rebondit comme une petite balle de caoutchouc, avec le sourire. Même pas peur lorsqu'une équation apparait soudain au milieu d'une page, mais il fallait oser. Puisqu'il s'agit d'intelligence, impossible d'éviter la confrontation avec l'IA, concentration de toutes les craintes pour qui évolue dans le domaine de la littérature, et épisode plutôt drôle même si on comprend que ses imperfections ne seront sans doute bientôt plus qu'un lointain souvenir. L'autrice réussit une immersion assez vertigineuse qui met en lumière l'imbrication du code dans nos vies, elle le fait avec toute la puissance de la littérature qui puise aux sources de nos blessures et failles les plus profondes ; avec l'espoir qu'elle garde le dessus et demeure vivante à jamais. Ultime preuve de notre humanité ?
Drôle et intelligent, je me suis régalée.
Lien : http://www.motspourmots.fr/2..
Lorsqu'on est une écrivaine fascinée par le langage, habituée à étudier et travailler la langue peut-être est-il naturel un jour de s'intéresser à d'autres langages, façonnés par les mains agiles de jeunes geeks absorbés par leur écran ? Cela devient l'obsession de la narratrice, une cinquantenaire qui ressemble beaucoup à l'autrice, bien décidée à explorer les mystères de l'élaboration des lignes de code destinées à remplacer celles tracées délicatement par une plume sur le papier, et surtout qui régissent désormais la moindre de nos activités. La voici donc telle une enquêtrice traquant les liens, les sources, les indices et les coupables, engagée sur le chemin qui mène aux algorithmes, discutant, expérimentant, séchant et digressant à chaque nouvelle étape. de tous les langages informatiques, c'est le Python qui l'attire, non pour ses caractéristiques qu'elle ne connaît pas mais pour ce qu'il évoque de matière ou de symboles. Chez l'écrivaine, l'imagination s'emballe vite. D'images en associations d'idées, l'exploration à laquelle elle nous invite mêle habilement les signes et les lettres, déborde joyeusement du langage binaire auquel on voudrait la cantonner. Il est question de littérature bien sûr, et Proust, Virginia Woolf ou Madame de Lafayette font partie du voyage sur le tableau magnétique de l'écrivaine-enquêtrice aux côtés de tous les inventeurs-défricheurs qui ont permis ces nouveaux langages. de cours particuliers en sessions à l'école 42 où l'écrivaine préfère observer voire fantasmer sur un ou deux codeurs à l'oeuvre, le champ d'exploration semble infini et on y rebondit comme une petite balle de caoutchouc, avec le sourire. Même pas peur lorsqu'une équation apparait soudain au milieu d'une page, mais il fallait oser. Puisqu'il s'agit d'intelligence, impossible d'éviter la confrontation avec l'IA, concentration de toutes les craintes pour qui évolue dans le domaine de la littérature, et épisode plutôt drôle même si on comprend que ses imperfections ne seront sans doute bientôt plus qu'un lointain souvenir. L'autrice réussit une immersion assez vertigineuse qui met en lumière l'imbrication du code dans nos vies, elle le fait avec toute la puissance de la littérature qui puise aux sources de nos blessures et failles les plus profondes ; avec l'espoir qu'elle garde le dessus et demeure vivante à jamais. Ultime preuve de notre humanité ?
Drôle et intelligent, je me suis régalée.
Lien : http://www.motspourmots.fr/2..
Etant un développeur Python dont la première passion est la littérature, j'ai naturellement reçu ce livre en cadeau. Même si j'étais sceptique par rapport à l'approche autofictionnelle, j'étais tout de même emballé par la promesse de départ, qui est d'explorer les liens et différences entre la pensée littéraire et la pratique informatique.
Le problème du livre, c'est que cette promesse, pourtant sans cesse réitérée, n'est jamais tenue. Car ce qui intéresse vraiment l'écrivaine, ce sont ses propres fantasmes et rien de plus. L'histoire démarre par un trouble érotique suscité par un jeune homme qui a passé la nuit à coder (alors que tout jeune homme normal devrait boire et faire la fête selon elle), elle se termine sur l'idée que le nerd est quand même une forme de bad boy (d'où l'érotisme ?), et à la fin, l'autrice ne sait toujours pas programmer en Python.
C'est l'hypocrisie de ce projet littéraire : l'autrice fuit sans cesse l'apprentissage du langage de programmation, malgré ses pédagogues d'une patience infinie. On lui dit d'emblée que la programmation est une forme d'artisanat, d'école de l'humilité où la moindre erreur fait tout planter, un processus addictif de résolution de problèmes. Pourtant, entre deux fantasmes sur Marlon Brando habillé en peau de serpent dans un film de Lumet, elle s'obstine à craindre un monde trop rationnel où les gens penseront comme des machines à force de programmer. Si elle avait pris la peine d'apprendre à programmer, elle se serait rendu compte que la résolution de problème demande beaucoup de curiosité et de créativité.
Personnellement, ça ne m'intéresse pas de voir comment une écrivaine transforme un langage de programmation en fantasme, d'autant plus que ce fantasme fuit la réalité et cherche au contraire à s'accrocher aux clichés. Certains sont d'ailleurs particulièrement insultants sur les introvertis, chose étonnante pour une écrivaine qui admire Proust et Kafka. Pourquoi imaginer une haine du monde perverse chez celui qui reste dans sa chambre à programmer, et pas chez celui qui lit ou écrit?
Ce livre est l'histoire d'une rencontre manquée entre une autrice et son sujet. C'est dommage, car encore aujourd'hui la technique, l'ingénierie et les mathématiques restent des impensés de la littérature blanche, et les bons écrivains-ingénieurs sont rares. Pour de vraies réflexions sur la technique, il faut mieux se tourner vers Les Désarrois de l'élève Törless de Musil, ou bien le Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes de Pirsig.
Et pour finir, sachez qu'il n'y a aucune honte à avoir à apprendre un langage informatique, quelque soit votre âge!
Le problème du livre, c'est que cette promesse, pourtant sans cesse réitérée, n'est jamais tenue. Car ce qui intéresse vraiment l'écrivaine, ce sont ses propres fantasmes et rien de plus. L'histoire démarre par un trouble érotique suscité par un jeune homme qui a passé la nuit à coder (alors que tout jeune homme normal devrait boire et faire la fête selon elle), elle se termine sur l'idée que le nerd est quand même une forme de bad boy (d'où l'érotisme ?), et à la fin, l'autrice ne sait toujours pas programmer en Python.
C'est l'hypocrisie de ce projet littéraire : l'autrice fuit sans cesse l'apprentissage du langage de programmation, malgré ses pédagogues d'une patience infinie. On lui dit d'emblée que la programmation est une forme d'artisanat, d'école de l'humilité où la moindre erreur fait tout planter, un processus addictif de résolution de problèmes. Pourtant, entre deux fantasmes sur Marlon Brando habillé en peau de serpent dans un film de Lumet, elle s'obstine à craindre un monde trop rationnel où les gens penseront comme des machines à force de programmer. Si elle avait pris la peine d'apprendre à programmer, elle se serait rendu compte que la résolution de problème demande beaucoup de curiosité et de créativité.
Personnellement, ça ne m'intéresse pas de voir comment une écrivaine transforme un langage de programmation en fantasme, d'autant plus que ce fantasme fuit la réalité et cherche au contraire à s'accrocher aux clichés. Certains sont d'ailleurs particulièrement insultants sur les introvertis, chose étonnante pour une écrivaine qui admire Proust et Kafka. Pourquoi imaginer une haine du monde perverse chez celui qui reste dans sa chambre à programmer, et pas chez celui qui lit ou écrit?
Ce livre est l'histoire d'une rencontre manquée entre une autrice et son sujet. C'est dommage, car encore aujourd'hui la technique, l'ingénierie et les mathématiques restent des impensés de la littérature blanche, et les bons écrivains-ingénieurs sont rares. Pour de vraies réflexions sur la technique, il faut mieux se tourner vers Les Désarrois de l'élève Törless de Musil, ou bien le Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes de Pirsig.
Et pour finir, sachez qu'il n'y a aucune honte à avoir à apprendre un langage informatique, quelque soit votre âge!
critiques presse (4)
Avec la vélocité d'un geek sur son clavier, Nathalie Azoulai décrypte, enquête, réféchit. Dans ce roman cyborg, cérébral et étrangement sensuel, ses idées fusent, percutantes et fulgurantes.
Lire la critique sur le site : Bibliobs
Sa quête nous fait découvrir un monde à part. Tout cela manque de poésie, mais pas de mystère
Lire la critique sur le site : LeFigaro
Ce que l’IA fait à la littérature est le sujet principal de Python, de Nathalie Azoulai, qui met en scène une écrivaine d’une cinquantaine d’années, dont l’obsession est d’apprendre à coder. Dans son roman précédent, La Fille parfaite, elle confrontait déjà les sciences et les lettres à travers deux amies, l’une brillante mathématicienne et l’autre ne vivant que par les livres. D’un ouvrage à l’autre, elle plaide pour la conciliation des deux.
Lire la critique sur le site : LeMonde
Dans son nouveau livre, "Python", l'autrice française Nathalie Azoulai se met en scène en train d'apprendre avec des codeurs un langage de programmation. Plongée dans un monde où la langue ne se parle pas. L'occasion de tester ce que peut ChatGPT pour la littérature.
Lire la critique sur le site : LaLibreBelgique
Citations et extraits (20)
Voir plus
Ajouter une citation
Mais j’ai lâché Anna Karénine, je l’ai lu avidement jusqu’à la page 350 et je me suis arrêtée tout net. Je n’arrive pas à le reprendre, je ne peux plus lire que la moitié d’un roman épais. J’entends souvent que les gens n’ont plus le temps pour ça mais si on fait le calcul, ils passent des heures devant des séries, à commencer par moi qui cède à ce loisir paresseux. C’est une question de cerveau, pas de temps, et de motivation, comme si l’idée que les romans ne disent plus le monde s’installait dans nos esprits. C’est une malédiction car le désir d’écrire, lui, ne disparaît pas et augmente même avec l’espérance de vie (après la retraite, les gens ont du temps pour ça). Mais la littérature, elle, a peut-être l’avenir d’un artisanat très rare comme la glyptique ou la plumasserie, bonne à ne plus fournir qu’une clientèle triée sur e volet. Si au moins elle avait le savoir-faire des luthiers, indémodable, indispensable et modeste, mais non, même pas.
– Python, ajoute-t-elle, s’écrit très rapidement, c’est un atout. En revanche, il s’exécute un peu moins vite que d’autres langages. Il faut toujours arbitrer entre le temps d’écriture et le temps d’exécution.
Cette idée d’exécution me plonge dans des abîmes de réflexion. Qu’un signe produise autre chose que du sens, je n’en reviens toujours pas, même si évidemment je pense aux notes d’une partition qu’on exécute. Et la langue courante ? Et si la littérature s’exécutait, que se passerait-il ? Tous les livres prendraient vie, nous deviendrions les personnages, leurs histoires contamineraient nos existences. La poésie s’exécuterait plus vite que la peinture. La Terre serait instantanément bleue comme une orange. La question du temps m’épate, le code court après la vitesse, pour qu’entre le signe et ce qu’il produit, l’intervalle se réduise, disparaisse, n’existe pas, running code, disent les Anglo-Saxons.
Cette idée d’exécution me plonge dans des abîmes de réflexion. Qu’un signe produise autre chose que du sens, je n’en reviens toujours pas, même si évidemment je pense aux notes d’une partition qu’on exécute. Et la langue courante ? Et si la littérature s’exécutait, que se passerait-il ? Tous les livres prendraient vie, nous deviendrions les personnages, leurs histoires contamineraient nos existences. La poésie s’exécuterait plus vite que la peinture. La Terre serait instantanément bleue comme une orange. La question du temps m’épate, le code court après la vitesse, pour qu’entre le signe et ce qu’il produit, l’intervalle se réduise, disparaisse, n’existe pas, running code, disent les Anglo-Saxons.
Je recommence à lire des blogs [sur le code]. La plupart sont écrits dans un mauvais français, bourrés de fautes, de t et de s mal placés. On peut soutenir une activité cérébrale intense et être illettré. Évidemment, mais au lieu de le déplorer, j’y vois une sorte d’état de fait, comme si les codeurs avaient admis que le langage humain était devenu secondaire. Ils ne font même pas semblant, n’accordent plus rien convenablement, laissent la langue partir à vau-l’eau tandis que l’autre langue, celle qu’ils pratiquent, elle, ne souffre aucune entorse, aucune inexactitude, pas la moindre petite virgule mal placée. Et ça ne dérange personne, même pas moi à vrai dire. Nos deux illettrismes se regardent en chiens de faïence.
En pleine Seconde Guerre mondiale, Grace Hopper est la première à dire qu'elle code quand elle donne des instructions à une machine. Jeune, elle a l'air d'une actrice hollywoodienne....
..... Grace entre dans l'armée. Elle définit le codage comme une suite d'ordres précis enregistrée dans une mémoire, elle ne parle pas encore de langage, mais en 1955 le concept de traduction émerge. Les machines se multiplient et il faut trouver un langage commun à toutes, universel. A cet époque-là, l'ordinateur n'a pas encore de visage puisqu'il n'a pas d'écran. C'est plutôt une sorte de grand tableau de bord. Il n'y a pas de reflet, l'hypnose n'a pas encore commencé et le codeur n'est pas né. Le verbe coder s'efface durant vingt ans et on dit programmer.
Dans les années quatre-vingt, coder revient, vif, compact. Certains le déplorent, le trouvent trop obscur, légèrement occulte. Pas le jeune homme qui, lui, aime bien ce verbe. Il ne sort plus de sa chambre, y passe des nuits blanches. Il pianote durant des heures sans parler, rivé, vissé. Son corps se réduit à ses yeux, à ses mains. Son visage se reflète dans l'écran. Les femmes, elles, ont quasiment disparu du champ, on reste entre hommes.
..... Grace entre dans l'armée. Elle définit le codage comme une suite d'ordres précis enregistrée dans une mémoire, elle ne parle pas encore de langage, mais en 1955 le concept de traduction émerge. Les machines se multiplient et il faut trouver un langage commun à toutes, universel. A cet époque-là, l'ordinateur n'a pas encore de visage puisqu'il n'a pas d'écran. C'est plutôt une sorte de grand tableau de bord. Il n'y a pas de reflet, l'hypnose n'a pas encore commencé et le codeur n'est pas né. Le verbe coder s'efface durant vingt ans et on dit programmer.
Dans les années quatre-vingt, coder revient, vif, compact. Certains le déplorent, le trouvent trop obscur, légèrement occulte. Pas le jeune homme qui, lui, aime bien ce verbe. Il ne sort plus de sa chambre, y passe des nuits blanches. Il pianote durant des heures sans parler, rivé, vissé. Son corps se réduit à ses yeux, à ses mains. Son visage se reflète dans l'écran. Les femmes, elles, ont quasiment disparu du champ, on reste entre hommes.
Big Data est une masse volumineuse et véloce. Si elle se composait de livres, elle napperait tout le territoire américain et grimperait sur cinquante-deux étages. Si elle se composait de CD, on en verrait cinq colonnes monter jusqu’à la Lune. Certains parlent du déluge de données face auquel il faut dresser une arche, au moins le savoir-faire d’un Noé ou d’un Thésée pour frayer son chemin, contrer cette manne, qu’elle ne nous engloutisse pas, ne devienne pas notre châtiment suprême.
Videos de Nathalie Azoulai (47)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Nathalie Azoulai (22)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (2 - littérature francophone )
Françoise Sagan : "Le miroir ***"
brisé
fendu
égaré
perdu
20 questions
3704 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, littérature francophoneCréer un quiz sur ce livre3704 lecteurs ont répondu