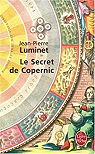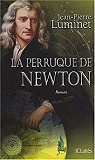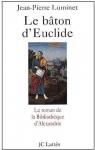Critiques de Jean-Pierre Luminet (147)
Depuis de nombreuses années, Jean-Pierre Luminet s'interroge sur la topologie de l'Univers. Dans cet essai, il synthétise le fruit de ses réflexions : l'Univers est-il plat ou courbe ? Est-il ouvert ou fermé ? Fini ou infini ? Relatif ou absolu ? Ressemble-t-il plus à un Mollusque universel qu'à une Fougasse hyperbolique (sic) ? Si vous souhaitez connaître ce qui se cache derrière ces lancinantes questions, ce livre est fait pour vous.
Mais attention, Luminet, astrophysicien de renommée internationale, spécialiste des trous noirs et de la topologie cosmique, est aussi à ses heures perdues un poète et un écrivain. Et un Luminet mal luné peut ruminer des idées lumineuses (désolé, je n'ai pas pu résister). Par exemple, Luminet adapte ici le contenant au contenu : il structure son texte de manière à permettre plusieurs itinéraires de lecture possibles, en proposant des raccourcis, bifurcations, croisements, sorties et entrées multiples… Un livre « dont vous êtes le héros » à la structure labyrinthique, comme pour faire comprendre au lecteur le sens du mot « chiffonné » qui figure dans le titre (les mathématiciens préfèreront parler d'espace topologique non simplement connexe, mais c'est la même chose).
Pour ne pas me perdre en route, j'ai joué la prudence et choisi de ne pas suivre les nombreux renvois et allers-retours proposés en adoptant une lecture bêtement séquentielle. Déjà, pour comprendre le concept d'Univers chiffonné, mieux vaut ne pas perdre le sens de l'orientation, et il est préférable d'affronter les idées de Luminet de face, plutôt que de profil, ou encore selon l'angle défini par la structure à base de dodécaèdres rhombiques découverte par Hantzsche et Wendt en 1935, qui est la sixième forme d'hypertore orientable dans un espace euclidien multiconnexe fini à trois dimensions (je mets ça pour l'exemple, mais le livre est truffé de trucs de ce genre). Luminet explore toutes les topologies possibles (et leurs conséquences) qui permettraient de décrire la structure de l'Univers, et, je ne vous le cache pas, sa préférence esthétique va plutôt vers l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré, prosaïquement dit « Univers en ballon de football » qui illustre magnifiquement la couverture du présent essai paru chez folio, ainsi que celle d'un numéro de la prestigieuse revue Nature publié en 2003 (faisant la fierté de l'auteur).
Cet essai véritablement très complet aborde dans ses nombreux et tortueux méandres des sujets très variés et il est bien entendu difficile de les citer tous ici, en voici néanmoins quelques-uns : les géométries non euclidiennes, l'âge, la dimension et la structure, finie ou non, fermée ou non, courbée ou non, de l'Univers, les différents modèles du big-bang, les dessins géométriques de Mauritz Cornélius Escher, les observations provenant des satellites COBE et WMAP, les mirages gravitationnels prévus par Einstein, le problème des sept ponts de Königsberg, la détection de la matière sombre et de l'énergie noire, les multivers, le paradoxe de la nuit noire, et, aussi, ce qui va suivre, je garde le meilleur pour la fin.
J'avais lu cet essai cet été, et au moment de rédiger cette chronique, j'ai parcouru rapidement les pages, schémas et illustrations afin de me remémorer son contenu. Et… surprise ! Je découvre aujourd'hui que cet ouvrage scientifique un peu ardu m'avait fourni en avant-première certaines des clés permettant de comprendre le film Interstellar de Christopher Nolan, sorti sur nos écrans en novembre 2014 !
En voici trois exemples :
1. le trou de ver : Bien entendu, d'autres auteurs, tels que Stephen Hawking, abordent la géométrie du trou de ver dans leurs ouvrages. Comme Hawking, Luminet théorise les trous de ver et les possibilités de voyager à des distances colossales en empruntant ces raccourcis de l'espace-temps. Prudent, il parle de théorie spéculative et de science-fiction, mais illustre néanmoins son propos par un joli schéma (page 60), plus convaincant que le stylo trouant une feuille de papier dans le film.
2. le trou noir : L'image simulée par ordinateur d'un trou noir, élaborée par Jean-Pierre Luminet (figures 5a et 5b de l'encart couleur), a été vue partout pour expliquer pourquoi un trou noir devrait ressembler à ce que l'on peut voir dans le film : une image déformée et redressée verticalement du disque d'accrétion entourant le trou noir Gargantua, en raison de la forte gravité, qui rend visibles les faces « cachées » du disque.
3. le tesseract : L'hypercube est au cube ce que le cube est au carré. La multiplication des images dans cet hypertore parallélépipédique, expliquée et superbement illustrée (page 118), rappelle furieusement le tesseract du film Interstellar. le temps joue dans le film le rôle de la quatrième dimension de l'hypercube quadridimensionnel, encore appellé tesseract.
Tout ceci est très plaisant et extrêmement jouissif, mais j'ajouterai néanmoins un petit bémol. L'édition « revue et augmentée » de cet essai date de 2005. Jean-Pierre Luminet semble appeler de ses voeux la confirmation de sa théorie d'un Univers en forme d'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré par l'analyse des données de WMAP. Or, aujourd'hui, la mission du satellite Planck lancé en mai 2009 a permis d'affiner en 2013 les résultats de WMAP et de COBE et je n'ai pas entendu parler à ce jour d'une quelconque confirmation de ce genre, bien au contraire, la « platitude » de l'Univers aurait été confirmée avec une valeur incompatible(*) avec le modèle proposé (-0,0029 < 1-Ω < +0,0008). Chiffonnant, non ?
(*) Dans son livre L'Univers chiffonné, Jean-Pierre Luminet aurait aimé trouver une valeur du paramètre de densité de l'Univers Oméga = 1,013 (page 452), donc une courbure spatiale positive de 0,013. Il annonce "une valeur de inférieure à 1,01 éliminerait l'espace de Poincaré comme modèle physique". Or, la densité maximale mesurée Ωmax = 1,0029 reste largement inférieure à 1,013 ce qui invalide son hypothèse.
Mais attention, Luminet, astrophysicien de renommée internationale, spécialiste des trous noirs et de la topologie cosmique, est aussi à ses heures perdues un poète et un écrivain. Et un Luminet mal luné peut ruminer des idées lumineuses (désolé, je n'ai pas pu résister). Par exemple, Luminet adapte ici le contenant au contenu : il structure son texte de manière à permettre plusieurs itinéraires de lecture possibles, en proposant des raccourcis, bifurcations, croisements, sorties et entrées multiples… Un livre « dont vous êtes le héros » à la structure labyrinthique, comme pour faire comprendre au lecteur le sens du mot « chiffonné » qui figure dans le titre (les mathématiciens préfèreront parler d'espace topologique non simplement connexe, mais c'est la même chose).
Pour ne pas me perdre en route, j'ai joué la prudence et choisi de ne pas suivre les nombreux renvois et allers-retours proposés en adoptant une lecture bêtement séquentielle. Déjà, pour comprendre le concept d'Univers chiffonné, mieux vaut ne pas perdre le sens de l'orientation, et il est préférable d'affronter les idées de Luminet de face, plutôt que de profil, ou encore selon l'angle défini par la structure à base de dodécaèdres rhombiques découverte par Hantzsche et Wendt en 1935, qui est la sixième forme d'hypertore orientable dans un espace euclidien multiconnexe fini à trois dimensions (je mets ça pour l'exemple, mais le livre est truffé de trucs de ce genre). Luminet explore toutes les topologies possibles (et leurs conséquences) qui permettraient de décrire la structure de l'Univers, et, je ne vous le cache pas, sa préférence esthétique va plutôt vers l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré, prosaïquement dit « Univers en ballon de football » qui illustre magnifiquement la couverture du présent essai paru chez folio, ainsi que celle d'un numéro de la prestigieuse revue Nature publié en 2003 (faisant la fierté de l'auteur).
Cet essai véritablement très complet aborde dans ses nombreux et tortueux méandres des sujets très variés et il est bien entendu difficile de les citer tous ici, en voici néanmoins quelques-uns : les géométries non euclidiennes, l'âge, la dimension et la structure, finie ou non, fermée ou non, courbée ou non, de l'Univers, les différents modèles du big-bang, les dessins géométriques de Mauritz Cornélius Escher, les observations provenant des satellites COBE et WMAP, les mirages gravitationnels prévus par Einstein, le problème des sept ponts de Königsberg, la détection de la matière sombre et de l'énergie noire, les multivers, le paradoxe de la nuit noire, et, aussi, ce qui va suivre, je garde le meilleur pour la fin.
J'avais lu cet essai cet été, et au moment de rédiger cette chronique, j'ai parcouru rapidement les pages, schémas et illustrations afin de me remémorer son contenu. Et… surprise ! Je découvre aujourd'hui que cet ouvrage scientifique un peu ardu m'avait fourni en avant-première certaines des clés permettant de comprendre le film Interstellar de Christopher Nolan, sorti sur nos écrans en novembre 2014 !
En voici trois exemples :
1. le trou de ver : Bien entendu, d'autres auteurs, tels que Stephen Hawking, abordent la géométrie du trou de ver dans leurs ouvrages. Comme Hawking, Luminet théorise les trous de ver et les possibilités de voyager à des distances colossales en empruntant ces raccourcis de l'espace-temps. Prudent, il parle de théorie spéculative et de science-fiction, mais illustre néanmoins son propos par un joli schéma (page 60), plus convaincant que le stylo trouant une feuille de papier dans le film.
2. le trou noir : L'image simulée par ordinateur d'un trou noir, élaborée par Jean-Pierre Luminet (figures 5a et 5b de l'encart couleur), a été vue partout pour expliquer pourquoi un trou noir devrait ressembler à ce que l'on peut voir dans le film : une image déformée et redressée verticalement du disque d'accrétion entourant le trou noir Gargantua, en raison de la forte gravité, qui rend visibles les faces « cachées » du disque.
3. le tesseract : L'hypercube est au cube ce que le cube est au carré. La multiplication des images dans cet hypertore parallélépipédique, expliquée et superbement illustrée (page 118), rappelle furieusement le tesseract du film Interstellar. le temps joue dans le film le rôle de la quatrième dimension de l'hypercube quadridimensionnel, encore appellé tesseract.
Tout ceci est très plaisant et extrêmement jouissif, mais j'ajouterai néanmoins un petit bémol. L'édition « revue et augmentée » de cet essai date de 2005. Jean-Pierre Luminet semble appeler de ses voeux la confirmation de sa théorie d'un Univers en forme d'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré par l'analyse des données de WMAP. Or, aujourd'hui, la mission du satellite Planck lancé en mai 2009 a permis d'affiner en 2013 les résultats de WMAP et de COBE et je n'ai pas entendu parler à ce jour d'une quelconque confirmation de ce genre, bien au contraire, la « platitude » de l'Univers aurait été confirmée avec une valeur incompatible(*) avec le modèle proposé (-0,0029 < 1-Ω < +0,0008). Chiffonnant, non ?
(*) Dans son livre L'Univers chiffonné, Jean-Pierre Luminet aurait aimé trouver une valeur du paramètre de densité de l'Univers Oméga = 1,013 (page 452), donc une courbure spatiale positive de 0,013. Il annonce "une valeur de inférieure à 1,01 éliminerait l'espace de Poincaré comme modèle physique". Or, la densité maximale mesurée Ωmax = 1,0029 reste largement inférieure à 1,013 ce qui invalide son hypothèse.
Passionnante biographie romancée nous présentant un Nicolas Copernic comme un homme bien né, se servant de l'appui et des relations de son oncle évêque pour l'aider à réussir dans sa vie. Il apparaît plus déluré et innovateur que son portrait tristounet laisserait supposer.
La vie des ecclésiastiques et nobles à cette époque est pleine de libertinages et notre Nicolas ne s'en prive pas.
La vie des ecclésiastiques et nobles à cette époque est pleine de libertinages et notre Nicolas ne s'en prive pas.
*****
« Mais quand donc ferai-je le ciel étoilé, ce tableau qui toujours me préoccupe ? »
Quel plaisir de retrouver dans le livre de Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, mon ami Vincent Van Gogh ! L’ouvrage mêlant art et science est une passionnante enquête de reconstitution et d’observation astronomique des magnifiques toiles de nuit de l’artiste.
Lorsque j’avais croisé Vincent à Auvers-sur-Oise, il m’avait conté les deux derniers mois de sa courte vie dans cette petite ville de la région parisienne. J’en avais fait une biographie romancée. Il revenait de 27 mois passés en Provence où sur les conseils de son ami Toulouse-Lautrec il était parti découvrir la lumière et les couleurs du Sud : longs mois de création intense et de souffrances intolérables qui l’avaient épuisé.
Vincent m’avait parlé d’une obsession qui le poursuivait depuis ses débuts en peinture : le crépuscule, les couleurs de la nuit activaient son imagination. Dans le Midi, ses plus grandes œuvres avaient été le fruit de sa fascination pour ce monde nocturne.
En septembre 1888, Vincent réalise une première toile de nuit étoilée servant de fond au portrait de son ami qu’il appelle « le poète » : « Le portrait d’Eugène Boch ». Il s’agit à ses yeux du plus beau portrait peint par l’artiste dont il écrit : « Je voudrais dire quelque chose de consolant comme une musique. Je voudrais peindre des hommes ou des femmes avec ce je-ne-sais quoi d’éternel ». Dans cette toile, Vincent cherche à évoquer le lien qu’il perçoit entre peinture, musique et poésie : « je fais un fond simple du bleu le plus riche, le plus intense, que je puisse confectionner, et par cette simple combinaison la tête blonde éclairée sur ce fond obtient un effet mystérieux comme l'étoile dans l'azur profond ».
Le même mois, Vincent s’installe un soir, en extérieur, devant la terrasse d’un café qu’il fréquente et peint « Terrasse du café le soir ». Les nuits étoilées de ce mois de septembre sont favorables à son projet : « Souvent il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour ». Le motif est illuminé par une grande lanterne de gaz jaune avec, dans un angle de maison, un coin de ciel bleu constellé d’étoiles.
Jean-Pierre Luminet, s’est installé au même endroit et cherche. Grâce à un logiciel de reconstitution astronomique, il parvient à vérifier, d’après les déclarations épistolaires de Vincent, son souci de représenter un ciel réel et non imaginaire.
Toujours au cours de ce mois de septembre 1888, Vincent passe la nuit assis devant son chevalet au bord du Rhône et peint un ciel plus ample dans « Nuit étoilée sur le Rhône : « La ville est bleue et violette, le gaz est jaune et ses reflets sont or roux et descendent jusqu’au bronze vert. Sur le champ bleu vert du ciel, la Grande Ourse a un scintillement vert et rose, dont la pâleur discrète contraste avec l’or brutal du gaz ».
Comme pour la « Terrasse du café », le scientifique arrive à reconstituer le ciel vu par Vincent dans cette nuit du 20 septembre 1888 et ainsi démontrer que le peintre peignait ses paysages de nuit dans la réalité du moment : la correspondance entre la position des étoiles du tableau et la reconstitution est assez stupéfiante.
Je vais m’attarder sur l’étude la plus intéressante de Jean-Pierre Luminet, celle du tableau de Vincent que le monde entier connait : la « Nuit étoilée » peinte de sa chambre à l’hospice Saint-Paul-de Mausole en 1889 où l’artiste est interné à sa demande. Il s’agit d’un paysage nocturne impressionnant, le tout éclairé par les étoiles, la lune, et un ciel astral tourbillonnant au-dessus d’une ville en miniature.
Je suis fasciné : la démonstration du scientifique pour ce tableau est éblouissante. Il dispose en 1995 du logiciel astronomique Voyager qui lui permet de découvrir la date de la seule nuit de ce printemps ou été 1889 présentant une configuration proche de celle peinte par Van Gogh : le 25 mai 1889 à 4h 40 heure locale. La superposition entre la toile et le vrai ciel est si frappante que le hasard est impossible.
L’auteur aurait pu en rester là et considérer son étude comme parfaitement satisfaisante. Mais il lui manquait quelques informations importantes. Il examine la correspondance du peintre et, surtout, visite le monastère de Saint-Paul-de-Mausole, lieu où Vincent voyait le paysage de sa chambre. La fenêtre à barreaux de fer est toujours orientée de la même façon, vers l’est, avec la vision tôt le matin du lever du Soleil et de Vénus. Vincent le dessine au réveil et le peindra plus tard. Jean-Pierre Luminet parvient à une conclusion surprenante : « La Nuit étoilée » de Vincent est composée d’éléments réels comme le positionnement des astres vus ce 25 mai au matin et de plusieurs composants qui sont imaginaires. Étonnant ! : le village du bas de la toile avec une église au clocher pointu ne serait pas le Saint-Rémy de l’époque mais une simple référence aux paysages de maîtres hollandais comme Van Ruysdael ou Van Goyen qu’appréciait Vincent. Par ailleurs, la volute astrale qui anime le ciel ne serait pas une nébuleuse spirale, élément astronomique que connaissait le peintre, mais plus probablement une représentation de nuages comme il est souvent observé dans plusieurs autres toiles peintes dans les mêmes mois de 1889 : « Champ de blé avec cyprès » et « Oliviers avec les Alpilles à l’arrière-plan ».
Une dernière observation d’une magnifique toile peinte le 20 avril 1890 « Route avec cyprès et ciel étoilé », peu avant le départ de Vincent pour Auvers, fournit à Jean-Pierre Luminet une confirmation de son approche précédente sur le travail du peintre : celui-ci faisait parfois, suivant les circonstances, des compositions d’atelier à partir de sa vision réelle du motif, puis s’en écartait avec des rajouts imaginaires quand son intuition artistique le lui indiquait, comme un contraste de couleurs ou le jaune domine après le bleu dans « Nuit étoilée ».
Ce livre superbement illustré devient exceptionnel lorsque, d’une étude scientifique sérieuse, il rapproche les formes et les couleurs pour les transformer en poésie :
« Van Gogh a fait un long voyage onirique vers les lumières du firmament et rendu leur beauté plus accessible. »
***
Lien : http://www.httpsilartetaitco..
« Mais quand donc ferai-je le ciel étoilé, ce tableau qui toujours me préoccupe ? »
Quel plaisir de retrouver dans le livre de Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, mon ami Vincent Van Gogh ! L’ouvrage mêlant art et science est une passionnante enquête de reconstitution et d’observation astronomique des magnifiques toiles de nuit de l’artiste.
Lorsque j’avais croisé Vincent à Auvers-sur-Oise, il m’avait conté les deux derniers mois de sa courte vie dans cette petite ville de la région parisienne. J’en avais fait une biographie romancée. Il revenait de 27 mois passés en Provence où sur les conseils de son ami Toulouse-Lautrec il était parti découvrir la lumière et les couleurs du Sud : longs mois de création intense et de souffrances intolérables qui l’avaient épuisé.
Vincent m’avait parlé d’une obsession qui le poursuivait depuis ses débuts en peinture : le crépuscule, les couleurs de la nuit activaient son imagination. Dans le Midi, ses plus grandes œuvres avaient été le fruit de sa fascination pour ce monde nocturne.
En septembre 1888, Vincent réalise une première toile de nuit étoilée servant de fond au portrait de son ami qu’il appelle « le poète » : « Le portrait d’Eugène Boch ». Il s’agit à ses yeux du plus beau portrait peint par l’artiste dont il écrit : « Je voudrais dire quelque chose de consolant comme une musique. Je voudrais peindre des hommes ou des femmes avec ce je-ne-sais quoi d’éternel ». Dans cette toile, Vincent cherche à évoquer le lien qu’il perçoit entre peinture, musique et poésie : « je fais un fond simple du bleu le plus riche, le plus intense, que je puisse confectionner, et par cette simple combinaison la tête blonde éclairée sur ce fond obtient un effet mystérieux comme l'étoile dans l'azur profond ».
Le même mois, Vincent s’installe un soir, en extérieur, devant la terrasse d’un café qu’il fréquente et peint « Terrasse du café le soir ». Les nuits étoilées de ce mois de septembre sont favorables à son projet : « Souvent il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour ». Le motif est illuminé par une grande lanterne de gaz jaune avec, dans un angle de maison, un coin de ciel bleu constellé d’étoiles.
Jean-Pierre Luminet, s’est installé au même endroit et cherche. Grâce à un logiciel de reconstitution astronomique, il parvient à vérifier, d’après les déclarations épistolaires de Vincent, son souci de représenter un ciel réel et non imaginaire.
Toujours au cours de ce mois de septembre 1888, Vincent passe la nuit assis devant son chevalet au bord du Rhône et peint un ciel plus ample dans « Nuit étoilée sur le Rhône : « La ville est bleue et violette, le gaz est jaune et ses reflets sont or roux et descendent jusqu’au bronze vert. Sur le champ bleu vert du ciel, la Grande Ourse a un scintillement vert et rose, dont la pâleur discrète contraste avec l’or brutal du gaz ».
Comme pour la « Terrasse du café », le scientifique arrive à reconstituer le ciel vu par Vincent dans cette nuit du 20 septembre 1888 et ainsi démontrer que le peintre peignait ses paysages de nuit dans la réalité du moment : la correspondance entre la position des étoiles du tableau et la reconstitution est assez stupéfiante.
Je vais m’attarder sur l’étude la plus intéressante de Jean-Pierre Luminet, celle du tableau de Vincent que le monde entier connait : la « Nuit étoilée » peinte de sa chambre à l’hospice Saint-Paul-de Mausole en 1889 où l’artiste est interné à sa demande. Il s’agit d’un paysage nocturne impressionnant, le tout éclairé par les étoiles, la lune, et un ciel astral tourbillonnant au-dessus d’une ville en miniature.
Je suis fasciné : la démonstration du scientifique pour ce tableau est éblouissante. Il dispose en 1995 du logiciel astronomique Voyager qui lui permet de découvrir la date de la seule nuit de ce printemps ou été 1889 présentant une configuration proche de celle peinte par Van Gogh : le 25 mai 1889 à 4h 40 heure locale. La superposition entre la toile et le vrai ciel est si frappante que le hasard est impossible.
L’auteur aurait pu en rester là et considérer son étude comme parfaitement satisfaisante. Mais il lui manquait quelques informations importantes. Il examine la correspondance du peintre et, surtout, visite le monastère de Saint-Paul-de-Mausole, lieu où Vincent voyait le paysage de sa chambre. La fenêtre à barreaux de fer est toujours orientée de la même façon, vers l’est, avec la vision tôt le matin du lever du Soleil et de Vénus. Vincent le dessine au réveil et le peindra plus tard. Jean-Pierre Luminet parvient à une conclusion surprenante : « La Nuit étoilée » de Vincent est composée d’éléments réels comme le positionnement des astres vus ce 25 mai au matin et de plusieurs composants qui sont imaginaires. Étonnant ! : le village du bas de la toile avec une église au clocher pointu ne serait pas le Saint-Rémy de l’époque mais une simple référence aux paysages de maîtres hollandais comme Van Ruysdael ou Van Goyen qu’appréciait Vincent. Par ailleurs, la volute astrale qui anime le ciel ne serait pas une nébuleuse spirale, élément astronomique que connaissait le peintre, mais plus probablement une représentation de nuages comme il est souvent observé dans plusieurs autres toiles peintes dans les mêmes mois de 1889 : « Champ de blé avec cyprès » et « Oliviers avec les Alpilles à l’arrière-plan ».
Une dernière observation d’une magnifique toile peinte le 20 avril 1890 « Route avec cyprès et ciel étoilé », peu avant le départ de Vincent pour Auvers, fournit à Jean-Pierre Luminet une confirmation de son approche précédente sur le travail du peintre : celui-ci faisait parfois, suivant les circonstances, des compositions d’atelier à partir de sa vision réelle du motif, puis s’en écartait avec des rajouts imaginaires quand son intuition artistique le lui indiquait, comme un contraste de couleurs ou le jaune domine après le bleu dans « Nuit étoilée ».
Ce livre superbement illustré devient exceptionnel lorsque, d’une étude scientifique sérieuse, il rapproche les formes et les couleurs pour les transformer en poésie :
« Van Gogh a fait un long voyage onirique vers les lumières du firmament et rendu leur beauté plus accessible. »
***
Lien : http://www.httpsilartetaitco..
Renouons avec notre part cosmique ! Scientifique amateur d'arts J. P. Luminet partage avec Van Gogh la connaissance des étoiles. Il fait partie d'un cercle restreint d'experts transdisciplinaires dont le « pedigree » donne envie d'ouvrir son dernier livre en se disant que le mot « enquête » est loin d'épuiser les différents niveaux de lecture qu'il offre. Au regard de l'esthétique de sa forme vous avez entre les mains un livre d'art (maniable et peu volumineux) dont la composition épouse complètement le propos et où l'iconographie vient souligner tous les vertiges interrogatifs rapprochant l'astrophysicien et le peintre auquel Luminet s'intéresse depuis longtemps. Juxtapositions somptueuses d'images cosmiques presque oniriques, dessins, croquis ou motifs et visions de peinture, illustrent comment chacun a pu scruter l'immensité astrale à sa manière avec ses propres outils à des années de distance. Un livre qui par sa beauté formelle et son approche me renvoie à la lecture précédente d'un catalogue d'exposition très riche "Peindre la nuit" (Pompidou/Metz, 2018). Il faut aller découvrir les subtiles variations de ce parcours très personnel auprès de van Gogh. La dizaine d'oeuvres présentées ici donne une large place aux plus belles nuits étoilées de van Gogh. Toutes peintes entre février 1888 et mai 1890, entre lucidité et « crises de folie » (dont l'épisode arlésien du morceau d'oreille tranché que Gauguin témoin et partie relatera beaucoup plus tard), apparaissant dans un parcours splendide fait pour questionner conçu et ordonné à partir du « Portrait d'Eugène Boch » sur fond outremer étoilé (réalisé à Arles), jusqu'à la dernière scène nocturne : « La Maison blanche, la nuit » (peinte à Auvers-sur-Oise peu avant son suicide en juillet 1890).
J. P. Luminet raconte le compagnonnage fructueux engagé avec Vincent il y a trente ans, à travers un texte sobre dont on perçoit immédiatement la portée biographique et artistique concernant le peintre, moins peut-être la démarche d'exigence scientifique, et de retour sur soi-même peut-être touchant l'auteur (?), qui me semble l'habiter circulant à plus bas bruit, devinés en sous-texte dans ce livre/synthèse. Comme la quête d'un dialogue renouvelé avec l'artiste. A la racine un besoin clairement énoncé au lecteur d'approfondir ses recherches en 2016 après avoir quitté l'Observatoire de Meudon et rejoint la Provence dont il est natif, puis accédé à la correspondance complète de van Gogh dont l'intégralité était mise en ligne en 2018. Un livre aussi, celui de son ami psychiatre Philippe André, lui ouvrait quelques perspectives différentes, poétiques, métaphysiques même mystiques, sur un artiste génial dont la puissance créatrice ne fut, semble-t-il, jamais entamée par la détérioration de son état psychique, contrairement à bien des idées reçues sur Van Gogh (« Moi, Vincent van Gogh artiste peintre », P. André, le Passeur 2018). Longue histoire initiée en 1995 par la redécouverte de l'analyse du chercheur américain A. Boime à propos de la plus belle sinon la plus mystérieuse oeuvre de van Gogh, "Nuit étoilée de Saint-Rémy" (1889), montrant qu'il y avait concordance, (qui n'était que partielle ainsi que l'explique l'auteur), entre ses reconstitutions astronomiques en date d'exécution de l'oeuvre et la représentation du ciel rendue à ce moment là par le peintre.
Bon nombre de scientifiques déduisirent de ce réalisme d'exécution de van Gogh (dans le positionnement des astres précise l'auteur) une passion avérée pour l'astronomie (popularisée grâce à la diffusion des ouvrages de C. Flammarion) qui pouvait même tenter certains de prétendre dater les oeuvres à partir de reconstitutions astronomiques. Luminet avouant lui même avoir été séduit par la démonstration restait pourtant prudent. D'autres, historiens d'art en particulier, mettaient toujours en avant l'imagination et l'altération de son état mental pour interpréter les fantasmagories étoilées de van Gogh dans la nuit de Saint Rémy ; sont épinglés à ce propos l'exposition et le catalogue « Van Gogh, les couleurs de la nuit », Amsterdam 2008/Actes Sud 2009. Dater chose hasardeuse, calculer très bien. Quelques surprises révélées à ce sujet attendent le lecteur... Si van Gogh réitère au fil de ses lettres son désir de "peindre d'après nature une nuit étoilée", cela signifie-t-il qu'il reste absolument fidèle à ce qu'il voit ou qu'il ait le goût de l'astronomie ? Dans une lettre à Théo il écrit (septembre 1888) :
"J'ai un besoin terrible – dirai-je le mot – de religion, alors je vais la nuit dehors pour peindre les étoiles.”
Voilà donc J. P. Luminet loin de la grande lunette de Meudon, calculs et datations repris, explorant autrement, "sur le terrain", les nuits provençales de van Gogh, et retraçant leur genèse à l'aune de ses écrits, abondamment cités, interrogeant les défis plastiques que l'artiste rêvait de surmonter durant les deux dernières années de sa courte vie à Arles et Saint-Rémy-de-Provence et mettant ses pas dans les siens. Devant le café "La Terrasse" à Arles, rebaptisé "Café van Gogh", dont la représentation fait tout juste apparaître une portion de ciel étoilé, comme une tentative initiale ; sur les berges du Rhône y cherchant la Grande Ourse de la première grande nuit peinte "Nuit étoilée, Arles" (1888) ; à Saint-Rémy scrutant la vue au-delà des barreaux de la chambre reconstituée dans la dernière résidence de l'asile Saint-Paul-de-Mausole (où Luminet fait mentir ceux qui prétendent qu'on puisse de là aperçevoir le village représenté dans la nuit de Saint-Rémy) ; admirant le motif du cyprès et replaçant « l'étoile du matin » où il faut ; s'intéressant aux collines et reliefs dans les paysages terrestres associés aux scènes nocturnes. "Ainsi je me plais souvent à imaginer Vincent parcourant la campagne provençale aux heures magiques de l'aube ou du crépuscule, entre chien et loup, chevalet sur le dos, la tête emplie de tourbillons célestes." (p. 147). de Meudon en Provence ce nouveau dialogue entre la science et l'art reste aussi et surtout un voyage entre terre et ciel à faire longuement rêver.
J. P. Luminet raconte le compagnonnage fructueux engagé avec Vincent il y a trente ans, à travers un texte sobre dont on perçoit immédiatement la portée biographique et artistique concernant le peintre, moins peut-être la démarche d'exigence scientifique, et de retour sur soi-même peut-être touchant l'auteur (?), qui me semble l'habiter circulant à plus bas bruit, devinés en sous-texte dans ce livre/synthèse. Comme la quête d'un dialogue renouvelé avec l'artiste. A la racine un besoin clairement énoncé au lecteur d'approfondir ses recherches en 2016 après avoir quitté l'Observatoire de Meudon et rejoint la Provence dont il est natif, puis accédé à la correspondance complète de van Gogh dont l'intégralité était mise en ligne en 2018. Un livre aussi, celui de son ami psychiatre Philippe André, lui ouvrait quelques perspectives différentes, poétiques, métaphysiques même mystiques, sur un artiste génial dont la puissance créatrice ne fut, semble-t-il, jamais entamée par la détérioration de son état psychique, contrairement à bien des idées reçues sur Van Gogh (« Moi, Vincent van Gogh artiste peintre », P. André, le Passeur 2018). Longue histoire initiée en 1995 par la redécouverte de l'analyse du chercheur américain A. Boime à propos de la plus belle sinon la plus mystérieuse oeuvre de van Gogh, "Nuit étoilée de Saint-Rémy" (1889), montrant qu'il y avait concordance, (qui n'était que partielle ainsi que l'explique l'auteur), entre ses reconstitutions astronomiques en date d'exécution de l'oeuvre et la représentation du ciel rendue à ce moment là par le peintre.
Bon nombre de scientifiques déduisirent de ce réalisme d'exécution de van Gogh (dans le positionnement des astres précise l'auteur) une passion avérée pour l'astronomie (popularisée grâce à la diffusion des ouvrages de C. Flammarion) qui pouvait même tenter certains de prétendre dater les oeuvres à partir de reconstitutions astronomiques. Luminet avouant lui même avoir été séduit par la démonstration restait pourtant prudent. D'autres, historiens d'art en particulier, mettaient toujours en avant l'imagination et l'altération de son état mental pour interpréter les fantasmagories étoilées de van Gogh dans la nuit de Saint Rémy ; sont épinglés à ce propos l'exposition et le catalogue « Van Gogh, les couleurs de la nuit », Amsterdam 2008/Actes Sud 2009. Dater chose hasardeuse, calculer très bien. Quelques surprises révélées à ce sujet attendent le lecteur... Si van Gogh réitère au fil de ses lettres son désir de "peindre d'après nature une nuit étoilée", cela signifie-t-il qu'il reste absolument fidèle à ce qu'il voit ou qu'il ait le goût de l'astronomie ? Dans une lettre à Théo il écrit (septembre 1888) :
"J'ai un besoin terrible – dirai-je le mot – de religion, alors je vais la nuit dehors pour peindre les étoiles.”
Voilà donc J. P. Luminet loin de la grande lunette de Meudon, calculs et datations repris, explorant autrement, "sur le terrain", les nuits provençales de van Gogh, et retraçant leur genèse à l'aune de ses écrits, abondamment cités, interrogeant les défis plastiques que l'artiste rêvait de surmonter durant les deux dernières années de sa courte vie à Arles et Saint-Rémy-de-Provence et mettant ses pas dans les siens. Devant le café "La Terrasse" à Arles, rebaptisé "Café van Gogh", dont la représentation fait tout juste apparaître une portion de ciel étoilé, comme une tentative initiale ; sur les berges du Rhône y cherchant la Grande Ourse de la première grande nuit peinte "Nuit étoilée, Arles" (1888) ; à Saint-Rémy scrutant la vue au-delà des barreaux de la chambre reconstituée dans la dernière résidence de l'asile Saint-Paul-de-Mausole (où Luminet fait mentir ceux qui prétendent qu'on puisse de là aperçevoir le village représenté dans la nuit de Saint-Rémy) ; admirant le motif du cyprès et replaçant « l'étoile du matin » où il faut ; s'intéressant aux collines et reliefs dans les paysages terrestres associés aux scènes nocturnes. "Ainsi je me plais souvent à imaginer Vincent parcourant la campagne provençale aux heures magiques de l'aube ou du crépuscule, entre chien et loup, chevalet sur le dos, la tête emplie de tourbillons célestes." (p. 147). de Meudon en Provence ce nouveau dialogue entre la science et l'art reste aussi et surtout un voyage entre terre et ciel à faire longuement rêver.
Premier d’une trilogie que Jean Pierre Luminet a appelée Les bâtisseurs du ciel. Il est suivi par “Kepler, la discorde céleste” et “Newton, le dernier des alchimistes”.
C’est donc une biographie romancée de Copernic, dont la vie est assez mal connue. Censée être écrite par Michael Maestlin, astronome allemand né 7 ans après la mort de Copernic et destiné à un autre astronome qui lui aussi révolutionnera cette science.
En cette fin de 15e, début 16e le ciel est régi par le système de Ptolémée, savant égyptien qui vécut à la fin du premier siècle - début du second et qui place la Terre au centre de l’univers, immobile tandis que les autres planètes tournent autour d’elle sur un fond d'étoiles fixes. Cette vision correspond à l’Écriture Sainte, et fait de la Terre et donc des humains le chef d’œuvre de la création. D’autres avant lui ont eu l’intuition de l'héliocentrisme, mais soit leurs écrits se sont perdu, soit ils ont préféré se taire, les dogmatiques ne sont tendres en aucune période où société.
Ce roman riche en personnages permet de remettre en perspective des hommes appartenant à des domaines différents, tels Albrecht Dürer ou Machiavel.
Copernic devient sous la plume de l’auteur un homme vivant avec ses défauts et ses contradictions. Dans une postface Luminet explique ce qui relève de l'Histoire et ce qui relève de son imagination.
Cette biographie imprégnée de l'Italie et de ses génies est très agréable à lire et abordable par tous, esprits scientifiques ou non. En revanche je ne vois pas le pourquoi du titre. S’il n’a pas vraiment divulgué ses découvertes, il n’en a pas fait non plus un secret.
Ce livre nous raconte la vie de Nicolas Copernic depuis sa plus tendre enfance. L'érudition règne et le style est soigné.
Cet ouvrage va séduire les amateurs d'histoire et de sciences.
Le seul petit bémol c'est que peut-être le rythme est un peu lent mais dans l'ensemble ça se lit bien.
Cet ouvrage va séduire les amateurs d'histoire et de sciences.
Le seul petit bémol c'est que peut-être le rythme est un peu lent mais dans l'ensemble ça se lit bien.
Moi qui, "trottinant sur le bas-côté du grand chemin de l'Histoire", ne sais que consommer et ne rien produire, qui soit utile à l'humanité j'entends, dois-je jalouser l'astronome danois Tycho Brahé qui formulait en ces termes son voeu le plus cher : "Ne frustra vixisse videar", que je ne semble avoir vécu en vain.
Avant que de lire cet ouvrage de Jean-Pierre Luminet, L'oeil de Galilée, par quelques nuits claires, les yeux dirigés vers les étoiles, j'avais déjà eu l'occasion de méditer sur la profondeur de l'univers. Mais que savons aujourd'hui de plus que Brahé, Kepler son disciple, Galilée, et autres astronome, mathématicien, physicien de ce fabuleux siècle de la Renaissance, sur le mystère de l'infini. Certes nos yeux se sont portés plus loin dans les galaxies, ont découvert planètes, comètes et autres trous noirs, mesuré des distances en années lumières, émis des hypothèses sur la formation de l'univers, le Big bang. Nos congénères ont même fait une incursion sur la boule d'ivoire qui illuminait les nuits de Copernic. "Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité". Mais plus que Brahé, Kepler et Galilée, sommes-nous capables de nous situer entre les deux infinis, le grand et le petit ? Ce mot qui justement échappe à notre entendement. Parce que dans ce mot, in-fi-ni, réside tout le mystère de la vie. Kepler le ressentait bien comme tel, même si, scrutant le ciel avec ce télescope rudimentaire qui vaut à cet ouvrage son titre, il lui fixait des bornes à cet univers.
Aussi qu'importe géocentrisme ou héliocentrisme dont il est beaucoup question ici. Qu'importe si c'est la terre qui est au centre de l'univers, concept cher à Aristote, Ptolémée et consorts, auquel s'accrochaient les "théologiens s'occupant d'autre chose que de foi", dans leur grande intolérance aveugle, ou si c'est le soleil qui est au centre de l'univers, contradiction défendue par Copernic puis Galilée. Ce dernier étant obligé de se déjuger au risque de condamnation pour hérésie, bougonnant dans sa barbe cette réflexion certainement apocryphe : "E pur si muove !" Et pourtant, elle tourne, en parlant de notre planète autour du soleil.
Qu'importe ce que l'on désigne comme le centre de l'univers, puisqu'entre les deux infinis, bien malin qui peut situer un centre. Car c'est là, c'est à dire partout et nulle part, que réside la réponse à la question, la seule, la vraie : pourquoi la vie ? Pourquoi nous sur terre, perdus au milieu de nulle part ? Pourquoi une vie bornée par une naissance et une mort dans un univers qui lui n'en connaît point de bornes ?
Que de questions sans réponse ! Abandonnant la métaphysique pour verser dans le concret, Kepler se les posait déjà. S'imposeront-elles à moi ces réponses quand mon coeur aura cessé d'irriguer cet organe insensé qui transforme un processus chimique en pensées ? Et Dieu sait s'il a bien fonctionné dans le crâne de Kepler ce cerveau, entre 1571 et 1630, pour lui faire écrire autant de théories qui dans sa postérité trouveront leur preuve. Sauf bien sûr la finitude de l'univers.
Il est vrai que lorsqu'on touche aux étoiles, on avance de quelques millimètres vers l'infini. C'est pour cela que l'expression que je trouve la plus seyante pour désigner cette belle science qu'est l'astronomie, c'est bien celle qui qualifiait alors l'astronomie de "philosophie naturelle". Toute hypothèse sur la conformation de l'univers ne sera jamais en fait, aussi loin que se portera notre regard, que vue de l'esprit sujette à réflexion, discussion, rêverie peut-être, et surtout contradiction. Et si un jour un esprit supérieur équipé d'yeux de lynx trouvait des bornes à notre univers, un début et une fin avec comme un grand mur, je serai le premier à l'approuver. C'est vrai ce que tu dis, mais dis-moi, au fait, derrière ce mur, il y a quoi ?
Utilisant le procédé narratif d'un témoin fictif de faits pourtant bien réels, pour autant que leurs colporteurs ne les aient pas trahis au fil du temps, cet ouvrage de Jean-Pierre Luminet a pu en dérouter plus d'un. Il est vrai qu'il y a de quoi se noyer dans les atermoiements des scientifiques de la Renaissance émis entre les menaces des papistes et leur envie de faire éclater le fruit de leurs cogitations illuminées, de mettre à jour l'exactitude, chère à Marguerite Yourcenar, qui seule appartient à la Nature, a contrario de la vérité qui existe en autant de versions qu'il y a de bouches pour la prononcer. Il n'en reste pas moins que Jean-Pierre Luminet a su retirer à ses écrits le côté abscons dont le sujet aurait pu remplir les pages.
La vie de cet homme de science, Kepler et non Galilée comme le titre de cet ouvrage le laisse à penser, m'a passionnée. Je reste subjugué par la production d'autant de théories avec aussi peu de moyens d'observation, et surtout dans un climat aussi tourmenté par la folie des hommes en ce siècle où la religion catholique n'admettait pas la contradiction.
Alors héliocentrisme ou géocentrisme quelle importance dans un univers où nul ne pourra jamais situer de centre. Et pourquoi ne serais-je finalement pas, moi, en entorse à ma réserve naturelle, le centre de l'univers ? Engendré par le grand orgueil du tempérament humain, l'égocentrisme n'est-il pas la seule constante à réunir les générations.
Johann Kepler, astronome ou astrologue ? Les deux mon général ! Il fallait bien flatter les faibles d'esprit quand ils se trouvaient avoir un peu d'influence, et les rassurer quant à un avenir dont ils ne voulaient voir le côté sombre. Avec cette singularité et celle de son époque, dans "la longue marche vers la vérité céleste" il a fait preuve d'une grande sagesse qui mérite d'être connue.
Avant que de lire cet ouvrage de Jean-Pierre Luminet, L'oeil de Galilée, par quelques nuits claires, les yeux dirigés vers les étoiles, j'avais déjà eu l'occasion de méditer sur la profondeur de l'univers. Mais que savons aujourd'hui de plus que Brahé, Kepler son disciple, Galilée, et autres astronome, mathématicien, physicien de ce fabuleux siècle de la Renaissance, sur le mystère de l'infini. Certes nos yeux se sont portés plus loin dans les galaxies, ont découvert planètes, comètes et autres trous noirs, mesuré des distances en années lumières, émis des hypothèses sur la formation de l'univers, le Big bang. Nos congénères ont même fait une incursion sur la boule d'ivoire qui illuminait les nuits de Copernic. "Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité". Mais plus que Brahé, Kepler et Galilée, sommes-nous capables de nous situer entre les deux infinis, le grand et le petit ? Ce mot qui justement échappe à notre entendement. Parce que dans ce mot, in-fi-ni, réside tout le mystère de la vie. Kepler le ressentait bien comme tel, même si, scrutant le ciel avec ce télescope rudimentaire qui vaut à cet ouvrage son titre, il lui fixait des bornes à cet univers.
Aussi qu'importe géocentrisme ou héliocentrisme dont il est beaucoup question ici. Qu'importe si c'est la terre qui est au centre de l'univers, concept cher à Aristote, Ptolémée et consorts, auquel s'accrochaient les "théologiens s'occupant d'autre chose que de foi", dans leur grande intolérance aveugle, ou si c'est le soleil qui est au centre de l'univers, contradiction défendue par Copernic puis Galilée. Ce dernier étant obligé de se déjuger au risque de condamnation pour hérésie, bougonnant dans sa barbe cette réflexion certainement apocryphe : "E pur si muove !" Et pourtant, elle tourne, en parlant de notre planète autour du soleil.
Qu'importe ce que l'on désigne comme le centre de l'univers, puisqu'entre les deux infinis, bien malin qui peut situer un centre. Car c'est là, c'est à dire partout et nulle part, que réside la réponse à la question, la seule, la vraie : pourquoi la vie ? Pourquoi nous sur terre, perdus au milieu de nulle part ? Pourquoi une vie bornée par une naissance et une mort dans un univers qui lui n'en connaît point de bornes ?
Que de questions sans réponse ! Abandonnant la métaphysique pour verser dans le concret, Kepler se les posait déjà. S'imposeront-elles à moi ces réponses quand mon coeur aura cessé d'irriguer cet organe insensé qui transforme un processus chimique en pensées ? Et Dieu sait s'il a bien fonctionné dans le crâne de Kepler ce cerveau, entre 1571 et 1630, pour lui faire écrire autant de théories qui dans sa postérité trouveront leur preuve. Sauf bien sûr la finitude de l'univers.
Il est vrai que lorsqu'on touche aux étoiles, on avance de quelques millimètres vers l'infini. C'est pour cela que l'expression que je trouve la plus seyante pour désigner cette belle science qu'est l'astronomie, c'est bien celle qui qualifiait alors l'astronomie de "philosophie naturelle". Toute hypothèse sur la conformation de l'univers ne sera jamais en fait, aussi loin que se portera notre regard, que vue de l'esprit sujette à réflexion, discussion, rêverie peut-être, et surtout contradiction. Et si un jour un esprit supérieur équipé d'yeux de lynx trouvait des bornes à notre univers, un début et une fin avec comme un grand mur, je serai le premier à l'approuver. C'est vrai ce que tu dis, mais dis-moi, au fait, derrière ce mur, il y a quoi ?
Utilisant le procédé narratif d'un témoin fictif de faits pourtant bien réels, pour autant que leurs colporteurs ne les aient pas trahis au fil du temps, cet ouvrage de Jean-Pierre Luminet a pu en dérouter plus d'un. Il est vrai qu'il y a de quoi se noyer dans les atermoiements des scientifiques de la Renaissance émis entre les menaces des papistes et leur envie de faire éclater le fruit de leurs cogitations illuminées, de mettre à jour l'exactitude, chère à Marguerite Yourcenar, qui seule appartient à la Nature, a contrario de la vérité qui existe en autant de versions qu'il y a de bouches pour la prononcer. Il n'en reste pas moins que Jean-Pierre Luminet a su retirer à ses écrits le côté abscons dont le sujet aurait pu remplir les pages.
La vie de cet homme de science, Kepler et non Galilée comme le titre de cet ouvrage le laisse à penser, m'a passionnée. Je reste subjugué par la production d'autant de théories avec aussi peu de moyens d'observation, et surtout dans un climat aussi tourmenté par la folie des hommes en ce siècle où la religion catholique n'admettait pas la contradiction.
Alors héliocentrisme ou géocentrisme quelle importance dans un univers où nul ne pourra jamais situer de centre. Et pourquoi ne serais-je finalement pas, moi, en entorse à ma réserve naturelle, le centre de l'univers ? Engendré par le grand orgueil du tempérament humain, l'égocentrisme n'est-il pas la seule constante à réunir les générations.
Johann Kepler, astronome ou astrologue ? Les deux mon général ! Il fallait bien flatter les faibles d'esprit quand ils se trouvaient avoir un peu d'influence, et les rassurer quant à un avenir dont ils ne voulaient voir le côté sombre. Avec cette singularité et celle de son époque, dans "la longue marche vers la vérité céleste" il a fait preuve d'une grande sagesse qui mérite d'être connue.
Longtemps mon univers était restreint à moi-même. Puis mon big-bang a eu lieu. Pas à ma naissance, plutôt vers huit ans.
Mon univers s’est retrouvé en expansion. Et encore mes parents et ma sœur m’ont longtemps encore semblé être des satellites de ma propre existence.
Peut-être est-ce ma sœur qui s’est détachée la première, telle la lune dans Cosmos 1999, à la dérive… Dérive dans le néant.
Une chose que nous apprend le bouquin, c’est qu’en restant statique, genre campé sur ses positions, dans un univers en expansion, la distance avec les autres, elle, grandit. Voilà comment faire le vide autour de vous.
En ces périodes de festivités, à défaut de pouvoir observer le ciel, illuminations polluantes obligent, laissons-nous éclairer des lumières de Luminet.
Jean-Pierre Luminet expose les avancées dans le domaine de la cosmologie, liées aux avancées des théories mathématiques, en particulier de la topologie.
Oh… ça a l’air pointu. Théories mathématiques…
Qui dit maths dit cartésien, rationnel, carré, logique, méthodique, rigoureux… bon autant dire carrément chiant quoi. En tout cas pas fun du tout.
Quand on dit « maths »…
Ne peut-on pas penser rendre possible l’impossible avec les nombres complexes et leurs imaginaires qui permettent subitement à un carré d’être négatif… ?
Ne peut-on pas penser art, beauté avec les pavages du plan d’Escher (ou ceux de l’Alhambra quelques siècles plus tôt) ou ses transformations de poissons en oiseaux… ?
Ne peut-on pas penser illusion avec les objets impossibles, le cube d’Escher, la représentation du mouvement perpétuel qu’il a proposé, l’escalier de Penrose… ?
Ne peut-on pas penser supercherie avec, un seul nom à citer, Nicolas Bourbaki, plusieurs parmi les plus grands mathématiciens… ?
Ne peut-on pas penser paradoxe avec Mandelbrot qui permet à la côte bretonne de faire partie du périmètre infini d’une surface finie, ou si vous préférez prendre un flocon de neige ou un chou romanesco… ?
Ne peut-on pas penser, même, poésie et littérature avec Queneau et ses cent mille milliards de poèmes, et bien d’autres de l’Oulipo… ?
Je pourrais poursuivre mais je vais juste dire que Jean-Pierre Luminet, à n’en pas douter, est un puits de sciences, bien rempli, qui a en plus l’extrêmement rare qualité de bien expliquer les choses, de rendre accessibles des concepts compliqués par des comparaisons vraiment parlantes et qui ne font pas perdre trop le sens de la théorie (j’ose le croire).
Donc les mathématiques, appliquées aux sciences, expliquées par Jean-Pierre Luminet, c’est passionnant.
J’ai appris sur le big-bang, sur le passé et l’avenir de l’univers, sur la forme de l’univers, sur les trous noirs et les trous de ver, et si j’ai pas tout bien compris, ce n’en est pas très loin quand même.
Merci à Eric75 d’avoir écrit une si belle critique de ce livre qui m’a immédiatement attiré l’attention et donné envie de l’acheter, pour l’offrir à mon pôpa à Noël, et de le lire, à tel point que je n’ai pas résisté avant de le mettre en paquet.
Pour ceux qui, la tête dans les étoiles, tentent d’atteindre le septième ciel, bonne bourre…
Mon univers s’est retrouvé en expansion. Et encore mes parents et ma sœur m’ont longtemps encore semblé être des satellites de ma propre existence.
Peut-être est-ce ma sœur qui s’est détachée la première, telle la lune dans Cosmos 1999, à la dérive… Dérive dans le néant.
Une chose que nous apprend le bouquin, c’est qu’en restant statique, genre campé sur ses positions, dans un univers en expansion, la distance avec les autres, elle, grandit. Voilà comment faire le vide autour de vous.
En ces périodes de festivités, à défaut de pouvoir observer le ciel, illuminations polluantes obligent, laissons-nous éclairer des lumières de Luminet.
Jean-Pierre Luminet expose les avancées dans le domaine de la cosmologie, liées aux avancées des théories mathématiques, en particulier de la topologie.
Oh… ça a l’air pointu. Théories mathématiques…
Qui dit maths dit cartésien, rationnel, carré, logique, méthodique, rigoureux… bon autant dire carrément chiant quoi. En tout cas pas fun du tout.
Quand on dit « maths »…
Ne peut-on pas penser rendre possible l’impossible avec les nombres complexes et leurs imaginaires qui permettent subitement à un carré d’être négatif… ?
Ne peut-on pas penser art, beauté avec les pavages du plan d’Escher (ou ceux de l’Alhambra quelques siècles plus tôt) ou ses transformations de poissons en oiseaux… ?
Ne peut-on pas penser illusion avec les objets impossibles, le cube d’Escher, la représentation du mouvement perpétuel qu’il a proposé, l’escalier de Penrose… ?
Ne peut-on pas penser supercherie avec, un seul nom à citer, Nicolas Bourbaki, plusieurs parmi les plus grands mathématiciens… ?
Ne peut-on pas penser paradoxe avec Mandelbrot qui permet à la côte bretonne de faire partie du périmètre infini d’une surface finie, ou si vous préférez prendre un flocon de neige ou un chou romanesco… ?
Ne peut-on pas penser, même, poésie et littérature avec Queneau et ses cent mille milliards de poèmes, et bien d’autres de l’Oulipo… ?
Je pourrais poursuivre mais je vais juste dire que Jean-Pierre Luminet, à n’en pas douter, est un puits de sciences, bien rempli, qui a en plus l’extrêmement rare qualité de bien expliquer les choses, de rendre accessibles des concepts compliqués par des comparaisons vraiment parlantes et qui ne font pas perdre trop le sens de la théorie (j’ose le croire).
Donc les mathématiques, appliquées aux sciences, expliquées par Jean-Pierre Luminet, c’est passionnant.
J’ai appris sur le big-bang, sur le passé et l’avenir de l’univers, sur la forme de l’univers, sur les trous noirs et les trous de ver, et si j’ai pas tout bien compris, ce n’en est pas très loin quand même.
Merci à Eric75 d’avoir écrit une si belle critique de ce livre qui m’a immédiatement attiré l’attention et donné envie de l’acheter, pour l’offrir à mon pôpa à Noël, et de le lire, à tel point que je n’ai pas résisté avant de le mettre en paquet.
Pour ceux qui, la tête dans les étoiles, tentent d’atteindre le septième ciel, bonne bourre…
Quel beau livre !
Je me rends compte que l'astronomie m'ennuie un peu finalement... Et donc, la recherche de correspondances faite par l'auteur entre les ciels peints et les ciels observables.
Mais ce que Luminet découvre est plus intéressant que l'improbable (et invérifiable) passion de Van Gogh pour le cosmos.
Son enquête met au jour ce que le génie d'un peintre parvient le mieux à dissimuler : la parfaite maîtrise de son art.
Je me rends compte que l'astronomie m'ennuie un peu finalement... Et donc, la recherche de correspondances faite par l'auteur entre les ciels peints et les ciels observables.
Mais ce que Luminet découvre est plus intéressant que l'improbable (et invérifiable) passion de Van Gogh pour le cosmos.
Son enquête met au jour ce que le génie d'un peintre parvient le mieux à dissimuler : la parfaite maîtrise de son art.
A sa mort, le sinistre Tycho Brahé (1546-1601), laisse derrière lui les relevés de ses observations méticuleuses du ciel. Johann Kepler (1571-1631) qui lui succède comme mathématicien de l'empereur Rodolphe II, à Prague, récupère ce précieux héritage ; il l'utilise pour comprendre les déplacements des planètes. En Italie, Galilée (1564-1642), lui, observe le ciel à travers les premières lunettes astronomiques.
Ce roman met en scène ces célèbres personnages et leurs découvertes. Ces trouvailles - sur lesquelles Newton (1642-1727) s'appuya pour construire sa théorie de la Gravitation universelle - bouleversèrent la vision que l'homme avait du monde, en confirmant la théorie héliocentrique du chanoine polonais Nicolas Copernic (1473-1543), et en infirmant les théories géocentriques de l'astrologue égyptien Ptolémée (100-168) et de Tycho Brahé (qui pensait que la Lune et le Soleil tournaient autour d'une Terre située au centre de l'Univers tandis que les planètes tournaient autour du Soleil, pensant ainsi résoudre des incohérences entre le système de Ptolémée et les mouvements de Vénus).
Au début du 17e siècle, l'Eglise catholique romaine luttait férocement contre l'idée selon laquelle la Terre n'est pas au centre du monde. N'est-il pas écrit dans l'ancien testament « aussi le monde est ferme, il ne chancelle (bouge) pas » (psaume 93) ? A l'époque, cette Eglise ne rigolait pas avec ses dogmes ! Ceux qui osaient les contredire risquaient tortures et passage à la rôtissoire, comme l'italien Giodano Bruno (1548-1600), brûlé vif pour avoir défendu l'héliocentrisme et affirmé l'existence d'« une infinité de terres, une infinité de soleils et un éther infini »… Comme le montre le roman, la mère de Johann Kepler, accusée de sorcellerie, fit aussi les frais des excès de zèle des juridictions inquisitoriales, même si elle parvint à échapper au bûcher.
Le dernier tribunal inquisitorial se réunit à Mexico en 1850, et l'Eglise ne se repentit officiellement des crimes commis par l'Inquisition qu'en 2000. Voyez à quelle vitesse cette institution - qui prétend dicter les comportements de chacun - reconnaît ses abus ! Et la large interprétation qu'elle fait du pardon quand il s'agit de se l'appliquer à elle-même ou aux membres de sa hiérarchie [à ce jour, le cardinal Barbarin n'a pas été démis de ses fonctions par le Vatican].
Ce roman est très documenté, sur l'évolution des théories cosmologiques (l'auteur est astrophysicien) et sur les contextes historiques dans lesquels elles sont nées. Il est très instructif mais les conflits de l'époque, entre Etats et entre chapelles, sont fastidieux à suivre pour ceux qui ne sont pas férus de cette période.
Sur la remise en cause du géocentrisme par Johann Kepler, je recommande plutôt l'excellent essai historique d'Arthur Koestler intitulé « Les Somnambules », bien plus agréable à lire.
Je lirai volontiers les premiers tomes de la série « Les Bâtisseurs du ciel » de Jean-Pierre Luminet, consacrés respectivement à Copernic (« le Secret de Copernic ») et à Tycho Brahé (« La Discorde céleste »), sans toutefois me précipiter.
Ce roman met en scène ces célèbres personnages et leurs découvertes. Ces trouvailles - sur lesquelles Newton (1642-1727) s'appuya pour construire sa théorie de la Gravitation universelle - bouleversèrent la vision que l'homme avait du monde, en confirmant la théorie héliocentrique du chanoine polonais Nicolas Copernic (1473-1543), et en infirmant les théories géocentriques de l'astrologue égyptien Ptolémée (100-168) et de Tycho Brahé (qui pensait que la Lune et le Soleil tournaient autour d'une Terre située au centre de l'Univers tandis que les planètes tournaient autour du Soleil, pensant ainsi résoudre des incohérences entre le système de Ptolémée et les mouvements de Vénus).
Au début du 17e siècle, l'Eglise catholique romaine luttait férocement contre l'idée selon laquelle la Terre n'est pas au centre du monde. N'est-il pas écrit dans l'ancien testament « aussi le monde est ferme, il ne chancelle (bouge) pas » (psaume 93) ? A l'époque, cette Eglise ne rigolait pas avec ses dogmes ! Ceux qui osaient les contredire risquaient tortures et passage à la rôtissoire, comme l'italien Giodano Bruno (1548-1600), brûlé vif pour avoir défendu l'héliocentrisme et affirmé l'existence d'« une infinité de terres, une infinité de soleils et un éther infini »… Comme le montre le roman, la mère de Johann Kepler, accusée de sorcellerie, fit aussi les frais des excès de zèle des juridictions inquisitoriales, même si elle parvint à échapper au bûcher.
Le dernier tribunal inquisitorial se réunit à Mexico en 1850, et l'Eglise ne se repentit officiellement des crimes commis par l'Inquisition qu'en 2000. Voyez à quelle vitesse cette institution - qui prétend dicter les comportements de chacun - reconnaît ses abus ! Et la large interprétation qu'elle fait du pardon quand il s'agit de se l'appliquer à elle-même ou aux membres de sa hiérarchie [à ce jour, le cardinal Barbarin n'a pas été démis de ses fonctions par le Vatican].
Ce roman est très documenté, sur l'évolution des théories cosmologiques (l'auteur est astrophysicien) et sur les contextes historiques dans lesquels elles sont nées. Il est très instructif mais les conflits de l'époque, entre Etats et entre chapelles, sont fastidieux à suivre pour ceux qui ne sont pas férus de cette période.
Sur la remise en cause du géocentrisme par Johann Kepler, je recommande plutôt l'excellent essai historique d'Arthur Koestler intitulé « Les Somnambules », bien plus agréable à lire.
Je lirai volontiers les premiers tomes de la série « Les Bâtisseurs du ciel » de Jean-Pierre Luminet, consacrés respectivement à Copernic (« le Secret de Copernic ») et à Tycho Brahé (« La Discorde céleste »), sans toutefois me précipiter.
Nouvelle édition, la première édition datait de 2005, les auteurs ont tenu compte des avancées récentes dans le domaine scientifique.
Ce livre a pour but d'explorer la notion d'infini telle qu'elle a été perçue à différents âges et de donner des perspectives nouvelles.
L'infini a toujours fasciné: tout au long de l'histoire de la pensée occidentale, les trois énigmes de l'infini, infini du temps, infini de l'espace, infini du nombre, ont inspiré artistes, écrivains, hommes de sciences: Blanqui, Hugo, Pascal, Goethe, pour n'en citer que quelques uns.
Descartes déjà reconnaissait l'infini mais ce dernier selon lui, est réservé au seul créateur. "Il n'y a que Dieu seul que je conçoive positivement infini."
Newton va opérer un gigantesque bond en avant dans le domaine de l'infini puisqu'il démontre que la portée de la force gravitationnelle étant infinie, l'espace aussi l'est. La cosmologie de Newton marque le triomphe de l'infini spatial et temporel mais, pour autant, il s'agit encore d'un espace rigide avec un temps figé. Tout va basculer avec Einstein: sa relativité générale bouleverse les concepts de temps et d'espace. L'Univers devient un espace-temps déformable, ce que les mathématiciens nomment une variété à quatre dimensions (trois pour l'espace, une pour le temps), déformée par la présence de la matière. Toutefois Einstein penchait pour un univers statique et fini, ce qui va être remis en cause par l'astronome américain Edwin Hubble qui, dans les années 1920, a montré que l'univers était en expansion et partant de là, infini.
Au fur et mesure que des découvertes interviennent, il semble que la notion d'infini "recule". Au fil de l'histoire de la pensée, il apparaît que chaque infini éliminé engendre à son tour un nouvel infini. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'infiniment petit et des particules.
Les Grecs avaient trouvé que la matière pouvait être divisée jusqu'à l'obtention d'atomes mais depuis une bonne centaine d'années les chercheurs explorent des entités bien plus petites. Après des siècles de débat sur la divisibilité à l'infini de la matière, la physique reconnaît aujourd'hui son caractère discontinu. Si la technique permet de voir les atomes, les briques élémentaires sont à chercher maintenant à un niveau plus fondamental, celui des particules élémentaires.
Ces questions sur l'infiniment petit ont aussi des répercussions sur l'appréhension de l'infiniment grand:, notamment à propos de la mystérieuse énergie sombre qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, phénomène que l'on connaît depuis vingt ans. L'idée est que le contenu de l'univers se trouverait dans un certain état quantique dont l'énergie exercerait une influence gravitationnelle répulsive.
Infiniment petit encore; la théorie des cordes magnifiquement expliquée ici, fait intervenir des constituants fondamentaux de matière (quarks, leptons et bosons) qui ne seraient pas des particules ponctuelles mais des vibrations appelées "cordes". Selon qu'elle s'enroule d'une manière ou d'une autre, nous la verrions comme un certain type de particule.
Une limite à cet infiniment petit: aux très petites distances, inférieures à 10 puissance -35 m, la fameuse longueur de Planck au-delà de laquelle de grandes incertitudes apparaissent et la géométrie de l'espace ne peut plus être considérée comme continue.
Infini dans l'espace, infini dans le temps; après avoir longuement évoqué le Big Bang les auteurs soulignent qu'on peut "remonter" l'histoire de l'univers jusqu'à un temps extrêmement petit (10 exp -43 secondes), au-delà, la relativité générale ne peut être appliquée).
Des limites donc apparaissent même si elles nous projettent vraiment très loin dans le temps ou dans l'espace.
L'infini peut prendre des formes surprenantes, si on en revient à l'espace qui nous entoure. Il nous apparaît lisse, comme si l'on voyait une mer de loin mais avec une vision plus résolue nous verrions une structure beaucoup plus tourmentée.
Après l'infini dans le temps, l'espace, les nombres, un volet intéressant qui est développé ici est celui de l'infiniment lourd avec le phénomène des trous noirs très bien décrit ici.
Parfois des surprises au détour de la lecture là où on pensait qu'il y aurait de l'infini, en fait il n'y en a pas: le cas du nombre d'atomes dans notre univers est intéressant: le nombre est immense: 10 puissance 80 mais tout immense que cela soit, c'est quand même un nombre fini.
Le livre est passionnant, il nous fait voyager dans l'Histoire, dans les représentations de l'univers au fil des époques, dans l'espace et le temps.
Les explications sont très claires, parfois j'ai regretté de ne pas avoir de culture mathématique suffisamment solide pour aborder certains passages.
Livre de sciences mais livre de philosophie aussi qui nous montre que l'infini "recule"... dès qu'une limite est franchie, une autre forme d'infini apparaît.
Les deux auteurs ont de grandes capacités pour se mettre à la portée d'un grand public. Ils sont des scientifiques de renommée internationale et ont déjà écrit de nombreux livres.
Jean-Pierre Luminet est directeur de recherches au laboratoire d'Astrophysique de Marseille, il est spécialiste de cosmologie et de trous noirs. Marc Lachièze-Rey est directeur de recherches au CNRS et spécialiste de cosmologie et de gravitation.
Je remercie vivement Babelio et son opération Masse Critique qui m'ont permis de découvrir ce livre et d'élargir ma culture scientifique.
Ce livre a pour but d'explorer la notion d'infini telle qu'elle a été perçue à différents âges et de donner des perspectives nouvelles.
L'infini a toujours fasciné: tout au long de l'histoire de la pensée occidentale, les trois énigmes de l'infini, infini du temps, infini de l'espace, infini du nombre, ont inspiré artistes, écrivains, hommes de sciences: Blanqui, Hugo, Pascal, Goethe, pour n'en citer que quelques uns.
Descartes déjà reconnaissait l'infini mais ce dernier selon lui, est réservé au seul créateur. "Il n'y a que Dieu seul que je conçoive positivement infini."
Newton va opérer un gigantesque bond en avant dans le domaine de l'infini puisqu'il démontre que la portée de la force gravitationnelle étant infinie, l'espace aussi l'est. La cosmologie de Newton marque le triomphe de l'infini spatial et temporel mais, pour autant, il s'agit encore d'un espace rigide avec un temps figé. Tout va basculer avec Einstein: sa relativité générale bouleverse les concepts de temps et d'espace. L'Univers devient un espace-temps déformable, ce que les mathématiciens nomment une variété à quatre dimensions (trois pour l'espace, une pour le temps), déformée par la présence de la matière. Toutefois Einstein penchait pour un univers statique et fini, ce qui va être remis en cause par l'astronome américain Edwin Hubble qui, dans les années 1920, a montré que l'univers était en expansion et partant de là, infini.
Au fur et mesure que des découvertes interviennent, il semble que la notion d'infini "recule". Au fil de l'histoire de la pensée, il apparaît que chaque infini éliminé engendre à son tour un nouvel infini. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'infiniment petit et des particules.
Les Grecs avaient trouvé que la matière pouvait être divisée jusqu'à l'obtention d'atomes mais depuis une bonne centaine d'années les chercheurs explorent des entités bien plus petites. Après des siècles de débat sur la divisibilité à l'infini de la matière, la physique reconnaît aujourd'hui son caractère discontinu. Si la technique permet de voir les atomes, les briques élémentaires sont à chercher maintenant à un niveau plus fondamental, celui des particules élémentaires.
Ces questions sur l'infiniment petit ont aussi des répercussions sur l'appréhension de l'infiniment grand:, notamment à propos de la mystérieuse énergie sombre qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, phénomène que l'on connaît depuis vingt ans. L'idée est que le contenu de l'univers se trouverait dans un certain état quantique dont l'énergie exercerait une influence gravitationnelle répulsive.
Infiniment petit encore; la théorie des cordes magnifiquement expliquée ici, fait intervenir des constituants fondamentaux de matière (quarks, leptons et bosons) qui ne seraient pas des particules ponctuelles mais des vibrations appelées "cordes". Selon qu'elle s'enroule d'une manière ou d'une autre, nous la verrions comme un certain type de particule.
Une limite à cet infiniment petit: aux très petites distances, inférieures à 10 puissance -35 m, la fameuse longueur de Planck au-delà de laquelle de grandes incertitudes apparaissent et la géométrie de l'espace ne peut plus être considérée comme continue.
Infini dans l'espace, infini dans le temps; après avoir longuement évoqué le Big Bang les auteurs soulignent qu'on peut "remonter" l'histoire de l'univers jusqu'à un temps extrêmement petit (10 exp -43 secondes), au-delà, la relativité générale ne peut être appliquée).
Des limites donc apparaissent même si elles nous projettent vraiment très loin dans le temps ou dans l'espace.
L'infini peut prendre des formes surprenantes, si on en revient à l'espace qui nous entoure. Il nous apparaît lisse, comme si l'on voyait une mer de loin mais avec une vision plus résolue nous verrions une structure beaucoup plus tourmentée.
Après l'infini dans le temps, l'espace, les nombres, un volet intéressant qui est développé ici est celui de l'infiniment lourd avec le phénomène des trous noirs très bien décrit ici.
Parfois des surprises au détour de la lecture là où on pensait qu'il y aurait de l'infini, en fait il n'y en a pas: le cas du nombre d'atomes dans notre univers est intéressant: le nombre est immense: 10 puissance 80 mais tout immense que cela soit, c'est quand même un nombre fini.
Le livre est passionnant, il nous fait voyager dans l'Histoire, dans les représentations de l'univers au fil des époques, dans l'espace et le temps.
Les explications sont très claires, parfois j'ai regretté de ne pas avoir de culture mathématique suffisamment solide pour aborder certains passages.
Livre de sciences mais livre de philosophie aussi qui nous montre que l'infini "recule"... dès qu'une limite est franchie, une autre forme d'infini apparaît.
Les deux auteurs ont de grandes capacités pour se mettre à la portée d'un grand public. Ils sont des scientifiques de renommée internationale et ont déjà écrit de nombreux livres.
Jean-Pierre Luminet est directeur de recherches au laboratoire d'Astrophysique de Marseille, il est spécialiste de cosmologie et de trous noirs. Marc Lachièze-Rey est directeur de recherches au CNRS et spécialiste de cosmologie et de gravitation.
Je remercie vivement Babelio et son opération Masse Critique qui m'ont permis de découvrir ce livre et d'élargir ma culture scientifique.
Enfin un bon moyen de combler quelque peu l’immense trou de ma culture dans le domaine de l’histoire des sciences (entre autres).
Ce livre, qui fait partie de la série « Les bâtisseurs du ciel », est bien écrit, même si son style n’est pas flamboyant non plus. Le seul problème est que l’on se pose la question des sources de l’auteur. Mais on peut faire confiance, je le pense et je l’espère, à Jean-Pierre Luminet pour ne trahir ni les faits, ni les caractères des personnages principaux.
Et quelle surprise bien souvent de découvrir la personnalité des Hommes célèbres, scientifiques par exemple, qui tout compte fait ne sont pas plus admirables dans leur personne que certaines stars ou certains « people ».
Newton se montre dans ce roman comme un grand autodidacte, un grand génie et quelqu’un de très studieux. Certes !
Mais, car il y a un mais, c’est aussi un homme irascible (à l’écrit uniquement, parce que de vive voix, il ne semble pas avoir le courage de ses opinions), très rancunier, plutôt imbus de sa personne, n’hésitant pas à tricher sur les dates pour garder la primauté de certaines découvertes.
De toute façon, il préférait ne pas partager ses découvertes car il pensait qu’il allait résoudre toutes les énigmes de l’univers…
Newton aurait fabriqué sa légende en racontant qu’il avait compris que la lune tombait en voyant une pomme tomber dans son verger.
Il s’est aussi perdu dans l’alchimie, ou du moins il a laissé des cheveux dans ses expériences, d’où la perruque de Newton.
Bien sûr on croise bien d’autres personnages de renom dans ce roman, logique, les scientifiques se fréquentent entre eux.
Et le plus beau personnage est sans conteste Edmund Halley, dont l’altruisme est indéniable. Sans lui, l’œuvre de Newton serait peut-être restée méconnue…
Quand le sage désigne la lune, l’idiot regarde le doigt…
« J’ai demandé à la lune
Et le soleil ne le sait pas
Je lui ai montré mes brûlures
Et la lune s’est moquée de moi
Et comme le ciel n’avait pas fière allure
Et que je ne guérissais pas
Je me suis dit quelle infortune
Et la lune s’est moquée de moi
[…] »
Extrait de « J’ai demandé à la lune », Indochine :
https://www.youtube.com/watch?v=KAOmC5qT02w
Ce livre, qui fait partie de la série « Les bâtisseurs du ciel », est bien écrit, même si son style n’est pas flamboyant non plus. Le seul problème est que l’on se pose la question des sources de l’auteur. Mais on peut faire confiance, je le pense et je l’espère, à Jean-Pierre Luminet pour ne trahir ni les faits, ni les caractères des personnages principaux.
Et quelle surprise bien souvent de découvrir la personnalité des Hommes célèbres, scientifiques par exemple, qui tout compte fait ne sont pas plus admirables dans leur personne que certaines stars ou certains « people ».
Newton se montre dans ce roman comme un grand autodidacte, un grand génie et quelqu’un de très studieux. Certes !
Mais, car il y a un mais, c’est aussi un homme irascible (à l’écrit uniquement, parce que de vive voix, il ne semble pas avoir le courage de ses opinions), très rancunier, plutôt imbus de sa personne, n’hésitant pas à tricher sur les dates pour garder la primauté de certaines découvertes.
De toute façon, il préférait ne pas partager ses découvertes car il pensait qu’il allait résoudre toutes les énigmes de l’univers…
Newton aurait fabriqué sa légende en racontant qu’il avait compris que la lune tombait en voyant une pomme tomber dans son verger.
Il s’est aussi perdu dans l’alchimie, ou du moins il a laissé des cheveux dans ses expériences, d’où la perruque de Newton.
Bien sûr on croise bien d’autres personnages de renom dans ce roman, logique, les scientifiques se fréquentent entre eux.
Et le plus beau personnage est sans conteste Edmund Halley, dont l’altruisme est indéniable. Sans lui, l’œuvre de Newton serait peut-être restée méconnue…
Quand le sage désigne la lune, l’idiot regarde le doigt…
« J’ai demandé à la lune
Et le soleil ne le sait pas
Je lui ai montré mes brûlures
Et la lune s’est moquée de moi
Et comme le ciel n’avait pas fière allure
Et que je ne guérissais pas
Je me suis dit quelle infortune
Et la lune s’est moquée de moi
[…] »
Extrait de « J’ai demandé à la lune », Indochine :
https://www.youtube.com/watch?v=KAOmC5qT02w
J'avais peur que ce livre ne soit trop scientifique, Luminet étant un astrophysicien, mais non, cet auteur a su vulgariser son propos.
Fin XVe, début XVie. Nicolas Copernic, par ses recherches, va démontrer que la Terre n'est pas le centre du monde, mais bien une planète qui tourne autour du soleil.
Un roman bien bâti qui nous plonge dans la grande Histoire au moment où les théories scientifiques affrontent les théories religieuses.
Fin XVe, début XVie. Nicolas Copernic, par ses recherches, va démontrer que la Terre n'est pas le centre du monde, mais bien une planète qui tourne autour du soleil.
Un roman bien bâti qui nous plonge dans la grande Histoire au moment où les théories scientifiques affrontent les théories religieuses.
Ulugh Beg, l'astronome de Samarcande, petit fils de Tamerlan, retrace, sous la plume agile de Jean-Pierre Luminet, l'histoire d'un prince qui préféra les étoiles au pouvoir. L'auteur nous emmène en Asie centrale au 15è siècle (calendrier grégorien). Guerre, intolérance religieuse et mariages arrangés ponctuent l'histoire. Mais Ulugh Beg, , n'a d'yeux que pour les étoiles et la construction d'un immense observatoire à Samarcande. On doit à cet astronome le calcul de la position de mille étoiles dont certaines portent encore de nos jours le nom qu'Ulugh Beg leur a données. Il est également l'auteur des tables sultanniennes parues en 1437. Quatre volumes d'importance majeure dans la compréhension du ciel. Il connait une triste fin, causée par une guerre de succession compliquée mais son héritage demeure de nos jours. Ce livre est enivrant même si l'abondance des noms rend la lecture un peu complexe. Le voyage entre cruauté des hommes sur terre et la fascination des astres vaut la peine.
Je fus d'abord attiré par la jaquette, qui promettait une mise en abyme rare pour le lecteur : le roman de la mythique bibliothèque d'Alexandrie ; un peu le même frisson qu'en découvrant "Une histoire de la lecture" de Manguel, ou en refermant "La bibliothèque de Babel" de Borgès. Las, les toutes premières pages impriment fortement un cadre romanesque et arabisant, apparemment sans grand rapport avec la promesse, qui m'ont d'abord fait l'effet d'une mise en bouche ratée.
Il a donc fallu que je m'y essaye une deuxième fois et que je dépasse la première (courte) partie et son style un peu précieux et ampoulé pour plonger dans le véritable apport de ce livre : retracer 1000 ans d'histoire des sciences antiques jusqu'à la fatidique destruction de "La Bibliothèque" vers 640 ap. JC.
Le livre est de ce fait à rapprocher du jubilatoire (et un peu frustrant de s'arrêter aussi tôt dans l'Histoire) "Théorème du Perroquet" de Denis Guedj, qui déclinait pour les sciences ce que Jostein Gaard avait assez brillamment réussi pour la philosophie avec son "Monde de Sophie".
Le propos de Luminet est un peu différent, puisqu'il centre son propos sur Alexandrie et la pensée scientifique grecque. Cela lui permet d'offrir un panorama unique sur une effervescence intellectuelle, ses poussées, ses relations avec les autres pouvoirs politiques et spirituels. Or il s'agit des fondements scientifiques qui vont servir de socle pendant encore 1000 ans, jusqu'aux remises en questions radicales de Copernic puis Newton.
Une première chose est plaisante pour l'ancien étudiant que je fus il y a quelques jolies lurettes : tous les concepts demeurent compréhensibles et accessibles, probablement de par leur relative simplicité. Qui plus est, l'auteur a rajouté un corpus de notes savantes qui en détaillent et expliquent la majeur partie d'entre eux.
A un deuxième niveau, on apprécie la construction, faite essentiellement de narrations alternées des quatre protagonistes et de leurs dialogues, sur le mode de la littérature didactique classique. Cette construction est aussi un hommage, un peu plaqué, laissant voir certaines ficelles mais qui s'effacent rapidement devant la qualité du talent de conteur de son auteur. Jamais rébarbatif, ne forçant pas sur des échanges trop scientifiques ou intellectuels, le livre nous embarque d'abord et avec une réussite certaine à travers le matin de notre aventure intellectuelle humaine. Les histoires s'enchainent, s'empilent, se répondent, pour tenir la promesse initiale, celle du roman. Ce que l'auteur avouera ouvertement dans sa postface : il a moins cherché à faire oeuvre d'historien qu'à construire une histoire qui sait prendre les libertés nécessaires avec l'Histoire, avérée ou précisément douteuse.
Au final donc, un bon plaisir de lecture.
Il a donc fallu que je m'y essaye une deuxième fois et que je dépasse la première (courte) partie et son style un peu précieux et ampoulé pour plonger dans le véritable apport de ce livre : retracer 1000 ans d'histoire des sciences antiques jusqu'à la fatidique destruction de "La Bibliothèque" vers 640 ap. JC.
Le livre est de ce fait à rapprocher du jubilatoire (et un peu frustrant de s'arrêter aussi tôt dans l'Histoire) "Théorème du Perroquet" de Denis Guedj, qui déclinait pour les sciences ce que Jostein Gaard avait assez brillamment réussi pour la philosophie avec son "Monde de Sophie".
Le propos de Luminet est un peu différent, puisqu'il centre son propos sur Alexandrie et la pensée scientifique grecque. Cela lui permet d'offrir un panorama unique sur une effervescence intellectuelle, ses poussées, ses relations avec les autres pouvoirs politiques et spirituels. Or il s'agit des fondements scientifiques qui vont servir de socle pendant encore 1000 ans, jusqu'aux remises en questions radicales de Copernic puis Newton.
Une première chose est plaisante pour l'ancien étudiant que je fus il y a quelques jolies lurettes : tous les concepts demeurent compréhensibles et accessibles, probablement de par leur relative simplicité. Qui plus est, l'auteur a rajouté un corpus de notes savantes qui en détaillent et expliquent la majeur partie d'entre eux.
A un deuxième niveau, on apprécie la construction, faite essentiellement de narrations alternées des quatre protagonistes et de leurs dialogues, sur le mode de la littérature didactique classique. Cette construction est aussi un hommage, un peu plaqué, laissant voir certaines ficelles mais qui s'effacent rapidement devant la qualité du talent de conteur de son auteur. Jamais rébarbatif, ne forçant pas sur des échanges trop scientifiques ou intellectuels, le livre nous embarque d'abord et avec une réussite certaine à travers le matin de notre aventure intellectuelle humaine. Les histoires s'enchainent, s'empilent, se répondent, pour tenir la promesse initiale, celle du roman. Ce que l'auteur avouera ouvertement dans sa postface : il a moins cherché à faire oeuvre d'historien qu'à construire une histoire qui sait prendre les libertés nécessaires avec l'Histoire, avérée ou précisément douteuse.
Au final donc, un bon plaisir de lecture.
J'ai adoré ce livre !!!
Même si voilà une vie de Copernic romancée, elle n'en est pas moins très crédible. L'auteur a beaucoup travaillé sur l'Histoire en puisant dans les lettres et récits d'époques. L'auteur décrit l'époque, les relations entre les gens, les connaissances de l'époque et comment Copernic a développé sa théorie.
L'écriture est simple, qui nous transporte dans le bureau de Copernic pour l'observer comme une petite souris. Rien n'est exagéré.
J'ai aimé les explications finales qui apportent une crédibilité supplémentaire au récit.
Pour tous les amoureux de l'Histoire des sciences.
Même si voilà une vie de Copernic romancée, elle n'en est pas moins très crédible. L'auteur a beaucoup travaillé sur l'Histoire en puisant dans les lettres et récits d'époques. L'auteur décrit l'époque, les relations entre les gens, les connaissances de l'époque et comment Copernic a développé sa théorie.
L'écriture est simple, qui nous transporte dans le bureau de Copernic pour l'observer comme une petite souris. Rien n'est exagéré.
J'ai aimé les explications finales qui apportent une crédibilité supplémentaire au récit.
Pour tous les amoureux de l'Histoire des sciences.
Devant l'Univers, nous sommes tout petits et perdus. Jean-Pierre Luminet est l'un de nos plus grands astrophysiciens. Il travaille au CNRS et fait partie de l'équipe de l'Observatoire Paris-Meudon. C'est un spécialiste international des trous noirs, ces ogres cosmiques qui défient l'imagination. Il est aussi un excellent vulgarisateur de cette science étonnante et passionnante qu'est la cosmologie. Un astéroïde porte d'ailleurs son nom en hommage à ses travaux.
Son dernier ouvrage s'appelle "100 questions sur l'univers" et s'adresse à un public très large.
Les questions balayées ici sont très larges: comment fait-on pour capter la lumière invisible, comment mesure-t-on les distances dans l'Univers, que sont vraiment les neutrinos, qu'est ce qu'est la matière noire qui constitue 85% de l'Univers, où s'arrête le système solaire, que va devenir l'Univers; le soleil se déplace-t-il dans la galaxie, comment naissent et meurent les étoiles, quelle a été la chronologie de l'Univers, qu'est-ce que la théorie des cordes; etc..
A chaque fois les réponses données par l'auteur sont extrêmement claires et le mérite de l'auteur est aussi de montrer combien cette science de l'astronomie est évolutive, ainsi la théorie du Big Bang peut être "revisitée" par certains scientifiques.
L'intérêt du livre est aussi de montrer les principales théories qui ont été développées en mastière d'astrophysique.
Certains travaux sont moins connus du grand public, comme les travaux réalisés par le savant belge Georges Lemaître dans les années 20, ce savant (qui était aussi un prêtre jésuite) s'est basé sur les théories récentes à l'époque de Einstein pour théoriser, avec le Russe Friedmann la notion d'expansion de l'Univers.
Le livre est passionnant d'un bout à l'autre.
On apprend par exemple que des centaines de tonnes de météorites tombent chaque jour sur la Terre, on apprend que la Lune s'éloigne de la Terre de plusieurs cm par an, ce qui posera à très long terme le problème de la stabilité de la Terre sur son axe, on apprend aussi que la plupart des galaxies ont dans leur centre un énorme "trou noir" qui peut avaler plusieurs étoiles par an.
Notre galaxie la Voie Lactée a aussi en son centre un énorme trou noir.
Bref c'est un livre passionnant et qui apprend plein de choses aussi aux scientifiques...
Son dernier ouvrage s'appelle "100 questions sur l'univers" et s'adresse à un public très large.
Les questions balayées ici sont très larges: comment fait-on pour capter la lumière invisible, comment mesure-t-on les distances dans l'Univers, que sont vraiment les neutrinos, qu'est ce qu'est la matière noire qui constitue 85% de l'Univers, où s'arrête le système solaire, que va devenir l'Univers; le soleil se déplace-t-il dans la galaxie, comment naissent et meurent les étoiles, quelle a été la chronologie de l'Univers, qu'est-ce que la théorie des cordes; etc..
A chaque fois les réponses données par l'auteur sont extrêmement claires et le mérite de l'auteur est aussi de montrer combien cette science de l'astronomie est évolutive, ainsi la théorie du Big Bang peut être "revisitée" par certains scientifiques.
L'intérêt du livre est aussi de montrer les principales théories qui ont été développées en mastière d'astrophysique.
Certains travaux sont moins connus du grand public, comme les travaux réalisés par le savant belge Georges Lemaître dans les années 20, ce savant (qui était aussi un prêtre jésuite) s'est basé sur les théories récentes à l'époque de Einstein pour théoriser, avec le Russe Friedmann la notion d'expansion de l'Univers.
Le livre est passionnant d'un bout à l'autre.
On apprend par exemple que des centaines de tonnes de météorites tombent chaque jour sur la Terre, on apprend que la Lune s'éloigne de la Terre de plusieurs cm par an, ce qui posera à très long terme le problème de la stabilité de la Terre sur son axe, on apprend aussi que la plupart des galaxies ont dans leur centre un énorme "trou noir" qui peut avaler plusieurs étoiles par an.
Notre galaxie la Voie Lactée a aussi en son centre un énorme trou noir.
Bref c'est un livre passionnant et qui apprend plein de choses aussi aux scientifiques...
L’astrophysicien Jean-Pierre Luminet nous fait vivre sous forme romancée le choc idéologique qui a opposé l’expérimentateur de génie Tycho Brahé, au théoricien astronome, non moins génial, Johann Kepler.
A première vue, tout les oppose : le premier, catholique, bon vivant, exubérant, le second protestant et austère. On découvre au fil des pages comment l’un aura besoin de l’autre. Les mesures astronomiques d’une précision jamais égalée jusqu’alors de Tycho Brahé serviront à Kepler non seulement à pérenniser l’héliocentrisme de Copernic, mais seront également à la base des fameuses lois de Kepler, en particulier la démonstration des orbites elliptiques des planètes.
Par ailleurs l’auteur nous plonge dans la vie quotidienne de l'époque, en nous faisant suivre des hommes évoluant dans un contexte complexe historique, géographique et religieux. Même si certaines longueurs rendent la lecture parfois laborieuse, on se laisse entraîner dans ces aventures scientifiques,épiques et romanesques de la fin du seizième siècle. En fermant le livre, on en saura un peu plus sur l’histoire des idées et des sciences concernant cette époque charnière. On retrouvera avec plaisir Kepler dans le tome trois des « bâtisseurs du ciel » au titre trompeur « L’œil de Galilée », où il est plus question de l’Allemand que de l’Italien.
A première vue, tout les oppose : le premier, catholique, bon vivant, exubérant, le second protestant et austère. On découvre au fil des pages comment l’un aura besoin de l’autre. Les mesures astronomiques d’une précision jamais égalée jusqu’alors de Tycho Brahé serviront à Kepler non seulement à pérenniser l’héliocentrisme de Copernic, mais seront également à la base des fameuses lois de Kepler, en particulier la démonstration des orbites elliptiques des planètes.
Par ailleurs l’auteur nous plonge dans la vie quotidienne de l'époque, en nous faisant suivre des hommes évoluant dans un contexte complexe historique, géographique et religieux. Même si certaines longueurs rendent la lecture parfois laborieuse, on se laisse entraîner dans ces aventures scientifiques,épiques et romanesques de la fin du seizième siècle. En fermant le livre, on en saura un peu plus sur l’histoire des idées et des sciences concernant cette époque charnière. On retrouvera avec plaisir Kepler dans le tome trois des « bâtisseurs du ciel » au titre trompeur « L’œil de Galilée », où il est plus question de l’Allemand que de l’Italien.
Il m’arrive très souvent de me caler devant la télé et regarder ces documentaires diffusés sur National geographic channel surtout ceux liés à l’astronomie, parmi lesquels on pourrait citer « Cosmos : une odyssée à travers l’univers » dont Neil deGrasse Tyson nous apporte toute sa science. Lorsque Babelio a proposé cette masse critique, mes yeux se sont posés indubitablement sur « De l’infini » de Jean-Pierre Luminet et Marc Lachièze-Rey. J’ai donc eu la chance de pouvoir recevoir ce beau livre et je remercie L’Édition Dunod et Babelio.
J’ignorais tout ce livre avant de l’avoir ouvert. J’avais juste quelques appréhensions. N’étant pas friands de tout ce qui trop scientifique, notamment les mathématiques et la physique, je me suis posé des questions sur le bon choix de cet ouvrage.
Hélas mes doutes se sont avérés exacts. C’est très scolaire, même très ardu. J’aurais bien aimé que ce livre soit plus abordable et non élitiste. Tout commence par un prologue, que j’ai trouvé plutôt philosophique. S’ensuit différents chapitres (L’infini du ciel, l’infini du nombre, l’infini de la matière, des singularités à la gravitation quantique) eux-mêmes divisés en sous-chapitres.
L’ouvrage est enrichi à la fois par des illustrations, mais aussi par des articles intéressants sur les personnalités scientifiques (Isaac Newton, Louis Auguste Blanqui, pour ne citer qu’eux).
Cette thèse sur l’infini est trop complexe pour moi. Pourtant il est intéressant de lire des faits historiques mettant en scène les divisions entre le monde scientifique et celui de la religion et ce, depuis l’Antiquité (Lucrèce) mais aussi au Moyen Âge (Copernic).
Le tout est agrémenté de notes qui ne sont pas renvoyées au bas de la page, mais malheureusement à la fin du livre. C’est dommage parce que ça n’incite pas à les lire.
Il est intéressant de voir les différentes possibilités de l’infini. On l’assimile souvent avec l’espace, mais c’est également le temps, le nombre et, ce que l’on pense le moins, la taille. L’infini n’est pas seulement au sens large, mais également à l’échelle de miniature comme les atomes.
L’être humain se pose beaucoup de questions sur l’infini car elle dépasse notre perception.
Il m’est difficile d’apprécier à sa juste valeur cet ouvrage tant j’ai été dupé – notamment par cette couverture. J’espérais davantage comprendre l’univers, l’astronomie, tout le monde qui nous entoure. Au lieu de cela j’ai été embarqué sur une longue thèse – pas forcément inintéressante – trop complexe et trop scolaire à mon goût. On ne lit pas un tel ouvrage comme un roman.
Notons le travail effectué par ces deux auteurs. Il est ici conséquent et bien documenté N’étant pas adepte de la science pure et dure, j’ai apprécié ces exemples historiques, bien que j’aurais aimé qu’elles soient plus développées.
J’ignorais tout ce livre avant de l’avoir ouvert. J’avais juste quelques appréhensions. N’étant pas friands de tout ce qui trop scientifique, notamment les mathématiques et la physique, je me suis posé des questions sur le bon choix de cet ouvrage.
Hélas mes doutes se sont avérés exacts. C’est très scolaire, même très ardu. J’aurais bien aimé que ce livre soit plus abordable et non élitiste. Tout commence par un prologue, que j’ai trouvé plutôt philosophique. S’ensuit différents chapitres (L’infini du ciel, l’infini du nombre, l’infini de la matière, des singularités à la gravitation quantique) eux-mêmes divisés en sous-chapitres.
L’ouvrage est enrichi à la fois par des illustrations, mais aussi par des articles intéressants sur les personnalités scientifiques (Isaac Newton, Louis Auguste Blanqui, pour ne citer qu’eux).
Cette thèse sur l’infini est trop complexe pour moi. Pourtant il est intéressant de lire des faits historiques mettant en scène les divisions entre le monde scientifique et celui de la religion et ce, depuis l’Antiquité (Lucrèce) mais aussi au Moyen Âge (Copernic).
Le tout est agrémenté de notes qui ne sont pas renvoyées au bas de la page, mais malheureusement à la fin du livre. C’est dommage parce que ça n’incite pas à les lire.
Il est intéressant de voir les différentes possibilités de l’infini. On l’assimile souvent avec l’espace, mais c’est également le temps, le nombre et, ce que l’on pense le moins, la taille. L’infini n’est pas seulement au sens large, mais également à l’échelle de miniature comme les atomes.
L’être humain se pose beaucoup de questions sur l’infini car elle dépasse notre perception.
Il m’est difficile d’apprécier à sa juste valeur cet ouvrage tant j’ai été dupé – notamment par cette couverture. J’espérais davantage comprendre l’univers, l’astronomie, tout le monde qui nous entoure. Au lieu de cela j’ai été embarqué sur une longue thèse – pas forcément inintéressante – trop complexe et trop scolaire à mon goût. On ne lit pas un tel ouvrage comme un roman.
Notons le travail effectué par ces deux auteurs. Il est ici conséquent et bien documenté N’étant pas adepte de la science pure et dure, j’ai apprécié ces exemples historiques, bien que j’aurais aimé qu’elles soient plus développées.
Une épopée spatiale en 40 petits chapitres de 3 à 4 pages. Des anecdotes aux faits les plus sérieux, de la compétition entre l'Amérique et la Russie le tout dans un contexte de guerre froide, jusqu'au devenir pour l'humanité, voilà de quoi faire un projet du plus haut intérêt à l'échelle humaine.
Formidable petite lecture, facile, agréable et qui nous tient en haleine, comme si on flottait dans l'aventure spatiale, on ne peut s'empêcher de penser à tous ces courageux astronautes qui nous font rêver et dont l'esprit de conquête nous rappelle qu'il reste beaucoup à faire pour passer à une étape possible de vie non terrestre, la science nous guidera sur ces chemins de traverses.
Formidable petite lecture, facile, agréable et qui nous tient en haleine, comme si on flottait dans l'aventure spatiale, on ne peut s'empêcher de penser à tous ces courageux astronautes qui nous font rêver et dont l'esprit de conquête nous rappelle qu'il reste beaucoup à faire pour passer à une étape possible de vie non terrestre, la science nous guidera sur ces chemins de traverses.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

La Grande Librairie 2022-2023
Laurie777
124 livres

Les romans historiques
GabySensei
166 livres
Auteurs proches de Jean-Pierre Luminet
Lecteurs de Jean-Pierre Luminet (931)Voir plus
Quiz
Voir plus
Le quiz des animaux (BD) facile
Spip
Tintin
Gargamel
Boule
Lucky Luke
Yakari
John
Gaston Lagaffe
Spirou
Astérix et Obélix
Ma Dalton
10 questions
31 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur31 lecteurs ont répondu