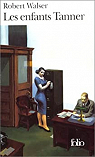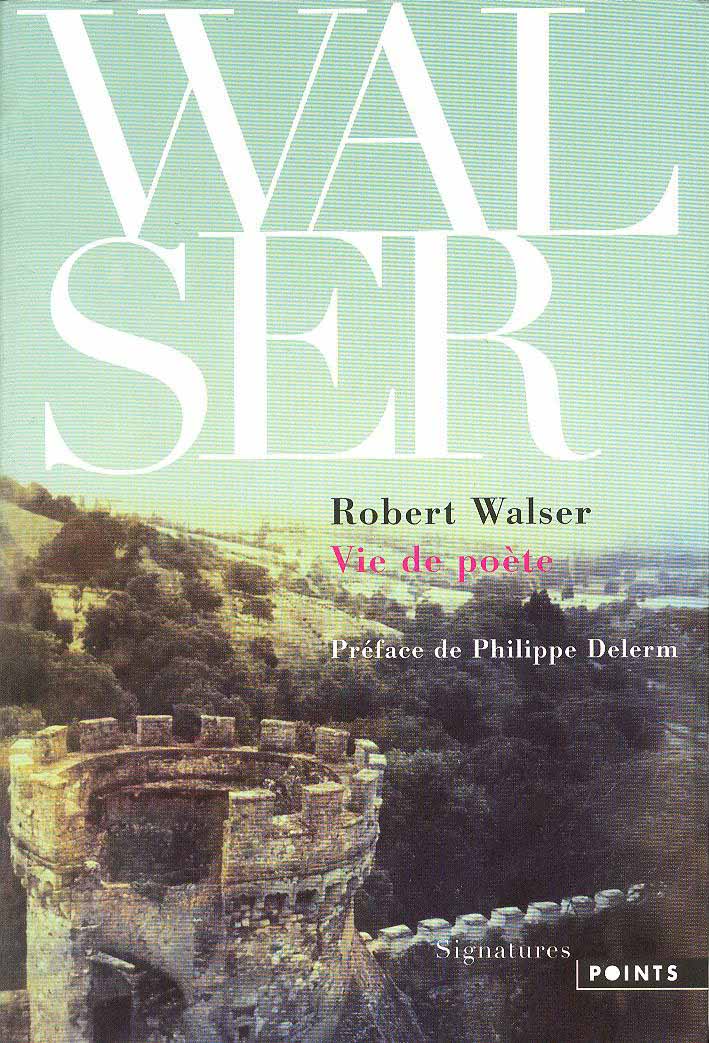Robert Walser/5
116 notes
Résumé :
« Nous apprenons très peu ici, on manque de personnel enseignant, et nous autres, garçons de l'Institut Benjamenta, nous n'arriverons à rien, c'est-à-dire que nous serons plus tard des gens très humbles et subalternes. » Dès la première phrase, le ton est donné. Jacob von Gunten a quitté sa famille pour entrer de son plein gré dans ce pensionnat où l'on n'apprend qu'une chose : obéir sans discuter. C'est une discipline du corps et de l'âme qui lui procure de curieux... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'institut BenjamentaVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (17)
Voir plus
Ajouter une critique
Cet ouvrage a été sélectionné par le Goethe Club des lecteurs d'Ostende dont je suis membre, pour discussion ce dimanche 22 avril. L'original du titre de cette oeuvre de l'écrivain suisse, en langue allemande, Robert Walser (1878-1956) est fort différent : "Jakob von Gunten. Ein Tagebuch" ou le nom du protagoniste principal, suivi de 'un journal (intime)'. On est donc loin de cet Institut Benjamenta situé à un endroit géographique non spécifié. Symbolique ?
Je dois admettre que la lecture, et à plus forte raison la critique de cette oeuvre, m'ont causé des problèmes. En fait, l'auteur m'a mis devant un paradoxe : d'un côté, on sent évidemment qu'on a à faire à un grand monsieur de la littérature mondiale ; d'un autre côté, on se sent comme un étranger dans son univers tout à fait particulier. le parallèle entre Robert Walser et Franz Kafka a souvent été fait...et à juste titre. Bien que je trouve que l'esprit de Walser est encore plus difficile à pénétrer que celui du grand maître de Prague.
Les réactions des lecteurs sont extrêmement divergentes : il y a ceux qui sont éblouis par son talent et estiment, comme le "New Yorker", qu'il s'agit d'un véritable chef d'oeuvre littéraire ; et ceux qui n'ont pas accroché. Honnêtement, il me faut avouer - à tort ou à raison - que j'appartienne à la deuxième catégorie. Et j'ajouterai que certains passages m'ont plutôt ennuyé. Peut-être parce que cet ouvrage manque un récit, dans le sens d'un enchaînement d'événements.
"L'institut Benjamenta" se présente avant tout comme une création d'atmosphère et cette atmosphère est celle qui, en Allemand, est qualifiée par le mot "Weltschmerz", où Welt est monde et Schmerz douleur. En d'autres mots, un sentiment de souffrance de l'individu devant un monde qui lui échappe et où il se sent plus ou moins perdu. L'écrivain John Green définit ce terme dans son roman comme "le sentiment d'abattement qu'on ressent quand le monde extérieur ne correspond pas au monde tel qu'on voudrait qu'il soit" (source Wikipédia pour la citation).
Le "Weltschmerz" était relativement bien répandu parmi les auteurs de l'Europe centrale de l'époque où cet ouvrage a paru, en 1909. Comme exemples, je mentionne Hermann Hesse et Heinrich Heine. Sans oublier Kafka, bien entendu.
Force est de constater que Robert Walser est un virtuose de la parole et un maître dans la formulation d'idées contradictoires.
Son jeune héros, Jakob von Gunten, excelle dans cet art. Les descriptions qu'il nous livre de ses camarades à l'institut, de son directeur Benjamenta et sa soeur Lisa Benjamenta, ainsi que de son propre frère, Johann, l'artiste, en sont remplies. Jakob lui-même ne fait pas exception à la règle : il a une multitude de conceptions sur le monde tel qu'il existe et devrait être, mais déclare aussi n'avoir de la vie "absolument aucune attente". Autre exemple : il considère Kraus comme son meilleur ami, mais ne peut s'empêcher de lui faire part de considérations dont il sait parfaitement bien qu'il aille les trouver débiles.
J'étais curieux d'apprendre les impressions de mes amis du Goethe Club d'Ostende, ce matin. Je n'ai pas été surpris outre mesure de constater que les avis y étaient autant partagés que parmi les chroniqueurs sur Babelio.
Celles et ceux qui sont intéressés par ce grand auteur un peu à part, je conseille vivement de lire la très belle biographie que l'écrivaine et journaliste française, d'origine autrichienne, en a publié, en 1989, Catherine Sauvat : "Robert Walser", réédité chez le Rocher en 2002. Cette auteure est connue pour ses biographies de Stefan Zweig et surtout d'Alma Mahler, livre que je compte chroniquer sous peu.
Pour finir, hélas, pas en beauté... 2 anecdotes.
1) du remarquable ouvrage de Laurent Seksik "Le cas d'Eduard Einstein", nous savons que le fils du génie d'Albert Einstein a passé un certain temps en clinique psychiatrique. À un moment donné, il y a passé son séjour en compagnie de Robert Walser, qui a été hospitalisé en 1929, à l'âge de 51 ans, au Centre d'Herisau en Suisse.
2) Ce dernier y est mort, en se promenant dans la neige, le jour de Noël 1956 ! Il avait 78 ans. Lire à ce propos de Carl Seelig "Promenades avec Robert Walser".
Je dois admettre que la lecture, et à plus forte raison la critique de cette oeuvre, m'ont causé des problèmes. En fait, l'auteur m'a mis devant un paradoxe : d'un côté, on sent évidemment qu'on a à faire à un grand monsieur de la littérature mondiale ; d'un autre côté, on se sent comme un étranger dans son univers tout à fait particulier. le parallèle entre Robert Walser et Franz Kafka a souvent été fait...et à juste titre. Bien que je trouve que l'esprit de Walser est encore plus difficile à pénétrer que celui du grand maître de Prague.
Les réactions des lecteurs sont extrêmement divergentes : il y a ceux qui sont éblouis par son talent et estiment, comme le "New Yorker", qu'il s'agit d'un véritable chef d'oeuvre littéraire ; et ceux qui n'ont pas accroché. Honnêtement, il me faut avouer - à tort ou à raison - que j'appartienne à la deuxième catégorie. Et j'ajouterai que certains passages m'ont plutôt ennuyé. Peut-être parce que cet ouvrage manque un récit, dans le sens d'un enchaînement d'événements.
"L'institut Benjamenta" se présente avant tout comme une création d'atmosphère et cette atmosphère est celle qui, en Allemand, est qualifiée par le mot "Weltschmerz", où Welt est monde et Schmerz douleur. En d'autres mots, un sentiment de souffrance de l'individu devant un monde qui lui échappe et où il se sent plus ou moins perdu. L'écrivain John Green définit ce terme dans son roman comme "le sentiment d'abattement qu'on ressent quand le monde extérieur ne correspond pas au monde tel qu'on voudrait qu'il soit" (source Wikipédia pour la citation).
Le "Weltschmerz" était relativement bien répandu parmi les auteurs de l'Europe centrale de l'époque où cet ouvrage a paru, en 1909. Comme exemples, je mentionne Hermann Hesse et Heinrich Heine. Sans oublier Kafka, bien entendu.
Force est de constater que Robert Walser est un virtuose de la parole et un maître dans la formulation d'idées contradictoires.
Son jeune héros, Jakob von Gunten, excelle dans cet art. Les descriptions qu'il nous livre de ses camarades à l'institut, de son directeur Benjamenta et sa soeur Lisa Benjamenta, ainsi que de son propre frère, Johann, l'artiste, en sont remplies. Jakob lui-même ne fait pas exception à la règle : il a une multitude de conceptions sur le monde tel qu'il existe et devrait être, mais déclare aussi n'avoir de la vie "absolument aucune attente". Autre exemple : il considère Kraus comme son meilleur ami, mais ne peut s'empêcher de lui faire part de considérations dont il sait parfaitement bien qu'il aille les trouver débiles.
J'étais curieux d'apprendre les impressions de mes amis du Goethe Club d'Ostende, ce matin. Je n'ai pas été surpris outre mesure de constater que les avis y étaient autant partagés que parmi les chroniqueurs sur Babelio.
Celles et ceux qui sont intéressés par ce grand auteur un peu à part, je conseille vivement de lire la très belle biographie que l'écrivaine et journaliste française, d'origine autrichienne, en a publié, en 1989, Catherine Sauvat : "Robert Walser", réédité chez le Rocher en 2002. Cette auteure est connue pour ses biographies de Stefan Zweig et surtout d'Alma Mahler, livre que je compte chroniquer sous peu.
Pour finir, hélas, pas en beauté... 2 anecdotes.
1) du remarquable ouvrage de Laurent Seksik "Le cas d'Eduard Einstein", nous savons que le fils du génie d'Albert Einstein a passé un certain temps en clinique psychiatrique. À un moment donné, il y a passé son séjour en compagnie de Robert Walser, qui a été hospitalisé en 1929, à l'âge de 51 ans, au Centre d'Herisau en Suisse.
2) Ce dernier y est mort, en se promenant dans la neige, le jour de Noël 1956 ! Il avait 78 ans. Lire à ce propos de Carl Seelig "Promenades avec Robert Walser".
L'Institut Benjamenta est un petit établissement qui se fait connaître de bouche à oreille... Tenu par deux enseignants qui tiennent davantage lieu de parents officieux que de professeurs officiels, son programme se résume brièvement :
« Il n'y a qu'un seul cours qui se répète continuellement : « Comment un garçon doit-il se conduire ? » En somme, tout l'enseignement tourne autour de ce problème. »
A partir de là, les brimades, punitions et humiliations ne nécessitent plus de justification et s'exercent sur les rares élèves qui se sont dévoués à intégrer l'Institut Benjamenta. Démarche masochiste ? … ou démarche désespérée. Pour Jacob von Gunten, il est clair que son intégration relève surtout du premier penchant, mais aussi d'une volonté salvatrice de quitter un milieu social aisé où tout est donné, où tout est factice, pour repartir dans l'anonymat le plus complet et pour acquérir son mérite par ses propres forces. Mais si Jacob justifie ainsi son intégration, quels sont les mobiles qui expliquent la présence de Kraus le simplet, de Fuchs l'hypocrite ou de Hans le primaire ? Et qu'est-ce qui a pu conduire M. Benjamenta à ouvrir cet étrange institut où l'on enseigne l'humilité jusqu'à l'abnégation ?
Jacob von Gunten passe au crible de son regard amusé le caractère et les manies de ses camarades. A travers eux, un large pan de l'humanité se laisse déjà décrire. Ne manquait plus que l'étude de la personnalité du narrateur, qui bénéficie de toutes les nuances progressivement acquises par l'enseignement Benjamenta. Humour et dérision caractérisent ce Jacob qui sait n'être rien mais qui ne peut s'empêcher de jouer la tragédie, se lamentant et pleurant sur son sort avec un air de je-m'en-foutisme aérien.
« Je serai toujours capable de m'échauffer, car rien de personnel ni d'égoïste ne m'empêchera jamais de me passionner, de m'enflammer, d'éprouver de la sympathie. Comme je suis heureux de n'avoir rien découvert en moi qui fût estimable ou curieux ! Être insignifiant et le rester. »
La ressemblance avec Kafka est évidente mais la plus frappante est peut-être celle qui unit cet Institut Benjamenta à La faim de Knut Hamsun. En effet, que caractérise le mieux les narrateurs de ces deux romans sinon leur volonté incompréhensible, masochiste et autodestructrice, de vouloir se placer de leur propre gré dans des situations impossibles, de s'y installer douloureusement et d'en jouir avec tristesse ?
« Reverrai-je jamais un sapin de montagne ? Ce ne serait d'ailleurs pas un bien grand malheur. Se passer de quelque chose : cela aussi a de l'odeur et de la sève. »
On découvre également des similitudes entre les pensées de Jacob et la force vitale transmise par la philosophie dansante d'un Nietzsche ou d'un Cioran (« La race humaine perd le courage de vivre avec toutes ces sciences, dissertations et traités ») mais ici, l'abolition de la frontière entre légèreté et aliénation se fait extrêmement ténue. On progresse avec appréhension dans la lecture, se demandant à chaque page tournée vers quel monstre d'insignifiance se dirige Jacob von Gunten.
L'institut Benjamenta, s'il plaît ou attire, mériterait que l'on se pose cette question : quel moteur inconscient nous pousse nous-mêmes à rechercher l'humiliation par substitution ? Quel plaisir pensons-nous tirer du récit d'un jeune garçon qui procède sciemment au gâchis de son existence ? L'institut Benjamenta se donne l'apparence d'un institut fermé inaccessible au grand nombre : il faut passer des examens pour y être intégré et suivre ensuite une discipline fermement inculquée. Mais certaines indications devraient nous mettre en alerte :
« L'enseignement qui nous est donné consiste ici principalement à nous inculquer l'obéissance et la patience, deux qualités qui promettent peu de succès, voire pas du tout. Des succès intérieurs, certes. Mais quel profit tire-t-on de ceux-là ? »
Et qu'est-ce que la vie docile, soumise aux volontés d'autrui, dont les potentialités ont été gâchées à force d'aliénation, sinon un Institut Benjamenta grandeur nature ? Prenant conscience de cette ressemblance, on oscillera une fois encore entre répulsion et attrait –attrait pour cette communion de l'indifférence qui se fait dans la joie la plus résignée qui soit, et répulsion pour l'insignifiance même d'un récit qui semble n'être plus qu'une voix anonyme perdue dans un immense brouhaha.
Lien : http://colimasson.over-blog...
« Il n'y a qu'un seul cours qui se répète continuellement : « Comment un garçon doit-il se conduire ? » En somme, tout l'enseignement tourne autour de ce problème. »
A partir de là, les brimades, punitions et humiliations ne nécessitent plus de justification et s'exercent sur les rares élèves qui se sont dévoués à intégrer l'Institut Benjamenta. Démarche masochiste ? … ou démarche désespérée. Pour Jacob von Gunten, il est clair que son intégration relève surtout du premier penchant, mais aussi d'une volonté salvatrice de quitter un milieu social aisé où tout est donné, où tout est factice, pour repartir dans l'anonymat le plus complet et pour acquérir son mérite par ses propres forces. Mais si Jacob justifie ainsi son intégration, quels sont les mobiles qui expliquent la présence de Kraus le simplet, de Fuchs l'hypocrite ou de Hans le primaire ? Et qu'est-ce qui a pu conduire M. Benjamenta à ouvrir cet étrange institut où l'on enseigne l'humilité jusqu'à l'abnégation ?
Jacob von Gunten passe au crible de son regard amusé le caractère et les manies de ses camarades. A travers eux, un large pan de l'humanité se laisse déjà décrire. Ne manquait plus que l'étude de la personnalité du narrateur, qui bénéficie de toutes les nuances progressivement acquises par l'enseignement Benjamenta. Humour et dérision caractérisent ce Jacob qui sait n'être rien mais qui ne peut s'empêcher de jouer la tragédie, se lamentant et pleurant sur son sort avec un air de je-m'en-foutisme aérien.
« Je serai toujours capable de m'échauffer, car rien de personnel ni d'égoïste ne m'empêchera jamais de me passionner, de m'enflammer, d'éprouver de la sympathie. Comme je suis heureux de n'avoir rien découvert en moi qui fût estimable ou curieux ! Être insignifiant et le rester. »
La ressemblance avec Kafka est évidente mais la plus frappante est peut-être celle qui unit cet Institut Benjamenta à La faim de Knut Hamsun. En effet, que caractérise le mieux les narrateurs de ces deux romans sinon leur volonté incompréhensible, masochiste et autodestructrice, de vouloir se placer de leur propre gré dans des situations impossibles, de s'y installer douloureusement et d'en jouir avec tristesse ?
« Reverrai-je jamais un sapin de montagne ? Ce ne serait d'ailleurs pas un bien grand malheur. Se passer de quelque chose : cela aussi a de l'odeur et de la sève. »
On découvre également des similitudes entre les pensées de Jacob et la force vitale transmise par la philosophie dansante d'un Nietzsche ou d'un Cioran (« La race humaine perd le courage de vivre avec toutes ces sciences, dissertations et traités ») mais ici, l'abolition de la frontière entre légèreté et aliénation se fait extrêmement ténue. On progresse avec appréhension dans la lecture, se demandant à chaque page tournée vers quel monstre d'insignifiance se dirige Jacob von Gunten.
L'institut Benjamenta, s'il plaît ou attire, mériterait que l'on se pose cette question : quel moteur inconscient nous pousse nous-mêmes à rechercher l'humiliation par substitution ? Quel plaisir pensons-nous tirer du récit d'un jeune garçon qui procède sciemment au gâchis de son existence ? L'institut Benjamenta se donne l'apparence d'un institut fermé inaccessible au grand nombre : il faut passer des examens pour y être intégré et suivre ensuite une discipline fermement inculquée. Mais certaines indications devraient nous mettre en alerte :
« L'enseignement qui nous est donné consiste ici principalement à nous inculquer l'obéissance et la patience, deux qualités qui promettent peu de succès, voire pas du tout. Des succès intérieurs, certes. Mais quel profit tire-t-on de ceux-là ? »
Et qu'est-ce que la vie docile, soumise aux volontés d'autrui, dont les potentialités ont été gâchées à force d'aliénation, sinon un Institut Benjamenta grandeur nature ? Prenant conscience de cette ressemblance, on oscillera une fois encore entre répulsion et attrait –attrait pour cette communion de l'indifférence qui se fait dans la joie la plus résignée qui soit, et répulsion pour l'insignifiance même d'un récit qui semble n'être plus qu'une voix anonyme perdue dans un immense brouhaha.
Lien : http://colimasson.over-blog...
Ce roman est un enchantement. Walser semble l'avoir envisagé à la lumière des contes de fées. Je crois que Kafka considérait « L'institut Benjamenta » comme le roman de Walser le plus proche de ce que lui-même écrivait. Et il y a effectivement des points communs. Un conte ce n'est pas simplement une histoire merveilleuse pour faire rêver les enfants, c'est aussi quelque chose d'inquiétant, sujet aux multiples interprétations, où le féérique se dispute aux peurs les plus enfouies.
L'histoire de « L'institut Benjamenta », conçu comme un journal intime, raconte le quotidien de Jacob von Gutten, un élève de cet institut, une école où les étudiants n'apprennent strictement rien, à part l'obéissance, une école qui forme des domestiques. Jacob - le rejeton d'une haute famille qui aspire donc à devenir un serviteur -, évoque les autres élèves de cette école, leurs caractères et ses relations avec eux, ainsi que le directeur et sa soeur. C'est du pur Walser ! Dès le début on reconnait son humour, les mots cassants, acerbes, au milieu de longues phrases cajoleuses. Mais il s'en repentit aussitôt, préférant à ces manifestations de vérité orgueilleuses célébrer la beauté et la bonté. Ce qui n'empêche pas Jacob de recommencer ses provocations par la suite… On rigole beaucoup de cette façon légère et délicate de se moquer des règles, des jugements, des rapports sociaux, de domination, de la bienséance, dont Jacob est par ailleurs le chantre absolu. Car il y a toujours l'humilité qui rentre en jeu, et même le soupçon d'une mystérieuse recherche de punition, plus que de l'humilité, de l'humiliation. Peu à peu Jacob abandonne sa causticité pour se contenter de l'émerveillement que lui procure la complexité des êtres et de leurs relations.
Où est l'enchantement ? Plus que dans les rêves de Jacob et dans la transformation de mademoiselle Benjamenta en une princesse ou une fée et monsieur Benjamenta en une sorte d'ogre ou de Barbe Bleue, l'enchantement est dans l'effleurement, la grâce de vouloir se maintenir à la surface des choses, ne pas s'attarder sur les laideurs et les malheurs de la vie. En fait, les désigner pour mieux les voiler de belles paroles et pouvoir les aimer.
[A part ça, il y a un nombre de coquilles impressionnant... Comme je l'ai déjà remarqué plusieurs fois dans la collection « L'imaginaire » de Gallimard. ]
L'histoire de « L'institut Benjamenta », conçu comme un journal intime, raconte le quotidien de Jacob von Gutten, un élève de cet institut, une école où les étudiants n'apprennent strictement rien, à part l'obéissance, une école qui forme des domestiques. Jacob - le rejeton d'une haute famille qui aspire donc à devenir un serviteur -, évoque les autres élèves de cette école, leurs caractères et ses relations avec eux, ainsi que le directeur et sa soeur. C'est du pur Walser ! Dès le début on reconnait son humour, les mots cassants, acerbes, au milieu de longues phrases cajoleuses. Mais il s'en repentit aussitôt, préférant à ces manifestations de vérité orgueilleuses célébrer la beauté et la bonté. Ce qui n'empêche pas Jacob de recommencer ses provocations par la suite… On rigole beaucoup de cette façon légère et délicate de se moquer des règles, des jugements, des rapports sociaux, de domination, de la bienséance, dont Jacob est par ailleurs le chantre absolu. Car il y a toujours l'humilité qui rentre en jeu, et même le soupçon d'une mystérieuse recherche de punition, plus que de l'humilité, de l'humiliation. Peu à peu Jacob abandonne sa causticité pour se contenter de l'émerveillement que lui procure la complexité des êtres et de leurs relations.
Où est l'enchantement ? Plus que dans les rêves de Jacob et dans la transformation de mademoiselle Benjamenta en une princesse ou une fée et monsieur Benjamenta en une sorte d'ogre ou de Barbe Bleue, l'enchantement est dans l'effleurement, la grâce de vouloir se maintenir à la surface des choses, ne pas s'attarder sur les laideurs et les malheurs de la vie. En fait, les désigner pour mieux les voiler de belles paroles et pouvoir les aimer.
[A part ça, il y a un nombre de coquilles impressionnant... Comme je l'ai déjà remarqué plusieurs fois dans la collection « L'imaginaire » de Gallimard. ]
Pour commencer, le titre original de ce roman de Walser se traduirait littéralement par « JAKOB VON GUNTEN. Un journal.1909 ». le titre de la traduction française est donc une pure invention, ce qui est problématique. En effet le roman est un journal, sans dates, de Jakob von Gunten, et de plus le fait qu'il soit LE personnage central est à la fois l'enjeu et le problème de ce roman. L'Institut Benjamenta en tant que tel n'est pas le sujet central du roman, c'est l'outil sur lequel s'appuie Jakob pour exprimer sa problématique existentielle. On peut donc se demander ce qui a traversé l'esprit de Marthe Robert, la traductrice, ou de l'éditeur d'origine, pour faire ce choix de travestir ainsi ce titre, et malheureusement on peut supposer que ce titre inventé leur ait paru plus vendeur que le titre walserien.
Pourquoi est-il ici question avant tout de Jakob, et pourquoi est-ce l'enjeu problématique du livre ? Parce que le livre tout entier repose sur la question subjective du personnage, pour qui exister est une tension permanente entre s'exprimer, se mettre en avant, vivre, profiter de la vie, (ce qui est supposément son penchant premier de nature), et s'anéantir, s'annihiler, s'humilier, s'effacer, et en définitive, être aussi invisible et utilitaire qu'un objet (ce qui est son impératif catégorique, si j'ose dire).
Jakob est un être qui semble toujours un peu à côté de lui-même. Il parle de ces enjeux, de fierté ou d'humiliation, d'être quelqu'un ou de n'être rien, comme si le sujet dont il était question était un autre. Il y a quelque chose d'Epictète dans sa distance vis à vis de ce qu'il vit. Et de Bartleby dans sa position d'énonciation, à ceci près que si Bartleby conserve une once d'opposition, ne serait-ce que dans le discours (I would prefer not to), Jakob von Gunten y a totalement renoncé. Il est ainsi dans une adhésion déconcertante avec l'idée d'être voué à l'esclavage et à une forme d'affliction existentielle irrémédiable. Ce que lui veut l'Autre, et ce à quoi il est voué à servir, semble n'avoir aucune limite, psychologique ou physique. Ainsi voit-on de façon répétée des ambiguïtés de conduite à consonance sexuelle de la part de pensionnaires, lointaine, climatique, et on perçoit nettement que la violence, même physique, que l'autre pourrait lui causer (M. Benjamenta au premier chef) n'est vraiment pas loin. Cependant cette violence faite par l'autre reste la plupart du temps allusive. Il y a dans le livre comme un climat, atmosphérique, de violence extrême qui s'exprime en toute civilité, entre gens de bien. Si je devais faire un parallèle avec une coutume médiévale, ce qu'on voit ici est l'envers de l'amour courtois : une forme consentie d'annihilation courtoise.
Il me semble que le roman exprime quelque chose de la position de Walser lui-même : une extériorité à soi-même assortie d'une sorte d'interdiction de vivre, ou de reproche d'exister.
Cependant, c'est peut-être une surinterprétation de ma part, on peut voir, dans cette réduction du sujet humain à une chose supposée consentante à être utilisée, une forme de préfiguration de la façon dont le capitalisme traite l'individu : un objet réduit au silence.
Pour finir, il faut dire que l'écriture est magnifique, à la fois dans son caractère évocateur et son ironie noire. Et qu'on ne peut manquer de reconnaître dans ce livre une influence singulière qui infusera l'oeuvre de Kafka (dans une modalité subjective plus volontiers en quête d'une issue), Beckett (dont la subjectivité de certains personnages est vraiment très proche de celle de Jakob), et, plus récemment Ishiguro (dans les Vestiges du jour et le personnage de Stevens).
Lien : http://www.williamjoshbeck.c..
Pourquoi est-il ici question avant tout de Jakob, et pourquoi est-ce l'enjeu problématique du livre ? Parce que le livre tout entier repose sur la question subjective du personnage, pour qui exister est une tension permanente entre s'exprimer, se mettre en avant, vivre, profiter de la vie, (ce qui est supposément son penchant premier de nature), et s'anéantir, s'annihiler, s'humilier, s'effacer, et en définitive, être aussi invisible et utilitaire qu'un objet (ce qui est son impératif catégorique, si j'ose dire).
Jakob est un être qui semble toujours un peu à côté de lui-même. Il parle de ces enjeux, de fierté ou d'humiliation, d'être quelqu'un ou de n'être rien, comme si le sujet dont il était question était un autre. Il y a quelque chose d'Epictète dans sa distance vis à vis de ce qu'il vit. Et de Bartleby dans sa position d'énonciation, à ceci près que si Bartleby conserve une once d'opposition, ne serait-ce que dans le discours (I would prefer not to), Jakob von Gunten y a totalement renoncé. Il est ainsi dans une adhésion déconcertante avec l'idée d'être voué à l'esclavage et à une forme d'affliction existentielle irrémédiable. Ce que lui veut l'Autre, et ce à quoi il est voué à servir, semble n'avoir aucune limite, psychologique ou physique. Ainsi voit-on de façon répétée des ambiguïtés de conduite à consonance sexuelle de la part de pensionnaires, lointaine, climatique, et on perçoit nettement que la violence, même physique, que l'autre pourrait lui causer (M. Benjamenta au premier chef) n'est vraiment pas loin. Cependant cette violence faite par l'autre reste la plupart du temps allusive. Il y a dans le livre comme un climat, atmosphérique, de violence extrême qui s'exprime en toute civilité, entre gens de bien. Si je devais faire un parallèle avec une coutume médiévale, ce qu'on voit ici est l'envers de l'amour courtois : une forme consentie d'annihilation courtoise.
Il me semble que le roman exprime quelque chose de la position de Walser lui-même : une extériorité à soi-même assortie d'une sorte d'interdiction de vivre, ou de reproche d'exister.
Cependant, c'est peut-être une surinterprétation de ma part, on peut voir, dans cette réduction du sujet humain à une chose supposée consentante à être utilisée, une forme de préfiguration de la façon dont le capitalisme traite l'individu : un objet réduit au silence.
Pour finir, il faut dire que l'écriture est magnifique, à la fois dans son caractère évocateur et son ironie noire. Et qu'on ne peut manquer de reconnaître dans ce livre une influence singulière qui infusera l'oeuvre de Kafka (dans une modalité subjective plus volontiers en quête d'une issue), Beckett (dont la subjectivité de certains personnages est vraiment très proche de celle de Jakob), et, plus récemment Ishiguro (dans les Vestiges du jour et le personnage de Stevens).
Lien : http://www.williamjoshbeck.c..
Que de mystères enfouis dans les "ambiances" et les psychologies d'un livre si court : des enfants-adolescents perdus, comme échoués là pour être "éduqués à l'obéissance absolue"... Une Fée et un Ogre - soeur et frère - comme "patrons" de l'Institut Benjamenta. L'étrange magie Walser, une fois de plus ! L'ambiance y est tout de même fort crépusculaire... Pour Jacob von Gunten, le jeune narrateur, la vie semble s'achever à la fin de l'ouvrage : s'en remettant à Dieu et au bon vouloir de l'Ogre... (puisque Lise Benjamenta, la soeur-fée de ce dernier vient de mourir). On sait qu'à cette époque, son créateur-vagabond avait à peine 31 ans.
Le dernier, très énigmatique et très bref roman de la trilogie magique (1907/1908/1909) de Robert WALSER.
Lien : http://www.regardsfeeriques...
Le dernier, très énigmatique et très bref roman de la trilogie magique (1907/1908/1909) de Robert WALSER.
Lien : http://www.regardsfeeriques...
Citations et extraits (56)
Voir plus
Ajouter une citation
J'ai fait la connaissance d'une foule de gens grâce à l'amabilité de Johann. Il y a parmi eux des artistes qui m'ont fait l'effet de gens gentils. Mais quoi, que peut-on dire quand on a eu un contact aussi superficiel? En vérité, les gens qui s'efforcent d'avoir du succès dans le monde se ressemble terriblement. Ils ont tous le même visage. Non, pas vraiment, et pourtant si. Ils se ressemblent par une certaine amabilité qui passe tout de suite, et je crois que ce que ces gens ressentent est de l'anxiété. Ils se débarrassent rapidement des êtres et des choses, à seule fin de pouvoir s'occuper des choses nouvelles qui, elles aussi, paraissent réclamer l'attention. Ils ne méprisent personne, ces braves gens, et pourtant si, peut-être méprisent-ils tout, mais ils n'ont pas le droit de le montrer, parce qu'ils craignent de commettre tout à coup quelque chose comme une imprudence. Ils sont aimables par mal du siècle, et gentils par anxiété. Et puis chacun d'entre eux veut avoir de l'estime pour lui-même. Ces gens sont des hommes du monde. Et ils ont l'air de ne jamais se sentir tout à fait à l'aise. Comment peut-on se sentir bien quand on attribue de la valeur aux preuves d'estime et au distinctions accordées par le monde? Et puis, je crois que ces hommes sentent qu'ils ne sont plus des créatures naturelles, mais des êtres sociaux, ayant toujours leur successeur sur les talons. Chacun sent l'adversaire inquiétant qui va le surprendre, le voleur qui vient en tapinois, avec un quelconque nouveau don, répandre toutes sortes de dommages et de dépréciations autour de lui; c'est pourquoi le phénomène tout nouveau est toujours le plus recherché et le plus favorisé dans ces milieux, et malheur aux anciens, quand cette nouveauté se distingue par l'esprit, le talent ou le génie naturel. Je m'exprime d'ailleurs d'une façon un peu simple. Il y a là encore tout autre chose. Il règne dans ces milieux de culture avancée une fatigue qu'il est à peine possible de ne pas voir, ou de mal comprendre. Ce n'est pas la lassitude formelle et blasé, disons de la noblesse de race, non, c'est une fatigue réelle, absolument vraie, reposant sur un sentiment plus élevé et plus vif, la fatigue de l'homme sain-malsain. Ils sont tous cultivés, mais s'estiment-ils entre eux? Quand ils réfléchissent honnêtement, ils sont satisfaits de leur position, mais sont-ils également content?
Quand on désespère et s’afflige, Jacob, on est si lamentablement mesquin, et les petitesses se jettent de plus en plus sur vous, comme une vermine rapide et vorace qui vous dévore très lentement, qui s’entend à vous étouffer et à vous avilir très lentement.
Mes photographies sont enfin prêtes. Je regarde le monde avec un air très, très énergique sur cette photo qui est vraiment réussie. Pour me fâcher, Kraus dit que j'ai l'air d'un Juif.Enfin, il rit un peu.《 Je t'en prie, Kraus, dis-je, les Juifs sont aussi des hommes.《 Nous nous querellons sur la valeur et la non valeur des Juifs, ce qui nous procure une merveilleuse distraction. Je m'étonne des bonnes opinions qu'il a.《Les Juifs ont tout l'argent》, Dit-il. J'approuve, je suis d'accord et j'ajoute: 《 C'est l'argent qui change les gens en Juifs.Un Juif pauvre n'en est pas un,et les chrétiens riches , merci bien , sont encore les pires Juifs qui soient.》--Il approuve enfin, enfin, j'ai fini par trouver l'approbation de cet homme.
Et quand une main, une circonstance, une vague me soulèveraient et me porteraient jusqu’en haut, là où règnent la puissance et le crédit, je détruirais l’état de choses qui me serait favorable, et je me jetterais moi-même au fond de l’obscurité basse et futile. Je ne puis respirer que dans les régions inférieures.
Quand on désespère et s’afflige..., on est si lamentablement mesquin, et les petitesses se jettent de plus en plus sur vous, comme une vermine rapide et vorace qui vous dévore très lentement, qui s’entend à vous étouffer et à vous avilir très lentement.
Videos de Robert Walser (6)
Voir plusAjouter une vidéo
Marion Graf présente le premier roman de Thilo Krause, "Presque étranger pourtant", qu'elle a traduit de l'allemand. Parution le 6 janvier 2022.
Un homme hanté par son enfance rentre au pays. Il y retrouve ses souvenirs intacts, les meilleurs comme les pires. Les allées de pommiers. le ciel immense. Les falaises de grès. Et Vito, l'ami d'enfance qui fut, dans un système asphyxiant, son compagnon d'apesanteur. Mais avec lui ressurgit le spectre de l'accident originel. Bientôt, la présence aimante de sa femme et de sa petite fille ne suffit plus à chasser le vertige. Des néo-nazis rôdent, une sourde menace plane, diffuse mais persistante. La nature échappe, se déchaîne. Quelle force pourra lever la chape de silence et d'hostilité ? le suspense subtil de ce roman place le lecteur au plus près du narrateur.
Thilo Krause est né à Dresde, en ex-Allemagne de l'Est, en 1977. Il est l'auteur de trois recueils de poèmes, tous primés. Presque étranger pourtant est son premier roman, lauréat du prix Robert Walser. Thilo Krause a l'art de traduire physiquement les émotions avec une précision et des images à couper le souffle.
https://editionszoe.ch/livre/presque-etranger-pourtant
Un homme hanté par son enfance rentre au pays. Il y retrouve ses souvenirs intacts, les meilleurs comme les pires. Les allées de pommiers. le ciel immense. Les falaises de grès. Et Vito, l'ami d'enfance qui fut, dans un système asphyxiant, son compagnon d'apesanteur. Mais avec lui ressurgit le spectre de l'accident originel. Bientôt, la présence aimante de sa femme et de sa petite fille ne suffit plus à chasser le vertige. Des néo-nazis rôdent, une sourde menace plane, diffuse mais persistante. La nature échappe, se déchaîne. Quelle force pourra lever la chape de silence et d'hostilité ? le suspense subtil de ce roman place le lecteur au plus près du narrateur.
Thilo Krause est né à Dresde, en ex-Allemagne de l'Est, en 1977. Il est l'auteur de trois recueils de poèmes, tous primés. Presque étranger pourtant est son premier roman, lauréat du prix Robert Walser. Thilo Krause a l'art de traduire physiquement les émotions avec une précision et des images à couper le souffle.
https://editionszoe.ch/livre/presque-etranger-pourtant
+ Lire la suite
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Robert Walser (36)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz: l'Allemagne et la Littérature
Les deux frères Jacob et Whilhelm sont les auteurs de contes célèbres, quel est leur nom ?
Hoffmann
Gordon
Grimm
Marx
10 questions
421 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature allemande
, guerre mondiale
, allemagneCréer un quiz sur ce livre421 lecteurs ont répondu