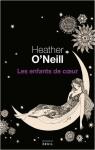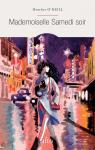Un roman fascinant qui commence par un duel au pistolet entre deux petites filles et la mort par balle d'une servante de la famille!
Dans le décor du Montréal de la fin du 19e siècle, deux fillettes, la riche et belle Marie Antoine aux boucles blondes qui habite une belle maison dans le Mile Doré et la méchante Sadie, à la chevelure sombre qui vient du quartier pauvre, le Mile Sordide.(des personnages symboliques qui me font un peu penser aux contes d'Amélie Nothomb).
C'est d'abord une histoire d'enfance avec ses amitiés, ses jalousies et ses trahisons. Mais c'est ensuite un éventail de thèmes : une fille en exil dans un pensionnat anglais pour apprendre les bonnes manières et une amie élevée dans un bordel.
Il y aura les droits des femmes, le sexe et le plaisir féminin, mais il sera aussi question de l'industrie du sucre, des classes sociales et du pouvoir de l'argent.
Et en bonus, des secrets de famille et des révélations inattendues.
Une lecture étonnante, un univers riche et un côté historico-fantastique dépaysant.
Dans le décor du Montréal de la fin du 19e siècle, deux fillettes, la riche et belle Marie Antoine aux boucles blondes qui habite une belle maison dans le Mile Doré et la méchante Sadie, à la chevelure sombre qui vient du quartier pauvre, le Mile Sordide.(des personnages symboliques qui me font un peu penser aux contes d'Amélie Nothomb).
C'est d'abord une histoire d'enfance avec ses amitiés, ses jalousies et ses trahisons. Mais c'est ensuite un éventail de thèmes : une fille en exil dans un pensionnat anglais pour apprendre les bonnes manières et une amie élevée dans un bordel.
Il y aura les droits des femmes, le sexe et le plaisir féminin, mais il sera aussi question de l'industrie du sucre, des classes sociales et du pouvoir de l'argent.
Et en bonus, des secrets de famille et des révélations inattendues.
Une lecture étonnante, un univers riche et un côté historico-fantastique dépaysant.
Suite à une gaffe majeure, un meurtre accidentel (annoncé dès les premières pages), deux jeunes amies sont séparées de force et connaîtront des destins bien différents. Au fil des ans, elles passeront par une gamme de relations : amitié, jalousie, complicité, rivalité, amour, jalousie, envie, haine, mais jamais par l'indifférence . . . L'époque n'est pas tendre pour les femmes. Qu'elles soient chefs d'entreprises, simples ouvrières, écrivaines, bonnes, prostituées ou avorteuses, qu'importe, les hommes ont le pouvoir et n'entendent pas leur céder. Conquérir son indépendance devient alors un combat quotidien, parfois ouvert, parfois souterrain.
Toute une trame de fond pour ce roman qui met en scène deux femmes “de la haute”, mais aussi plusieurs autres de classe moins privilégiées. On passe d'une perspective à une autre, on saute des motivations individuelles à des considérations de classes sociales, on flirte avec l'ambiguïté de genre. En plus, l'auteure nous mène en bateau, s'amuse à détricoter ce qu'elle nous avait concocté, finit le tout avec un feu d'artifice. J'ai bien aimé cette lecture à multiples tiroirs, avec ses personnages pétillants, toujours animés par de fortes pulsions.
Toute une trame de fond pour ce roman qui met en scène deux femmes “de la haute”, mais aussi plusieurs autres de classe moins privilégiées. On passe d'une perspective à une autre, on saute des motivations individuelles à des considérations de classes sociales, on flirte avec l'ambiguïté de genre. En plus, l'auteure nous mène en bateau, s'amuse à détricoter ce qu'elle nous avait concocté, finit le tout avec un feu d'artifice. J'ai bien aimé cette lecture à multiples tiroirs, avec ses personnages pétillants, toujours animés par de fortes pulsions.
Le roman débute comme un conte et on pourrait presque observer les jeux des petites filles comme si elles étaient des héroïnes de la comtesse De Segur, sauf qu'elles jouent avec des pistolets décorés de roses au milieu d'un labyrinthe de rosiers.
Marie et Sadie, les deux petites aristocrates, sont présentées comme "deux poupées destinées aux petites filles, l'une blonde et l'autre brune".Sauf qu'elles viennent de tuer la bonne qui s'est interposée dans leur simulacre de duel.
La situation initiale donne le ton de ce roman aux accents de conte gothique et de roman-feuilleton qui débute en 1873 dans une ville découpée en quartier du Mile doré et quartier du Mile sordide.
Heather O'Neill s'amuse à une présentation très manichéenne de ses héroïnes : la blonde Marie est qualifiée de "charmante" alors que la brune Sadie apparaît "diabolique". Marie est la riche héritière d'un père qui l'idolâtre, elle séduit et fascine tous ceux qui l'approchent. Par opposition, la ténébreuse Sadie se montre arrogante et gêne sa famille qui désapprouve sa maturité et craint son intelligence.
La rencontre entre les fillettes est décrite comme un coup de foudre, une fascination réciproque et leurs serments d'amitié ressemblent à des déclarations d'amour, prélude à une amitié amoureuse passionnelle.
Alors que Sadie est envoyée dans un pensionnat en Angleterre en guise de punition et qu'elle découvre ses talents d'écrivaine, Marie découvre le monde de l'usine et prend goût à la richesse et au pouvoir. Pour ne pas perdre son ascendant sur les ouvriers, elle décide d'annuler ses fiançailles avec le frère de Sadie parce qu'elle sait qu"il allait la priver de tout son pouvoir, comme son père l'avait fait avec sa mère. "
"Sadie était morte pour elle. Mais elle ne pleurait pas Sadie, elle pleurait la part d'elle-même qui avait déjà aimé Sadie. Elle avait mis de côté son amour pour son père et désormais elle mettait de côté son amour de jeunesse. Au cours des jours suivants, elle savait qu'elle allait devenir un monstre. Debout sur le balcon, elle laissait advenir la métamorphose. "
Cette prise de conscience féministe, la peur de disparaître derrière un mari," jusqu'à n'être plus qu'une esquisse sur une feuille de papier ", traverse toutes les femmes du roman, et peu importe que cette révélation ne se déroule pas toujours de manière exemplaire. Marie devient alors la parfaite représentante de la classe dirigeante qui exploite et opprime la classe ouvrière.
Quant à Sadie, version féminine du marquis De Sade, elle écrit un roman pornographique, "Justine et Juliette" , où le désir des femmes triomphe sur le désir des hommes. Dans cette perspective, elle construit un monde où les femmes découvrent la perversion et la volupté en laissant libre cours à leurs fantasmes.
Comme chez Marie, ses revendications en faveur du plaisir féminin sont purement égoïstes : ni l'une, ni l'autre n'envisagent de participer à la Révolution qui s'amorce sous l'impulsion d'autres femmes.
Toutes deux appartiennent à la haute bourgeoisie et sont totalement déconnectées de la réalité du peuple, même si Sadie a passé quelques années dans le bordel du Mile sordide. Pourtant, elles sont, bien malgré elles, les instigatrices d'une révolution fomentée par les ouvrières des manufactures: l'une parce qu'elle s'oppose à l'amélioration des conditions de travail au nom de la rentabilité , l'autre parce qu'elle est à l'origine des pamphlets contre le patronat.
Si la Révolution industrielle sert de décor à ces quartiers ouvriers de la fin du XIXe, une autre révolution se prépare menée par Georgina Danton, Mary Robespierre et Jeanne-Pauline Marat contre la bien-nommée Marie Antoine.
Par ses clins d'oeil onomastiques, l'autrice place avec humour les trois femmes sur un piédestal révolutionnaire et féministe.
Georgina, la plus sincère et empathique d'entre elles, est une orpheline élevée dans une maison close. Non-binaire, iel a choisi le prénom George et s'habille en homme parce que la vie est ainsi plus facile.
" Comme elle ne se voyait réellement ni comme un homme ni comme une femme, peut-être que les autres ne la voyaient pas comme une personne à part entière, avec des sentiments, une dignité, et un besoin d'amour aussi grand que celui de n'importe qui."
L'échec de sa relation amoureuse avec Sadie est à l'origine de son désir de vengeance, mais elle a toujours envisagé ses relations avec les femmes dans un esprit de sororité, d'entraide et d'affection.
Les choses sont différentes pour Mary Robespierre, l'une des filles illégitimes ( elles sont toutes nommées Mary) du père de Marie qui avait la détestable habitude de forniquer avec toutes les bonnes.
Essentiellement motivée par la haine et la jalousie, elle veut s'emparer de la fortune de Marie et on comprendra par un ultime rebondissement toute la légitimité de son combat. Elle est cependant aussi animée, en tant que femme et ouvrière, du désir de lutter pour l'égalité des droits sur le principe qu'en atteignant ses objectifs, "leurs droits seraient plus ou moins inévitablement défendus du même coup".
Avec une plume originale, entre préciosité et libertinage, entre imbroglio romanesque et réalisme militant, Heather O'Neil explore la condition féminine au XIXe S, et rebondit sur la question du genre et du désir féminin en mettant en scène des femmes qui s'imposent et décident de prendre le pouvoir, au risque d'agir avec le même égocentrisme que le patriarcat.
Remerciements à Babelio et aux éditions Alto pour l'envoi de ce livre lors d'une masse critique québécoise.
Perdre la tête d'Heather O'Neill est un roman abouti, très inspiré et fascinant.
Mile doré, mile sordide.
Mile doré est un quartier de bourgeois anglophones qui migrent à l'intérieur de Montréal sur une pente du mont Royal dans cette partie de la ville qui présentait un habitat plus sain, en amont des vents dominants.
Mile sordide, quartier pauvre de la ville, où l'air est saturé des odeurs des usines, où les filles survivent comme prostituées ou comme travailleuses industrielles à très petit salaire, dans des conditions exécrables.
Ce quatrième roman d'Heather O'Neill, sous la magnifique traduction de Dominique Fortier, aborde la rencontre de deux jeunes aristocrates du Golden Mile de Montréal, Marie Antoine et Sadie Arnett, aux personnalités complexes, qui ont l'impression chacune de trouver l'âme soeur.
« Une fillette aux boucles blondes et aux joues bien reconnaissable, rondes comme des pommes. Une seconde était une petite fille aux yeux noirs avec une tignasse noire. »
Cette rencontre est déterminante car en naîtra une amitié particulière et intense qui changera le cours de leurs vies.
Après un de leur jeu dangereux qui virera au drame, les deux jeunes filles seront séparées.
Sadie ira étudier en Angleterre et verra sa vie complètement bouleversée et Marie commencera à prendre compte de son statut de riche héritière de l'empire de son père Louis dans les usines de sucre.
L'oeuvre est prétexte à la description de l'industrialisation de la ville, aux soulèvements populaires liés aux mauvaises conditions de travail mais surtout à la force des femmes qui peut soulever des montagnes. L'amorce en 1873 et les années suivantes nous en dit beaucoup sur la transmission du savoir féminin avec les pamphlets, les rencontres secrètes et le début d'émancipation par la parole.
Il y a beaucoup de matière dans ce roman, les classes sociales, l'action révolutionnaire, l'amour maternel mais aussi et surtout, la folie, celle qui fait aimer et celle qui fait haïr.
Marie, Mary, Sadie, George, ces femmes ont un lien fort qui est complexe et imparfait, destructeur même. L'auteure refait à sa façon la Révolution française.
Roman féministe, qui oscille entre amour et haine, entre opulence et pauvreté, m'a tenu en haleine jusqu'à la toute fin. La forme est classique mais le fond, ludique et d'une imagination sans bornes en fait un roman des plus captivant.
Perdre la tête d'Heather O'Neill est un roman abouti, très inspiré et fascinant.
Mile doré, mile sordide.
Mile doré est un quartier de bourgeois anglophones qui migrent à l'intérieur de Montréal sur une pente du mont Royal dans cette partie de la ville qui présentait un habitat plus sain, en amont des vents dominants.
Mile sordide, quartier pauvre de la ville, où l'air est saturé des odeurs des usines, où les filles survivent comme prostituées ou comme travailleuses industrielles à très petit salaire, dans des conditions exécrables.
Ce quatrième roman d'Heather O'Neill, sous la magnifique traduction de Dominique Fortier, aborde la rencontre de deux jeunes aristocrates du Golden Mile de Montréal, Marie Antoine et Sadie Arnett, aux personnalités complexes, qui ont l'impression chacune de trouver l'âme soeur.
« Une fillette aux boucles blondes et aux joues bien reconnaissable, rondes comme des pommes. Une seconde était une petite fille aux yeux noirs avec une tignasse noire. »
Cette rencontre est déterminante car en naîtra une amitié particulière et intense qui changera le cours de leurs vies.
Après un de leur jeu dangereux qui virera au drame, les deux jeunes filles seront séparées.
Sadie ira étudier en Angleterre et verra sa vie complètement bouleversée et Marie commencera à prendre compte de son statut de riche héritière de l'empire de son père Louis dans les usines de sucre.
L'oeuvre est prétexte à la description de l'industrialisation de la ville, aux soulèvements populaires liés aux mauvaises conditions de travail mais surtout à la force des femmes qui peut soulever des montagnes. L'amorce en 1873 et les années suivantes nous en dit beaucoup sur la transmission du savoir féminin avec les pamphlets, les rencontres secrètes et le début d'émancipation par la parole.
Il y a beaucoup de matière dans ce roman, les classes sociales, l'action révolutionnaire, l'amour maternel mais aussi et surtout, la folie, celle qui fait aimer et celle qui fait haïr.
Marie, Mary, Sadie, George, ces femmes ont un lien fort qui est complexe et imparfait, destructeur même. L'auteure refait à sa façon la Révolution française.
Roman féministe, qui oscille entre amour et haine, entre opulence et pauvreté, m'a tenu en haleine jusqu'à la toute fin. La forme est classique mais le fond, ludique et d'une imagination sans bornes en fait un roman des plus captivant.
Montréal. Marie Antoine et Sadie Arnett ont douze ans lorsqu'elles se rencontrent dans un parc, en 1873. La première est blonde, aux yeux bleus et a un teint de porcelaine. La seconde est brune, aux yeux sombres et a des lèvres d'un rouge vermillon. L'une est qualifiée de charmante, l'autre de diabolique. Malgré les apparences, elles se ressemblent, énormément, dans le secret de leur coeur. Aussi, elles nouent une amitié fusionnelle et multiplient les jeux dangereux, jusqu'au drame évoqué dans le premier chapitre. Seule Sadie est sacrifiée : elle est envoyée en exil, dans un pensionnat, en Angleterre. La vie de Marie ne subit aucune transformation ; elle traverse l'adolescence dans le luxe et les voyages. Éloignées l'une de l'autre, aucune n'oublie son amie, son alter égo.
Plusieurs années plus tard, Marie dirige la raffinerie familiale. Elle a refusé de subir le joug du mariage, aussi, elle détient tous les pouvoirs. Quant à Sadie, elle évolue dans le milieu interlope et écrit un roman érotique. Leurs actes et leurs décisions influent, de manière différente, sur la révolution ouvrière féminine.
Oubliez tout ce que vous savez sur les romans féministes. En effet, même si les femmes tentent de prendre le pouvoir dans ce roman, seule une est attachante (elle s'appelle George). Elles sont fascinantes, hypnotisantes, elles mettent, parfois, mal à l'aise, mais leurs desseins ne sont pas toujours louables. La révolution féministe est en marche, mais elle s'oppose à la lutte des classes. Ces deux grandes thématiques montrent les limites de chacune, en fonction des intérêts. Elles questionnent, également, sur la part d'inné et d'acquis dans la constitution des personnalités. La majorité des femmes de l'histoire veut garder ou acquérir des privilèges. Leurs combats semblent justes, pourtant, il leur manque l'union. Leurs actes possèdent une grande part d'ambiguïté alors que les objectifs et les aspects négatifs du patriarcat sont affirmés. L'intrigue possède une aura diabolique, qui se lit dans les détails et bouscule nos attentes. Perdre la tête est un roman surprenant, magnétique, décrivant des combats justes mais maculés de perversité morale. Il est enivrant de machiavélisme et de nuances.
Lien : https://valmyvoyoulit.com/20..
Plusieurs années plus tard, Marie dirige la raffinerie familiale. Elle a refusé de subir le joug du mariage, aussi, elle détient tous les pouvoirs. Quant à Sadie, elle évolue dans le milieu interlope et écrit un roman érotique. Leurs actes et leurs décisions influent, de manière différente, sur la révolution ouvrière féminine.
Oubliez tout ce que vous savez sur les romans féministes. En effet, même si les femmes tentent de prendre le pouvoir dans ce roman, seule une est attachante (elle s'appelle George). Elles sont fascinantes, hypnotisantes, elles mettent, parfois, mal à l'aise, mais leurs desseins ne sont pas toujours louables. La révolution féministe est en marche, mais elle s'oppose à la lutte des classes. Ces deux grandes thématiques montrent les limites de chacune, en fonction des intérêts. Elles questionnent, également, sur la part d'inné et d'acquis dans la constitution des personnalités. La majorité des femmes de l'histoire veut garder ou acquérir des privilèges. Leurs combats semblent justes, pourtant, il leur manque l'union. Leurs actes possèdent une grande part d'ambiguïté alors que les objectifs et les aspects négatifs du patriarcat sont affirmés. L'intrigue possède une aura diabolique, qui se lit dans les détails et bouscule nos attentes. Perdre la tête est un roman surprenant, magnétique, décrivant des combats justes mais maculés de perversité morale. Il est enivrant de machiavélisme et de nuances.
Lien : https://valmyvoyoulit.com/20..
Deux petites filles nées fin du XIXème siècle à Montréal, l'une bien née de parents dépourvus de richesse, l'autre fille d'un industriel fortuné, magnat du sucre.
Marie Antoine, dont l'effigie est présente sur les sacs de sucre des raffineries de son cher papa, s'ennuie profondément et s'ingénie à se créer une petite cour. Curieuse de ce monde industriel en développement, elle va obtenir de son père d'aller visiter la concurrence. Dévorée d'ambition, elle se voit succéder à son père à une époque où les maris prennent les rennes de la fortune de leur riche épouse.
Sadie, gamine rebelle, est née dans une famille bien déterminée à reconquérir la fortune par tous les moyens. Particulièrement celui de mettre les deux gamines en relation dans l'espoir de se voir accorder les faveurs du richissime veuf qui est le père de Marie Antoine.
Funeste rencontre en vérité que celle de deux gamines admiratives l'une de l'autre. de surenchère en surenchère, un drame les sépare, Marie reste à Mile Doré quand Sadie est exilée à Londres pour couper court à des poursuites. Elles ont tué la bonne.
En 1873, quelle punition infligée à deux petites meurtrières ? Un accident malheureux qui va déstabiliser bien plus que leur vie. Pour l'une, l'exil et le rejet de sa mère, pour l'autre les voyages et l'ennui.
Ce roman ne vous laisse aucun répit. Il vous faudra savoir ce qu'il advient de cet amour-amitié passionné. Quels seront les dommages collatéraux dans cette société où il vaut mieux être bien né. Sadie investit le Mile Sordide, s'y fait une place dans le coeur de George Danton orpheline née dans une maison close.
Dans cette société où le destin des femmes semble tout tracé, Marie Antoine, Mary Robespierre, Sadie et George vont se jouer de leurs conditions en grandissant entre amour et haine.
L'autrice dans cette ode aux femmes puissantes à une époque où on les juge fragiles, combattantes quitte à sacrifier un morceau d'elles-mêmes, nous propose un regard féministe sur le monde du Mile doré ou sordide, où il est question d'inégalités sociales, de genre, de la destinée qui s'impose mais que l'on culbute parfois pour arriver à ses fins.
Heather O'neill tisse patiemment sa toile révolutionnaire, dans un monde fantasmé où l'émancipation des femmes, se livre comme un conte. Il vous sera certainement difficile de les quitter avant l'épilogue.
Marie Antoine, dont l'effigie est présente sur les sacs de sucre des raffineries de son cher papa, s'ennuie profondément et s'ingénie à se créer une petite cour. Curieuse de ce monde industriel en développement, elle va obtenir de son père d'aller visiter la concurrence. Dévorée d'ambition, elle se voit succéder à son père à une époque où les maris prennent les rennes de la fortune de leur riche épouse.
Sadie, gamine rebelle, est née dans une famille bien déterminée à reconquérir la fortune par tous les moyens. Particulièrement celui de mettre les deux gamines en relation dans l'espoir de se voir accorder les faveurs du richissime veuf qui est le père de Marie Antoine.
Funeste rencontre en vérité que celle de deux gamines admiratives l'une de l'autre. de surenchère en surenchère, un drame les sépare, Marie reste à Mile Doré quand Sadie est exilée à Londres pour couper court à des poursuites. Elles ont tué la bonne.
En 1873, quelle punition infligée à deux petites meurtrières ? Un accident malheureux qui va déstabiliser bien plus que leur vie. Pour l'une, l'exil et le rejet de sa mère, pour l'autre les voyages et l'ennui.
Ce roman ne vous laisse aucun répit. Il vous faudra savoir ce qu'il advient de cet amour-amitié passionné. Quels seront les dommages collatéraux dans cette société où il vaut mieux être bien né. Sadie investit le Mile Sordide, s'y fait une place dans le coeur de George Danton orpheline née dans une maison close.
Dans cette société où le destin des femmes semble tout tracé, Marie Antoine, Mary Robespierre, Sadie et George vont se jouer de leurs conditions en grandissant entre amour et haine.
L'autrice dans cette ode aux femmes puissantes à une époque où on les juge fragiles, combattantes quitte à sacrifier un morceau d'elles-mêmes, nous propose un regard féministe sur le monde du Mile doré ou sordide, où il est question d'inégalités sociales, de genre, de la destinée qui s'impose mais que l'on culbute parfois pour arriver à ses fins.
Heather O'neill tisse patiemment sa toile révolutionnaire, dans un monde fantasmé où l'émancipation des femmes, se livre comme un conte. Il vous sera certainement difficile de les quitter avant l'épilogue.
Marie Antoine et Sadie Arnett sont deux jeunes filles de la classe sociale la plus élevée de Montréal. Elles habitent le même quartier, le Mile doré. Elles ont toutes les deux une personnalité hors du commun, qui envoûtent ceux qu'elles croisent. Si elles sont très amies, il y a aussi entre elles une certaine rivalité. Cette rivalité les mènent à un drame, la mort d'une bonne, qui aura des répercussions importantes. Marie étant la plus riche, c'est elle qu'on épargnera. Sadie, elle, est envoyée en Angleterre dans un pensionnat. Quand elle revient cinq ans plus tard, l'amitié entre Marie et Sadie a disparu. Tandis que Marie se perd dans le Mile Doré, obsédée par la prospérité de son entreprise, Sadie explore le Mile sordide, un quartier pauvre et miné de bordels.
J'ai bien aimé ce livre. L'histoire d'amitié entre les deux filles est très bien écrite, avec à la fois cette attirance et cette rivalité. La différence entre les deux mondes est également très bien restituée et on découvre avec fascination le Mile Sordide. J'ai trouvé la deuxième partie du livre, avec l'arrivée des personnages secondaires comme George et Marie, beaucoup plus rythmée et plus prenante.
Ce livre me faisait penser à une de mes anciennes lectures dans son atmosphère, Les enfants de coeur, et je me suis rendue compte que c'était tout à fait normal car c'est la même autrice. Et effectivement, on y retrouve bien ce côté conte gothique assez marqué.
Merci à Netgalley et aux éditions Les Escales pour cette lecture.
J'ai bien aimé ce livre. L'histoire d'amitié entre les deux filles est très bien écrite, avec à la fois cette attirance et cette rivalité. La différence entre les deux mondes est également très bien restituée et on découvre avec fascination le Mile Sordide. J'ai trouvé la deuxième partie du livre, avec l'arrivée des personnages secondaires comme George et Marie, beaucoup plus rythmée et plus prenante.
Ce livre me faisait penser à une de mes anciennes lectures dans son atmosphère, Les enfants de coeur, et je me suis rendue compte que c'était tout à fait normal car c'est la même autrice. Et effectivement, on y retrouve bien ce côté conte gothique assez marqué.
Merci à Netgalley et aux éditions Les Escales pour cette lecture.
Ma troisième lecture de la Montréalaise Heather O'Neill après le recueil La vie rêvée des grille-pains (que j'ai trouvé bon quoique inégal) et la nouvelle coup de poing Tu redeviendras poussière. Son dernier roman paru, Perdre la tête, se révèle aussi maîtrisé que percutant.
En 1873, dans un Montréal où « la richesse [connaît] une croissance exponentielle, même si le nombre de riches [n'augmente] pas », les jeunes Marie Antoine et Sadie Arnett nouent une amitié amoureuse aussi tordue que fusionnelle. Séparées, elles mènent chacune leur barque pendant dix ans avant de se retrouver. Marie, fille du riche propriétaire d'une raffinerie de sucre, a des goûts de luxe dignes de Marie-Antoinette, tandis que la rebelle Sadie est autant opposée à toute forme de morale qu'un marquis de Sade au féminin. Chacune, à sa manière, tente de s'affranchir des diktats de la bonne société dont elles sont issues :
Mais, et c'est là le coeur du roman, elles ne remarquent pas que leur quête d'épanouissement personnel, loin de remettre en cause le système, ne fait qu'oppresser un peu plus une autre catégorie de femmes : celles de la classe ouvrière.
L'autrice soulève une réflexion assez fine sur deux types d'oppressions sociétales et la façon dont celles-ci s'entre-nourrissent : le patriarcat et la lutte des classes. Marie et Sadie, en tant que femmes privilégiées, se trouvent dans une position ambivalente. le portrait que l'autrice brosse d'elles, quoique nuancé, est toutefois dénué d'ambiguïté. On peut y voir, en creux, une possible remise en question des récentes réhabilitations féministes de Marie-Antoinette.
Par ailleurs, j'ai adoré l'univers baroque quasi-irréaliste si caractéristique d'Heather O'Neill ainsi que sa plume très bien rendue par la traduction de Dominique Fortier. Les personnages sont tous haïssables (hormis George, très attachante) mais j'ai pris un grand plaisir à les détester.
Une très bonne lecture pour commencer l'année!
En 1873, dans un Montréal où « la richesse [connaît] une croissance exponentielle, même si le nombre de riches [n'augmente] pas », les jeunes Marie Antoine et Sadie Arnett nouent une amitié amoureuse aussi tordue que fusionnelle. Séparées, elles mènent chacune leur barque pendant dix ans avant de se retrouver. Marie, fille du riche propriétaire d'une raffinerie de sucre, a des goûts de luxe dignes de Marie-Antoinette, tandis que la rebelle Sadie est autant opposée à toute forme de morale qu'un marquis de Sade au féminin. Chacune, à sa manière, tente de s'affranchir des diktats de la bonne société dont elles sont issues :
Mais, et c'est là le coeur du roman, elles ne remarquent pas que leur quête d'épanouissement personnel, loin de remettre en cause le système, ne fait qu'oppresser un peu plus une autre catégorie de femmes : celles de la classe ouvrière.
L'autrice soulève une réflexion assez fine sur deux types d'oppressions sociétales et la façon dont celles-ci s'entre-nourrissent : le patriarcat et la lutte des classes. Marie et Sadie, en tant que femmes privilégiées, se trouvent dans une position ambivalente. le portrait que l'autrice brosse d'elles, quoique nuancé, est toutefois dénué d'ambiguïté. On peut y voir, en creux, une possible remise en question des récentes réhabilitations féministes de Marie-Antoinette.
Par ailleurs, j'ai adoré l'univers baroque quasi-irréaliste si caractéristique d'Heather O'Neill ainsi que sa plume très bien rendue par la traduction de Dominique Fortier. Les personnages sont tous haïssables (hormis George, très attachante) mais j'ai pris un grand plaisir à les détester.
Une très bonne lecture pour commencer l'année!
- Mourons toutes les deux.
- Parfait!
- Et on se tue avec les doigts? demanda Marie
- Je vais emprunter les pistolets de mon père. Ils sont si beaux,
Un simple jeu aux conséquences dramatiques.
Marie et Sadie vivent une relation fusionnelle. L'amitié entre les deux enfants est si exclusive qu'elles se mettent à l'écart des autres, s'excluant de facto de presque toute vie sociale et créant un monde dans lequel elles évoluent sans limites.
Marie, enfant gâtée superficielle et blasée. Sadie, intelligente, cynique et extrêmement lucide.
Les deux personnalités contraires s'attirent, se confondent pour ne former qu'une jusqu'au jour où l'irréparable les séparera.
Dans son style baroque débridé et inimitable (on aime ou pas, moi j'adore) Heather O'Neill brosse un portrait du Montréal industriel fin XIXème siècle en opposant le Mile doré au Mile sordide, la condition des femmes à celles des hommes, la luxure aux plaisirs de la chair.
Au-delà de l'histoire de ces deux femmes se révèle une apologie féroce du féminisme et des forces qui en découlent ainsi qu'un portrait peu glorieux de toute société basée sur le capitalisme industriel.
Je remercie les Éditions Alto et Babelio (Masse critique Québec) de m'avoir permis de poursuivre la découverte de l'oeuvre de Heather O'Neill, une autrice que j'apprécie particulièrement.
- Parfait!
- Et on se tue avec les doigts? demanda Marie
- Je vais emprunter les pistolets de mon père. Ils sont si beaux,
Un simple jeu aux conséquences dramatiques.
Marie et Sadie vivent une relation fusionnelle. L'amitié entre les deux enfants est si exclusive qu'elles se mettent à l'écart des autres, s'excluant de facto de presque toute vie sociale et créant un monde dans lequel elles évoluent sans limites.
Marie, enfant gâtée superficielle et blasée. Sadie, intelligente, cynique et extrêmement lucide.
Les deux personnalités contraires s'attirent, se confondent pour ne former qu'une jusqu'au jour où l'irréparable les séparera.
Dans son style baroque débridé et inimitable (on aime ou pas, moi j'adore) Heather O'Neill brosse un portrait du Montréal industriel fin XIXème siècle en opposant le Mile doré au Mile sordide, la condition des femmes à celles des hommes, la luxure aux plaisirs de la chair.
Au-delà de l'histoire de ces deux femmes se révèle une apologie féroce du féminisme et des forces qui en découlent ainsi qu'un portrait peu glorieux de toute société basée sur le capitalisme industriel.
Je remercie les Éditions Alto et Babelio (Masse critique Québec) de m'avoir permis de poursuivre la découverte de l'oeuvre de Heather O'Neill, une autrice que j'apprécie particulièrement.
Un magnifique roman qui débute par un premier chapitre qui vous laisse sans voix. C'était de bon augure. Sur un rythme lent, nous allons apprendre à connaître deux fillettes bien différentes l'une de l'autre et pourtant qui sont irrésistiblement attirées l'une par l'autre. Nous sommes en 1873 à Montréal et Marie et Sadie forme un duo de personnage extraordinaire. Marie, représente la bourgeoisie avec un père industriel qui a fait fortune dans le sucre, elle est blonde et populaire, elle domine toutes les filles du quartier aisé du Golden Mile. Sadie intègre le quartier, brune, brillante elle possède une aura plus obscure. Ensemble elles vont se lier d'une amitié intense mais qui semble vouée à l'échec dès le début. Suite à un accident violent, la séparation est inévitable. Les années ont passées , entre innocence et perversité. Les choses sérieuses peuvent commencer.
La plume de Heather O'Neill, dans le style victorien est assez réussie, même s'il y avait trop de métaphores à mon goût heureusement les pointes d'humour étaient quand à elles, bienvenue. le roman est touchant, bien que je ne sois pas certaine de la véracité de la vie au 19e siècle telle qu'elle est proposée dans le livre. On suit nos héroïnes dans leurs actes, passant d'une école ultra stricte à la férocité du travail à l'usine, ou encore à la façon de vivre des nantis de Montréal. Les thèmes traités sont nombreux, sexe, désir, genre, homosexualité, pouvoir, statut social et inégalité. Un grand melting pot pour ce roman riche qui nous parle des femmes, de la fidélité, de la trahison. Une expérience que de découvrir cette fiction historique dans le Montréal de la fin du 19ième siècle en pleine révolution industrielle. Un bon point pour ce livre qui débute dramatiquement et nous offre nombre de rebondissement et d'intrigue, et même si cela frise parfois le mélo, pourquoi résister quitte à perdre la tête. Bonne lecture.
Lien : http://latelierdelitote.cana..
La plume de Heather O'Neill, dans le style victorien est assez réussie, même s'il y avait trop de métaphores à mon goût heureusement les pointes d'humour étaient quand à elles, bienvenue. le roman est touchant, bien que je ne sois pas certaine de la véracité de la vie au 19e siècle telle qu'elle est proposée dans le livre. On suit nos héroïnes dans leurs actes, passant d'une école ultra stricte à la férocité du travail à l'usine, ou encore à la façon de vivre des nantis de Montréal. Les thèmes traités sont nombreux, sexe, désir, genre, homosexualité, pouvoir, statut social et inégalité. Un grand melting pot pour ce roman riche qui nous parle des femmes, de la fidélité, de la trahison. Une expérience que de découvrir cette fiction historique dans le Montréal de la fin du 19ième siècle en pleine révolution industrielle. Un bon point pour ce livre qui débute dramatiquement et nous offre nombre de rebondissement et d'intrigue, et même si cela frise parfois le mélo, pourquoi résister quitte à perdre la tête. Bonne lecture.
Lien : http://latelierdelitote.cana..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Heather O'Neill (6)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Littérature québécoise
Quel est le titre du premier roman canadien-français?
Les anciens canadiens
La terre paternelle
Les rapaillages
L'influence d'un livre
Maria Chapdelaine
18 questions
221 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature québécoise
, québec
, québécoisCréer un quiz sur ce livre221 lecteurs ont répondu