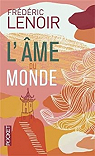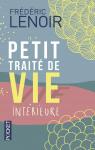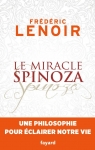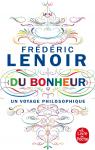Citations sur L'Odyssée du sacré : La Grande Histoire des croyances et .. (27)
Toujours est-il que nos ancêtres nourrissaient très probablement des croyances similaires à celles des peuples chasseurs-cueilleurs plus proches de nous et un même lien sacré avec la nature, en partageant principalement trois comportements spécifiques ; un sentiment d'union et d'interdépendance avec la nature ; une vision égalitaire entre tous les êtres vivants ; des rites d'identification-simulation pour communiquer avec les esprits.
L'accès au bonheur individuel est également fonction de la qualité de notre vie intérieure et spirituelle. De notre capacité à voir dans tout événement, même contrariant ou douloureux, une occasion d'élargir notre regard ou d'ouvrir davantage notre coeur; de comprendre, à la suite de Sénèque, que "Vivre ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie" et de dire, à la suite de Nietzsche, un "grand oui sacré à la vie"; d'aimer la vie de manière inconditionnelle, comme on aime un enfant, et non pas seulement quand tout va bien ou qu'elle répond à nos attentes.
Ce ne sont plus les rituels des prêtres, mais la moralité de l'individu, sa foi et sa propre discipline de vie qui le mènent désormais au salut. Il ne s'agit plus de « faire le sacré » (selon l'étymologie latine du mot « sacrifice »), mais de le vivre : chaque individu peut et doit créer son propre « dialogue » avec l'absolu ou la divinité de son choix. Cela passe par la connaissance et le respect des lois divines ou de l'univers, par un perfectionnement spirituel.
( À propos de l’âge axial de Karl Jaspers)
( À propos de l’âge axial de Karl Jaspers)
Puisque les femmes sont les seules à posséder ce mystérieux pouvoir de créer la vie, les divinités ne peuvent être qu'à leur image.
Le sentiment océanique n’appartient à aucune religion, a aucune philosophie et c’est tant mieux. Ce n’est pas un dogme, ni un acte de foi. C’est une expérience…
… lors de ces expériences, le temps semble aboli, il n’y a plus que le présent. La pensée et la raison se taisent, il n’y a plus que le réel affirme t-il. Il y a parfois rarement des moments de grâce, ou l’on a cesse de désirer quoi que ce soit d’autre que ce qui est( …) ou que ce que l’on fait(…) , ou l’on ne manque de rien, ou l’on a plus rien à espérer, ni à regretter, ou la question de la possession ne se pose plus(…) et c’est ce que j’appelle plénitude.
… lors de ces expériences, le temps semble aboli, il n’y a plus que le présent. La pensée et la raison se taisent, il n’y a plus que le réel affirme t-il. Il y a parfois rarement des moments de grâce, ou l’on a cesse de désirer quoi que ce soit d’autre que ce qui est( …) ou que ce que l’on fait(…) , ou l’on ne manque de rien, ou l’on a plus rien à espérer, ni à regretter, ou la question de la possession ne se pose plus(…) et c’est ce que j’appelle plénitude.
En somme, homo sapiens est un animal spirituel susceptible de faire une expérience intime du sacré, laquelle peut s'inscrire dans une philosophie matérialiste ou spiritualiste. Et, dans ce dernier cas, elle pourra être qualifiée de religieuse si elle s'insère dans un collectif ou se réfère à une tradition.
Mon propos n’est donc pas d’abord celui des croyances en général, mais de la quête spirituelle, du sacré et des croyances en des forces surnaturelles ou dans un monde invisible, qui ont pris tout au long de l’histoire des formes très variées : des chamanes de la Préhistoire aux nouvelles quêtes de sens contemporaines, en passant par les grandes voies spirituelles, ésotériques et religieuses de l’Orient et de l’Occident, ou par la persistance de l’animisme, de la magie et de la relation aux morts sur toute la surface du globe.
J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai, il suscite l'art et la science. Si quelqu'un ne connaît pas cette sensation ou ne peut pus ressentir étonnement ou surprise, il est un mort vivant et ses yeux sont désormais aveugles.
Propos d'Albert Einstein.
Propos d'Albert Einstein.
Si la dimension spirituelle de l’être humain peut le conduire à éprouver cette expérience intime et universelle du sacré, elle peut aussi l’amener à faire l’expérience ou à croire en des forces invisibles suprasensibles. Il est donc nécessaire de distinguer ceux qui font une expérience spirituelle sans croire en un monde suprasensible ou en l’immortalité de l’âme de ceux qui font cette même expérience intime, tout en pensant qu’il existe un monde suprasensible et que l’âme est immortelle.
Ces deux conceptions philosophiques existent depuis plusieurs millénaires : on qualifiera la première de « matérialiste » et la seconde de « spiritualiste ». Ainsi, dans l’Antiquité, Platon peut-il être qualifié de penseur spiritualiste, puisqu’il croit en l’existence de l’immortalité de l’âme et d’un monde divin invisible, et Épicure de penseur matérialiste, puisqu’il n’y croit pas… ce qui ne l’empêche pas d’être éminemment spirituel. De nos jours, le philosophe français André Comte-Sponville a aussi fort bien rappelé le fait qu’il existait une spiritualité laïque, et même athée, et qu’il ne fallait pas réduire la spiritualité (et j’ajouterai l’expérience du sacré) à sa dimension spiritualiste ou religieuse.
Ces deux conceptions philosophiques existent depuis plusieurs millénaires : on qualifiera la première de « matérialiste » et la seconde de « spiritualiste ». Ainsi, dans l’Antiquité, Platon peut-il être qualifié de penseur spiritualiste, puisqu’il croit en l’existence de l’immortalité de l’âme et d’un monde divin invisible, et Épicure de penseur matérialiste, puisqu’il n’y croit pas… ce qui ne l’empêche pas d’être éminemment spirituel. De nos jours, le philosophe français André Comte-Sponville a aussi fort bien rappelé le fait qu’il existait une spiritualité laïque, et même athée, et qu’il ne fallait pas réduire la spiritualité (et j’ajouterai l’expérience du sacré) à sa dimension spiritualiste ou religieuse.
La formation des empires nécessite la création d'organisations sociales, politiques et religieuses complexes. Des règles et croyances semblables sont instaurées pour unir des habitants de plusieurs cités et de différentes cultures.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Frédéric Lenoir (66)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Coeur de cristal
Quelle est le sort du prince?
Il a des boutons sur le nez
Son coeur est enveloppé de cristal
Il a des problèmes de coeur
5 questions
32 lecteurs ont répondu
Thème : Coeur de cristal de
Frédéric LenoirCréer un quiz sur ce livre32 lecteurs ont répondu