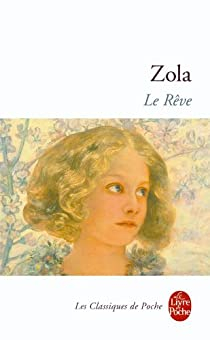Critiques filtrées sur 4 étoiles
C'est à la passion, mystique ou amoureuse que Zola consacre cet opus de la série des Rougon-Macquart. incarnée par la jeune Angélique, c'est une enfant abandonnée (elle est la fille de Sidonie Rougon) et recueillie par Hubert et Hubertine, un couple qui a lui aussi préféré la passion à la raison et a ressenti comme un châtiment le décès de leur fille unique.
Angélique, tout en apprenant son métier de brodeuse, s'enflamme en secret pour les figures légendaires qui font le décor de la religion chrétienne. Elle se nourrit des légendes contant la vie de martyre des vierges qui ornent la cathédrale avoisinant la maison où elle vit. Jusqu'au jour où une ombre entrevue à son balcon éveille son émoi, et se substitue à ses héros mystiques.
Amoureuse du jeune homme, qui se dit ouvrier verrier, elle en oublie pour un temps les illusions qui la berçaient et lui faisaient entrevoir un avenir de princesse de conte de fées.
Le roman en possède les codes, la jeune fille pauvre, recueillie par un couple sans enfant, rêvant d'un avenir fastueux auprès d'un prince charmant. Zola casse cependant le mythe par une fin qui ne reprend pas la formule : « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ».
Dans ces derniers tomes, qui mettent en scène les héritiers de la génération fondatrice, à chaque fois, le personnage principal s'interroge sur son hérédité et Angélique n'échappe pas à la règle :
"Elle l'entendait gronder au fond d'elle, le démon du mal héréditaire. Qui sait ce qu'elle serait devenue, dans le sol natal? Une mauvaise fille sans doute ; tandis qu'elle grandissait en santé nouvelle, à chaque saison, dans ce coin béni. N'était-ce pas la grâce, ce milieu fait des contes qu'elle savait par coeur, de la foi qu'elle y avait bue, de l'au-delà mystique où elle baignait, ce milieu de l'invisible où le miracle lui semblait naturel, de niveau avec son existence quotidienne."
La religion est au coeur du roman , à travers la dévotion des personnages, des figures du curé et de l'évêque, des processions et de la remise des légendes des premiers chrétiens. (L'énumération des vierges et de leurs destinées peut être un peu lassante, mais quand Zola s'empare d'un thème, il le décline jusqu'à plus soif!)
On entrevoit aussi l'univers des brodeurs, un métier artistique exigeant, que la jeune Angélique s'approprie avec talent et abnégation.
Un opus qui se distingue des précédents par sa brièveté , à peine deux cent pages. Ce qui est suffisant.
Lien : https://kittylamouette.blogs..
Angélique, tout en apprenant son métier de brodeuse, s'enflamme en secret pour les figures légendaires qui font le décor de la religion chrétienne. Elle se nourrit des légendes contant la vie de martyre des vierges qui ornent la cathédrale avoisinant la maison où elle vit. Jusqu'au jour où une ombre entrevue à son balcon éveille son émoi, et se substitue à ses héros mystiques.
Amoureuse du jeune homme, qui se dit ouvrier verrier, elle en oublie pour un temps les illusions qui la berçaient et lui faisaient entrevoir un avenir de princesse de conte de fées.
Le roman en possède les codes, la jeune fille pauvre, recueillie par un couple sans enfant, rêvant d'un avenir fastueux auprès d'un prince charmant. Zola casse cependant le mythe par une fin qui ne reprend pas la formule : « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ».
Dans ces derniers tomes, qui mettent en scène les héritiers de la génération fondatrice, à chaque fois, le personnage principal s'interroge sur son hérédité et Angélique n'échappe pas à la règle :
"Elle l'entendait gronder au fond d'elle, le démon du mal héréditaire. Qui sait ce qu'elle serait devenue, dans le sol natal? Une mauvaise fille sans doute ; tandis qu'elle grandissait en santé nouvelle, à chaque saison, dans ce coin béni. N'était-ce pas la grâce, ce milieu fait des contes qu'elle savait par coeur, de la foi qu'elle y avait bue, de l'au-delà mystique où elle baignait, ce milieu de l'invisible où le miracle lui semblait naturel, de niveau avec son existence quotidienne."
La religion est au coeur du roman , à travers la dévotion des personnages, des figures du curé et de l'évêque, des processions et de la remise des légendes des premiers chrétiens. (L'énumération des vierges et de leurs destinées peut être un peu lassante, mais quand Zola s'empare d'un thème, il le décline jusqu'à plus soif!)
On entrevoit aussi l'univers des brodeurs, un métier artistique exigeant, que la jeune Angélique s'approprie avec talent et abnégation.
Un opus qui se distingue des précédents par sa brièveté , à peine deux cent pages. Ce qui est suffisant.
Lien : https://kittylamouette.blogs..
"Le rêve" est le seizième tome des Rougon-Macquart, il met en scène Angélique Rougon, fille de Sidonie et petite-fille de Pierre Rougon, mais qui a été élevée par l'Assistance publique dès la naissance. Après s'être enfuie d'une famille d'accueil qui la maltraitait, elle est recueillie par le couple Hubert, chasublier de génération en génération dans une petite commune du Val d'Oise. Elle apprendra à son tour le métier, dans lequel elle excellera. Entourée des saintes vierges de la cathédrale voisine et du livre "La Légende dorée" qu'elle ne quitte jamais, Angélique va vivre tout au long de sa courte vie dans un rêve. Car en effet, persuadée d'être guidée par sainte-Agnès et toutes ses acolytes, elle vit dans l'attente de son prince charmant : celui qu'elle aimera à la folie et qui l'aimera tout autant, en plus d'être beau et riche (bah oui tant qu'à faire !). Elle le trouvera en la personne de Félicien, beau garçon et fils du richissime Monseigneur de Hautecoeur. le rêve d'Angélique pourrait se réaliser si seulement le papa du garçon pouvait donner son accord pour qu'il épouse "cette fille de rien"... C'est un déchirement pour les deux amoureux, car oui ils s'aiment à la folie...
Nous avons là une nouvelle fois un opus bien différent des autres. Émile Zola ne dénonce pas, ne se fait pas critique de la société. Pas de cancans, pas de mesquineries. Pas de personnages avides de pouvoir et d'argent non plus. "Le rêve" fait partie des quelques tomes les plus doux, voire même romantiques, de la série. Une romance, un roman d'amour, pourrait-on le qualifier.
L'ambiance est également tout autre puisque nous sommes plongés dans une sorte de rêve, ou de réalité cotonneuse, entourés des saintes vierges et martyres, influencés par leur destin et leurs messages que l'on perçoit dans le bruissement des feuilles au vent par exemple. L'obsession de Zola en ce qui concerne le blanc prend ici une ampleur démesurée. Tout est blanc, d'Angélique elle-même à sa chambre, en passant par la lumière de la lune et ses reflets et toutes les saintes. Tout est référence et symbole de chasteté, pureté, innocence, virginité. Avec de temps à autre un halo doré, rappel aux divinités, à la noblesse et la richesse. Zola implante par conséquent une atmosphère très pieuse, "soyeuse", chimérique, qui prend le dessus sur tout le reste.
Zola aborde à nouveau le thème de la religion, mais sous un aspect différent. Il y est davantage question ici de mysticisme, de miracle, de la vie des martyres qui aiguilleront les rêves d'Angélique. Il me faut avouer que c'est parfois pesant, le sujet ne m'intéressant guère à la base.
Quant à Angélique, même si on comprend dès le début qu'elle a hérité du gène "folie" de son arrière-grand-mère Adélaïde, on ne peut qu'avoir beaucoup d'empathie pour elle. Cette jeune fille, qui vit isolée, que les Hubert n'ont jamais voulu scolariser pour la préserver, n'a pas appris à faire la différence entre le rêve et la réalité. Elle s'est imaginé une vie de princesse et vit dans la béatitude et l'attente. Elle ne comprend pas les mises en garde de sa mère adoptive, et pour cause puisque son prince charmant fait son apparition et que tout se déroule comme elle l'avait prédit. Quand le père de Félicien refuse le mariage, elle n'était évidemment pas préparée et tombe de haut. C'est à partir de là qu'on prend pitié d'elle, que l'histoire devient de plus en plus douloureuse.
Le dénouement m'a grandement étonnée, il s'est produit un "miracle" que je n'attendais pas. Zola n'a quand même pas pu s'empêcher de s'arrêter sur un drame, mais qui s'avère être beaucoup moins violent que ce que je m'étais imaginé.
Malgré quelques longueurs dues à des explications/descriptions que j'ai trouvées rébarbatives (le thème, comme dit plus haut, ne m'attirant pas, c'est donc très personnel), j'ai une nouvelle fois passé un bon moment. "Le rêve" ne fera pas partie de mes préférés de la série, alors qu'il est pourtant l'un des tomes les plus doux et touchants, peut-être même le plus lumineux, que j'ai lus jusqu'ici.
Nous avons là une nouvelle fois un opus bien différent des autres. Émile Zola ne dénonce pas, ne se fait pas critique de la société. Pas de cancans, pas de mesquineries. Pas de personnages avides de pouvoir et d'argent non plus. "Le rêve" fait partie des quelques tomes les plus doux, voire même romantiques, de la série. Une romance, un roman d'amour, pourrait-on le qualifier.
L'ambiance est également tout autre puisque nous sommes plongés dans une sorte de rêve, ou de réalité cotonneuse, entourés des saintes vierges et martyres, influencés par leur destin et leurs messages que l'on perçoit dans le bruissement des feuilles au vent par exemple. L'obsession de Zola en ce qui concerne le blanc prend ici une ampleur démesurée. Tout est blanc, d'Angélique elle-même à sa chambre, en passant par la lumière de la lune et ses reflets et toutes les saintes. Tout est référence et symbole de chasteté, pureté, innocence, virginité. Avec de temps à autre un halo doré, rappel aux divinités, à la noblesse et la richesse. Zola implante par conséquent une atmosphère très pieuse, "soyeuse", chimérique, qui prend le dessus sur tout le reste.
Zola aborde à nouveau le thème de la religion, mais sous un aspect différent. Il y est davantage question ici de mysticisme, de miracle, de la vie des martyres qui aiguilleront les rêves d'Angélique. Il me faut avouer que c'est parfois pesant, le sujet ne m'intéressant guère à la base.
Quant à Angélique, même si on comprend dès le début qu'elle a hérité du gène "folie" de son arrière-grand-mère Adélaïde, on ne peut qu'avoir beaucoup d'empathie pour elle. Cette jeune fille, qui vit isolée, que les Hubert n'ont jamais voulu scolariser pour la préserver, n'a pas appris à faire la différence entre le rêve et la réalité. Elle s'est imaginé une vie de princesse et vit dans la béatitude et l'attente. Elle ne comprend pas les mises en garde de sa mère adoptive, et pour cause puisque son prince charmant fait son apparition et que tout se déroule comme elle l'avait prédit. Quand le père de Félicien refuse le mariage, elle n'était évidemment pas préparée et tombe de haut. C'est à partir de là qu'on prend pitié d'elle, que l'histoire devient de plus en plus douloureuse.
Le dénouement m'a grandement étonnée, il s'est produit un "miracle" que je n'attendais pas. Zola n'a quand même pas pu s'empêcher de s'arrêter sur un drame, mais qui s'avère être beaucoup moins violent que ce que je m'étais imaginé.
Malgré quelques longueurs dues à des explications/descriptions que j'ai trouvées rébarbatives (le thème, comme dit plus haut, ne m'attirant pas, c'est donc très personnel), j'ai une nouvelle fois passé un bon moment. "Le rêve" ne fera pas partie de mes préférés de la série, alors qu'il est pourtant l'un des tomes les plus doux et touchants, peut-être même le plus lumineux, que j'ai lus jusqu'ici.
Je continue de cheminer de manière chronologique dans la saga extraordinaire des Rougon-Macquart et me voici parvenu déjà au seizième roman. Après La Terre, voici le Rêve, d'un esprit totalement différent. Ici Émile Zola s'éloigne radicalement de son registre habituel.
De temps en temps, dans ce parcours, cela lui arrive. Comme j'ai fait le choix assumé de lire jusqu'à présent cette oeuvre dans son ordre chronologique, je peux témoigner que c'est la troisième fois qu'il convoque la religion, ceci après La Conquête de Plassans et La Faute de l'abbé Mouret.
Souvent après un roman dur, Zola cherche à nous apaiser avec un roman doux. Après La Terre nous en avions bien besoin.
Pas facile en effet de passer de la Terre au Rêve, des culbutes dans les tas de foin à l'amour mystique. Est-ce le même Zola ? Certes, ce n'est pas ici du Zola pur jus, cependant...
Angélique, est une enfant abandonnée placée dès sa naissance à l'assistance publique. Mais à l'adolescence, souffrant de la violence qu'elle subit, elle décide de s'enfuir de la famille dans laquelle elle avait été confiée. Elle sera recueillie par un couple de brodeurs, les Hubert, elle va grandir comme protégée du reste du monde, oubliant le mal qui existe peut-être encore ailleurs, elle va mettre toute la force de son âme dans son métier de brodeuse.
Angélique laisse entrer dans son âme la paix, la majesté des vieilles pierres de la cathédrale toute proche, ces pages sont belles.
Mais que vient faire dans la grande fresque des Rougon-Macquart cette histoire d'une enfant abandonnée, recueillie dans l'ombre protectrice d'une cathédrale romane ? Tout simplement parce qu'Angélique descend de la lignée des Rougon. Elle est la fille de Sidonie Rougon. Enfant battue, abandonnée, fuyant une lignée maudite... Fuyant un destin qui n'était pas le sien... Ici, Zola rajoute un morceau au puzzle de la grande fresque.
Nous voici donc à Beaumont-l'Église, ville créée de pure fantaisie, tout comme la ville de Plassans sortie de l'imaginaire de l'auteur. Qui plus est, c'est une ville épiscopale pour la circonstance. J'ai reconnu ici toute la force créatrice de ce cher Zola et sa capacité à évoluer vers des univers où on ne l'attend pas.
Zola qu'on pourrait aisément qualifier de mécréant, nous délivre ici une crise de foi aiguë.
Angélique guette à sa fenêtre et brusquement un prince charmant débarque comme par miracle, il s'appelle Félicien. Il est doué aussi de ses mains, entendez ici qu'il est un artiste lui aussi dans le registre ecclésiastique. Il est peintre verrier.
Angélique et lui ont en commun l'art de leur métier et puis autre chose aussi... Ils vont apprendre à se connaître parce qu'ils sont amenés à travailler sur un ouvrage commun en vue d'une prochaine procession...
Le sujet est tellement banal qu'on pourrait presque en rire. Écoutez un peu. Ils s'aiment en silence et chacun s'interdit d'y croire un seul instant, ils se mentent l'un à l'autre et se mentent à eux-mêmes, puis quand ils se l'avouent enfin et qu'ils veulent se marier, ils n'ont pas encore dans leur naïveté enfantine imaginé que leurs familles s'opposeront à ce mariage. Plus particulièrement c'est la famille du jeune homme ou plutôt son père évêque qui va interdire cet amour. Oui, un évêque, vous m'avez bien lu... Cela dit, c'était possible, il avait eu cet enfant et était entré dans la religion après le décès de son épouse, morte en donnant naissance à l'enfant...
Elle et lui, c'est un trait de lumière. Elle aimait Jésus jusqu'à présent et elle va trahir ce dernier pour ce Félicien tombé du ciel comme un archange.
Félicien est destiné à une autre, compte tenu du rang que tient sa famille. Qu'importe !
C'est un sujet banal, un amour interdit, un mythe intemporel. Je me suis demandé dans quelle histoire ce foutu Zola était venu se fourvoyer, et nous avec.
Selon moi, c'est plus un univers mystique que Zola a cherché ici à construire plutôt qu'un univers religieux, même si Jésus et tout le tralala, les évêques, les abbés, les saintes, les vitraux, les processions, tout ça est fortement présent dans ce récit. Je ne sais pas comment Émile a su tirer son épingle du jeu... Mais je trouve qu'il le fait à merveille...
C'est comme un poème, c'est comme un songe, c'est une oeuvre éthérée, presque aérienne...
On sent Zola ébloui peut-être plus que nous d'ailleurs...
Mais que vient faire cet écart, ce pas de côté dans cette oeuvre ? Cela dit, ce n'est pas la première fois.
Autant, dans le livre précédent, La Terre, tout paraissait odieux, ici c'est comme si Zola avait voulu respirer le bonheur, un besoin presque naïf de fraîcheur qu'il voulait nous partager.
J'imagine que Zola a sans doute pris ici un risque, frôlant le ridicule à chaque chapitre, l'évitant par l'honnêteté qu'il inspire, l'amour qu'il porte cela se voit à son héroïne, la compassion, la capacité aussi à porter de la lumière sur les personnages. J'ai senti que Zola rêvait d'Angélique, un oiseau blessé encore fragile, posé sur la branche des pages de ce livre.
Zola surprend donc ici, et c'est peut-être ça qu'il cherchait seulement à faire. Surprendre son lecteur. Mais je commence à le connaître ce lascar, Zola ne fait jamais les choses innocemment.
Pourtant, on retrouve des thèmes qui lui sont chers, la lutte éternelle de la passion et du devoir, le déterminisme, la filiation.
C'est la revanche d'une enfant abandonnée dont on voudrait croire au bonheur, sa revanche sur la réalité, sur les rebuffades qu'elle a peut-être connues auparavant.
Angélique, oiseau fugitif traversant la fragilité des pages, aura-t-elle connu au moins le bonheur, à défaut d'avoir été touchée par la grâce lorsqu'elle rêve de ressembler à Sainte Agnès ?
Mais le réveil après le rêve ressemble parfois à une gueule de bois. Se réveiller après le rêve, c'est revenir de plein pied dans l'ordre raisonnable et cruel du monde. Pour Angélique aussi...
On peut y voir plein de choses insoupçonnées. Loin d'une bluette.
C'est dans la durée qu'il faut apprécier Zola, sachant avec autant de talent convoquer les saintes nitouches que le petit peuple des caniveaux...
Ici j'ai découvert une pudeur exceptionnelle, une chasteté absolue, auxquelles Zola ne nous avait pas habituées jusqu'à présent.
Il y a dans ce récit une poésie, des envolées d'oiseaux qui touchent le ciel et des coeurs qui battent, tellement fort qu'on pourrait les entendre.
Je vous avouerai que le Rêve est loin d'être l'opus que j'ai préféré dans la saga des Rougon-Macquart, mais il mérite cependant le détour, ne serait-ce que pour les respirations qu'il apporte à cette grande fresque chahutée par la violence de l'âme humaine.
De temps en temps, dans ce parcours, cela lui arrive. Comme j'ai fait le choix assumé de lire jusqu'à présent cette oeuvre dans son ordre chronologique, je peux témoigner que c'est la troisième fois qu'il convoque la religion, ceci après La Conquête de Plassans et La Faute de l'abbé Mouret.
Souvent après un roman dur, Zola cherche à nous apaiser avec un roman doux. Après La Terre nous en avions bien besoin.
Pas facile en effet de passer de la Terre au Rêve, des culbutes dans les tas de foin à l'amour mystique. Est-ce le même Zola ? Certes, ce n'est pas ici du Zola pur jus, cependant...
Angélique, est une enfant abandonnée placée dès sa naissance à l'assistance publique. Mais à l'adolescence, souffrant de la violence qu'elle subit, elle décide de s'enfuir de la famille dans laquelle elle avait été confiée. Elle sera recueillie par un couple de brodeurs, les Hubert, elle va grandir comme protégée du reste du monde, oubliant le mal qui existe peut-être encore ailleurs, elle va mettre toute la force de son âme dans son métier de brodeuse.
Angélique laisse entrer dans son âme la paix, la majesté des vieilles pierres de la cathédrale toute proche, ces pages sont belles.
Mais que vient faire dans la grande fresque des Rougon-Macquart cette histoire d'une enfant abandonnée, recueillie dans l'ombre protectrice d'une cathédrale romane ? Tout simplement parce qu'Angélique descend de la lignée des Rougon. Elle est la fille de Sidonie Rougon. Enfant battue, abandonnée, fuyant une lignée maudite... Fuyant un destin qui n'était pas le sien... Ici, Zola rajoute un morceau au puzzle de la grande fresque.
Nous voici donc à Beaumont-l'Église, ville créée de pure fantaisie, tout comme la ville de Plassans sortie de l'imaginaire de l'auteur. Qui plus est, c'est une ville épiscopale pour la circonstance. J'ai reconnu ici toute la force créatrice de ce cher Zola et sa capacité à évoluer vers des univers où on ne l'attend pas.
Zola qu'on pourrait aisément qualifier de mécréant, nous délivre ici une crise de foi aiguë.
Angélique guette à sa fenêtre et brusquement un prince charmant débarque comme par miracle, il s'appelle Félicien. Il est doué aussi de ses mains, entendez ici qu'il est un artiste lui aussi dans le registre ecclésiastique. Il est peintre verrier.
Angélique et lui ont en commun l'art de leur métier et puis autre chose aussi... Ils vont apprendre à se connaître parce qu'ils sont amenés à travailler sur un ouvrage commun en vue d'une prochaine procession...
Le sujet est tellement banal qu'on pourrait presque en rire. Écoutez un peu. Ils s'aiment en silence et chacun s'interdit d'y croire un seul instant, ils se mentent l'un à l'autre et se mentent à eux-mêmes, puis quand ils se l'avouent enfin et qu'ils veulent se marier, ils n'ont pas encore dans leur naïveté enfantine imaginé que leurs familles s'opposeront à ce mariage. Plus particulièrement c'est la famille du jeune homme ou plutôt son père évêque qui va interdire cet amour. Oui, un évêque, vous m'avez bien lu... Cela dit, c'était possible, il avait eu cet enfant et était entré dans la religion après le décès de son épouse, morte en donnant naissance à l'enfant...
Elle et lui, c'est un trait de lumière. Elle aimait Jésus jusqu'à présent et elle va trahir ce dernier pour ce Félicien tombé du ciel comme un archange.
Félicien est destiné à une autre, compte tenu du rang que tient sa famille. Qu'importe !
C'est un sujet banal, un amour interdit, un mythe intemporel. Je me suis demandé dans quelle histoire ce foutu Zola était venu se fourvoyer, et nous avec.
Selon moi, c'est plus un univers mystique que Zola a cherché ici à construire plutôt qu'un univers religieux, même si Jésus et tout le tralala, les évêques, les abbés, les saintes, les vitraux, les processions, tout ça est fortement présent dans ce récit. Je ne sais pas comment Émile a su tirer son épingle du jeu... Mais je trouve qu'il le fait à merveille...
C'est comme un poème, c'est comme un songe, c'est une oeuvre éthérée, presque aérienne...
On sent Zola ébloui peut-être plus que nous d'ailleurs...
Mais que vient faire cet écart, ce pas de côté dans cette oeuvre ? Cela dit, ce n'est pas la première fois.
Autant, dans le livre précédent, La Terre, tout paraissait odieux, ici c'est comme si Zola avait voulu respirer le bonheur, un besoin presque naïf de fraîcheur qu'il voulait nous partager.
J'imagine que Zola a sans doute pris ici un risque, frôlant le ridicule à chaque chapitre, l'évitant par l'honnêteté qu'il inspire, l'amour qu'il porte cela se voit à son héroïne, la compassion, la capacité aussi à porter de la lumière sur les personnages. J'ai senti que Zola rêvait d'Angélique, un oiseau blessé encore fragile, posé sur la branche des pages de ce livre.
Zola surprend donc ici, et c'est peut-être ça qu'il cherchait seulement à faire. Surprendre son lecteur. Mais je commence à le connaître ce lascar, Zola ne fait jamais les choses innocemment.
Pourtant, on retrouve des thèmes qui lui sont chers, la lutte éternelle de la passion et du devoir, le déterminisme, la filiation.
C'est la revanche d'une enfant abandonnée dont on voudrait croire au bonheur, sa revanche sur la réalité, sur les rebuffades qu'elle a peut-être connues auparavant.
Angélique, oiseau fugitif traversant la fragilité des pages, aura-t-elle connu au moins le bonheur, à défaut d'avoir été touchée par la grâce lorsqu'elle rêve de ressembler à Sainte Agnès ?
Mais le réveil après le rêve ressemble parfois à une gueule de bois. Se réveiller après le rêve, c'est revenir de plein pied dans l'ordre raisonnable et cruel du monde. Pour Angélique aussi...
On peut y voir plein de choses insoupçonnées. Loin d'une bluette.
C'est dans la durée qu'il faut apprécier Zola, sachant avec autant de talent convoquer les saintes nitouches que le petit peuple des caniveaux...
Ici j'ai découvert une pudeur exceptionnelle, une chasteté absolue, auxquelles Zola ne nous avait pas habituées jusqu'à présent.
Il y a dans ce récit une poésie, des envolées d'oiseaux qui touchent le ciel et des coeurs qui battent, tellement fort qu'on pourrait les entendre.
Je vous avouerai que le Rêve est loin d'être l'opus que j'ai préféré dans la saga des Rougon-Macquart, mais il mérite cependant le détour, ne serait-ce que pour les respirations qu'il apporte à cette grande fresque chahutée par la violence de l'âme humaine.
Roman de Zola qui m'a beaucoup surprise.
Cela commence comme un conte (j'ai pensé à la petite fille aux allumettes).
Angélique une petite fille s'est enfuie de chez sa nounou qui la traitait mal. C'est l'hiver. Elle se recroqueville dans un recoin d'une église. Hubert et Hubertine un couple de brodeurs volent à son secours, deviennent ses tuteurs en attendant de pouvoir l'adopter. Leur unique enfant est mort.
Angélique grandit et tout en apprenant le métier de brodeuse pour lequel elle est infiniment douée, elle se prend de passion pour les saintes et martyres de la religion chrétienne. Zola raconte si bien l'histoire de ses saintes que j'avoue avoir apprécié les passages à connotation religieuse.
Angélique finit par tomber amoureuse d'un beau jeune homme verrier.
Seulement, le garçon n'est pas un simple ouvrier et l'évêque ne consent pas au mariage.
Cela commence comme un conte (j'ai pensé à la petite fille aux allumettes).
Angélique une petite fille s'est enfuie de chez sa nounou qui la traitait mal. C'est l'hiver. Elle se recroqueville dans un recoin d'une église. Hubert et Hubertine un couple de brodeurs volent à son secours, deviennent ses tuteurs en attendant de pouvoir l'adopter. Leur unique enfant est mort.
Angélique grandit et tout en apprenant le métier de brodeuse pour lequel elle est infiniment douée, elle se prend de passion pour les saintes et martyres de la religion chrétienne. Zola raconte si bien l'histoire de ses saintes que j'avoue avoir apprécié les passages à connotation religieuse.
Angélique finit par tomber amoureuse d'un beau jeune homme verrier.
Seulement, le garçon n'est pas un simple ouvrier et l'évêque ne consent pas au mariage.
Emile Zola pensait avoir rempli « la case réservée pour l'étude de l'au-delà » avec son Rêve mais à l'au-delà religieux et inaccessible auquel on pense spontanément, l'écrivain nous propose un imaginaire sacré et merveilleux qui relève plutôt de l'ici-maintenant du fantasme.
Tout commence avec la lecture de la Légende dorée de Jacques de Voragine. Ce livre, consacré aux saints de la tradition chrétienne, est la source de l'émerveillement enfantin d'Angélique, recueillie par des parents adoptifs après une nuit de souffrances glaciales. Les motifs traditionnels des descriptions zoliennes s'égrainent cette fois sur le mode de la découverte intérieure. Les saints, les diables et les miracles deviennent les déclinaisons de modes d'émerveillement ; les symboles sacrés se drapent de tissus et de couleurs sans cesse redécouverts dans la répétition du travail quotidien de la broderie. Dans son univers clos, Angélique confond le rêve et la réalité. Pour quelle raison les miracles de la Légende dorée ne se produiraient-ils plus ? Innocente dans sa conception de l'amour, elle ne rêve plus que de rencontrer l'image pure et idéale, presque christique, de celui qui l'aimera et qui se dévoilera à elle sans se présenter, au-delà de la superfluité des mots et des usages.
Le Rêve ne se brise pas à cause de la naïveté d'une enfant insouciante. Emile Zola s'attaque presque à la volonté toujours trop pragmatique d'adultes qui se vouent à la réalité comme à un refuge contre leurs fantasmes. le rêve échoue à cause de la réalité, sa faillite tient tout entière dans le manque de foi.
Après la magie d'un premier temps d'innocence édénique, le Rêve se transforme en cri de révolte outré contre le péché de tristesse et de désespoir des parents. Angélique refuse le modèle qu'on lui propose en héritage. On entend la voix de Henry David Thoreau qui écrivait :
« Nulle façon de penser ou d'agir, si ancienne soit-elle, ne saurait être acceptée sans preuve. Ce que chacun répète en écho ou passe sous silence comme vrai aujourd'hui, peut demain se révéler mensonge, simple fumée de l'opinion, que d'aucuns avaient prise pour le nuage appelé à répandre sur les champs une pluie fertilisante. Ce que les vieilles gens disent que vous ne pouvez faire, vous vous apercevez, en l'essayant, que vous le pouvez fort bien. »
Car après tout, puisque les parents sont malheureux, à quoi bon écouter leurs conseils et suivre leur exemple ? La mort plutôt qu'une vie indigne. Mais Emile Zola n'est pas un chantre de la dissidence et ses considérations plus nuancées nous conduisent bientôt à l'étape supérieure de la réflexion. Parcours existentiel et cheminement initiatique vers une spiritualité moins parjure s'alignent pour conduire la bouillante petite fille à la sage jeune femme.
Le Rêve, récit d'une passion en trois étapes, ne mérite absolument pas sa réputation de parenthèse innocente et inconsistante. On oserait presque croire que l'âme d'Emile Zola y palpite dans toute la faiblesse de son coeur d'homme…
Tout commence avec la lecture de la Légende dorée de Jacques de Voragine. Ce livre, consacré aux saints de la tradition chrétienne, est la source de l'émerveillement enfantin d'Angélique, recueillie par des parents adoptifs après une nuit de souffrances glaciales. Les motifs traditionnels des descriptions zoliennes s'égrainent cette fois sur le mode de la découverte intérieure. Les saints, les diables et les miracles deviennent les déclinaisons de modes d'émerveillement ; les symboles sacrés se drapent de tissus et de couleurs sans cesse redécouverts dans la répétition du travail quotidien de la broderie. Dans son univers clos, Angélique confond le rêve et la réalité. Pour quelle raison les miracles de la Légende dorée ne se produiraient-ils plus ? Innocente dans sa conception de l'amour, elle ne rêve plus que de rencontrer l'image pure et idéale, presque christique, de celui qui l'aimera et qui se dévoilera à elle sans se présenter, au-delà de la superfluité des mots et des usages.
Le Rêve ne se brise pas à cause de la naïveté d'une enfant insouciante. Emile Zola s'attaque presque à la volonté toujours trop pragmatique d'adultes qui se vouent à la réalité comme à un refuge contre leurs fantasmes. le rêve échoue à cause de la réalité, sa faillite tient tout entière dans le manque de foi.
Après la magie d'un premier temps d'innocence édénique, le Rêve se transforme en cri de révolte outré contre le péché de tristesse et de désespoir des parents. Angélique refuse le modèle qu'on lui propose en héritage. On entend la voix de Henry David Thoreau qui écrivait :
« Nulle façon de penser ou d'agir, si ancienne soit-elle, ne saurait être acceptée sans preuve. Ce que chacun répète en écho ou passe sous silence comme vrai aujourd'hui, peut demain se révéler mensonge, simple fumée de l'opinion, que d'aucuns avaient prise pour le nuage appelé à répandre sur les champs une pluie fertilisante. Ce que les vieilles gens disent que vous ne pouvez faire, vous vous apercevez, en l'essayant, que vous le pouvez fort bien. »
Car après tout, puisque les parents sont malheureux, à quoi bon écouter leurs conseils et suivre leur exemple ? La mort plutôt qu'une vie indigne. Mais Emile Zola n'est pas un chantre de la dissidence et ses considérations plus nuancées nous conduisent bientôt à l'étape supérieure de la réflexion. Parcours existentiel et cheminement initiatique vers une spiritualité moins parjure s'alignent pour conduire la bouillante petite fille à la sage jeune femme.
Le Rêve, récit d'une passion en trois étapes, ne mérite absolument pas sa réputation de parenthèse innocente et inconsistante. On oserait presque croire que l'âme d'Emile Zola y palpite dans toute la faiblesse de son coeur d'homme…
« La religion est l'opium du peuple »
Un roman relativement court, en comparaison des autres de la série des Rougon-Macquart, et en apparence bien différent de ceux que j'avais déjà lus dans ma jeunesse (c'est-à-dire il y a bien longtemps), tels L'assommoir, Germinal, La bête humaine.
D'ailleurs, Zola, lui-même, avait écrit: « Je voudrais faire un livre qu'on n'attende pas de moi ».
Et une lecture superficielle de ce roman pourrait l'assimiler à une sorte de conte édifiant pour catholiques bien-pensants.
Car voilà l'histoire en quelques mots. Une pauvre enfant, abandonnée par sa mère, maltraitée par sa famille d'accueil, s'enfuit et se réfugie un soir d'hiver sous le porche enneigé d'une cathédrale. Recueillie par un couple d'artisans spécialisé dans la confection de broderies religieuses, elle va se révéler en grandissant une brodeuse de génie, mais aussi une jeune fille fascinée par l'histoire et le destin des saintes du Moyen Âge, et fantasmant la rencontre avec un « Prince Charmant » jeune, beau et riche. Ce « rêve » va se concrétiser par la rencontre d'un jeune noble et par leur coup de foudre réciproque, jeune noble qui est le fils d'un Monseigneur, un homme rentré dans les ordres suite à la mort de sa femme, et devenu Évêque. Mais le projet de mariage va se heurter à l'opposition de Monseigneur, et aussi des parents adoptifs. La jeune fille va faire alors ce que l'on appellerait de nos jours un épisode dépressif mélancolique, et devant son état critique, le mariage est accepté, la jeune fille retrouve la force de vivre la cérémonie nuptiale pour mourir aussitôt sur le parvis de la cathédrale.
Et toute une symbolique parcourt le récit. La pure jeune fille ne s'appelle- t-elle pas Angélique, le beau jeune homme Félicien, les parents adoptifs et fusionnels, Hubert et Hubertine. La cathédrale à laquelle est adossée la maison des brodeurs est omniprésente, comme un personnage imposant et inquiétant, symbole de la toute puissance du religieux. Et tant d'autres symboles, les vitraux de la cathédrale, les motifs brodés, l'églantier, la blancheur de la neige et des vêtements, etc….je ne peux pas tous les citer.
Mais tous ces symboles, tous ces détails, le lecteur le comprend peu à peu, c'est l'intention de l'auteur de montrer la religion comme une illusion que l'on se construit, un fantasme, un refus du réel pour s'évader dans un rêve mortifère, une vie au sein d'un monde surnaturel. Et ceci à ce moment si critique, sensible et fragile qu'est l'adolescence, avec les délices et les tourments de l'éveil amoureux, magnifiquement décrits par Zola.
Il faut donc prendre, en définitive, le Rêve comme une critique de la religion qui fait préférer un « Paradis Artificiel » à l'acceptation de la vie telle qu'elle est.
Mais cette intention de Zola peut ne pas apparaître évidente à première vue, et d'ailleurs celui-ci avait perçu l'écueil, et redouté qu'on prenne le Rêve pour un conte très « fleur bleue ».
A ce propos, une fois n'est pas coutume, il faut lire la préface remarquable du grand spécialiste de Zola, Henri Mitterand (qui n'est pas apparenté à François!), passionnante pour nous décrire la genèse de l'oeuvre, les incertitudes et les hésitations de Zola, ainsi que l'ambiguïté de la réception du roman.
Mais, bon, après avoir rêvé au ciel, je voudrais bien retourner à La Terre, et retrouver la cruauté de mon Zola.
Un roman relativement court, en comparaison des autres de la série des Rougon-Macquart, et en apparence bien différent de ceux que j'avais déjà lus dans ma jeunesse (c'est-à-dire il y a bien longtemps), tels L'assommoir, Germinal, La bête humaine.
D'ailleurs, Zola, lui-même, avait écrit: « Je voudrais faire un livre qu'on n'attende pas de moi ».
Et une lecture superficielle de ce roman pourrait l'assimiler à une sorte de conte édifiant pour catholiques bien-pensants.
Car voilà l'histoire en quelques mots. Une pauvre enfant, abandonnée par sa mère, maltraitée par sa famille d'accueil, s'enfuit et se réfugie un soir d'hiver sous le porche enneigé d'une cathédrale. Recueillie par un couple d'artisans spécialisé dans la confection de broderies religieuses, elle va se révéler en grandissant une brodeuse de génie, mais aussi une jeune fille fascinée par l'histoire et le destin des saintes du Moyen Âge, et fantasmant la rencontre avec un « Prince Charmant » jeune, beau et riche. Ce « rêve » va se concrétiser par la rencontre d'un jeune noble et par leur coup de foudre réciproque, jeune noble qui est le fils d'un Monseigneur, un homme rentré dans les ordres suite à la mort de sa femme, et devenu Évêque. Mais le projet de mariage va se heurter à l'opposition de Monseigneur, et aussi des parents adoptifs. La jeune fille va faire alors ce que l'on appellerait de nos jours un épisode dépressif mélancolique, et devant son état critique, le mariage est accepté, la jeune fille retrouve la force de vivre la cérémonie nuptiale pour mourir aussitôt sur le parvis de la cathédrale.
Et toute une symbolique parcourt le récit. La pure jeune fille ne s'appelle- t-elle pas Angélique, le beau jeune homme Félicien, les parents adoptifs et fusionnels, Hubert et Hubertine. La cathédrale à laquelle est adossée la maison des brodeurs est omniprésente, comme un personnage imposant et inquiétant, symbole de la toute puissance du religieux. Et tant d'autres symboles, les vitraux de la cathédrale, les motifs brodés, l'églantier, la blancheur de la neige et des vêtements, etc….je ne peux pas tous les citer.
Mais tous ces symboles, tous ces détails, le lecteur le comprend peu à peu, c'est l'intention de l'auteur de montrer la religion comme une illusion que l'on se construit, un fantasme, un refus du réel pour s'évader dans un rêve mortifère, une vie au sein d'un monde surnaturel. Et ceci à ce moment si critique, sensible et fragile qu'est l'adolescence, avec les délices et les tourments de l'éveil amoureux, magnifiquement décrits par Zola.
Il faut donc prendre, en définitive, le Rêve comme une critique de la religion qui fait préférer un « Paradis Artificiel » à l'acceptation de la vie telle qu'elle est.
Mais cette intention de Zola peut ne pas apparaître évidente à première vue, et d'ailleurs celui-ci avait perçu l'écueil, et redouté qu'on prenne le Rêve pour un conte très « fleur bleue ».
A ce propos, une fois n'est pas coutume, il faut lire la préface remarquable du grand spécialiste de Zola, Henri Mitterand (qui n'est pas apparenté à François!), passionnante pour nous décrire la genèse de l'oeuvre, les incertitudes et les hésitations de Zola, ainsi que l'ambiguïté de la réception du roman.
Mais, bon, après avoir rêvé au ciel, je voudrais bien retourner à La Terre, et retrouver la cruauté de mon Zola.
J'ai trouvé cette lecture plus ardue que les tomes précédents des Rougon-Macquart. On est tellement dans l'onirisme que je décrochais. Ben voyons me disais-je!
Et puis, les dernières pages m'ont apportées une profonde réflexion, une paix de l'esprit en fait, car je reconnaissais les tourments de l'adolescence, les dérives de la croyance en un dieu, le mourir d'aimer.
Quand le Rêve surpasse la réalité; quand l'au-delà et l'insaisissable se présentent, comment résister?
J'ai été élevée par des parents très croyants, qui ont passés les années avec une religion forte qui surveillait les faits et gestes par dessus leurs épaules.
L'emprise de cette foi catholique, qui obligeait ma mère à mettre des cailloux dans ses souliers pour aller à l'église, qui lui a fait se souvenir du christ jusqu'à son décès alors qu'elle avait oublié son mari, mon père, depuis des années.
Le Rêve raconte Angélique, jeune orpheline, recueillie par Hubert et Hubertine, un couple très croyant de la région du Val-d'Oise, qui habitent une maison qui sent bon la tendresse. Angélique s'adapte lentement à la vie douce et ascète du couple mais le temps fait son oeuvre et son tempérament s'assagit. Elle se repaît de lectures pieuses et fricote « en compagnie des vierges, errantes et douces dans l'air frissonnant. »
Elle rencontre Félicien, peintre-verrier qui ressemble au prince de Son Rêve de pauvre petite Angélique. Elle se voit mariée, Sainte-Agnès au bras de Saint-Georges. Chimère ou illusion?
Il y a peu d'acteurs dans ce livre. J'ai déjà nommé les principaux. J'ajouterai le Monseigneur et la cathédrale, la maison et la broderie, les tissus et les vierges. Car même les fils et les étoffes prennent vie pour notre bonheur. Les descriptions de Zola sont fascinantes et si l'histoire d'amour n'est qu'illusion, la vie du village mérite attention.
Les séances de lavage à la rivière, les processions, les légendes et les métiers m'ont particulièrement intéressée.
Je termine cette lecture à l'action de grâce, est-ce que je dois y voir un signe?
Et puis, les dernières pages m'ont apportées une profonde réflexion, une paix de l'esprit en fait, car je reconnaissais les tourments de l'adolescence, les dérives de la croyance en un dieu, le mourir d'aimer.
Quand le Rêve surpasse la réalité; quand l'au-delà et l'insaisissable se présentent, comment résister?
J'ai été élevée par des parents très croyants, qui ont passés les années avec une religion forte qui surveillait les faits et gestes par dessus leurs épaules.
L'emprise de cette foi catholique, qui obligeait ma mère à mettre des cailloux dans ses souliers pour aller à l'église, qui lui a fait se souvenir du christ jusqu'à son décès alors qu'elle avait oublié son mari, mon père, depuis des années.
Le Rêve raconte Angélique, jeune orpheline, recueillie par Hubert et Hubertine, un couple très croyant de la région du Val-d'Oise, qui habitent une maison qui sent bon la tendresse. Angélique s'adapte lentement à la vie douce et ascète du couple mais le temps fait son oeuvre et son tempérament s'assagit. Elle se repaît de lectures pieuses et fricote « en compagnie des vierges, errantes et douces dans l'air frissonnant. »
Elle rencontre Félicien, peintre-verrier qui ressemble au prince de Son Rêve de pauvre petite Angélique. Elle se voit mariée, Sainte-Agnès au bras de Saint-Georges. Chimère ou illusion?
Il y a peu d'acteurs dans ce livre. J'ai déjà nommé les principaux. J'ajouterai le Monseigneur et la cathédrale, la maison et la broderie, les tissus et les vierges. Car même les fils et les étoffes prennent vie pour notre bonheur. Les descriptions de Zola sont fascinantes et si l'histoire d'amour n'est qu'illusion, la vie du village mérite attention.
Les séances de lavage à la rivière, les processions, les légendes et les métiers m'ont particulièrement intéressée.
Je termine cette lecture à l'action de grâce, est-ce que je dois y voir un signe?
Jeune adolescente, Angélique, fille abandonnée de Sidonie Rougon, est, une nuit, recueillie par les Hubert, brodeurs de la ville de Beaumont-sur-Oise, puis adoptée. En grandissant, elle devient une belle jeune fille, aux talents de brodeuse exceptionnels, mais à l'obsession maladive, typique des Rougon quant au côté maladif, pour la religion, contemplant à longueur de temps la cathédrale voisine de la demeure de ses parents adoptifs, et lisant avec passion la Légende dorée de Voragine, jusqu'à l'apparition onirique d'un ange, un soir, qui n'est autre que Félicien, un peintre verrier qui vient rénover les vitraux, et qui n'est pas resté insensible au charme d'Angélique...
J'avais jusqu'à présent toujours apprécié les romans plus doux, plus intimistes, des Rougon-Macquart, qui permettaient un souffle plus lumineux après la noirceur d'autres tomes. Ce n'a pas été le cas du Rêve, que j'ai trouvé non seulement assez mièvre, mais aussi très artificiel, autant quant à son intrigue que quant à la psychologie, trop typique, des personnages. Et puis, lorsque l'on s'intéresse précisément aux dernières pages, l'on se rend compte que le destin d'Angélique devient prétexte à l'absolution finale des autres personnages, et tant pis pour une Rougon, qui ne semble en fin de compte pas mériter mieux.
Oui, la lecture précédente de la terre m'a grandement ouvert les yeux sur l'antipathie que le romancier a en fin de compte pour ses personnages. Mon regard va-t-il changer aussi à la relecture du prochain tome, La bête humaine ?
J'avais jusqu'à présent toujours apprécié les romans plus doux, plus intimistes, des Rougon-Macquart, qui permettaient un souffle plus lumineux après la noirceur d'autres tomes. Ce n'a pas été le cas du Rêve, que j'ai trouvé non seulement assez mièvre, mais aussi très artificiel, autant quant à son intrigue que quant à la psychologie, trop typique, des personnages. Et puis, lorsque l'on s'intéresse précisément aux dernières pages, l'on se rend compte que le destin d'Angélique devient prétexte à l'absolution finale des autres personnages, et tant pis pour une Rougon, qui ne semble en fin de compte pas mériter mieux.
Oui, la lecture précédente de la terre m'a grandement ouvert les yeux sur l'antipathie que le romancier a en fin de compte pour ses personnages. Mon regard va-t-il changer aussi à la relecture du prochain tome, La bête humaine ?
J'aime ce qui est beau et poétique, surtout lorsqu'il y a un arrière-goût doux-amer. Autant dire qu'avec "Le rêve" de Zola, je suis servi !!
C'est effectivement quelque chose d'avant tout beau et poétique, que Zola écrit ici, un roman qui n'est rien d'autre qu'une longue et belle poésie, dont Zola m'a enveloppé peu à peu, mot après mot, phrase après phrase, délicatement, progressivement, sans se presser... Et si les premières pages peuvent paraître difficiles, plus j'ai avancé dans le roman, plus j'ai été conquis. C'est beau, c'est délicat, c'est poétique et je me suis plongé dans le monde qu'a créé Zola, ce monde d'encre et de papier, ce monde de rêve qui semble réel sans jamais sembler l'être tout à fait.
Zola le crée peu à peu, il faut être patient, il le dessine petit à petit, ce monde pas tout à fait réaliste (bien que Zola n'abandonne pas complètement sa fibre naturaliste), ce monde qui est à l'image du titre du roman : comme un rêve, un rêve où l'on se plonge, un rêve qui est comme une belle et longue poésie. Et comme j'aime ce rêve !! Comme je l'aime, ce rêve un peu étrange, que Zola nous a offert, avec ce roman !! Oui, je l'aime, j'aime me laisser emporter par ce doux poème, dans lequel Zola a décidé de plonger son lecteur...
Un bien bon Zola !!
C'est effectivement quelque chose d'avant tout beau et poétique, que Zola écrit ici, un roman qui n'est rien d'autre qu'une longue et belle poésie, dont Zola m'a enveloppé peu à peu, mot après mot, phrase après phrase, délicatement, progressivement, sans se presser... Et si les premières pages peuvent paraître difficiles, plus j'ai avancé dans le roman, plus j'ai été conquis. C'est beau, c'est délicat, c'est poétique et je me suis plongé dans le monde qu'a créé Zola, ce monde d'encre et de papier, ce monde de rêve qui semble réel sans jamais sembler l'être tout à fait.
Zola le crée peu à peu, il faut être patient, il le dessine petit à petit, ce monde pas tout à fait réaliste (bien que Zola n'abandonne pas complètement sa fibre naturaliste), ce monde qui est à l'image du titre du roman : comme un rêve, un rêve où l'on se plonge, un rêve qui est comme une belle et longue poésie. Et comme j'aime ce rêve !! Comme je l'aime, ce rêve un peu étrange, que Zola nous a offert, avec ce roman !! Oui, je l'aime, j'aime me laisser emporter par ce doux poème, dans lequel Zola a décidé de plonger son lecteur...
Un bien bon Zola !!
Emile Zola, c'est mon chouchou, l'auteur classique que je préfère, grâce à qui j'ai découvert la littérature française du 19è siècle.
Je voulais lire toute la série des Rougon-Macquart quand j'étais étudiante et finalement je n'en ai lu que quelques-uns : Au bonheur des Dames, Pot-Bouille (au passage il est super), l'Assommoir, Germinal.
Aujourd'hui, je ne suis pas peu fière d'en ajouter un à ma liste : le rêve.
J'avais très envie de renouer avec Zola, de redécouvrir son style, de voir si j'étais encore capable de lire des romans richement rédigés, avec de longues phrases !!!! Je me demande parfois si nos auteurs pourraient encore écrire comme ça. Bref…
Eh bien, oui je l'ai fait et oui j'ai adoré ce roman qui est toutefois à classer dans un registre à part des thèmes habituels de Zola. Pas de machine ou d'ouvriers en colère, pas de folies parisiennes… Avec son héroïne Angélique, Zola nous plonge dans la religion catholique, le poids de ses croyances et de l'ordre instauré.
Angélique petite orpheline est recueillie au pied d'une cathédrale, sous une statue de Sainte Agnès, un jour de neige, par un couple de brodeurs les Hubert, de braves gens. Cela commence par leur pitié pour l'enfant et leur bon coeur. Ils la prennent chez eux et l'élèvent comme leur fille, à l'écart de tout dans un bourg de l'Oise, lui enseigne la broderie. Son seul paysage est la cathédrale et sainte Agnès jeune martyre de 13 ans. Angélique grandit, devient une jeune fille et tombe amoureuse.
J'ai suivi avec plaisir les premiers émois d'Angélique et ceux de Félicien, l'innocence de leur amour et son aveuglement.
Mais voilà la société ne permet pas tout. Nous sommes en 1860 en Picardie, les puissants sont respectés et Dieu est le grand ordonnateur.
Et puis il y a ce parallèle constant, cette confusion entretenue entre Angélique et sainte Agnès.
Du coup, Zola nous sert de longues descriptions religieuses, de scènes mystiques à la limite de la superstition. Angélique, dans ce décor, fait montre d'une grande pureté, donne satisfaction à ses parents, aime le blanc qui est sa couleur préférée.
J'ai fait un peu abstraction de tout ça pour profiter de l'histoire d'Angélique et de la beauté de ce roman, de cette plume sublime.
A découvrir si vous aimez Zola et que vous souhaitez changer un peu du registre habituel.
Je voulais lire toute la série des Rougon-Macquart quand j'étais étudiante et finalement je n'en ai lu que quelques-uns : Au bonheur des Dames, Pot-Bouille (au passage il est super), l'Assommoir, Germinal.
Aujourd'hui, je ne suis pas peu fière d'en ajouter un à ma liste : le rêve.
J'avais très envie de renouer avec Zola, de redécouvrir son style, de voir si j'étais encore capable de lire des romans richement rédigés, avec de longues phrases !!!! Je me demande parfois si nos auteurs pourraient encore écrire comme ça. Bref…
Eh bien, oui je l'ai fait et oui j'ai adoré ce roman qui est toutefois à classer dans un registre à part des thèmes habituels de Zola. Pas de machine ou d'ouvriers en colère, pas de folies parisiennes… Avec son héroïne Angélique, Zola nous plonge dans la religion catholique, le poids de ses croyances et de l'ordre instauré.
Angélique petite orpheline est recueillie au pied d'une cathédrale, sous une statue de Sainte Agnès, un jour de neige, par un couple de brodeurs les Hubert, de braves gens. Cela commence par leur pitié pour l'enfant et leur bon coeur. Ils la prennent chez eux et l'élèvent comme leur fille, à l'écart de tout dans un bourg de l'Oise, lui enseigne la broderie. Son seul paysage est la cathédrale et sainte Agnès jeune martyre de 13 ans. Angélique grandit, devient une jeune fille et tombe amoureuse.
J'ai suivi avec plaisir les premiers émois d'Angélique et ceux de Félicien, l'innocence de leur amour et son aveuglement.
Mais voilà la société ne permet pas tout. Nous sommes en 1860 en Picardie, les puissants sont respectés et Dieu est le grand ordonnateur.
Et puis il y a ce parallèle constant, cette confusion entretenue entre Angélique et sainte Agnès.
Du coup, Zola nous sert de longues descriptions religieuses, de scènes mystiques à la limite de la superstition. Angélique, dans ce décor, fait montre d'une grande pureté, donne satisfaction à ses parents, aime le blanc qui est sa couleur préférée.
J'ai fait un peu abstraction de tout ça pour profiter de l'histoire d'Angélique et de la beauté de ce roman, de cette plume sublime.
A découvrir si vous aimez Zola et que vous souhaitez changer un peu du registre habituel.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Émile Zola (296)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le rêve - Emile Zola
Comment se nomme l'héroïne du roman ?
Juliette
Angeline
Angélique
Marie
10 questions
40 lecteurs ont répondu
Thème : Les Rougon-Macquart, tome 16 : Le Rêve de
Émile ZolaCréer un quiz sur ce livre40 lecteurs ont répondu