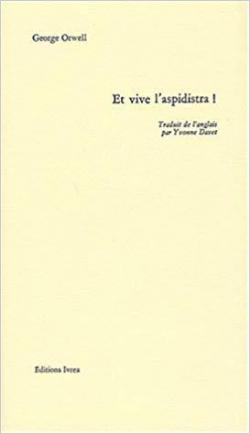>
Critique de Apoapo
Comment l'aspidistra devint-il, de l'époque victorienne jusqu'à sans doute la Seconde Guerre mondiale, une véritable icône de l'intérieur domestique « comme il faut », emblème de la respectabilité conventionnelle petit-bourgeoise en Angleterre ? Un article de presse récent émet l'hypothèse que, dès que l'illumination des logements londoniens passa majoritairement au gaz de ville, cette plante d'intérieur était la seule à être suffisamment robuste pour survivre à ses effluves : sa mode aurait survécu à l'électrification ; d'autre part, on peut avancer que l'essor des portraits photographiques des premières décennies du XXe siècle, où les décors d'intérieurs étaient reconstitués en studio, favorisait le minimalisme bon marché d'une pose où le personnage debout ou assis se faisait pendant à un guéridon surmonté d'un aspidistra : on en trouve d'innombrables exemples dans les photos de l'époque.
Toujours est-il que Gordon Comstock, le héros de ce roman précoce d'Eric Blair qui ne signait pas encore George Orwell, considère cette plante comme le symbole de tout ce qu'il hait, voire comme son ennemie personnelle. Depuis sa jeunesse au sein d'une famille qui a toujours vécu dans les privations et a placé en ses études tous les espoirs d'élévations sociale, Gordon, féru de poésie et de révolte sociale, a déclaré la guerre à l'argent et s'est escrimé à éviter d'en gagner assez. Mais chez lui un rapport obsessionnel, voire franchement monomaniaque à l'impécuniosité contribue à démolir le charme de l'indigence et l'empêche de jouir du bonheur de la bohème. Cette guerre qu'il déclare mener contre la pourriture du système économique environnant ne le conduit ni à une réflexion et encore moins à une action subversive – ne serait-ce que par le socialisme d'intentions de son très riche ami Ravelston – ni à une vie alternative d'anachorète serein, mais au contraire à la hargne victimaire d'un aspirant petit-bourgeois frustré par des conditions de vie de prolétaire, incapable cependant d'en connaître les astuces et les plaisirs. Son inspiration poétique se tarit dans la souillure alors qu'il est animé par un sentiment d'humiliation, le plus souvent imaginaire. Il se dédouane de ses comportements antipathiques avec ses amis, immoraux avec sa soeur et décidément abjects envers sa petite amie par la sempiternelle ritournelle de la pauvreté ; et le lecteur d'aujourd'hui le trouve sans doute encore plus odieux que ses contemporains du fait de ses crasses misogynie et homophobie.
En vérité, seules deux « batailles » justifient ce qu'il qualifie de guerre contre l'argent : sa démission d'un poste d'articlier publicitaire, et sa dilapidation en une seule nuit d'ivresse, de ripaille et de stupre d'un solide cachet inespéré... Mais son quotidien fait de quelques années de misère, d'invocation de la destruction de l'univers entier et de tentation à se laisser soi-même choir « dans le ruisseau » ne lui permet de s'arroger aucun héroïsme de belligérant. Les gens de son entourage sont encore trop bons pour ce qu'il mérite, pense-t-on.
Son retour dans les rangs les plus conventionnels et détestables du salariat, à l'évidence avec davantage de succès qu'il n'en avait jamais eu auparavant, serait-il le résultat d'un pari insensé, d'une acte d'audace terriblement dangereux de Rosemary, d'un ultime geste d'amour sacrificiel ou d'une profonde intuition féminine de sa part ? Serait-il l'effet d'une simple maturation, d'une sortie de l'adolescence qui a été plus tardive et plus risquée pour le protagoniste que pour un homme ordinaire dans sa condition ?
Représenterait-il déjà le pessimisme un peu cynique et très désabusé qui caractérisera l'ensemble de l'oeuvre orwellienne en ce qu'elle s'attelait à déconstruire les idéaux d'amélioration de la société qui avaient cours à son époque... ?
Toujours est-il que Gordon Comstock, le héros de ce roman précoce d'Eric Blair qui ne signait pas encore George Orwell, considère cette plante comme le symbole de tout ce qu'il hait, voire comme son ennemie personnelle. Depuis sa jeunesse au sein d'une famille qui a toujours vécu dans les privations et a placé en ses études tous les espoirs d'élévations sociale, Gordon, féru de poésie et de révolte sociale, a déclaré la guerre à l'argent et s'est escrimé à éviter d'en gagner assez. Mais chez lui un rapport obsessionnel, voire franchement monomaniaque à l'impécuniosité contribue à démolir le charme de l'indigence et l'empêche de jouir du bonheur de la bohème. Cette guerre qu'il déclare mener contre la pourriture du système économique environnant ne le conduit ni à une réflexion et encore moins à une action subversive – ne serait-ce que par le socialisme d'intentions de son très riche ami Ravelston – ni à une vie alternative d'anachorète serein, mais au contraire à la hargne victimaire d'un aspirant petit-bourgeois frustré par des conditions de vie de prolétaire, incapable cependant d'en connaître les astuces et les plaisirs. Son inspiration poétique se tarit dans la souillure alors qu'il est animé par un sentiment d'humiliation, le plus souvent imaginaire. Il se dédouane de ses comportements antipathiques avec ses amis, immoraux avec sa soeur et décidément abjects envers sa petite amie par la sempiternelle ritournelle de la pauvreté ; et le lecteur d'aujourd'hui le trouve sans doute encore plus odieux que ses contemporains du fait de ses crasses misogynie et homophobie.
En vérité, seules deux « batailles » justifient ce qu'il qualifie de guerre contre l'argent : sa démission d'un poste d'articlier publicitaire, et sa dilapidation en une seule nuit d'ivresse, de ripaille et de stupre d'un solide cachet inespéré... Mais son quotidien fait de quelques années de misère, d'invocation de la destruction de l'univers entier et de tentation à se laisser soi-même choir « dans le ruisseau » ne lui permet de s'arroger aucun héroïsme de belligérant. Les gens de son entourage sont encore trop bons pour ce qu'il mérite, pense-t-on.
Son retour dans les rangs les plus conventionnels et détestables du salariat, à l'évidence avec davantage de succès qu'il n'en avait jamais eu auparavant, serait-il le résultat d'un pari insensé, d'une acte d'audace terriblement dangereux de Rosemary, d'un ultime geste d'amour sacrificiel ou d'une profonde intuition féminine de sa part ? Serait-il l'effet d'une simple maturation, d'une sortie de l'adolescence qui a été plus tardive et plus risquée pour le protagoniste que pour un homme ordinaire dans sa condition ?
Représenterait-il déjà le pessimisme un peu cynique et très désabusé qui caractérisera l'ensemble de l'oeuvre orwellienne en ce qu'elle s'attelait à déconstruire les idéaux d'amélioration de la société qui avaient cours à son époque... ?