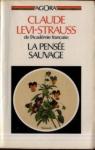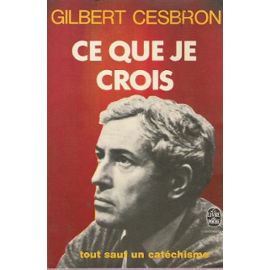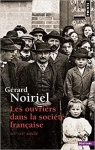Face au passage en force de la réforme des retraites, la colère sociale ne faiblit pas. Sommes-nous confrontés à une crise socio-politique inédite dans l'histoire de la Ve République ?
Guillaume Erner reçoit Gérard Noiriel, historien spécialiste de l'immigration et de l'histoire de la classe ouvrière, et directeur d'études à l'EHESS.
#actualite #reformedesretraites #politique
____________
Découvrez tous les invités des Matins de Guillaume Erner ici https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDroMCMte_GTmH-UaRvUg6aXj
ou sur le site https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins
Suivez France Culture sur :
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture
Twitter : https://twitter.com/franceculture
Instagram : https://www.instagram.com/franceculture
TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture
Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture

Gérard Noiriel/5
6 notes
Résumé :
Comment devient-on historien ? Ma réponse consiste en un hommage rendu aux historiens, sociologues et philosophes qui ont le plus compté dans ma formation et dans mon itinéraire, notamment Marc Bloch, Pierre Bourdieu, Norbert Elias, Michel Foucault, Richard Rorty et Max Weber. Avec eux, j'ai d'emblée partagé l'essentiel : le souci d'énoncer des vérités utiles.
En évoquant l'itinéraire qui m'a conduit des marges de la société française jusqu'au coeur de l'él... >Voir plus
En évoquant l'itinéraire qui m'a conduit des marges de la société française jusqu'au coeur de l'él... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Penser avec, penser contre : Itinéraire d'un historienVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
Je ne vais penser ici ni avec ni contre Gérard Noiriel mais vais simplement essayer de dégager mon ressenti quant à la lecture de ce texte largement autobiographique découvert grâce à Masse Critique.
Moderniste, je ne connaissais que très peu, avant la lecture de cet ouvrage, les travaux et surtout le parcours de cet historien. C'est d'ailleurs sans doute le dernier chapitre, consacré à son itinéraire, qui m'a le plus intéressée. Noiriel y livre son histoire personnelle: de son père alcoolique qui maltraite sa famille en passant par son engagement au Parti Communiste jusqu'à son poste de Directeur d'études à l'EHESS. Et le chemin vers la réussite académique fut loin de s'apparenter à un long fleuve tranquille, Noiriel étant issu d'un milieu fort modeste: “A la fin du cours moyen, la République m'avait déjà signifié où se situaient les limites de la mobilité sociale à laquelle je pouvais prétendre. La filière courte qu'elle avait choisie pour moi indiquait que mon parcours scolaire devait s'arrêter au niveau du brevet. L'Ecole normale d'instituteurs m'avait permis d'obtenir le Bac et donc de gravir un échelon supplémentaire. Mais il convenait de s'en tenir là.” (p.253-254)
Si ce dernier chapitre est largement accessible, cela n'est pas le cas, il me semble, du reste de l'ouvrage. Que le lecteur peu au fait des questionnements propres aux sciences sociales s'arme de courage ou se détourne. Un minimum de connaissances sur les grands penseurs évoqués apparaît comme un préalable nécessaire à qui entend lire (et prendre du plaisir à le faire) ce livre. En effet, chaque chapitre présente un auteur, qu'il soit sociologue, philosophe ou écrivain. de Bloch à Rorty en passant par Bourdieu et Foucault, Noiriel rassemble des réflexions sur ces intellectuels «qui ont le plus compté dans sa formation et dans son itinéraire d'historien depuis deux décennies».
Noiriel livre un ouvrage complexe qui mériterait une analyse profonde. Cependant, trois grands points retinrent tout particulièrement mon attention.
-La question du rapport crucial entre l'histoire et les autres sciences sociales au cours du XXe siècle; de la géographie (cf. par exemple le chapitre sur Braudel, p. 48-49), en passant par la sociologie et la philosophie. Cette dernière discipline occupe d'ailleurs une place importante dans la réflexion de Noiriel: “Qu'un historien français puisse trouver de l'intérêt à lire un philosophe pragmatiste américain peut paraître étrange, voire inconvenant (…) La première raison qui rendait impossible ma rencontre avec Rorty tient au fossé qui sépare toujours, en France, l'histoire et la philosophie” (p. 187 et 190).
Noiriel démontre donc avec force l'importance et l'enrichissement mutuel du débat entre disciplines voisines.
-La question du manque d'unité de la communauté savante ainsi que celle du rapport du chercheur en sciences sociales avec les institutions universitaires. En ce qui concerne le premier point, Noiriel s'appuie notamment sur Foucault “l'intellectuel se définit avant tout comme un être unique, exceptionnel, surtout motivé par le désir de faire triompher sa propre pensée contre celle de ses concurrents. Toute notre formation scolaire, tous les investissements et les sacrifices que nous avons consentis pour devenir des savants nous poussent à concevoir et à pratiquer le débat comme un acte de rupture avec les autres et non comme un acte de solidarité. La construction d'une véritable communauté de chercheurs engagés nécessiterait que nous nous interrogions davantage sur cette dimension majeure de notre identité d'intellectuel”.(p.184-185)
Quant au rapport avec les institutions et la question de l'intégration du chercheur dans le monde académique, il est également très présent dans le livre et le reflet d'une réalité connue de tout universitaire. Noiriel s'appuie sur sa propre expérience mais aussi sur celle des auteurs mentionnés, notamment Braudel qui “pour que ses projets institutionnels aient une chance d'aboutir doit ménager sees anciens adversaires, qui détiennent des positions-clé dans les réseaux de pouvoir.” (p. 70)
-La question tout aussi récurente de l'objectivité et de la rationnalité de l'historien. C'est ainsi que l'on peut lire, dans le chapitre consacré à Bourdieu: “ J'ai longtemps cru que les historiens, et plus généralement les chercheurs en sciences sociales, étaient des acteurs rationnels, qui passaient leur vie à échanger des arguments objectifs, dans un monde reposant sur les principes d'une communication universelle. Ce n'est donc pas sans déplaisir qu'il a fallu admettre, en relisant mes notes, que mes accords et mes désaccords avec la sociologie de Bourdieu avaient eu, généralement, pour point de départ des humeurs ou des émotions, enracinées dans ma propre expérience vécue, les arguments rationnels n'étant venus qu'après, pour justifier dans le langage légitime de la science ces réactions spontanées.” (p.124) On retrouve notamment ce rapport à l'histoire personnelle dans le chapitre consacré à Rorty qui aborde dans ses textes l'ancrage de la pensée dans l'expérience vécue (p. 205). D'où également le chapitre, surprenant de prime abord, consacré à Virginia Wolff “c'est en lisant Virginia Wolff que j'ai commencé à comprendre pourquoi les écrivains pouvaient être utiles aux chercheurs en sciences humaines désireux d'expliciter le rapport qu'ils entretiennent avec leurs textes. Ses écrits se prêtent particulièrement bien à ce rapprochement, parce que la préoccupation centrale qui relie toutes les parties de son oeuvre, c'est le problème de la vérité” (p. 214-215).
Enfin, la motivation de Noiriel, convaincu que la démocratisation du monde intellectuel est une grande nécessité, est avant tout son “désir de vérité et souci de l'action” (p. 211).
Moderniste, je ne connaissais que très peu, avant la lecture de cet ouvrage, les travaux et surtout le parcours de cet historien. C'est d'ailleurs sans doute le dernier chapitre, consacré à son itinéraire, qui m'a le plus intéressée. Noiriel y livre son histoire personnelle: de son père alcoolique qui maltraite sa famille en passant par son engagement au Parti Communiste jusqu'à son poste de Directeur d'études à l'EHESS. Et le chemin vers la réussite académique fut loin de s'apparenter à un long fleuve tranquille, Noiriel étant issu d'un milieu fort modeste: “A la fin du cours moyen, la République m'avait déjà signifié où se situaient les limites de la mobilité sociale à laquelle je pouvais prétendre. La filière courte qu'elle avait choisie pour moi indiquait que mon parcours scolaire devait s'arrêter au niveau du brevet. L'Ecole normale d'instituteurs m'avait permis d'obtenir le Bac et donc de gravir un échelon supplémentaire. Mais il convenait de s'en tenir là.” (p.253-254)
Si ce dernier chapitre est largement accessible, cela n'est pas le cas, il me semble, du reste de l'ouvrage. Que le lecteur peu au fait des questionnements propres aux sciences sociales s'arme de courage ou se détourne. Un minimum de connaissances sur les grands penseurs évoqués apparaît comme un préalable nécessaire à qui entend lire (et prendre du plaisir à le faire) ce livre. En effet, chaque chapitre présente un auteur, qu'il soit sociologue, philosophe ou écrivain. de Bloch à Rorty en passant par Bourdieu et Foucault, Noiriel rassemble des réflexions sur ces intellectuels «qui ont le plus compté dans sa formation et dans son itinéraire d'historien depuis deux décennies».
Noiriel livre un ouvrage complexe qui mériterait une analyse profonde. Cependant, trois grands points retinrent tout particulièrement mon attention.
-La question du rapport crucial entre l'histoire et les autres sciences sociales au cours du XXe siècle; de la géographie (cf. par exemple le chapitre sur Braudel, p. 48-49), en passant par la sociologie et la philosophie. Cette dernière discipline occupe d'ailleurs une place importante dans la réflexion de Noiriel: “Qu'un historien français puisse trouver de l'intérêt à lire un philosophe pragmatiste américain peut paraître étrange, voire inconvenant (…) La première raison qui rendait impossible ma rencontre avec Rorty tient au fossé qui sépare toujours, en France, l'histoire et la philosophie” (p. 187 et 190).
Noiriel démontre donc avec force l'importance et l'enrichissement mutuel du débat entre disciplines voisines.
-La question du manque d'unité de la communauté savante ainsi que celle du rapport du chercheur en sciences sociales avec les institutions universitaires. En ce qui concerne le premier point, Noiriel s'appuie notamment sur Foucault “l'intellectuel se définit avant tout comme un être unique, exceptionnel, surtout motivé par le désir de faire triompher sa propre pensée contre celle de ses concurrents. Toute notre formation scolaire, tous les investissements et les sacrifices que nous avons consentis pour devenir des savants nous poussent à concevoir et à pratiquer le débat comme un acte de rupture avec les autres et non comme un acte de solidarité. La construction d'une véritable communauté de chercheurs engagés nécessiterait que nous nous interrogions davantage sur cette dimension majeure de notre identité d'intellectuel”.(p.184-185)
Quant au rapport avec les institutions et la question de l'intégration du chercheur dans le monde académique, il est également très présent dans le livre et le reflet d'une réalité connue de tout universitaire. Noiriel s'appuie sur sa propre expérience mais aussi sur celle des auteurs mentionnés, notamment Braudel qui “pour que ses projets institutionnels aient une chance d'aboutir doit ménager sees anciens adversaires, qui détiennent des positions-clé dans les réseaux de pouvoir.” (p. 70)
-La question tout aussi récurente de l'objectivité et de la rationnalité de l'historien. C'est ainsi que l'on peut lire, dans le chapitre consacré à Bourdieu: “ J'ai longtemps cru que les historiens, et plus généralement les chercheurs en sciences sociales, étaient des acteurs rationnels, qui passaient leur vie à échanger des arguments objectifs, dans un monde reposant sur les principes d'une communication universelle. Ce n'est donc pas sans déplaisir qu'il a fallu admettre, en relisant mes notes, que mes accords et mes désaccords avec la sociologie de Bourdieu avaient eu, généralement, pour point de départ des humeurs ou des émotions, enracinées dans ma propre expérience vécue, les arguments rationnels n'étant venus qu'après, pour justifier dans le langage légitime de la science ces réactions spontanées.” (p.124) On retrouve notamment ce rapport à l'histoire personnelle dans le chapitre consacré à Rorty qui aborde dans ses textes l'ancrage de la pensée dans l'expérience vécue (p. 205). D'où également le chapitre, surprenant de prime abord, consacré à Virginia Wolff “c'est en lisant Virginia Wolff que j'ai commencé à comprendre pourquoi les écrivains pouvaient être utiles aux chercheurs en sciences humaines désireux d'expliciter le rapport qu'ils entretiennent avec leurs textes. Ses écrits se prêtent particulièrement bien à ce rapprochement, parce que la préoccupation centrale qui relie toutes les parties de son oeuvre, c'est le problème de la vérité” (p. 214-215).
Enfin, la motivation de Noiriel, convaincu que la démocratisation du monde intellectuel est une grande nécessité, est avant tout son “désir de vérité et souci de l'action” (p. 211).
C'est un livre très personnel et parfois douloureux, un regard jeté sur tout un chemin parcouru - et quel chemin ! C'est aussi un ouvrage extrêmement généreux . Il y est question du parcours du socio-historien, spécialiste de l'immigration et du mouvement ouvrier ; des sociologues et des philosophes qui ont interféré dans son itinéraire et qui, comme lui, ont le souci d'énoncer des vérités utiles. « Penser avec, penser contre : Itinéraire d'un historien» rassemble ses réflexions quant aux écrivains qui ont le plus compté dans sa recherche. En huit chapitres, Gérard Noiriel évoque sept auteurs essentiels. Il reprend principalement des interventions faites ailleurs à propos de Marc Bloch, Fernand Braudel, Max Weber, Michel Foucault. Et à ceux déjà cités, il ajoute Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Richard Rorty et la romancière Virginia Woolf.
Il n'est évidemment pas possible de rendre en quelques lignes exhaustivement compte de cette somme, de penser, à notre tour, contre et avec elle. Il faudrait pour cela encore mieux connaître les penseurs dont il est question et avoir souffert en posture d'«Homo academicus», ce qui n'est évidemment pas le cas. Nous tenterons donc d'appliquer modestement dans cette petite critique le principe de charité, défendu par Richard Rorty et si cher à notre historien, exposant sous son meilleur jour quelques points pour nous saillants et nous dispensant d'expliquer, quand il y en a, et il en a en ce qui concerne Pierre Bourdieu, nos divergences.
Le fonctionnement, l'autonomie, le rôle des paires et de l'intellectuel collectif dans le champ de l'histoire sont invoqués dans cet ouvrage quand il s'agit de Marc Bloch et Fernand Braudel. le premier est, semble-t-il, pour l'auteur l'illustration remarquable d'un fonctionnement souhaité, tandis que le second, auquel il applique la méthode historique et les conclusions bourdieusiennes, en est en quelque sorte le contre-exemple. La figure de l'intellectuel foucaldien, dans le chapitre que Gérard Noiriel consacre au philosophe, est pour lui l'image même de l'intellectuel collectif qu'il appelle de ses voeux. L'intellectuel en effet pour Foucault doit faire un travail sur lui pour parvenir à une véritable générosité de pensée, il doit dénouer sans cesse pouvoir et vérité, modifier non seulement la pensée des autres mais aussi la sienne propre. L'éthique de l'intellectuel est pour Foucault un moyen de « se rendre capable en permanence de se dépendre de soi-même ».
Gérard Noiriel nous parle longuement de son travail de chercheur. Il consacre un chapitre à Pierre Bourdieu et un autre à Richard Rorty. Il rend un hommage ambigu au premier avec lequel il a, nous dit-il, appris à penser (tout de même). Il défend par contre sans réserve la philosophie pragmatique de l'action du second qui rend son travail, contesté par une épistémologie surplombante, légitime. Max Weber, conforte également la démarche de l'auteur : «La connaissance de l'épistémologie n'est pas plus indispensable à l'historien que la connaissance de l'anatomie à l'apprentissage de la marche ».
Enfin, l'approche historique, pour Gérard Noiriel, dépend toujours de la trajectoire personnelle et de l'itinéraire particulier du chercheur : « le passé s'écrit toujours au présent » nous dit-il. L'historien tire de ce constat deux conclusions. La première : la discipline historique exige des personnes très différentes pour couvrir le plus large champ. Gérard Noiriel montre ainsi, dans le chapitre qu'il consacre à Norbert Elias, que le sociologue allemand produit sur la question nationale à partir d'un rejet, celui de sa personne par le régime nazi. La deuxième conclusion : le chercheur doit faire un nécessaire travail sur lui-même. Gérard Noiriel va chercher à la fin de son livre, de façon originale, l'exemple de ce travail dans la littérature et plus particulièrement dans un roman de Virginia Woolf ; et il l'entreprend lui même cette auto analyse dans les dernières et très touchantes pages de son livre.
Pour terminer citons une dernière fois Richard Rorty qui opère une distinction précieuse entre les ouvrages qui nous aident à devenir plus autonomes et ceux qui nous aident à devenir moins cruels et plus généreux à l'égard des autres. « Penser avec, penser contre : Itinéraire d'un historien» fait incontestablement partie de la deuxième catégorie.
Il n'est évidemment pas possible de rendre en quelques lignes exhaustivement compte de cette somme, de penser, à notre tour, contre et avec elle. Il faudrait pour cela encore mieux connaître les penseurs dont il est question et avoir souffert en posture d'«Homo academicus», ce qui n'est évidemment pas le cas. Nous tenterons donc d'appliquer modestement dans cette petite critique le principe de charité, défendu par Richard Rorty et si cher à notre historien, exposant sous son meilleur jour quelques points pour nous saillants et nous dispensant d'expliquer, quand il y en a, et il en a en ce qui concerne Pierre Bourdieu, nos divergences.
Le fonctionnement, l'autonomie, le rôle des paires et de l'intellectuel collectif dans le champ de l'histoire sont invoqués dans cet ouvrage quand il s'agit de Marc Bloch et Fernand Braudel. le premier est, semble-t-il, pour l'auteur l'illustration remarquable d'un fonctionnement souhaité, tandis que le second, auquel il applique la méthode historique et les conclusions bourdieusiennes, en est en quelque sorte le contre-exemple. La figure de l'intellectuel foucaldien, dans le chapitre que Gérard Noiriel consacre au philosophe, est pour lui l'image même de l'intellectuel collectif qu'il appelle de ses voeux. L'intellectuel en effet pour Foucault doit faire un travail sur lui pour parvenir à une véritable générosité de pensée, il doit dénouer sans cesse pouvoir et vérité, modifier non seulement la pensée des autres mais aussi la sienne propre. L'éthique de l'intellectuel est pour Foucault un moyen de « se rendre capable en permanence de se dépendre de soi-même ».
Gérard Noiriel nous parle longuement de son travail de chercheur. Il consacre un chapitre à Pierre Bourdieu et un autre à Richard Rorty. Il rend un hommage ambigu au premier avec lequel il a, nous dit-il, appris à penser (tout de même). Il défend par contre sans réserve la philosophie pragmatique de l'action du second qui rend son travail, contesté par une épistémologie surplombante, légitime. Max Weber, conforte également la démarche de l'auteur : «La connaissance de l'épistémologie n'est pas plus indispensable à l'historien que la connaissance de l'anatomie à l'apprentissage de la marche ».
Enfin, l'approche historique, pour Gérard Noiriel, dépend toujours de la trajectoire personnelle et de l'itinéraire particulier du chercheur : « le passé s'écrit toujours au présent » nous dit-il. L'historien tire de ce constat deux conclusions. La première : la discipline historique exige des personnes très différentes pour couvrir le plus large champ. Gérard Noiriel montre ainsi, dans le chapitre qu'il consacre à Norbert Elias, que le sociologue allemand produit sur la question nationale à partir d'un rejet, celui de sa personne par le régime nazi. La deuxième conclusion : le chercheur doit faire un nécessaire travail sur lui-même. Gérard Noiriel va chercher à la fin de son livre, de façon originale, l'exemple de ce travail dans la littérature et plus particulièrement dans un roman de Virginia Woolf ; et il l'entreprend lui même cette auto analyse dans les dernières et très touchantes pages de son livre.
Pour terminer citons une dernière fois Richard Rorty qui opère une distinction précieuse entre les ouvrages qui nous aident à devenir plus autonomes et ceux qui nous aident à devenir moins cruels et plus généreux à l'égard des autres. « Penser avec, penser contre : Itinéraire d'un historien» fait incontestablement partie de la deuxième catégorie.
J'ai "rencontré" Noiriel l'année dernière lors d'un cours de sociologie de l'immigration alors voir Penser avec, penser contre : Itinéraire d'un historien proposé dans le cadre de l'opération masse critique a tout de suite suscité ma curiosité. J'avoue aussi que mon choix a été dicté par le fait que j'espérais obtenir, par la lecture de ce livre, quelques éclaircissements sur la méthodologie, la démarche historique. Or ce n'est pas là l'objet de cet ouvrage, ce n'est pas un manuel méthodologique mais il n'en reste pas moins qu'il pousse à s'interroger, se questionner.
En réalité Penser avec, penser contre est un livre très personnel, autobiographique dans lequel Noiriel rassemble ses nombreuses et intéressantes réflexions sur les auteurs qui ont particulièrement compter dans sa formation et la construction de sa pensée. Au cours des 7 chapitres consacrés chacun à un auteur (Bloch, Bourdieu, Elias, Foucaults, Rorty, Weber et Virginia Woolf, présence pour le moins singulière après les références à tous ces grands penseurs), en même temps qu'il parle de l'histoire en tant que discipline, c'est aussi sa propre histoire que Noiriel nous livre. Il nous montre ainsi qu'en histoire il est important de ne pas tout prendre pour argent comptant mais bien au contraire de penser à la fois avec les auteurs rencontrés au grès des lectures mais aussi de penser contre ces derniers, de faire preuve d'esprit critique.
Il est difficile de parler ce livre tant il est riche. Il suscite en effet de nombreuses réflexions et donne à voir que dans son travail l'historien est particulièrement marqué par son vécu dans le sens où on aborde pas de la même manière un sujet. Au contraire la trajectoire personnelle, le vécu peut influencer le travail, c'est pourquoi finalement l'historien doit faire un travail sur lui afin de produire un savoir scientifique en toute objectivité.
Pour conclure voilà un livre très intéressant. Cependant il m'a semblé difficile d'accès, notamment pour des lecteurs peu familiers des problématiques des sciences humaines et sociales. En effet personnellement je ne suis pas historienne mais j'ai rencontré Bourdieu, Elias, Foucault et Weber lors de mes séminaires de science politique. Aussi je pouvais à peu près comprendre de quoi parlait Noiriel. Je ne suis pas sûre que cela soit le cas pour la majeure partie des lecteurs mais je pense que les pages consacrées à Noiriel lui-même, sa propre histoire (en bref le début du livre) ne manqueront pas de les intéresser.
En réalité Penser avec, penser contre est un livre très personnel, autobiographique dans lequel Noiriel rassemble ses nombreuses et intéressantes réflexions sur les auteurs qui ont particulièrement compter dans sa formation et la construction de sa pensée. Au cours des 7 chapitres consacrés chacun à un auteur (Bloch, Bourdieu, Elias, Foucaults, Rorty, Weber et Virginia Woolf, présence pour le moins singulière après les références à tous ces grands penseurs), en même temps qu'il parle de l'histoire en tant que discipline, c'est aussi sa propre histoire que Noiriel nous livre. Il nous montre ainsi qu'en histoire il est important de ne pas tout prendre pour argent comptant mais bien au contraire de penser à la fois avec les auteurs rencontrés au grès des lectures mais aussi de penser contre ces derniers, de faire preuve d'esprit critique.
Il est difficile de parler ce livre tant il est riche. Il suscite en effet de nombreuses réflexions et donne à voir que dans son travail l'historien est particulièrement marqué par son vécu dans le sens où on aborde pas de la même manière un sujet. Au contraire la trajectoire personnelle, le vécu peut influencer le travail, c'est pourquoi finalement l'historien doit faire un travail sur lui afin de produire un savoir scientifique en toute objectivité.
Pour conclure voilà un livre très intéressant. Cependant il m'a semblé difficile d'accès, notamment pour des lecteurs peu familiers des problématiques des sciences humaines et sociales. En effet personnellement je ne suis pas historienne mais j'ai rencontré Bourdieu, Elias, Foucault et Weber lors de mes séminaires de science politique. Aussi je pouvais à peu près comprendre de quoi parlait Noiriel. Je ne suis pas sûre que cela soit le cas pour la majeure partie des lecteurs mais je pense que les pages consacrées à Noiriel lui-même, sa propre histoire (en bref le début du livre) ne manqueront pas de les intéresser.
Citations et extraits (1)
Ajouter une citation
Une telle perspective nous permet de montrer ce qui différencie, en histoire contemporaine notamment, le journaliste et l'historien. Contrairement à ce que l’on dit souvent, ce n’est pas avant tout la familiarité avec les archives qui constitue leur principal critère de distinction. Nombre d’ouvrages historiques écrits par des journalistes satisfont à cet égard aux exigences requises par la recherche historique universitaire. Ce qui différencie les deux approches du passé, c’est surtout la nature du questionnement mis en oeuvre. Le journaliste – et c’est la noblesse de son métier- cherche des responsables: il juge, excuse parfois, dénonce souvent. L’historien s’efforce quant à lui d’expliquer, en mobilisant les outils que l’ensemble des sciences sociales ont forgés pour étudier le monde social et en cherchant des réponses aux questions qui ont été élaborées collectivement par les spécialistes du domaine concerné.
Videos de Gérard Noiriel (17)
Voir plusAjouter une vidéo
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Gérard Noiriel (27)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3262 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3262 lecteurs ont répondu