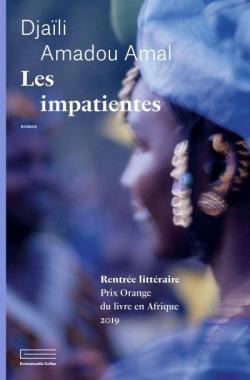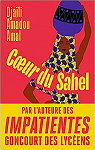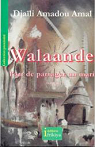La patience des impatientes, raconté par la voix des sans voix.
Les Impatientes
Djaïli Amadou Amal
Ce livre est si bien écrit qu'on a presque l'impression d'être à la place de ces femmes, mais en même temps, on a le sentiment qu'on ne connait pas cette situation (en tout cas pour ma part) et qu'on ne peut pas comprendre. C'est très paradoxal.
Avec ce livre, j'ai pensé deux choses :
- Premièrement, je me suis dit que j'avais de la chance, parce que oui, on a encore des progrès à faire en France par rapport à l'égalité homme/femme, mais on a beaucoup plus de droits que les femmes au Sahel.
- Deuxièmement, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de travail dans d'autres pays que la France pour garantir les droits de la femme.
J'ai adoré ce livre parce qu'il y avait trois histoires et qu'elles étaient toutes différentes. Djaïli Amadou Amal va raconter les trois histoires à des moments différents du mariage :
-Ramla nous raconte la vie des femmes au Sahel ou plutôt son histoire avant son mariage. Elle dénonce le mariage forcé.
-Hindou, quant à elle, nous fait réfléchir sur la violence conjugale mais aussi sur les viols. L'histoire d'Hindou est poignante. Ça me fait penser aux combats que les féministes en France engagent contre les violences et les viols. Une phrase m'a interpelée : « Une fois que je suis allongée près de lui, Moubarak me viole en guise de consolation. » Djaïli Amadou Amal, Les impatientes, Emmanuelle collas, 2020, page 131.
Un autre moment de l'histoire qui m'a marqué, c'est quand une dame va s'indigner du fait qu'Hindou ait des marques de coups sur le visage. Elle va lui dire que ce n'est pas normal qu'un homme frappe sa femme au visage mais qu'en revanche, il a le droit de la frapper sur le corps. Ça m'a indignée. Comment ça !!! Un homme a le droit de frapper sa femme tant que ce n'est pas sur le visage !!!
-Safira nous fait réfléchir sur la polygamie qui m'a dérangée pour deux raisons : d'abord je ne trouve pas normal qu'on puisse se marier avec deux personnes sans demander l'avis à la première femme. Selon moi, si la deuxième femme est d'accord mais pas la première, le mariage ne devrait pas être possible. La polygamie est d'ailleurs interdite en France. Ensuite, parce que la polygamie, c'est toujours le même schéma : UN homme et DES femmes. Pourquoi pas l'inverse ? Encore une fois l'homme et la femme ne sont pas sur un pied d'égalité. On m'a donné une réponse à cette question. Il y aurait plusieurs femmes parce que pendant qu'une femme est enceinte, l'homme lui, peut encore féconder ses autres femmes alors que l'inverse ne serait pas possible. Je trouve ça aberrant. C'est stupide. Ont-ils besoin de trente enfants pour finalement même pas les aimer, pour à peine les voir ? Ça me répugne. Safira subit beaucoup de violence mentale et va recevoir ces mots de son mari : « Regarde comment tu es accoutrée. Et tes yeux ? Depuis quand n'ont-ils pas vu de khôl ? Tu penses que c'est ainsi que tu vas me séduire ? » Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes, Emmanuelle Collas, pages 173/174.
J'ai adoré ce livre comme vous l'avez compris car il parle de faits réels et injustes. J'avais envie de me révolter avec ces femmes. J'espère en tout cas que grâce à son livre, Djaïli Amadou Amal pourra faire bouger les choses et j'espère que dans quelques années tout cela n'existera plus.
Louane Robic S08
Pressées de vivre
« Munyal », ce mot qui résonne en elles depuis toujours. Ce mot qui les suit autant qu'il les précède. Ce mot qui leur est si familier mais pourtant qu'elles haïssent plus que tout au monde. Ramla, Hindou et Safira, ces trois femmes au destin lié vivent l'enfer d'attendre. L'enfer de la polygamie, de la vie en concessions et des viols. Cet ouvrage de Djaïli Amadou Amal ayant déjà reçu le prix orange en Afrique ne peut laisser quiconque impassible. Renommée « la voix des sans voix », Djaïli Amadou Amal a aussi vécu le mariage forcé, à 17 ans ! Cette féministe oeuvre pour son combat, celui de libérer ces femmes de l'oppression masculine. Son roman ouvre le débat, il fait prendre conscience à chacun qu'un esclavagisme des temps modernes sévit encore en ce moment même.
Dans le nord du Cameroun, dans cette région où règne le machisme, les femmes sont totalement soumise d'abord à leurs pères puis à leurs maris. Elles n'ont aucun droit. Leur seul devoir est de satisfaire leur mari. Elles ne peuvent pas se plaindre et même si elles osaient, on leur répondrait «munyal » autrement dit « patiente », « accepte tout », « soumets-toi sans rien dire ». Ramla, Hindou, Safira ainsi que toutes les femmes passent leur vie à patienter sans recevoir aucune aide des femmes qui les entourent. L'auteur se sert de son roman pour alerter toutes les femmes qui vivent actuellement la polygamie. En ne faisant rien, en acceptant que leurs filles soient mariées de force, elles deviennent complices. Djaïli montre, par son propre exemple, qu'il est possible de faire changer les choses. Elle a réussi à quitter son mari 5 ans après son mariage forcé. Ces coutumes sont tellement inscrites dans leur société que les femmes ne se rendent même plus compte que c'est un problème. Djaïli cite par exemple : « Dans la société d'où je viens, qui est le Sahel, le viol est devenu une habitude, voire une culture, surtout les soirs de noces.» Ce livre est un appel à ouvrir les yeux.
Tout ce roman tourne autour de la thématique du féminisme, de l'égalité homme/femme. Ces trois témoignages poignants écrits très justement sans tomber dans le sordide, retranscrivent l'histoire de toutes ces femmes trop patientes pour accomplir leurs rêves. Ce livre est très intéressant à lire autant pour les femmes que pour les hommes. Il est très bien écrit car il illustre parfaitement les pensées de ces femmes soumises à cette vie qu'elles n'ont pas choisie. C'est une très bonne approche du féminisme qui devrait être lue par tous. C'est un livre qui éduque sans en donner l'impression.
Pour l'avenir, Djaïli Amadou Amal pense que l'éducation est la clé. Pour pouvoir changer les choses, on doit éduquer nos fils et enseigner à nos filles. Les filles au Sahel ne sont même pas 50 % à être scolarisées, ce qui explique que leur avenir repose sur le mariage. L'éducation des garçons est aussi très importante. C'est le rôle de toutes les mères de faire changer les choses en éduquant leur fils, en leur apprenant qu'il n'est pas concevable de violer et de frapper sa femme. L'espoir d'un avenir meilleur réside dans la jeunesse.
Nora Carpinelli S08
Patienter, se soumettre, accepter
Après avoir remporté le prix Orange du livre en Afrique. Djaili Amadou Amal emmène les lecteurs français dans l'univers épouvantable des mariages forcés et de la polygamie au Sahel en écrivant le livre «Les impatientes»….C'est un livre à lire,qui est très émouvant avec beaucoup de sincérité.
L'auteur raconte en détail la condition féminine dans son pays dont le mariage forcé à un très jeune âge.
Elle n'a pas voulu faire une autobiographie, mais on retrouve sa vie dans celle d'une jeune fille sous le nom de Ramla.
Comment peut-on vivre dans ces conditions…. La soumission, l'obéissance, patienter toute sa vie (Munyal), être considéré comme le sexe faible et être inférieur aux hommes dans toute sa globalité.
« Une femme naît avant tout une épouse et mère » p120
C'est ce que Djaili Amadou Amal a voulu émettre en racontant trois histoires, trois destins, de trois jeunes filles, tout d'abord Ramla (17 ans) marié à un homme de 50 ans puis Hindou sa soeur marié à son cousin et enfin Safira la première épouse du marie de Ramla.
L'auteur nous fait ressentir le courage qu'elles ont, à quel point elles souffrent de la situation du mariage précoce et forcé, qui est au fond un mariage sans droit de regard.
Quels sont les avenirs de Ramla, Hindou et Safira, que sont-elles devenues ?
Elise Laine Belliot S08
Endurer
Les Impatientes
Djaïli Amadou Amal
Une femme doit-elle patienter toute sa vie ?
Non, surtout pas même. Pourtant Djaïli Amadou Amal a voulu évoquer cette idée en nommant son roman Les Impatientes.
Née en 1975 à Maroua au Cameroun, Djaïli est écrivaine et militante féministe depuis dix ans. Elle a publié trois livres qui ont tous un rapport avec les mariages forcés et les violences faites aux femmes. L'auteure a remporté le prix Orange du livre en Afrique grâce à son dernier ouvrage, Les Impatientes ou Munyal, qui signifie la patience en camerounais. L'écrivaine a également subi une vie difficile. Mariée de force à 17 ans avec un homme beaucoup plus âgé, elle a en vain, après plusieurs tentatives, réussi à partir avec ses filles. Maintenant, elle est mariée, vivant avec un homme qu'elle aime et ses enfants.
Cet ouvrage a une faible part autobiographique mais Djaïli connait les trois femmes dont elle nous raconte l'histoire et auxquelles elle s'est identifiée. Ramla 17 ans, a été victime d'un mariage arrangé par son père et son oncle. Elle doit apprendre à vivre avec son mari mais aussi sa coépouse, Safira. Celle-qui n'apprécie pas le fait que son mari, après 20 ans de mariage lui impose une autre femme à la maison et va tout faire pour que Ramla s'en aille le plus vite possible. On apprend aussi l'histoire d'Hindou, la soeur de Ramla, contrainte à épouser son cousin, qui l'agresse physiquement et sexuellement.
L'auteure nous raconte ces histoires en écrivant l'intégralité à la première personne du singulier, nous faisant vivre à la place des mariées.
C'est après avoir lu ce livre que nous nous rendons vraiment compte de l'horreur de ces mariages. Une énorme majorité de femmes comme celles dont il est question dans le roman sont soumises à ce genre de vies toutes tracées sans pouvoir compter sur le soutien de leurs familles. Elles ne peuvent, ou du moins rarement finir leurs études. Sans diplômes ni accord de leurs maris c'est pour elles impossible de s'imaginer un jour travailler. Leur seule solution est de patienter, se soumettre et enfin accepter, auprès de leurs époux.
La tristesse prend donc le dessus durant tout le long de la lecture des ces histoires.
Parmi les livres parlant des contraintes de notre société, celui-ci est fortement à conseiller pour que le maximum de gens prennent conscience du nombre de personnes qui en sont victimes. Espérons de tout coeur que Ramla, Hindou et Safira s'en sortiront plus tard et arriveront à vaincre ce fameux « Munyal ».
Erin Guyodo
S08
« Les impatientes » est un roman de Djaili Amadou Amal, qui a été publié en Afrique sous le nom de « Munyal » qui veut dire patience dans la culture peule. Grâce au prix gagné, elle a publié son livre en France sous le nom « Les impatientes ». L'auteur est actuellement sélectionnée our le prix « Goncourt 2020 ». Djaili Amadou Amal est Camerounaise et connue pour ses différents livres qui dénoncent la violence et l'injustice faite aux femmes. Pour cela, elle s'inspire de son passé et des témoignages de quelques femmes de sa région.
Ce roman rapide, fluide à lire est inspiré de faits réels dans le but de dénoncer la polygamie, le mariage forcé, la consanguinité, et violences conjugales que subissent les femmes en Afrique.
Tout se passe au Sahel dans le Nord du Cameroun. On y retrouve trois femmes aux destins liés: Ramla, Hindou, Safira. Elles soufrent toutes les trois de l'injustice de la société où les hommes ont tous les droits. Les femmes sont obligées d'êtres soumises et obéissantes envers leur mari et de tout accepter dans un silence et un calme oppressants.
Les mères de Ramla et Hindou sont coépouses et mariées au même homme, de ce fait dans leur cultures Hindou et Ramla sont soeurs. Safira est la première femme du mari de Ramla. Il y a Moubarak, un personnage abominable, agressif, irrespectueux qui est le mari d'Hindou mais aussi son cousin germain. Tous ces liens sont touchants, car c'est dans ce récit que l'on remarque la domination masculine. Ainsi que la soumission obligatoire des femmes, par peur d'être répudiées et de laisser derrière elles leurs enfants.
Ce livre m'a vraiment beaucoup plu, on se met facilement à la place de ces trois femmes, leur histoire est émouvante tout en étant tragique. C'est pour toutes ces émotions que l'on a lors de la lecture, que je conseille ce roman. Il nous permet de réfléchir et comparer cette société où seuls les hommes ont la parole et la liberté. Et si la religion était à votre avantage profiteriez-vous ainsi ? Quand on lit ce livre on se rend compte de la chance que l'on a d'être libre et de pouvoir compter sur sa famille et sur la justice. L'auteur a eu le courage de dénoncer l'injustice que subissent les femmes au Sahel, et met en avant la parole de ces femmes que l'on a toujours voulu faire taire. Djaili Amadou Amal essaye de casser toutes ces règles pour permettre aux générations de demain d'évoluer puis de changer les mentalités. L'auteur cherche aussi à influencer l'éducation des futurs hommes au Sahel, afin d'arrêter la maltraitance et la persécution des femmes, pour qu'elles puissent s'exprimer et vivre librement.
Manon Durand, S08
Les Impatientes
Djaïli Amadou Amal
Ce livre est si bien écrit qu'on a presque l'impression d'être à la place de ces femmes, mais en même temps, on a le sentiment qu'on ne connait pas cette situation (en tout cas pour ma part) et qu'on ne peut pas comprendre. C'est très paradoxal.
Avec ce livre, j'ai pensé deux choses :
- Premièrement, je me suis dit que j'avais de la chance, parce que oui, on a encore des progrès à faire en France par rapport à l'égalité homme/femme, mais on a beaucoup plus de droits que les femmes au Sahel.
- Deuxièmement, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de travail dans d'autres pays que la France pour garantir les droits de la femme.
J'ai adoré ce livre parce qu'il y avait trois histoires et qu'elles étaient toutes différentes. Djaïli Amadou Amal va raconter les trois histoires à des moments différents du mariage :
-Ramla nous raconte la vie des femmes au Sahel ou plutôt son histoire avant son mariage. Elle dénonce le mariage forcé.
-Hindou, quant à elle, nous fait réfléchir sur la violence conjugale mais aussi sur les viols. L'histoire d'Hindou est poignante. Ça me fait penser aux combats que les féministes en France engagent contre les violences et les viols. Une phrase m'a interpelée : « Une fois que je suis allongée près de lui, Moubarak me viole en guise de consolation. » Djaïli Amadou Amal, Les impatientes, Emmanuelle collas, 2020, page 131.
Un autre moment de l'histoire qui m'a marqué, c'est quand une dame va s'indigner du fait qu'Hindou ait des marques de coups sur le visage. Elle va lui dire que ce n'est pas normal qu'un homme frappe sa femme au visage mais qu'en revanche, il a le droit de la frapper sur le corps. Ça m'a indignée. Comment ça !!! Un homme a le droit de frapper sa femme tant que ce n'est pas sur le visage !!!
-Safira nous fait réfléchir sur la polygamie qui m'a dérangée pour deux raisons : d'abord je ne trouve pas normal qu'on puisse se marier avec deux personnes sans demander l'avis à la première femme. Selon moi, si la deuxième femme est d'accord mais pas la première, le mariage ne devrait pas être possible. La polygamie est d'ailleurs interdite en France. Ensuite, parce que la polygamie, c'est toujours le même schéma : UN homme et DES femmes. Pourquoi pas l'inverse ? Encore une fois l'homme et la femme ne sont pas sur un pied d'égalité. On m'a donné une réponse à cette question. Il y aurait plusieurs femmes parce que pendant qu'une femme est enceinte, l'homme lui, peut encore féconder ses autres femmes alors que l'inverse ne serait pas possible. Je trouve ça aberrant. C'est stupide. Ont-ils besoin de trente enfants pour finalement même pas les aimer, pour à peine les voir ? Ça me répugne. Safira subit beaucoup de violence mentale et va recevoir ces mots de son mari : « Regarde comment tu es accoutrée. Et tes yeux ? Depuis quand n'ont-ils pas vu de khôl ? Tu penses que c'est ainsi que tu vas me séduire ? » Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes, Emmanuelle Collas, pages 173/174.
J'ai adoré ce livre comme vous l'avez compris car il parle de faits réels et injustes. J'avais envie de me révolter avec ces femmes. J'espère en tout cas que grâce à son livre, Djaïli Amadou Amal pourra faire bouger les choses et j'espère que dans quelques années tout cela n'existera plus.
Louane Robic S08
Pressées de vivre
« Munyal », ce mot qui résonne en elles depuis toujours. Ce mot qui les suit autant qu'il les précède. Ce mot qui leur est si familier mais pourtant qu'elles haïssent plus que tout au monde. Ramla, Hindou et Safira, ces trois femmes au destin lié vivent l'enfer d'attendre. L'enfer de la polygamie, de la vie en concessions et des viols. Cet ouvrage de Djaïli Amadou Amal ayant déjà reçu le prix orange en Afrique ne peut laisser quiconque impassible. Renommée « la voix des sans voix », Djaïli Amadou Amal a aussi vécu le mariage forcé, à 17 ans ! Cette féministe oeuvre pour son combat, celui de libérer ces femmes de l'oppression masculine. Son roman ouvre le débat, il fait prendre conscience à chacun qu'un esclavagisme des temps modernes sévit encore en ce moment même.
Dans le nord du Cameroun, dans cette région où règne le machisme, les femmes sont totalement soumise d'abord à leurs pères puis à leurs maris. Elles n'ont aucun droit. Leur seul devoir est de satisfaire leur mari. Elles ne peuvent pas se plaindre et même si elles osaient, on leur répondrait «munyal » autrement dit « patiente », « accepte tout », « soumets-toi sans rien dire ». Ramla, Hindou, Safira ainsi que toutes les femmes passent leur vie à patienter sans recevoir aucune aide des femmes qui les entourent. L'auteur se sert de son roman pour alerter toutes les femmes qui vivent actuellement la polygamie. En ne faisant rien, en acceptant que leurs filles soient mariées de force, elles deviennent complices. Djaïli montre, par son propre exemple, qu'il est possible de faire changer les choses. Elle a réussi à quitter son mari 5 ans après son mariage forcé. Ces coutumes sont tellement inscrites dans leur société que les femmes ne se rendent même plus compte que c'est un problème. Djaïli cite par exemple : « Dans la société d'où je viens, qui est le Sahel, le viol est devenu une habitude, voire une culture, surtout les soirs de noces.» Ce livre est un appel à ouvrir les yeux.
Tout ce roman tourne autour de la thématique du féminisme, de l'égalité homme/femme. Ces trois témoignages poignants écrits très justement sans tomber dans le sordide, retranscrivent l'histoire de toutes ces femmes trop patientes pour accomplir leurs rêves. Ce livre est très intéressant à lire autant pour les femmes que pour les hommes. Il est très bien écrit car il illustre parfaitement les pensées de ces femmes soumises à cette vie qu'elles n'ont pas choisie. C'est une très bonne approche du féminisme qui devrait être lue par tous. C'est un livre qui éduque sans en donner l'impression.
Pour l'avenir, Djaïli Amadou Amal pense que l'éducation est la clé. Pour pouvoir changer les choses, on doit éduquer nos fils et enseigner à nos filles. Les filles au Sahel ne sont même pas 50 % à être scolarisées, ce qui explique que leur avenir repose sur le mariage. L'éducation des garçons est aussi très importante. C'est le rôle de toutes les mères de faire changer les choses en éduquant leur fils, en leur apprenant qu'il n'est pas concevable de violer et de frapper sa femme. L'espoir d'un avenir meilleur réside dans la jeunesse.
Nora Carpinelli S08
Patienter, se soumettre, accepter
Après avoir remporté le prix Orange du livre en Afrique. Djaili Amadou Amal emmène les lecteurs français dans l'univers épouvantable des mariages forcés et de la polygamie au Sahel en écrivant le livre «Les impatientes»….C'est un livre à lire,qui est très émouvant avec beaucoup de sincérité.
L'auteur raconte en détail la condition féminine dans son pays dont le mariage forcé à un très jeune âge.
Elle n'a pas voulu faire une autobiographie, mais on retrouve sa vie dans celle d'une jeune fille sous le nom de Ramla.
Comment peut-on vivre dans ces conditions…. La soumission, l'obéissance, patienter toute sa vie (Munyal), être considéré comme le sexe faible et être inférieur aux hommes dans toute sa globalité.
« Une femme naît avant tout une épouse et mère » p120
C'est ce que Djaili Amadou Amal a voulu émettre en racontant trois histoires, trois destins, de trois jeunes filles, tout d'abord Ramla (17 ans) marié à un homme de 50 ans puis Hindou sa soeur marié à son cousin et enfin Safira la première épouse du marie de Ramla.
L'auteur nous fait ressentir le courage qu'elles ont, à quel point elles souffrent de la situation du mariage précoce et forcé, qui est au fond un mariage sans droit de regard.
Quels sont les avenirs de Ramla, Hindou et Safira, que sont-elles devenues ?
Elise Laine Belliot S08
Endurer
Les Impatientes
Djaïli Amadou Amal
Une femme doit-elle patienter toute sa vie ?
Non, surtout pas même. Pourtant Djaïli Amadou Amal a voulu évoquer cette idée en nommant son roman Les Impatientes.
Née en 1975 à Maroua au Cameroun, Djaïli est écrivaine et militante féministe depuis dix ans. Elle a publié trois livres qui ont tous un rapport avec les mariages forcés et les violences faites aux femmes. L'auteure a remporté le prix Orange du livre en Afrique grâce à son dernier ouvrage, Les Impatientes ou Munyal, qui signifie la patience en camerounais. L'écrivaine a également subi une vie difficile. Mariée de force à 17 ans avec un homme beaucoup plus âgé, elle a en vain, après plusieurs tentatives, réussi à partir avec ses filles. Maintenant, elle est mariée, vivant avec un homme qu'elle aime et ses enfants.
Cet ouvrage a une faible part autobiographique mais Djaïli connait les trois femmes dont elle nous raconte l'histoire et auxquelles elle s'est identifiée. Ramla 17 ans, a été victime d'un mariage arrangé par son père et son oncle. Elle doit apprendre à vivre avec son mari mais aussi sa coépouse, Safira. Celle-qui n'apprécie pas le fait que son mari, après 20 ans de mariage lui impose une autre femme à la maison et va tout faire pour que Ramla s'en aille le plus vite possible. On apprend aussi l'histoire d'Hindou, la soeur de Ramla, contrainte à épouser son cousin, qui l'agresse physiquement et sexuellement.
L'auteure nous raconte ces histoires en écrivant l'intégralité à la première personne du singulier, nous faisant vivre à la place des mariées.
C'est après avoir lu ce livre que nous nous rendons vraiment compte de l'horreur de ces mariages. Une énorme majorité de femmes comme celles dont il est question dans le roman sont soumises à ce genre de vies toutes tracées sans pouvoir compter sur le soutien de leurs familles. Elles ne peuvent, ou du moins rarement finir leurs études. Sans diplômes ni accord de leurs maris c'est pour elles impossible de s'imaginer un jour travailler. Leur seule solution est de patienter, se soumettre et enfin accepter, auprès de leurs époux.
La tristesse prend donc le dessus durant tout le long de la lecture des ces histoires.
Parmi les livres parlant des contraintes de notre société, celui-ci est fortement à conseiller pour que le maximum de gens prennent conscience du nombre de personnes qui en sont victimes. Espérons de tout coeur que Ramla, Hindou et Safira s'en sortiront plus tard et arriveront à vaincre ce fameux « Munyal ».
Erin Guyodo
S08
« Les impatientes » est un roman de Djaili Amadou Amal, qui a été publié en Afrique sous le nom de « Munyal » qui veut dire patience dans la culture peule. Grâce au prix gagné, elle a publié son livre en France sous le nom « Les impatientes ». L'auteur est actuellement sélectionnée our le prix « Goncourt 2020 ». Djaili Amadou Amal est Camerounaise et connue pour ses différents livres qui dénoncent la violence et l'injustice faite aux femmes. Pour cela, elle s'inspire de son passé et des témoignages de quelques femmes de sa région.
Ce roman rapide, fluide à lire est inspiré de faits réels dans le but de dénoncer la polygamie, le mariage forcé, la consanguinité, et violences conjugales que subissent les femmes en Afrique.
Tout se passe au Sahel dans le Nord du Cameroun. On y retrouve trois femmes aux destins liés: Ramla, Hindou, Safira. Elles soufrent toutes les trois de l'injustice de la société où les hommes ont tous les droits. Les femmes sont obligées d'êtres soumises et obéissantes envers leur mari et de tout accepter dans un silence et un calme oppressants.
Les mères de Ramla et Hindou sont coépouses et mariées au même homme, de ce fait dans leur cultures Hindou et Ramla sont soeurs. Safira est la première femme du mari de Ramla. Il y a Moubarak, un personnage abominable, agressif, irrespectueux qui est le mari d'Hindou mais aussi son cousin germain. Tous ces liens sont touchants, car c'est dans ce récit que l'on remarque la domination masculine. Ainsi que la soumission obligatoire des femmes, par peur d'être répudiées et de laisser derrière elles leurs enfants.
Ce livre m'a vraiment beaucoup plu, on se met facilement à la place de ces trois femmes, leur histoire est émouvante tout en étant tragique. C'est pour toutes ces émotions que l'on a lors de la lecture, que je conseille ce roman. Il nous permet de réfléchir et comparer cette société où seuls les hommes ont la parole et la liberté. Et si la religion était à votre avantage profiteriez-vous ainsi ? Quand on lit ce livre on se rend compte de la chance que l'on a d'être libre et de pouvoir compter sur sa famille et sur la justice. L'auteur a eu le courage de dénoncer l'injustice que subissent les femmes au Sahel, et met en avant la parole de ces femmes que l'on a toujours voulu faire taire. Djaili Amadou Amal essaye de casser toutes ces règles pour permettre aux générations de demain d'évoluer puis de changer les mentalités. L'auteur cherche aussi à influencer l'éducation des futurs hommes au Sahel, afin d'arrêter la maltraitance et la persécution des femmes, pour qu'elles puissent s'exprimer et vivre librement.
Manon Durand, S08
Ce roman, largement auto-biographique, est un coup de poing et nous fait connaître, par la voix d'une femme camerounaise, peule et musulmane, et quelle voix, le sort des femmes de cette communauté et nous le rend douloureusement palpable parce que vécu de l'intérieur.
Nous suivons 3 femmes dont le destin est lié :
* Ramla, jeune fille de 17 ans, qui suit des études jusqu'en terminale mais qui à l'issue est offerte comme 2ème épouse à un homme d'une cinquantaine d'années, riche; ce mariage permet aux deux familles de devenir plus puissantes et plus riches. Ses aspirations à devenir pharmacienne et à épouser le jeune homme dont elle amoureuses sont impitoyablement écrasées.
* Hindou, sa jeune demi-soeur, est également mariée de force à son cousin, violent , alcoolique, drogué; elle sera battue, humiliée jusqu'à la folie sans que sa famille, y compris sa mère, n'intervienne, la considérant même comme une mauvaise fille.
* Safira, la quarantaine, la première épouse depuis 22 ans, 6 enfants, de l'homme auquel Ramla va être mariée; la polygamie est insupportable pour elle, qui aime sincèrement son mari; elle utilise tous les subterfuges, y compris la sorcellerie, pour récupérer son mari.
La vie de ces 3 femmes est scandée par la notion de "munyal", la patience; ce mot parcourt le roman comme une incantation, censée être la solution à tous les malheurs des femmes et socle de la domination sans partage des hommes.
Ce roman-témoignage dénonce la violence, à la fois physique et morale, faite aux femmes et souvent, malheureusement, perpétuée par les mères qui reproduisent elles-mêmes ce qu'elles ont subi. On oblige, les jeunes filles, dès leur plus jeune âge, à réfréner leurs sentiments, à cacher leur ressenti, à dire "oui" quand elles veulent crier "non", ce qui peut conduire à la folie comme le montre le cas d'Hindou.
Le roman véhicule, cependant, un message d'espoir, même s'il est ténu : seule l'éducation des filles pourra faire évoluer la situation car seul le savoir leur permettra de découvrir qu'il y a un ailleurs, une autre vie possible et que leur calvaire n'est pas une fatalité. D'ailleurs le mantra de l'association Femmes du Sahel, fondée par Djaïli Amadou Amal, pour inciter et aider les filles à étudier, est : "le premier mari de la femme, c'est le diplôme".
L'écriture est sans fioriture, au plus près de la douleur des ces femmes, ce qui rend le roman percutant. Mais de nombreuses répétitions entre chaque partie (conseils aux jeunes mariées, conseils à la co-épouse, conseils à la première épouse) auraient pu être évitées et la fin, très abrupte, est assez déconcertante.
Néanmoins, c'est un roman que je n'oublierai pas au même titre qu'un autre, "Le silence d'Isra", primo-roman d'Etaf Rum sur la condition des femmes palestiniennes musulmanes, dans leur pays et en exil.
Enfin, je voudrais terminer ce billet sur une note d'espoir et rappeler qu'il y a encore quelques siècles, les femmes françaises étaient vendues, pardon données en mariage sans leur consentement à un homme choisi par leur père, pour assurer la fortune de leur famille, que le viol conjugal n'était qu'une péripétie du mariage, que les hommes entretenaient des maîtresses, sortes de co-épouses sans statut, que la religion était aussi un outil d'asservissement. Alors, bien sûr, évitons les comparaisons simplistes car tout n'est pas comparable mais soyons modérément optimistes et misons sur la force de l'éducation.
Nous suivons 3 femmes dont le destin est lié :
* Ramla, jeune fille de 17 ans, qui suit des études jusqu'en terminale mais qui à l'issue est offerte comme 2ème épouse à un homme d'une cinquantaine d'années, riche; ce mariage permet aux deux familles de devenir plus puissantes et plus riches. Ses aspirations à devenir pharmacienne et à épouser le jeune homme dont elle amoureuses sont impitoyablement écrasées.
* Hindou, sa jeune demi-soeur, est également mariée de force à son cousin, violent , alcoolique, drogué; elle sera battue, humiliée jusqu'à la folie sans que sa famille, y compris sa mère, n'intervienne, la considérant même comme une mauvaise fille.
* Safira, la quarantaine, la première épouse depuis 22 ans, 6 enfants, de l'homme auquel Ramla va être mariée; la polygamie est insupportable pour elle, qui aime sincèrement son mari; elle utilise tous les subterfuges, y compris la sorcellerie, pour récupérer son mari.
La vie de ces 3 femmes est scandée par la notion de "munyal", la patience; ce mot parcourt le roman comme une incantation, censée être la solution à tous les malheurs des femmes et socle de la domination sans partage des hommes.
Ce roman-témoignage dénonce la violence, à la fois physique et morale, faite aux femmes et souvent, malheureusement, perpétuée par les mères qui reproduisent elles-mêmes ce qu'elles ont subi. On oblige, les jeunes filles, dès leur plus jeune âge, à réfréner leurs sentiments, à cacher leur ressenti, à dire "oui" quand elles veulent crier "non", ce qui peut conduire à la folie comme le montre le cas d'Hindou.
Le roman véhicule, cependant, un message d'espoir, même s'il est ténu : seule l'éducation des filles pourra faire évoluer la situation car seul le savoir leur permettra de découvrir qu'il y a un ailleurs, une autre vie possible et que leur calvaire n'est pas une fatalité. D'ailleurs le mantra de l'association Femmes du Sahel, fondée par Djaïli Amadou Amal, pour inciter et aider les filles à étudier, est : "le premier mari de la femme, c'est le diplôme".
L'écriture est sans fioriture, au plus près de la douleur des ces femmes, ce qui rend le roman percutant. Mais de nombreuses répétitions entre chaque partie (conseils aux jeunes mariées, conseils à la co-épouse, conseils à la première épouse) auraient pu être évitées et la fin, très abrupte, est assez déconcertante.
Néanmoins, c'est un roman que je n'oublierai pas au même titre qu'un autre, "Le silence d'Isra", primo-roman d'Etaf Rum sur la condition des femmes palestiniennes musulmanes, dans leur pays et en exil.
Enfin, je voudrais terminer ce billet sur une note d'espoir et rappeler qu'il y a encore quelques siècles, les femmes françaises étaient vendues, pardon données en mariage sans leur consentement à un homme choisi par leur père, pour assurer la fortune de leur famille, que le viol conjugal n'était qu'une péripétie du mariage, que les hommes entretenaient des maîtresses, sortes de co-épouses sans statut, que la religion était aussi un outil d'asservissement. Alors, bien sûr, évitons les comparaisons simplistes car tout n'est pas comparable mais soyons modérément optimistes et misons sur la force de l'éducation.
Les Impatientes de Amadou Djaïli Amal
Plus qu'un témoignage, ce livre est un réquisitoire ! Bien que relativement court, ce récit polyphonique qui raconte en trois parties le calvaire vécu par trois femmes camerounaises peules et musulmanes nous envahit et nous submerge. Il nous dit clairement ce que nous soupçonnons, sans jamais en être sûrs car l'omerta est là, de l'enfer vécu par les femmes dans certaines sociétés africaines aux moeurs archaïques qui pratiquent la polygamie. Car au-delà de la condition féminine, ce livre dénonce cette tradition musulmane, pratique très répandue en Afrique.
« C'est mon frère, même père, même mère ! » On ne mesure pas ce que recouvre cette expression extrêmement courante en Afrique subsaharienne.
Deux soeurs « par le père » vont être mariées sans leur consentement.
Dans une première partie, Ramla, 16 ans, décrit la manière dont elle va être livrée, pieds et poings liés à un homme de 50 ans qui la veut comme seconde épouse car elle est jolie et comment sa famille l'utilise comme une marchandise supposée faire fructifier les affaires. Ni soutien, ni sentiment, ni compassion pour cette adolescente pourtant instruite, désireuse de finir des études et amoureuse d'un autre. La soumission, la peur, la dépendance ont transformé celle qui devrait la soutenir, sa propre mère, en complice de cette trahison absolue.
Dans la seconde partie, Hindou, la demi-soeur de Ramla, (fille d'une seconde épouse) mariée de force à son cousin qu'elle craint et déteste car il est alcoolique, drogué et violent, un bon à rien que le clan cherche à caser malgré ses déviances, nous délivre un témoignage poignant, déchirant de son calvaire. Une seconde partie particulièrement difficile qui raconte par le menu le calvaire physique et psychologique qui amène cette toute jeune fille aux portes de la mort dans l'indifférence générale de la "concession".
Dans une troisième partie enfin, on retrouve Ramla arrivant dans la maison de son mari mais c'est sa coépouse de 50 ans qui nous la fait voir, débarquant dans sa vie d'épouse jusque-là seule et aimée. Une femme sage et posée qui va sombrer dans la haine et la perversion, cherchant sans relâche comment détruire son involontaire jeune rivale.
Toutes les déviances sont exposées et permises dans les huis clos étouffants et malsains que sont ces "concessions", bâtiments communautaires où femmes et enfants cohabitent et accueillent en alternance le maître du lieu.
De cette lecture, on sort essoré.
Ce petit livre par la taille est un très grand livre par le contenu et l'uppercut qu'il décoche. Un roman autobiographique qui devrait être lu partout, y compris dans les lycées de notre pays. Djaïli Amadou Amal est une grande auteure, très prometteuse, dont on devrait reparler dans le monde de la littérature, et pas que… C'est en tous cas une très belle découverte que je recommande à tous, il va sans dire!!
Plus qu'un témoignage, ce livre est un réquisitoire ! Bien que relativement court, ce récit polyphonique qui raconte en trois parties le calvaire vécu par trois femmes camerounaises peules et musulmanes nous envahit et nous submerge. Il nous dit clairement ce que nous soupçonnons, sans jamais en être sûrs car l'omerta est là, de l'enfer vécu par les femmes dans certaines sociétés africaines aux moeurs archaïques qui pratiquent la polygamie. Car au-delà de la condition féminine, ce livre dénonce cette tradition musulmane, pratique très répandue en Afrique.
« C'est mon frère, même père, même mère ! » On ne mesure pas ce que recouvre cette expression extrêmement courante en Afrique subsaharienne.
Deux soeurs « par le père » vont être mariées sans leur consentement.
Dans une première partie, Ramla, 16 ans, décrit la manière dont elle va être livrée, pieds et poings liés à un homme de 50 ans qui la veut comme seconde épouse car elle est jolie et comment sa famille l'utilise comme une marchandise supposée faire fructifier les affaires. Ni soutien, ni sentiment, ni compassion pour cette adolescente pourtant instruite, désireuse de finir des études et amoureuse d'un autre. La soumission, la peur, la dépendance ont transformé celle qui devrait la soutenir, sa propre mère, en complice de cette trahison absolue.
Dans la seconde partie, Hindou, la demi-soeur de Ramla, (fille d'une seconde épouse) mariée de force à son cousin qu'elle craint et déteste car il est alcoolique, drogué et violent, un bon à rien que le clan cherche à caser malgré ses déviances, nous délivre un témoignage poignant, déchirant de son calvaire. Une seconde partie particulièrement difficile qui raconte par le menu le calvaire physique et psychologique qui amène cette toute jeune fille aux portes de la mort dans l'indifférence générale de la "concession".
Dans une troisième partie enfin, on retrouve Ramla arrivant dans la maison de son mari mais c'est sa coépouse de 50 ans qui nous la fait voir, débarquant dans sa vie d'épouse jusque-là seule et aimée. Une femme sage et posée qui va sombrer dans la haine et la perversion, cherchant sans relâche comment détruire son involontaire jeune rivale.
Toutes les déviances sont exposées et permises dans les huis clos étouffants et malsains que sont ces "concessions", bâtiments communautaires où femmes et enfants cohabitent et accueillent en alternance le maître du lieu.
De cette lecture, on sort essoré.
Ce petit livre par la taille est un très grand livre par le contenu et l'uppercut qu'il décoche. Un roman autobiographique qui devrait être lu partout, y compris dans les lycées de notre pays. Djaïli Amadou Amal est une grande auteure, très prometteuse, dont on devrait reparler dans le monde de la littérature, et pas que… C'est en tous cas une très belle découverte que je recommande à tous, il va sans dire!!
Je ressors un peu sonné de ce livre lu impatiemment dans la journée.
Munyal, munyal. Patience, patience.
C'est le leitmotiv asséné aux épouses peules musulmanes du Cameroun septentrional. Là où sévit Boko Haram, entre Tchad et Nigeria , 3 femmes témoignent.
Le livre , toujours en lice pour le Goncourt, est construit chronologiquement autour de ces 3 discours.
Largement autobiographique il est indispensable pour comprendre de l'intérieur les souffrances de ces femmes , les enjeux et les mécanismes de la polygamie , le rôle des « Oncles », des imams,des marabouts etc...
L'acculturation comme condition de ce qui devient une terrible servitude volontaire....
Mais le billet de Kirzy sur Babelio développe tout cela parfaitement !!!!
Alors oui ,bien d'accord ,un livre important de cette rentrée littéraire, de ce confinement qui paraît dérisoire face à l'ultra-confinement de ces africaines là. Avec une note d'espoir, en toute fin , pour celle qui s'est battue pour faire des études....
Munyal, munyal. Patience, patience.
C'est le leitmotiv asséné aux épouses peules musulmanes du Cameroun septentrional. Là où sévit Boko Haram, entre Tchad et Nigeria , 3 femmes témoignent.
Le livre , toujours en lice pour le Goncourt, est construit chronologiquement autour de ces 3 discours.
Largement autobiographique il est indispensable pour comprendre de l'intérieur les souffrances de ces femmes , les enjeux et les mécanismes de la polygamie , le rôle des « Oncles », des imams,des marabouts etc...
L'acculturation comme condition de ce qui devient une terrible servitude volontaire....
Mais le billet de Kirzy sur Babelio développe tout cela parfaitement !!!!
Alors oui ,bien d'accord ,un livre important de cette rentrée littéraire, de ce confinement qui paraît dérisoire face à l'ultra-confinement de ces africaines là. Avec une note d'espoir, en toute fin , pour celle qui s'est battue pour faire des études....
Ce roman choral raconte la vie après le mariage de trois jeunes femmes africaines et c'est bouleversant.
Chez les peuls musulmans du Cameroun, ce sont les hommes de la famille, le père et les oncles, qui choisissent l'époux des jeunes filles qu'on marie très jeunes. La polygamie est la coutume.
La première histoire est celle de Ramla qui, à 17 ans, doit épouser un vieil homme qui a déjà une épouse. On découvre ainsi les rêves de la jeune fille qui, amoureuse d'un jeune homme sans fortune, va très vite être forcée d'accepter pour mari l'homme désigné par le clan. Elle ne peut se plaindre, ni se révolter au risque d'humilier sa famille qui ne veut que son bonheur. Munyal ! c'est-à-dire patience ! Voilà le seul conseil prodigué aux jeunes épousées.
Sa cousine Hindou n'est pas mieux lotie, elle doit épouser son cousin, drogué et alcoolique. La famille espère que le caractère soumis de la jeune fille apaisera le jeune homme irascible et rebelle, et tant pis si la jeune femme doit subir sa violence, c'est le lot des épouses.
Le troisième portrait est celui de Safira, première épouse d'un homme riche et qui ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée d'une seconde épouse. Pour garder son pouvoir sur son mari, elle va harceler Ramla sa co-épouse et l'accuser de mille maux.
A chaque fois est brandi le « munyal » cette patience, vertu des femmes soumises et qui excuse toutes les violences.
Ces récits nous révèlent le poids des traditions, les superstitions et le carcan dans lequel sont élevées les filles. de toute leur existence, elles seront sous le joug des hommes, père et oncles, frères et mari. Elles ne peuvent compter sur l'aide des autres femmes, soumises comme elles aux mêmes règles et craintives des retombées d'une désobéissance qui les relèguerait au banc de la société. le poids de la famille est considérable et tue dans l'oeuf toutes velléité de rébellion.
On découvre les ravages causés par la polygamie et on frémit à ces vies piétinées, on s'émeut de ces femmes violentées, humiliées. A travers ces récits, c'est notre indignation que cherche à provoquer l'auteure et elle y réussit admirablement, c'est ce qui fait la force de ce roman et le fait qu'il s'inspire de situations bien réelles ne le rend que plus terrible.
On peut trouver le style direct et sans aucune recherche, mais cette simplicité voulue et la spontanéité des dialogues font mouche et nous touchent davantage qu'un long discours.
Djaili Amadou Amal, elle-même victime de violence conjugale, mène un vrai combat dans ce roman, qui dénonce la condition des femmes africaines soumises au mariage forcé et à la polygamie, et on ne peut que saluer son courage.
Chez les peuls musulmans du Cameroun, ce sont les hommes de la famille, le père et les oncles, qui choisissent l'époux des jeunes filles qu'on marie très jeunes. La polygamie est la coutume.
La première histoire est celle de Ramla qui, à 17 ans, doit épouser un vieil homme qui a déjà une épouse. On découvre ainsi les rêves de la jeune fille qui, amoureuse d'un jeune homme sans fortune, va très vite être forcée d'accepter pour mari l'homme désigné par le clan. Elle ne peut se plaindre, ni se révolter au risque d'humilier sa famille qui ne veut que son bonheur. Munyal ! c'est-à-dire patience ! Voilà le seul conseil prodigué aux jeunes épousées.
Sa cousine Hindou n'est pas mieux lotie, elle doit épouser son cousin, drogué et alcoolique. La famille espère que le caractère soumis de la jeune fille apaisera le jeune homme irascible et rebelle, et tant pis si la jeune femme doit subir sa violence, c'est le lot des épouses.
Le troisième portrait est celui de Safira, première épouse d'un homme riche et qui ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée d'une seconde épouse. Pour garder son pouvoir sur son mari, elle va harceler Ramla sa co-épouse et l'accuser de mille maux.
A chaque fois est brandi le « munyal » cette patience, vertu des femmes soumises et qui excuse toutes les violences.
Ces récits nous révèlent le poids des traditions, les superstitions et le carcan dans lequel sont élevées les filles. de toute leur existence, elles seront sous le joug des hommes, père et oncles, frères et mari. Elles ne peuvent compter sur l'aide des autres femmes, soumises comme elles aux mêmes règles et craintives des retombées d'une désobéissance qui les relèguerait au banc de la société. le poids de la famille est considérable et tue dans l'oeuf toutes velléité de rébellion.
On découvre les ravages causés par la polygamie et on frémit à ces vies piétinées, on s'émeut de ces femmes violentées, humiliées. A travers ces récits, c'est notre indignation que cherche à provoquer l'auteure et elle y réussit admirablement, c'est ce qui fait la force de ce roman et le fait qu'il s'inspire de situations bien réelles ne le rend que plus terrible.
On peut trouver le style direct et sans aucune recherche, mais cette simplicité voulue et la spontanéité des dialogues font mouche et nous touchent davantage qu'un long discours.
Djaili Amadou Amal, elle-même victime de violence conjugale, mène un vrai combat dans ce roman, qui dénonce la condition des femmes africaines soumises au mariage forcé et à la polygamie, et on ne peut que saluer son courage.
Ramla a 17 ans, est en terminale et voudrait devenir pharmacienne. Elle est amoureuse d'Aminou, qu'elle veut épouser. Mais une fille appartient à sa famille et ses voeux ne comptent pas. Elle devra épouser Alhadji Issa, un riche marchand. Qu'elle n'aime pas. Qui a 50 ans. Qu'elle n'a jamais vue. Sera-t-elle assez forte pour se révolter contre la Tradition ?
Un roman très prenant. le lecteur suit le destin de 3 femmes : Ramla, Safira, la 1ère épouse, et Hindou, la demi-soeur de Ramla. Elles subissent toutes les trois la volonté masculine , mais chacune se bat seule, les hommes ont réussi aussi à les dresser les unes contre les autres : Safia est prête à tout pour garder sa place de « femme préférée », enchaînant les mesquineries et les vexations (et pire !) ; Hindou est mariée à un homme violent, qui se drogue, qui boit et même quand elle essaie de trouver un refuge auprès des femmes de sa famille, elle est ramenée auprès de son époux… le maître mot est : « Munyal », « Patience » et ces femmes en ont assez de l'entendre et de le subir ! « Inscrivez-la dans votre coeur, répétez-la dans votre esprit ! » scandent les hommes …
On ne peut qu'être touché par ces femmes et révolté par les discours qui leur sont tenus. Surtout quand on sait que ce roman est inspiré de faits réels…
Un roman très prenant. le lecteur suit le destin de 3 femmes : Ramla, Safira, la 1ère épouse, et Hindou, la demi-soeur de Ramla. Elles subissent toutes les trois la volonté masculine , mais chacune se bat seule, les hommes ont réussi aussi à les dresser les unes contre les autres : Safia est prête à tout pour garder sa place de « femme préférée », enchaînant les mesquineries et les vexations (et pire !) ; Hindou est mariée à un homme violent, qui se drogue, qui boit et même quand elle essaie de trouver un refuge auprès des femmes de sa famille, elle est ramenée auprès de son époux… le maître mot est : « Munyal », « Patience » et ces femmes en ont assez de l'entendre et de le subir ! « Inscrivez-la dans votre coeur, répétez-la dans votre esprit ! » scandent les hommes …
On ne peut qu'être touché par ces femmes et révolté par les discours qui leur sont tenus. Surtout quand on sait que ce roman est inspiré de faits réels…
Largement autobiographique, ce carcan culturel ne peut que révolter dans notre société où la liberté semble un droit !
Une fois de plus, on en est loin dans notre monde !
Tout y est : le mariage forcé, le viol de la nuit de noces, la polygamie et son enfer, les violences faites aux femmes ...
Combien de témoignages faudra-t-il encore pour que les femmes puissent choisir !?
Une fois de plus, on en est loin dans notre monde !
Tout y est : le mariage forcé, le viol de la nuit de noces, la polygamie et son enfer, les violences faites aux femmes ...
Combien de témoignages faudra-t-il encore pour que les femmes puissent choisir !?
Une lecture prenante mais fort éprouvante…qui raconte combien le genre masculin dans certaines et trop nombreuses parties du monde maltraite, méprise, exploite, empêche les femmes de vivre, les soumettent de toutes les manières imaginables…encore et toujours !
La veille du deuxième confinement, jeudi 29 octobre, je me trouvais à Paris, dans le Marais, et au fil de ma promenade, je n'ai pas résisté à pénétrer encore « librement » dans une librairie , m'étant inconnue , « Comme un roman » [ Rue de Bretagne ], j'ai flâné, et un des libraires avait mis en avant ce texte dont je ne savais rien… Intéressée par les thèmes et le parcours de l'auteure, ayant semble-t-il, mis beaucoup de son propre vécu…j'ai acheté le dernier exemplaire…de cette auteure camerounaise, dont je lisais le nom pour la toute première fois !!
Ironie mordante que le choix du titre, alors que tout le long du récit de ces trios destins féminins, l'entourage familial, éducatif, social serine, répète à longueur de temps aux petites filles, puis aux jeunes filles que l'on marie de force selon les intérêts des familles et des hommes du clan, aux épouses…que la femme n'a qu'un choix et un devoir : La Patience, envers et contre tout, en permanence !
« Je ne suis pas folle. Si je ne mange pas, c'est à cause de la boule que j'ai au fond de la gorge, de mon estomac si noué qu'aucune goutte d'eau ne peut plus accéder. Je ne suis pas folle. Si j'entends des voix, ce n'est pas celle du djinn. C'est juste la voix de mon père. La voix de mon époux et celle de mon oncle. La voix de tous les hommes de ma famille. (...)Non, je ne suis pas folle. Pourquoi m'empêchez-vous de respirer ? Pourquoi m'empêcher-vous de vivre ? « (p. 152) [Hindou ]
Cet extrait dit l'essentiel du noyau central de ce roman , qui nous raconte le destin de trois femmes reliées par une même famille : des parcours de vie, fracassés par les traditions machistes [ pour ne pas dire plus !!! ] du Sahel…
« Je n'étais pas que la fille de mon père. J'étais celle de toute la famille. Et chacun de mes oncles pouvait disposer de moi comme de son enfant. il était hors de question que je ne sois pas d'accord. J'étais leur fille. j'avais été élevée selon la tradition, initiée au respect strict que je devais à mes aînés. (p. 41)” [Ramla ]
L'ennemi n°1 des petites filles, jeunes filles, et des femmes… sont en premier les Hommes qui ont tout pouvoir sur elles, tout le long de leur existence bafouée… le deuxième ennemi, plus terrifiant encore , sont les victimes devenues bourreaux, c'est-à dire les femmes elles-mêmes : les co-épouses [ dans un régime polygame ], les belles-mères…etc.
Ces trois récits de parcours de femmes insistent sur les mariages forcés, les dégâts induites par la polygamie, la violence des hommes envers leurs femmes, leurs filles ; violence se communiquant ultérieurement sur les femmes elles-mêmes, qui se vengent, à leur tour, sur leurs « soeurs » plus faibles, ou en position de plus grande dépendance, ; un cercle infernal, incessant…
Dans ce monde peule, pour lutter contre la fatalité de naître « Femme » l'ésotérisme a une place de choix: les djinns, , les recours aux esprits , aux marabouts, jeter des sorts…tout est bon pour supporter et braver les malheurs qui tombent, s'accumulent sur la tête des Femmes !
La veille du deuxième confinement, jeudi 29 octobre, je me trouvais à Paris, dans le Marais, et au fil de ma promenade, je n'ai pas résisté à pénétrer encore « librement » dans une librairie , m'étant inconnue , « Comme un roman » [ Rue de Bretagne ], j'ai flâné, et un des libraires avait mis en avant ce texte dont je ne savais rien… Intéressée par les thèmes et le parcours de l'auteure, ayant semble-t-il, mis beaucoup de son propre vécu…j'ai acheté le dernier exemplaire…de cette auteure camerounaise, dont je lisais le nom pour la toute première fois !!
Ironie mordante que le choix du titre, alors que tout le long du récit de ces trios destins féminins, l'entourage familial, éducatif, social serine, répète à longueur de temps aux petites filles, puis aux jeunes filles que l'on marie de force selon les intérêts des familles et des hommes du clan, aux épouses…que la femme n'a qu'un choix et un devoir : La Patience, envers et contre tout, en permanence !
« Je ne suis pas folle. Si je ne mange pas, c'est à cause de la boule que j'ai au fond de la gorge, de mon estomac si noué qu'aucune goutte d'eau ne peut plus accéder. Je ne suis pas folle. Si j'entends des voix, ce n'est pas celle du djinn. C'est juste la voix de mon père. La voix de mon époux et celle de mon oncle. La voix de tous les hommes de ma famille. (...)Non, je ne suis pas folle. Pourquoi m'empêchez-vous de respirer ? Pourquoi m'empêcher-vous de vivre ? « (p. 152) [Hindou ]
Cet extrait dit l'essentiel du noyau central de ce roman , qui nous raconte le destin de trois femmes reliées par une même famille : des parcours de vie, fracassés par les traditions machistes [ pour ne pas dire plus !!! ] du Sahel…
« Je n'étais pas que la fille de mon père. J'étais celle de toute la famille. Et chacun de mes oncles pouvait disposer de moi comme de son enfant. il était hors de question que je ne sois pas d'accord. J'étais leur fille. j'avais été élevée selon la tradition, initiée au respect strict que je devais à mes aînés. (p. 41)” [Ramla ]
L'ennemi n°1 des petites filles, jeunes filles, et des femmes… sont en premier les Hommes qui ont tout pouvoir sur elles, tout le long de leur existence bafouée… le deuxième ennemi, plus terrifiant encore , sont les victimes devenues bourreaux, c'est-à dire les femmes elles-mêmes : les co-épouses [ dans un régime polygame ], les belles-mères…etc.
Ces trois récits de parcours de femmes insistent sur les mariages forcés, les dégâts induites par la polygamie, la violence des hommes envers leurs femmes, leurs filles ; violence se communiquant ultérieurement sur les femmes elles-mêmes, qui se vengent, à leur tour, sur leurs « soeurs » plus faibles, ou en position de plus grande dépendance, ; un cercle infernal, incessant…
Dans ce monde peule, pour lutter contre la fatalité de naître « Femme » l'ésotérisme a une place de choix: les djinns, , les recours aux esprits , aux marabouts, jeter des sorts…tout est bon pour supporter et braver les malheurs qui tombent, s'accumulent sur la tête des Femmes !
Très bon roman réaliste qui décrit la vie de 3 musulmanes africaines qui vivent un calvaire auprès de leurs maris.elles n'acceptent pas la polygamie.
El les n'apprécient pas le fait que leurs maris.aient plusieurs femmes.elles font leur possible pour rendre l'existence des coépouses invivable.elles sont obligés de se marier avec une personne choisie par leur père et non avec celui qu'elles aiment.livre très bien ecrit et limpide.on apprend différentes choses sur les coutumes des musulmans du sahel.elles évoluent neamoins dans des conditions de vie assez aisées.
El les n'apprécient pas le fait que leurs maris.aient plusieurs femmes.elles font leur possible pour rendre l'existence des coépouses invivable.elles sont obligés de se marier avec une personne choisie par leur père et non avec celui qu'elles aiment.livre très bien ecrit et limpide.on apprend différentes choses sur les coutumes des musulmans du sahel.elles évoluent neamoins dans des conditions de vie assez aisées.
*** Rentrée littéraire #36 ***
Les Impatientes est un livre important. Djaïli Amadou Amal est la première auteure africaine à aborder le thème douloureux du mariage forcé. C'est un livre de révolte et de combat qui va droit au but et aborde frontalement la question, sans tabou.
Djaïli Amadaou Amal est camerounaise, peule et musulmane. Elle a été mariée de force à 17 ans à un cinquantenaire polygame qui a fini par la répudier. Elle a été remariée et a fini par fuir suite à des violences conjugales qui menaçait sa vie et celle de ses enfants. Elle s'est reconstruite et dans sa résilience a fondé en 2012 l'association Femmes du Sahel qui aide les jeunes femmes à obtenir l'indépendance par les études.
Pour son roman, forcément inspiré de sa vie, elle a fait le choix d'un roman choral dénonçant la condition des femmes en Afrique sahélienne à travers les destins croisés de trois femmes mariées de force. Et la réalité décrite donne envie de hurler ! L'auteure parvient à décrire un processus « traditionnel » avec beaucoup de force et de subtilité. Car un mariage forcé, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on peut imaginer de l'extérieur. Dans le Nord Cameroun, un enfant n'est pas que l'enfant de ses parents mais de toute sa famille, notamment des oncles qui, dans le roman, décident de donner leurs nièces pour des intérêts personnels présentés comme familiaux.
Surtout, les jeunes filles sont persuadées, suite à un chantage affectif intense, à donner leur accord. Depuis le plus jeune âge, on leur inculque les règles à suivre pour ne pas être rejetées de la communauté : le sens de la dignité, la honte d'avoir honte et le munyal, la patience. Ce qu'elles acceptent avant de déchanter.
Voici ce que dit la communauté sur les violences conjugales que subit Hindou : « Ce n'est pas un viol. C'est une preuve d'amour. On conseilla tout de même à Moubarak de refréner ses ardeurs vu les points de suture que ma blessure nécessita. On me consola. C'est ça le mariage. La prochaine fois, ça ira mieux. Et puis, c'est ça la patience, le munyal dont on parlait justement. Une femme passe plusieurs étapes douloureuses de sa vie. Ce qui s'était produit en faisait partie. Il ne me restait qu'à prendre des bains de bouillies agrémentées de natron afin d'accélérer mon rétablissement. (... ) Goggo Diya m'a avoué plus tard qu'elle avait eu honte de moi tant j'avais crié : tout le monde avait dû m'entendre. A l'hôpital, j'avais continué à hurler. J'avais été impudique. Elle était tellement embarrassée pendant ma nuit de noces quelle avait failli s'en aller. Même mon père et mon beau-père avaient dû savoir que mon mari me touchait ! Quelle honte ! Quelle vulgarité ! Ce moment était secret. Comment allais-je désormais affronter le regard des autres ? Quel manque de courage, de munyal ! »
L'écriture est très simple, sobre. Je me suis plusieurs fois demandée si ce récit relevait du témoignage, saisissant et nécessaire, ou de l'oeuvre littéraire. Après l'avoir refermé, il est évident que oui, Les Impatiences est une oeuvre littéraire à part entière. L'auteure déploie un dispositif implacable pour soulever l'indignation et faire bouger les consciences. Si les mots semblent choisis et assemblés « simplement », c'est pour éviter toutes scories lyriques ou trop expressionnistes : la dénonciation n'en ressort que plus rigoureuse sans passer par le prisme d'une émotion trop directe et envahissante. C'est au lecteur de se faire sa propre idée.
La construction en trois parties successives est remarquable par la chronologie proposée, construction à la fois prémonitoire et sans issue : d'abord le chapitre centré sur la jeune Ramla, 17 ans et sur l'avant mariage forcé afin de décrypter les mécanismes de la persuasion insidieuse ; puis c'est celui sur sa cousine Hindou qui raconte son calvaire une fois mariée ; et enfin celui narrée par Safira, la première épouse, obsédée par l'idée de se débarrasser de Ramla, la deuxième épouse. Trois destins pour une même vie. Chaque chapitre est rythmée par le leitmotiv du munyal, patience, un mot qui revient comme une lame lancinante qui déchire la vie de ses femmes. Ce mot, on en vient à ne plus pouvoir le lire, le supporter.
Mais au delà de ce réquisitoire entêté et entêtant, ce qui ressort et désole, c'est de voir comment les femmes perpétuent les violences qui leur sont faites, la polygamie créant des rivalités impitoyables entre femmes, les emprisonnant dans des chaînes qui se transmettent de génération en génération, là où la sororité pourrait être un réconfort et une arme pour mettre à bas ce système.
Un roman terrible qui explose les tabous. Djaïli Amadou Amal a trois filles. Ces dernières ont bien de la chance d'avoir une telle maman.
Les Impatientes est un livre important. Djaïli Amadou Amal est la première auteure africaine à aborder le thème douloureux du mariage forcé. C'est un livre de révolte et de combat qui va droit au but et aborde frontalement la question, sans tabou.
Djaïli Amadaou Amal est camerounaise, peule et musulmane. Elle a été mariée de force à 17 ans à un cinquantenaire polygame qui a fini par la répudier. Elle a été remariée et a fini par fuir suite à des violences conjugales qui menaçait sa vie et celle de ses enfants. Elle s'est reconstruite et dans sa résilience a fondé en 2012 l'association Femmes du Sahel qui aide les jeunes femmes à obtenir l'indépendance par les études.
Pour son roman, forcément inspiré de sa vie, elle a fait le choix d'un roman choral dénonçant la condition des femmes en Afrique sahélienne à travers les destins croisés de trois femmes mariées de force. Et la réalité décrite donne envie de hurler ! L'auteure parvient à décrire un processus « traditionnel » avec beaucoup de force et de subtilité. Car un mariage forcé, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on peut imaginer de l'extérieur. Dans le Nord Cameroun, un enfant n'est pas que l'enfant de ses parents mais de toute sa famille, notamment des oncles qui, dans le roman, décident de donner leurs nièces pour des intérêts personnels présentés comme familiaux.
Surtout, les jeunes filles sont persuadées, suite à un chantage affectif intense, à donner leur accord. Depuis le plus jeune âge, on leur inculque les règles à suivre pour ne pas être rejetées de la communauté : le sens de la dignité, la honte d'avoir honte et le munyal, la patience. Ce qu'elles acceptent avant de déchanter.
Voici ce que dit la communauté sur les violences conjugales que subit Hindou : « Ce n'est pas un viol. C'est une preuve d'amour. On conseilla tout de même à Moubarak de refréner ses ardeurs vu les points de suture que ma blessure nécessita. On me consola. C'est ça le mariage. La prochaine fois, ça ira mieux. Et puis, c'est ça la patience, le munyal dont on parlait justement. Une femme passe plusieurs étapes douloureuses de sa vie. Ce qui s'était produit en faisait partie. Il ne me restait qu'à prendre des bains de bouillies agrémentées de natron afin d'accélérer mon rétablissement. (... ) Goggo Diya m'a avoué plus tard qu'elle avait eu honte de moi tant j'avais crié : tout le monde avait dû m'entendre. A l'hôpital, j'avais continué à hurler. J'avais été impudique. Elle était tellement embarrassée pendant ma nuit de noces quelle avait failli s'en aller. Même mon père et mon beau-père avaient dû savoir que mon mari me touchait ! Quelle honte ! Quelle vulgarité ! Ce moment était secret. Comment allais-je désormais affronter le regard des autres ? Quel manque de courage, de munyal ! »
L'écriture est très simple, sobre. Je me suis plusieurs fois demandée si ce récit relevait du témoignage, saisissant et nécessaire, ou de l'oeuvre littéraire. Après l'avoir refermé, il est évident que oui, Les Impatiences est une oeuvre littéraire à part entière. L'auteure déploie un dispositif implacable pour soulever l'indignation et faire bouger les consciences. Si les mots semblent choisis et assemblés « simplement », c'est pour éviter toutes scories lyriques ou trop expressionnistes : la dénonciation n'en ressort que plus rigoureuse sans passer par le prisme d'une émotion trop directe et envahissante. C'est au lecteur de se faire sa propre idée.
La construction en trois parties successives est remarquable par la chronologie proposée, construction à la fois prémonitoire et sans issue : d'abord le chapitre centré sur la jeune Ramla, 17 ans et sur l'avant mariage forcé afin de décrypter les mécanismes de la persuasion insidieuse ; puis c'est celui sur sa cousine Hindou qui raconte son calvaire une fois mariée ; et enfin celui narrée par Safira, la première épouse, obsédée par l'idée de se débarrasser de Ramla, la deuxième épouse. Trois destins pour une même vie. Chaque chapitre est rythmée par le leitmotiv du munyal, patience, un mot qui revient comme une lame lancinante qui déchire la vie de ses femmes. Ce mot, on en vient à ne plus pouvoir le lire, le supporter.
Mais au delà de ce réquisitoire entêté et entêtant, ce qui ressort et désole, c'est de voir comment les femmes perpétuent les violences qui leur sont faites, la polygamie créant des rivalités impitoyables entre femmes, les emprisonnant dans des chaînes qui se transmettent de génération en génération, là où la sororité pourrait être un réconfort et une arme pour mettre à bas ce système.
Un roman terrible qui explose les tabous. Djaïli Amadou Amal a trois filles. Ces dernières ont bien de la chance d'avoir une telle maman.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Djaïli Amadou Amal (4)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les impatientes
Patience est le mantra de ce livre mais comment cela se dit-il ?
Kamo
Pulaaku
Munyal
Daada
7 questions
0 lecteurs ont répondu
Thème : Les Impatientes de
Djaïli Amadou AmalCréer un quiz sur ce livre0 lecteurs ont répondu