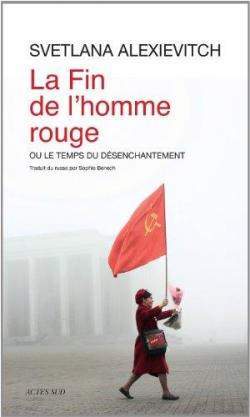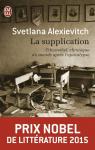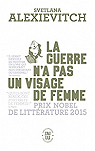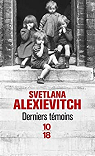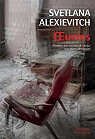Ce roman constitue en fait plusieurs témoignages par des interviews dans le but de montrer diverses périodes historiques de la Russie.
On retrouve beaucoup de similitudes dans ces témoignages, et nous montre la tragédie de ces époques.
Ces témoignages m'ont beaucoup appris sur cette période que finalement je ne connaissais qu'en grande ligne.
On sent dans ces témoignages toute la vérité qui arrive à sortir et à quel point il est encore difficile d'en parler. Beaucoup d'émotions en ressortent.
Cette lecture n'a pas été toujours facile, mais est tellement importante historiquement qu'il faut s'y accrocher.
On retrouve beaucoup de similitudes dans ces témoignages, et nous montre la tragédie de ces époques.
Ces témoignages m'ont beaucoup appris sur cette période que finalement je ne connaissais qu'en grande ligne.
On sent dans ces témoignages toute la vérité qui arrive à sortir et à quel point il est encore difficile d'en parler. Beaucoup d'émotions en ressortent.
Cette lecture n'a pas été toujours facile, mais est tellement importante historiquement qu'il faut s'y accrocher.
À la faveur d'un excellent Podcast de France Culture rediffusant une adaptation théâtrale de ce recueil de témoignages, je me suis souvenue d'avoir lu ce livre de Svetlana Alexievitch, La Fin de l'homme rouge, sous-titré « ou le temps de désenchantement ».
Je n'en ai cependant gardé aucune note de lecture et le regrette aujourd'hui.
Pendant quarante ans, Svetlana Alexievitch a parcouru l'ancienne URSS et enregistré des centaines de témoignages auprès de celles et ceux qui avaient totalement adhéré à l'idéal soviétique ou, au contraire, qui avaient connu les Goulags. Elle nous propose un véritable choeur de solistes ou chaque voix se donne à lire ou à entendre : des voix de survivants et de bourreaux, des voix de victimes, des voix d'intellectuels, de dissidents, de soldats, d'ouvriers, de « zombis »…
La grande Histoire est revisitée par le prisme de l'intime à travers une polyphonie émouvante, poignante, horrible, choquante, toujours profondément humaine. Ce livre est présenté comme « la petite histoire d'une grande utopie »… C'est comme un devoir de mémoire, car les manuels et les archives officielles ne peuvent pas raconter ces bribes de vies, ces réalités uniques et exemplaires.
J'ai eu ce livre entre les mains peu de temps après sa sortie.
Je garde le souvenir d'une lecture difficile, d'un défilé de personnages, ambivalents, certains très attachants, d'autres repoussants. Les évènements décrits m'étaient étrangers, lointains, mise à part la catastrophe de Tchernobyl ; dans les années 1990, je ne m'intéressais pas vraiment à la chute de l'Union Soviétique, même si j'ai connu une période studieuse, autour de l'oeuvre de Soljenitsyne, qui m'a particulièrement marquée à la fin des années 1970 ou au début des années 1980…
De La Fin de l'homme rouge, je me souviens de détails, d'allusions qui me paraissaient surréalistes, de récits particulièrement dérangeants. Dans les détails, il y a l'ouverture du premier McDonald's, la découverte d'objets qui, dans les pays capitalistes, font partie du quotidien… Dans les souvenirs plus choquants, il y a le les Goulags, les traumatismes des survivants, des récits de l'indicible… Il y a aussi l'obéissance aveugle au Parti…
Svetlana Alexievitch ne porte aucun jugement, elle recueille et transmet, tout simplement ; c'est donc forcément brutal, surtout sorti du contexte.
L'homme rouge est un être complexe, communiste sans doute, mais combien d'habitants de l'Union Soviétique ont subi le système sans avoir pris part à l'écriture de l'Histoire. Faut-il être ou avoir été soviétique pour comprendre ? Y-a-t-il un « homo sovieticus » ? Svetlana Alexievitch a été élevée dans cette idéologie.
Je retiens une impression de grande souffrance, de grand bouillonnement et toujours une certaine ambivalence. Je n'ai pas la connaissance socio-politique pour associer cette lecture à l'Histoire de l'Union Soviétique ou à la situation politique actuelle de la Russie et il me manque indéniablement des clés de lecture… : empire tsariste, révolution bolchevique, chute de l'Union Soviétique… aujourd'hui Poutine…
L'homme rouge est un exilé, égaré dans un monde qu'il ne reconnaît pas.
Un livre difficile, très difficile.
Une grande impression de malaise.
Une lecture intense.
https://www.facebook.com/piratedespal/
https://www.instagram.com/la_pirate_des_pal/
Je n'en ai cependant gardé aucune note de lecture et le regrette aujourd'hui.
Pendant quarante ans, Svetlana Alexievitch a parcouru l'ancienne URSS et enregistré des centaines de témoignages auprès de celles et ceux qui avaient totalement adhéré à l'idéal soviétique ou, au contraire, qui avaient connu les Goulags. Elle nous propose un véritable choeur de solistes ou chaque voix se donne à lire ou à entendre : des voix de survivants et de bourreaux, des voix de victimes, des voix d'intellectuels, de dissidents, de soldats, d'ouvriers, de « zombis »…
La grande Histoire est revisitée par le prisme de l'intime à travers une polyphonie émouvante, poignante, horrible, choquante, toujours profondément humaine. Ce livre est présenté comme « la petite histoire d'une grande utopie »… C'est comme un devoir de mémoire, car les manuels et les archives officielles ne peuvent pas raconter ces bribes de vies, ces réalités uniques et exemplaires.
J'ai eu ce livre entre les mains peu de temps après sa sortie.
Je garde le souvenir d'une lecture difficile, d'un défilé de personnages, ambivalents, certains très attachants, d'autres repoussants. Les évènements décrits m'étaient étrangers, lointains, mise à part la catastrophe de Tchernobyl ; dans les années 1990, je ne m'intéressais pas vraiment à la chute de l'Union Soviétique, même si j'ai connu une période studieuse, autour de l'oeuvre de Soljenitsyne, qui m'a particulièrement marquée à la fin des années 1970 ou au début des années 1980…
De La Fin de l'homme rouge, je me souviens de détails, d'allusions qui me paraissaient surréalistes, de récits particulièrement dérangeants. Dans les détails, il y a l'ouverture du premier McDonald's, la découverte d'objets qui, dans les pays capitalistes, font partie du quotidien… Dans les souvenirs plus choquants, il y a le les Goulags, les traumatismes des survivants, des récits de l'indicible… Il y a aussi l'obéissance aveugle au Parti…
Svetlana Alexievitch ne porte aucun jugement, elle recueille et transmet, tout simplement ; c'est donc forcément brutal, surtout sorti du contexte.
L'homme rouge est un être complexe, communiste sans doute, mais combien d'habitants de l'Union Soviétique ont subi le système sans avoir pris part à l'écriture de l'Histoire. Faut-il être ou avoir été soviétique pour comprendre ? Y-a-t-il un « homo sovieticus » ? Svetlana Alexievitch a été élevée dans cette idéologie.
Je retiens une impression de grande souffrance, de grand bouillonnement et toujours une certaine ambivalence. Je n'ai pas la connaissance socio-politique pour associer cette lecture à l'Histoire de l'Union Soviétique ou à la situation politique actuelle de la Russie et il me manque indéniablement des clés de lecture… : empire tsariste, révolution bolchevique, chute de l'Union Soviétique… aujourd'hui Poutine…
L'homme rouge est un exilé, égaré dans un monde qu'il ne reconnaît pas.
Un livre difficile, très difficile.
Une grande impression de malaise.
Une lecture intense.
https://www.facebook.com/piratedespal/
https://www.instagram.com/la_pirate_des_pal/
Ce livre est éprouvant. Une épreuve en résonance avec le vécu des témoins. Une longue litanie de confessions. Pas un seul texte serein. Des acteurs ou des observateurs qui se laissent aller à un flux de paroles inextinguible. Des rescapés engagés dans le parti ou dans la lutte, mouillés jusqu'au cou, des victimes innocentes ou collatérales, des témoins obscurs, tous se confient abandonnant leur réticence au cours de l'entretien, mis en confiance par la journaliste. Enfin ! On leur donne la parole à tous ces oubliés de l'ère soviétique. Tous ont connu l'URSS et sa chute. Des Russes, des vieux communistes pour la plupart, des retraités exsangues laissés pour compte et réduits à la misère qui en ont gros sur le coeur. La seconde partie, donne la parole à des Russes malmenés par la transition après les années 1990, les années Eltsine : des victimes d'attentats, des conflits, de la guerre d'Afghanistan ou de Tchétchénie, des Arméniens, des Abkhazes, des immigrés, des émigrés, des Russes persécutés au Tadjikistan, des Tadjiks persécutés à Moscou… L'énumération est quasi sans fin. Seule catastrophe omise, Tchernobyl, mais on sait qu'elle a fait l'objet d'un livre à part entière.
La grande violence que nous décrivent ces survivants, c'était la leur. Ils savent qu'elle constitue leur ADN «Gloire aux héros ! L'homme n'est pas prêt pour le bonheur, il est prêt pour la guerre…Les Russes ne se préparent pas au bonheur ». Cul sec ! Avenir radieux communiste ou richesse capitaliste ? Pour atteindre ce but, rien n'est négociable, ni la famille, ni la loyauté, ni la vie, ni le respect. La foi sans faille dans le chef suprême fort accompagne l'Homo sovieticus et ses descendants. L'idéal a juste été remplacé par une « économie de marché », une économie de pacotille, de jeans et de saucissons sans grandeur.
Ces témoignages soigneusement choisis sont aussi consternants que troublants. Chaque récit est plus scabreux que le précédent. Ce n'est pas l'Histoire qui est présentée. Les archives ne sont pas convoquées, seulement quelques notes en bas de page pour situer les personnages principaux ou le contexte. C'est la petite histoire du quotidien, des faits et des émotions, le cadre est familier, l'histoire brute, un miroir poignant et grossissant. Sur le plan formel les titres de chapitres « Où il est question de… » nous renvoient à une oeuvre littéraire ou aux contes édifiants. En ce sens l'auteur produit aussi un texte littéraire puissant.
La grande violence que nous décrivent ces survivants, c'était la leur. Ils savent qu'elle constitue leur ADN «Gloire aux héros ! L'homme n'est pas prêt pour le bonheur, il est prêt pour la guerre…Les Russes ne se préparent pas au bonheur ». Cul sec ! Avenir radieux communiste ou richesse capitaliste ? Pour atteindre ce but, rien n'est négociable, ni la famille, ni la loyauté, ni la vie, ni le respect. La foi sans faille dans le chef suprême fort accompagne l'Homo sovieticus et ses descendants. L'idéal a juste été remplacé par une « économie de marché », une économie de pacotille, de jeans et de saucissons sans grandeur.
Ces témoignages soigneusement choisis sont aussi consternants que troublants. Chaque récit est plus scabreux que le précédent. Ce n'est pas l'Histoire qui est présentée. Les archives ne sont pas convoquées, seulement quelques notes en bas de page pour situer les personnages principaux ou le contexte. C'est la petite histoire du quotidien, des faits et des émotions, le cadre est familier, l'histoire brute, un miroir poignant et grossissant. Sur le plan formel les titres de chapitres « Où il est question de… » nous renvoient à une oeuvre littéraire ou aux contes édifiants. En ce sens l'auteur produit aussi un texte littéraire puissant.
Après la fin de l'U.R.S.S, après la pérestroïka, que reste-il de l'homme rouge, l'homme soviétique, si tant est qu'il ait jamais existé… ? voilà une question politique, philosophique et morale à laquelle Svetlana Alexievitch tente d'apporter une réponse.
À sa manière, en écoutant, en retranscrivant les témoignages des gens, leurs histoires pour tenter de comprendre l'Histoire.
Mais la vérité n'est pas une, elle est mouvante d'un individu à l'autre, d'une époque à l'autre. Insaisissable mais en écoutant suffisamment on peut entendre certaines choses…
Que certains regrettent Staline, d'autres non. Qu'il y a des nostalgiques de la grandeur de la Patrie et d'une certaine idée de l'homme.
Que pour certains la pénurie des produits pendant la période soviétique n'était pas si importante par rapport aux discussions politiques dans les cuisines face à cette époque post-communiste consacrant le dieu l'argent.
Que la chute du communisme s'est faite entre pessimisme et espoir. Que les grands gagnants du nouveau capitalisme sont les plus malins pour certains, les plus malhonnêtes pour d'autres.
Que les épreuves, les malheurs, les drames et les deuils ont d'autres causes mais que sous une forme ou une autre, la souffrance est là comme collée au peuple russe.
Que l'homme rouge est une espèce en voie de disparition mais que l'homme qui l'a suivi ne vaut pas mieux que son prédécesseur.
Que la vérité comme souvent fait mal, elle rappelle que les utopies sont finies, mais pas les souffrances des hommes.
Un livre éclairant, tragique et magnifique. Un coup de coeur, encore une fois, pour Svetlana Alexievitch.
À sa manière, en écoutant, en retranscrivant les témoignages des gens, leurs histoires pour tenter de comprendre l'Histoire.
Mais la vérité n'est pas une, elle est mouvante d'un individu à l'autre, d'une époque à l'autre. Insaisissable mais en écoutant suffisamment on peut entendre certaines choses…
Que certains regrettent Staline, d'autres non. Qu'il y a des nostalgiques de la grandeur de la Patrie et d'une certaine idée de l'homme.
Que pour certains la pénurie des produits pendant la période soviétique n'était pas si importante par rapport aux discussions politiques dans les cuisines face à cette époque post-communiste consacrant le dieu l'argent.
Que la chute du communisme s'est faite entre pessimisme et espoir. Que les grands gagnants du nouveau capitalisme sont les plus malins pour certains, les plus malhonnêtes pour d'autres.
Que les épreuves, les malheurs, les drames et les deuils ont d'autres causes mais que sous une forme ou une autre, la souffrance est là comme collée au peuple russe.
Que l'homme rouge est une espèce en voie de disparition mais que l'homme qui l'a suivi ne vaut pas mieux que son prédécesseur.
Que la vérité comme souvent fait mal, elle rappelle que les utopies sont finies, mais pas les souffrances des hommes.
Un livre éclairant, tragique et magnifique. Un coup de coeur, encore une fois, pour Svetlana Alexievitch.
A quoi ça sert la littérature ? Tisser des personnages et des intrigues pour provoquer de l'émotion, que de superficialité. Philosopher est également un luxe, sonder l'abstrait n'a pas de sens lorsque l'extrême survie - cruelle, injuste, impitoyable - est le gouvernail des jours. Et pourtant le communisme est magnifique, et pourtant le "communisme" est abominable. Et pourtant l'humain porte en lui une beauté transcendante, et pourtant l'humain est la plus abjecte des créatures. Ne reste qu'une certitude, l'âme russe n'est que souffrance.
Le début qui fait état de différentes réactions sur la chute de l'URSS est assez déroutant, mais les témoignages fournis qui suivent éclairent vraiment sur les sentiments contradictoires de différents citoyens de l URSS. Suivant qu'ils ont été acteurs ou victimes du communautarisme, le plus étonnant c'est leurs regrets d'une grand idéal et d'un grand pays, même parmi les victimes. Passionnant.
Ayant été à la fois fascinée, terrifiée et bouleversée par la Supplication, oeuvre peut-être plus connue de l'auteure, je voulais lire aussi celui-ci, d'autant que le sujet m'intéresse "professionnellement", puisque je travaille avec mes élèves sur la chute de l'URSS, l'écroulement d'un Empire. Mais pour moi, c'est de l'histoire, puisque je suis née au moment de la chute du Mur, je ne connais ces événements que par les récits.
Et ici, c'est un récit choral, une multitude de récits où le particulier rejoint l'universel. Pas besoin de connaissances, ce n'est pas un traité universitaire sur la fin d'une époque, mais la façon dont les hommes et les femmes ordinaires l'ont vécue, dans leur coeur, dans leur âme et dans leur chair, voyant ce "monde d'hier" disparaître.
J'ai retrouvé ici tout le talent de l'auteure, qui recueille des témoignages en s'effaçant - même si elle est elle-même touchée et directement concernée, puisqu'elle aussi était une "femme rouge". Ses rares interventions sont d'autant plus fortes qu'on a l'impression que l'écrivain disparaît et que la femme surgit.
Certes, face à ce foisonnement, cette densité, cette multitude de témoignages et de récit, on se sent submergé, mais ce sont des images fortes, marquantes, que je retiens : l'importance du saucisson comme symbole de l'abondance, les couleurs qui arrivent dans les magasins, les réfugiés qui dorment dans les gares, les professeurs et les ingénieurs au chômage, le culte de l'argent, la terreur des camps et des tortures, la fuite de ce nouveau monde par le suicide... Oui, il y a beaucoup de suicidés, mais aussi beaucoup d'amour, seule réponse face à la mort, même quand c'est Roméo et Juliette (ou Margarita et Abulfaz). Car oui, la fin de l'homo sovieticus, c'est la fin de l'unité des peuples et de tout ce qui faisait le vivre ensemble, les langues, les religions ou l'origine redeviennent un sujet de haine et de violence.
Oui, c'est effrayant, et la fin n'incite pas à l'optimisme : dès le début, il semble prévisible que Poutine fera tout pour se maintenir au pouvoir.
Et ici, c'est un récit choral, une multitude de récits où le particulier rejoint l'universel. Pas besoin de connaissances, ce n'est pas un traité universitaire sur la fin d'une époque, mais la façon dont les hommes et les femmes ordinaires l'ont vécue, dans leur coeur, dans leur âme et dans leur chair, voyant ce "monde d'hier" disparaître.
J'ai retrouvé ici tout le talent de l'auteure, qui recueille des témoignages en s'effaçant - même si elle est elle-même touchée et directement concernée, puisqu'elle aussi était une "femme rouge". Ses rares interventions sont d'autant plus fortes qu'on a l'impression que l'écrivain disparaît et que la femme surgit.
Certes, face à ce foisonnement, cette densité, cette multitude de témoignages et de récit, on se sent submergé, mais ce sont des images fortes, marquantes, que je retiens : l'importance du saucisson comme symbole de l'abondance, les couleurs qui arrivent dans les magasins, les réfugiés qui dorment dans les gares, les professeurs et les ingénieurs au chômage, le culte de l'argent, la terreur des camps et des tortures, la fuite de ce nouveau monde par le suicide... Oui, il y a beaucoup de suicidés, mais aussi beaucoup d'amour, seule réponse face à la mort, même quand c'est Roméo et Juliette (ou Margarita et Abulfaz). Car oui, la fin de l'homo sovieticus, c'est la fin de l'unité des peuples et de tout ce qui faisait le vivre ensemble, les langues, les religions ou l'origine redeviennent un sujet de haine et de violence.
Oui, c'est effrayant, et la fin n'incite pas à l'optimisme : dès le début, il semble prévisible que Poutine fera tout pour se maintenir au pouvoir.
c'est le quatrième livre de Svetlana que j'ai lu.
J'ai découvert cette femme et son travail en 2017 avec Derniers Témoins et Cercueils de zinc.
Que dire ! comprendre la Russie, les Ukrainiens, les Belarus. Cette histoire si complexe. Svetlana témoigne. Ce n'est pas du roman. Des témoignages, par milliers, réécrits, certes. Grâce à ses livres, j'ai ressenti ce qu'était l"Histoire, le sacrifice, la nécessité de la mémoire, l'humilité aussi.
Sa méthode (des témoignages, et une réécriture) donne un ton particulier (on aime ou pas, moi j'aime). C'est souvent triste, tragique, que de vies perdues. Pas beau l'humain.
J'ai découvert cette femme et son travail en 2017 avec Derniers Témoins et Cercueils de zinc.
Que dire ! comprendre la Russie, les Ukrainiens, les Belarus. Cette histoire si complexe. Svetlana témoigne. Ce n'est pas du roman. Des témoignages, par milliers, réécrits, certes. Grâce à ses livres, j'ai ressenti ce qu'était l"Histoire, le sacrifice, la nécessité de la mémoire, l'humilité aussi.
Sa méthode (des témoignages, et une réécriture) donne un ton particulier (on aime ou pas, moi j'aime). C'est souvent triste, tragique, que de vies perdues. Pas beau l'humain.
« Naître en URSS. Vivre en Russie. » Peau contre peau avec les russes.
« Время секонд хэнд ». Voilà ce que nous propose Svetlana Alexievitch, par son entier retrait de l'oeuvre, elle place le lecteur, brutalement parfois, face aux personnages, témoins désenchantés des transformations sociales que connaît le peuple slave depuis la fin du XXème siècle.
« C'est grâce à ça que je vis maintenant. Grâce à l'aumône des souvenirs. » Ces aumônes de la mémoire - toujours trop avare, faute de se rappeler suffisamment de nos vies écoulées, liquidées - l'écrivaine les a traqués : de conversations sur la place rouge aux chuchotements dans les cuisines, de souvenirs de goulag aux guérillas civiles entre ethnies de l'ex bloc-soviétique, l'autrice parcourt inlassablement les mémoires torturées.
Les livres n'ont pas été écrits pour être lus dans les transports en commun, hagards après une journée de travail. Pourtant ici l'effort de concentration n'a pas été insurmontable. Une fois que ces histoires, très dures mais passionnantes, vous attrapent, elles ne vous rejettent qu'empreint de rage, de tristesse, d'impuissance ou gonflé d'empathie.
« La vérité des hommes est un clou auquel tout le monde accroche son chapeau ». Il faut bien comprendre que ce livre est un matériau brut, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire. La quête de vérité au sens de vérification des témoignages, de recoupements factuels n'est pas l'objet de l'écrivaine, prix Nobel de littérature.
C'est la subjectivité du vécu que propose l'autrice minskoise et c'est ainsi que je l'ai lu, me rappelant soudainement que peut-être, on me mentait, et qu'en tout cas je n'avais qu'un son de cloche. Et ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas d'opposer subjectivité humaine et vérité des documents : « j'ai travaillé dans les archives, je sais que les papiers mentent encore plus que les hommes », souligne l'un des protagonistes.
« Nous avons une âme d'esclaves ». S'il est exact que le mot « slave » (esclave en anglais) vient bien du peuple slave, historiquement un des premiers peuples à avoir été réduit en esclavage, j'ai peine à croire à la prédisposition des russes à la soumission. C'est un thème récurrent pourtant dans les témoignages, les russes « aiment souffrir » ne se « préparent pas au bonheur », « La liberté ! Les russes ça leur va comme des lunettes à une guenon. Personne ne sait quoi en faire ».
Voilà bien l'exemple de subjectivité du livre car il est tout à fait possible d'appliquer les préceptes de la « servitude volontaire » à bien des peuplades par le monde. Mais les russes, spécialement depuis la chute de l'U.R.S.S, se comparent aux occidentaux et à leur système politique plus libéral : «et à la télévision, ils nous montrent la façon dont vivent les allemands... les vaincus vivent cent fois mieux que les vainqueurs ».
« Il croyait que le communisme serait là pour toujours. C'est ridicule de dire ça maintenant ». Que s'est-il passé en 1991, lorsque la Russie a tourné le dos au communisme et rejoint le capitalisme ?
C'est la question à laquelle se propose de répondre Svetlana Alexievitch grâce à ses entretiens, ainsi nous avons l'avis d'anciens membres du parti, de nouveaux riches, d'intellectuels dépassés, d'anciens déportés. le choc a touché les russes mais s'est vite propagé aux biélorusses, géorgiens, tchétchènes, arméniens, azéris, kazakhs etc, réveillant les nationalismes et les antagonismes entre les « camarades » d'hier.
« Nos parents ont vendu un grand pays pour des jeans, des Marlboro's et du chewing-gum ». Ce que constatent les russes, c'est qu'ils n'étaient pas prêts pour ça. L'esprit d'entreprise, l'accumulation ne faisait pas partie de leur logiciel. Chacun recevait selon son rang, dans des écarts jugés limités et qui semblent avoir explosés, de l'avis de certains récits, avec l'arrivée du capitalisme.
Il y a comme un malentendu, les russes ne seraient pas tous sortis lors des évènements de 1991 pour qu'Eltsine déclare le pays « capitaliste », ce que lui reprocha aussi Gorbatchev, mais simplement pour que des ruines d'un communisme autoritaire naisse le véritable progrès socialiste et non pas ce qui a été vécu, de la pérestroïka à l'avènement de la Fédération de Russie comme une trahison des élites, ainsi que le regrette cette manifestante « la liberté de parole m'aurait suffi ». Finalement « après tous les changements, les gens simples finissent toujours par se faire avoir ».
« Des communistes auraient jugé d'autres communistes, ceux qui avaient quittés le Parti le mercredi auraient jugé ceux qui l'avaient quitté le jeudi... ». Mais l'homo sovieticus n'a pas disparu pour autant, l'homme rouge n'est peut-être plus à la mode dans les grandes métropoles, mais la Russie périphérique reste fortement imprégnée par le communisme. Les méthodes de la police russe ne sont pas forcément très éloignées des méthodes communistes, les écoutes, la paranoïa et la surveillance orwellienne généralisée et de tous par chacun non plus. Les anciens déportés aux goulags reviennent parfois vivre dans le quartier où réside ceux qui les ont dénoncés : « notre drame c'est que chez nous les victimes et les bourreaux se sont les mêmes personnes ».
« Les hommes n'ont de pitié que pour eux-mêmes ». La répression des camps est toujours présente dans les mémoires, les horreurs staliniennes sont racontées par les survivants ou leurs enfants : « en hiver, les crevards qui n'avaient pas rempli la norme quotidienne étaient arrosés d'eau. Et des dizaines de statues de glace restaient là, devant le portail du camp, jusqu'au printemps. ».
Mais la fin de l'U.R.S.S a également son lot d'avanies, ainsi les anciens soldats, ivres de vodka, qui retrouvent une vie miséreuse en rentrant de la Seconde Guerre Mondiale, d'Afghanistan ou de Tchétchénie et perpétuent eux-mêmes sur les femmes une violence sordide, insoutenable car presque banale : « la guerre et la prison se sont les deux mots les plus importants de la langue russe ».
Mais malgré les atrocités vécues, il semble à nombre des protagonistes que « si on rouvre des camps, on n'aura aucun mal à trouver des gens pour les garder ». Ainsi, l'heure où l'on enraillait les téléphones pour empêcher les « tchékistes » d'espionner les conversations, où l'on se faisait passer des livres « samizdat » sous le manteau est peut-être passée mais les réflexes policiers sont bien présents. Les récentes manifestations pour des élections libres en Russie ou en Biélorussie le montrent.
Preuve de l'impasse dans laquelle s'engouffre les russes, l'écoeurement face aux méthodes de la police et du pouvoir politique actuel alimente une nostalgie nauséabonde : « il faudrait que Staline sorte de sa tombe tiens ! (...) il aurait dû en arrêter et en fusiller encore plus, de ces petits chefs ».
“que les héros se sont ceux qui achètent quelque chose dans un endroit pour le revendre trois kopecks de plus ailleurs. C'est ce qu'on nous rentre dans le crâne maintenant.” En effet, la Russie semble être revenue aux temps pré-communistes. Désormais il faut faire de l'argent, la télévision vante les mérites des oligarques dans chaque foyer démuni, on montre sans pudeur leurs résidences secondaires avec piscine, leurs vacances à Miami, leur personnel de maison « comme les propriétaires terriens au temps des tsars ».
« L'argent, ça aime ni la pitié ni la honte ». Alexievitch, adaptée au théâtre des Bouffes du Nord, dont la série « Tchernobyl » et le film « Une grande fille » en 2019, sont inspirés par l'oeuvre, n'a pas fini d'interroger l'âme slave trente ans après la chute du mur de Berlin. A l'heure où la Russie s'est convertie au capitalisme débridé « en trois jours » (contre plusieurs siècles en Occident), les inégalités ont métastasées, un seul crédo : « comme nous l'avait dit le prof de physique : chers étudiants ! N'oubliez jamais que l'argent résout tout ! Même les équations différentielles ! ».
« Comment as tu fais pour rester en vie là-bas ? J'ai été très aimé dans mon enfance. La quantité d'amour que nous avons reçu, c'est ça qui nous sauve. » Mais « faute d'amour », beaucoup n'ont pas survécu…
Il ne tient désormais qu'à vous d'enfiler une chapka et d'aller à la rencontre de l'Homme rouge, ou ce qu'il en reste, il ou elle vous recevra dans sa datcha, vous proposera des pirojkis et une vodka et peut-être alors vous ouvrira ses entrailles et remembrera ses souvenirs pour vous, trop longtemps étouffés, comme des lames de rasoir impuissantes à franchir le pas de sa gorge. Spasiba.
Qu'en pensez-vous ?
« Время секонд хэнд ». Voilà ce que nous propose Svetlana Alexievitch, par son entier retrait de l'oeuvre, elle place le lecteur, brutalement parfois, face aux personnages, témoins désenchantés des transformations sociales que connaît le peuple slave depuis la fin du XXème siècle.
« C'est grâce à ça que je vis maintenant. Grâce à l'aumône des souvenirs. » Ces aumônes de la mémoire - toujours trop avare, faute de se rappeler suffisamment de nos vies écoulées, liquidées - l'écrivaine les a traqués : de conversations sur la place rouge aux chuchotements dans les cuisines, de souvenirs de goulag aux guérillas civiles entre ethnies de l'ex bloc-soviétique, l'autrice parcourt inlassablement les mémoires torturées.
Les livres n'ont pas été écrits pour être lus dans les transports en commun, hagards après une journée de travail. Pourtant ici l'effort de concentration n'a pas été insurmontable. Une fois que ces histoires, très dures mais passionnantes, vous attrapent, elles ne vous rejettent qu'empreint de rage, de tristesse, d'impuissance ou gonflé d'empathie.
« La vérité des hommes est un clou auquel tout le monde accroche son chapeau ». Il faut bien comprendre que ce livre est un matériau brut, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire. La quête de vérité au sens de vérification des témoignages, de recoupements factuels n'est pas l'objet de l'écrivaine, prix Nobel de littérature.
C'est la subjectivité du vécu que propose l'autrice minskoise et c'est ainsi que je l'ai lu, me rappelant soudainement que peut-être, on me mentait, et qu'en tout cas je n'avais qu'un son de cloche. Et ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas d'opposer subjectivité humaine et vérité des documents : « j'ai travaillé dans les archives, je sais que les papiers mentent encore plus que les hommes », souligne l'un des protagonistes.
« Nous avons une âme d'esclaves ». S'il est exact que le mot « slave » (esclave en anglais) vient bien du peuple slave, historiquement un des premiers peuples à avoir été réduit en esclavage, j'ai peine à croire à la prédisposition des russes à la soumission. C'est un thème récurrent pourtant dans les témoignages, les russes « aiment souffrir » ne se « préparent pas au bonheur », « La liberté ! Les russes ça leur va comme des lunettes à une guenon. Personne ne sait quoi en faire ».
Voilà bien l'exemple de subjectivité du livre car il est tout à fait possible d'appliquer les préceptes de la « servitude volontaire » à bien des peuplades par le monde. Mais les russes, spécialement depuis la chute de l'U.R.S.S, se comparent aux occidentaux et à leur système politique plus libéral : «et à la télévision, ils nous montrent la façon dont vivent les allemands... les vaincus vivent cent fois mieux que les vainqueurs ».
« Il croyait que le communisme serait là pour toujours. C'est ridicule de dire ça maintenant ». Que s'est-il passé en 1991, lorsque la Russie a tourné le dos au communisme et rejoint le capitalisme ?
C'est la question à laquelle se propose de répondre Svetlana Alexievitch grâce à ses entretiens, ainsi nous avons l'avis d'anciens membres du parti, de nouveaux riches, d'intellectuels dépassés, d'anciens déportés. le choc a touché les russes mais s'est vite propagé aux biélorusses, géorgiens, tchétchènes, arméniens, azéris, kazakhs etc, réveillant les nationalismes et les antagonismes entre les « camarades » d'hier.
« Nos parents ont vendu un grand pays pour des jeans, des Marlboro's et du chewing-gum ». Ce que constatent les russes, c'est qu'ils n'étaient pas prêts pour ça. L'esprit d'entreprise, l'accumulation ne faisait pas partie de leur logiciel. Chacun recevait selon son rang, dans des écarts jugés limités et qui semblent avoir explosés, de l'avis de certains récits, avec l'arrivée du capitalisme.
Il y a comme un malentendu, les russes ne seraient pas tous sortis lors des évènements de 1991 pour qu'Eltsine déclare le pays « capitaliste », ce que lui reprocha aussi Gorbatchev, mais simplement pour que des ruines d'un communisme autoritaire naisse le véritable progrès socialiste et non pas ce qui a été vécu, de la pérestroïka à l'avènement de la Fédération de Russie comme une trahison des élites, ainsi que le regrette cette manifestante « la liberté de parole m'aurait suffi ». Finalement « après tous les changements, les gens simples finissent toujours par se faire avoir ».
« Des communistes auraient jugé d'autres communistes, ceux qui avaient quittés le Parti le mercredi auraient jugé ceux qui l'avaient quitté le jeudi... ». Mais l'homo sovieticus n'a pas disparu pour autant, l'homme rouge n'est peut-être plus à la mode dans les grandes métropoles, mais la Russie périphérique reste fortement imprégnée par le communisme. Les méthodes de la police russe ne sont pas forcément très éloignées des méthodes communistes, les écoutes, la paranoïa et la surveillance orwellienne généralisée et de tous par chacun non plus. Les anciens déportés aux goulags reviennent parfois vivre dans le quartier où réside ceux qui les ont dénoncés : « notre drame c'est que chez nous les victimes et les bourreaux se sont les mêmes personnes ».
« Les hommes n'ont de pitié que pour eux-mêmes ». La répression des camps est toujours présente dans les mémoires, les horreurs staliniennes sont racontées par les survivants ou leurs enfants : « en hiver, les crevards qui n'avaient pas rempli la norme quotidienne étaient arrosés d'eau. Et des dizaines de statues de glace restaient là, devant le portail du camp, jusqu'au printemps. ».
Mais la fin de l'U.R.S.S a également son lot d'avanies, ainsi les anciens soldats, ivres de vodka, qui retrouvent une vie miséreuse en rentrant de la Seconde Guerre Mondiale, d'Afghanistan ou de Tchétchénie et perpétuent eux-mêmes sur les femmes une violence sordide, insoutenable car presque banale : « la guerre et la prison se sont les deux mots les plus importants de la langue russe ».
Mais malgré les atrocités vécues, il semble à nombre des protagonistes que « si on rouvre des camps, on n'aura aucun mal à trouver des gens pour les garder ». Ainsi, l'heure où l'on enraillait les téléphones pour empêcher les « tchékistes » d'espionner les conversations, où l'on se faisait passer des livres « samizdat » sous le manteau est peut-être passée mais les réflexes policiers sont bien présents. Les récentes manifestations pour des élections libres en Russie ou en Biélorussie le montrent.
Preuve de l'impasse dans laquelle s'engouffre les russes, l'écoeurement face aux méthodes de la police et du pouvoir politique actuel alimente une nostalgie nauséabonde : « il faudrait que Staline sorte de sa tombe tiens ! (...) il aurait dû en arrêter et en fusiller encore plus, de ces petits chefs ».
“que les héros se sont ceux qui achètent quelque chose dans un endroit pour le revendre trois kopecks de plus ailleurs. C'est ce qu'on nous rentre dans le crâne maintenant.” En effet, la Russie semble être revenue aux temps pré-communistes. Désormais il faut faire de l'argent, la télévision vante les mérites des oligarques dans chaque foyer démuni, on montre sans pudeur leurs résidences secondaires avec piscine, leurs vacances à Miami, leur personnel de maison « comme les propriétaires terriens au temps des tsars ».
« L'argent, ça aime ni la pitié ni la honte ». Alexievitch, adaptée au théâtre des Bouffes du Nord, dont la série « Tchernobyl » et le film « Une grande fille » en 2019, sont inspirés par l'oeuvre, n'a pas fini d'interroger l'âme slave trente ans après la chute du mur de Berlin. A l'heure où la Russie s'est convertie au capitalisme débridé « en trois jours » (contre plusieurs siècles en Occident), les inégalités ont métastasées, un seul crédo : « comme nous l'avait dit le prof de physique : chers étudiants ! N'oubliez jamais que l'argent résout tout ! Même les équations différentielles ! ».
« Comment as tu fais pour rester en vie là-bas ? J'ai été très aimé dans mon enfance. La quantité d'amour que nous avons reçu, c'est ça qui nous sauve. » Mais « faute d'amour », beaucoup n'ont pas survécu…
Il ne tient désormais qu'à vous d'enfiler une chapka et d'aller à la rencontre de l'Homme rouge, ou ce qu'il en reste, il ou elle vous recevra dans sa datcha, vous proposera des pirojkis et une vodka et peut-être alors vous ouvrira ses entrailles et remembrera ses souvenirs pour vous, trop longtemps étouffés, comme des lames de rasoir impuissantes à franchir le pas de sa gorge. Spasiba.
Qu'en pensez-vous ?
Un énorme volume, composé de témoignages, de récits, de bouts de vie, qui au-delà de leurs singularités, dressent en quelque sorte le tableau de « l'homme soviétique », tel qu'il s'est construit pendant les années où régnait le communisme en URSS, puis le choc qu'a créé la disparition officielle du régime, et les répercussion qu'il a eu sur les mentalités, les représentations mais aussi les destins individuels. Sans oublier un aperçu d'un éventuel « homme nouveau » et de son devenir dans un pays toujours en transformation. Et bien entendu, en fond de toile, l'histoire du pays et aussi un peu du monde pendant ce vingtième siècle si fertile en événements, en atrocités, en révolutions et changements.
Les interlocuteurs de Svetlana Alexievitch sont divers : beaucoup de petites gens, au statut modeste et avec une vision limitée des événements, qu'ils ressentent pourtant au plus profond de leur être, car ils en sont souvent les premières victimes. Quelques responsables ou chefs de temps en temps viennent aussi témoigner, souvent anonymement. Il y a des bourreaux, des victimes, ceux qui ont été à la fois, successivement, bourreau et victime. Les destructions et les morts de la guerre, les déportations, le goulag, les travaux excessifs, la faim, le froid… Et tout l'appareil de répression d'un état pouvant se retourner contre n'importe qui, par besoin d'avaler sa dose de souffrance et de chair humaine, pour maintenir la peur, provoquer la soumission.
Il y a aussi en contre-point la capacité de l'être humain à se fabriquer du bonheur malgré tout, en adhérant à un discours, en s'investissant dans un idéal que la réalité paraissait pourtant démentir au quotidien, mais une certaine forme d'aveuglement est peut-être nécessaire au bonheur. En se construisant des minuscules bouts de liberté, d'autant plus précieux que minuscules, en bâtissant des liens avec les autres, dont la chaleur pouvaient contrebalancer la violence et les manques matériels. En sortent parfois d'étranges récits, où la pire souffrance peut être mêlée à des souvenirs heureux : une femme née dans un camp, séparée très tôt de sa mère, confiée à un orphelinat dans lequel les sévices et les privations étaient la règle, se souvient des décennies plus tard, avec émotion d'une lettre écrite à Staline, des chants communistes, des défilés… Regrette le passé et rejette la nouvelle Russie.
C'est cette ambiguïté qui frappe dans la plupart des textes : malgré tout, le monde disparu provoque un manque ; parfois d'un aspect secondaire, parfois comme mise en évidence de quelque chose qui fait défaut au nouveau monde, mais pour certains un manque absolu. Il faut dire que le livre montre à quel point le passage dans un nouveau monde a été violent et destructeur : la paupérisation brutale d'une partie de la population, le règne de gangs mafieux, une nouvelle richesse de quelques uns, ostentatoire et agressive. Sans oublier les guerres qui ont en particulier surgi dans certaines républiques qui se sont séparées de l'empire dans la violence la plus extrême. Certains ont pu trouver leur place dans le nouvel environnement, mais la plupart restent des victimes, au mieux des figurants qui s'en sortent plus au moins mal, en se demandant ce qui a déraillé et pourquoi c'est si peu satisfaisant au final.
Les protagonistes de ce vaste récit collectif ont vécu et vivent toujours des situations difficiles, voire désespérantes, objets et non sujets d'un monde qui les emportent souvent vers le pire, ou tout au moins vers l'incertain. Au point parfois de préférer quitter le pays, comme cet homme, habité par la peur du retour toujours possible de « la hache », si seulement un nouvel homme fort décidait de s'en emparer. Comme si la violence ne pouvait jamais vraiment s'arrêter. Il faut dire que tous ces récits mettent en évidence un siècle d'expériences à la limite du supportable, sans beaucoup de raisons d'espérer ni dans l'histoire, ni dans la nature humaine, ni surtout dans la possibilité de connaître un jour un monde dans lequel la plupart des individus pourraient avoir une existence digne et satisfaisante. Au-delà de la Russie, et des conditions de vie extrêmes qu'elle a imposée aux individus, ces récits posent des questions sur ce qu'est un être humain.
Les interlocuteurs de Svetlana Alexievitch sont divers : beaucoup de petites gens, au statut modeste et avec une vision limitée des événements, qu'ils ressentent pourtant au plus profond de leur être, car ils en sont souvent les premières victimes. Quelques responsables ou chefs de temps en temps viennent aussi témoigner, souvent anonymement. Il y a des bourreaux, des victimes, ceux qui ont été à la fois, successivement, bourreau et victime. Les destructions et les morts de la guerre, les déportations, le goulag, les travaux excessifs, la faim, le froid… Et tout l'appareil de répression d'un état pouvant se retourner contre n'importe qui, par besoin d'avaler sa dose de souffrance et de chair humaine, pour maintenir la peur, provoquer la soumission.
Il y a aussi en contre-point la capacité de l'être humain à se fabriquer du bonheur malgré tout, en adhérant à un discours, en s'investissant dans un idéal que la réalité paraissait pourtant démentir au quotidien, mais une certaine forme d'aveuglement est peut-être nécessaire au bonheur. En se construisant des minuscules bouts de liberté, d'autant plus précieux que minuscules, en bâtissant des liens avec les autres, dont la chaleur pouvaient contrebalancer la violence et les manques matériels. En sortent parfois d'étranges récits, où la pire souffrance peut être mêlée à des souvenirs heureux : une femme née dans un camp, séparée très tôt de sa mère, confiée à un orphelinat dans lequel les sévices et les privations étaient la règle, se souvient des décennies plus tard, avec émotion d'une lettre écrite à Staline, des chants communistes, des défilés… Regrette le passé et rejette la nouvelle Russie.
C'est cette ambiguïté qui frappe dans la plupart des textes : malgré tout, le monde disparu provoque un manque ; parfois d'un aspect secondaire, parfois comme mise en évidence de quelque chose qui fait défaut au nouveau monde, mais pour certains un manque absolu. Il faut dire que le livre montre à quel point le passage dans un nouveau monde a été violent et destructeur : la paupérisation brutale d'une partie de la population, le règne de gangs mafieux, une nouvelle richesse de quelques uns, ostentatoire et agressive. Sans oublier les guerres qui ont en particulier surgi dans certaines républiques qui se sont séparées de l'empire dans la violence la plus extrême. Certains ont pu trouver leur place dans le nouvel environnement, mais la plupart restent des victimes, au mieux des figurants qui s'en sortent plus au moins mal, en se demandant ce qui a déraillé et pourquoi c'est si peu satisfaisant au final.
Les protagonistes de ce vaste récit collectif ont vécu et vivent toujours des situations difficiles, voire désespérantes, objets et non sujets d'un monde qui les emportent souvent vers le pire, ou tout au moins vers l'incertain. Au point parfois de préférer quitter le pays, comme cet homme, habité par la peur du retour toujours possible de « la hache », si seulement un nouvel homme fort décidait de s'en emparer. Comme si la violence ne pouvait jamais vraiment s'arrêter. Il faut dire que tous ces récits mettent en évidence un siècle d'expériences à la limite du supportable, sans beaucoup de raisons d'espérer ni dans l'histoire, ni dans la nature humaine, ni surtout dans la possibilité de connaître un jour un monde dans lequel la plupart des individus pourraient avoir une existence digne et satisfaisante. Au-delà de la Russie, et des conditions de vie extrêmes qu'elle a imposée aux individus, ces récits posent des questions sur ce qu'est un être humain.
Les Dernières Actualités
Voir plus

Les romans les mieux notés
heros_pitch
195 livres

Le livre qui vous a tiré une larme
Gwen21
100 livres

Les 100 romans du Monde
Cronos
100 livres
Autres livres de Svetlana Alexievitch (9)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3260 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3260 lecteurs ont répondu