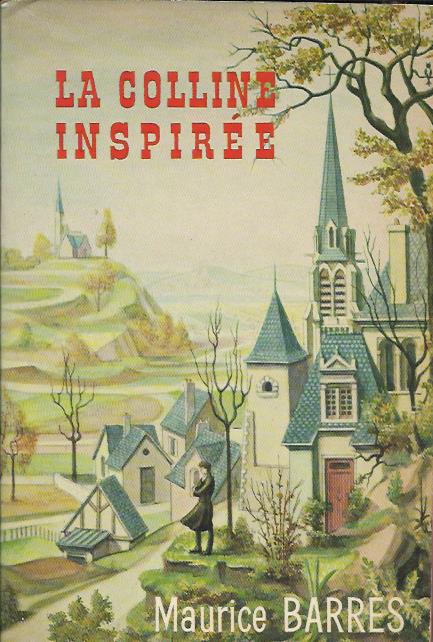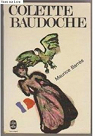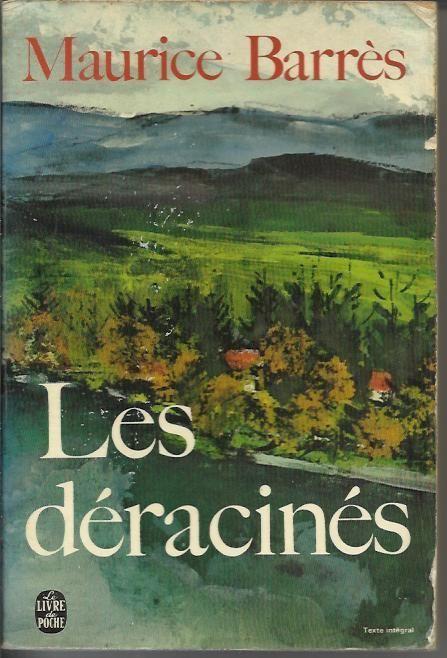Critiques de Maurice Barrès (73)
« Il est des lieux où souffle l'esprit… Combien de fois, au hasard d'une heureuse et profonde journée, n'avons-nous pas rencontré la lisière d'un bois, un sommet, une source, une simple prairie, qui nous commandait de faire taire nos pensées et d'écouter plus profond que notre coeur ! Silence ! les Dieux sont ici. »
Pour Maurice Barrès, la colline de Sion est un de ces lieux qui soulève l'âme. Il raconte l'histoire vraie des frères Baillard, trois prêtres, qui ont entrepris de réhabiliter un pèlerinage dédié à la vierge qui se passait depuis des temps immémoriaux sur cette colline mythique. Leur rencontre avec le prêtre excommunié Vintras, hérésiarque et prophète illuminé, fait de Notre Dame de Sion un bastion de l'hérésie «Vintrasiène», et met les trois frères au ban de la religion catholique. Disons-le honnêtement : l'affreux mécréant que je suis n'a pas tout capté. Les angoisses existentielles des trois frères, les charlataneries de Vintras, les papillonnements et autres tressaillements des bonnes soeurs m'ont franchement laissé de marbre.
Mais il y a une chose qui m'a retenu dans ce livre : la manière dont Maurice Barrès décrit les paysages de sa Loraine natale, dont il parle de ses racines, de sa terre, des arbres et du vent. C'est sublime ! C'est flamboyant !
Arrivé poussivement au milieu de ce fichu livre, je me suis juré que si je parvenais à l'achever, j'irai faire un pèlerinage à la colline de Sion. Il ne me reste plus qu'à m'exécuter…
Pour Maurice Barrès, la colline de Sion est un de ces lieux qui soulève l'âme. Il raconte l'histoire vraie des frères Baillard, trois prêtres, qui ont entrepris de réhabiliter un pèlerinage dédié à la vierge qui se passait depuis des temps immémoriaux sur cette colline mythique. Leur rencontre avec le prêtre excommunié Vintras, hérésiarque et prophète illuminé, fait de Notre Dame de Sion un bastion de l'hérésie «Vintrasiène», et met les trois frères au ban de la religion catholique. Disons-le honnêtement : l'affreux mécréant que je suis n'a pas tout capté. Les angoisses existentielles des trois frères, les charlataneries de Vintras, les papillonnements et autres tressaillements des bonnes soeurs m'ont franchement laissé de marbre.
Mais il y a une chose qui m'a retenu dans ce livre : la manière dont Maurice Barrès décrit les paysages de sa Loraine natale, dont il parle de ses racines, de sa terre, des arbres et du vent. C'est sublime ! C'est flamboyant !
Arrivé poussivement au milieu de ce fichu livre, je me suis juré que si je parvenais à l'achever, j'irai faire un pèlerinage à la colline de Sion. Il ne me reste plus qu'à m'exécuter…
« La colline inspirée ». Ce roman, publié en 1913 décrit l'affrontement de deux mouvements religieux : le courant illuminé des "vintrasiens" et le courant plus traditionnel des fidèles à Rome. Le premier, tenant sa raison d'être de la colline de Sion en terre lorraine, symbolise la liberté ainsi que la fidélité aux "racines". Le second, tenant sa raison d'être de Rome et de l'évêque de Nancy, symbolise l'ordre et la soumission à l'autorité.
Malgré la folie dans laquelle tombe Léopold et malgré la victoire de l'Église par sa rétractation, Maurice Barrès refuse de trancher entre l'ordre et la liberté. Il donnera son sentiment dans les dernières lignes en rappelant l’opposition entre la chapelle (l'ordre) et la prairie (l'enthousiasme) en montrant combien elles nous sont indispensables toutes deux.
Un remarquable ouvrage, reconnu plus tard comme un ouvrage majeur par son intégration dans la « liste des meilleurs romans du demi siècle » ; néanmoins à conseiller aux amateurs de belle prose académique début XX ème...
Malgré la folie dans laquelle tombe Léopold et malgré la victoire de l'Église par sa rétractation, Maurice Barrès refuse de trancher entre l'ordre et la liberté. Il donnera son sentiment dans les dernières lignes en rappelant l’opposition entre la chapelle (l'ordre) et la prairie (l'enthousiasme) en montrant combien elles nous sont indispensables toutes deux.
Un remarquable ouvrage, reconnu plus tard comme un ouvrage majeur par son intégration dans la « liste des meilleurs romans du demi siècle » ; néanmoins à conseiller aux amateurs de belle prose académique début XX ème...
Nous sommes en Lorraine, trente-huit ans après la défaite de la France face à la Prusse en 1871. Les Prussiens vainqueurs occupent le territoire depuis 1872, et l'un d'eux, le Dr Frédéric Asmus arrive à Metz pour y être professeur. Il loue deux chambres meublées au domicile des dames Baudoche, une grand-mère et sa petite fille, Colette. Il va peu à peu se découvrir une sensibilité pour la beauté et la délicatesse de la culture messine, lorraine et française. ● Maurice Barrès nous prévient dès les premières pages : « je ne prépare aucune surprise et ne fais pas appel aux amateurs d'aventures », et, de fait son récit est très plat et ne possède pour ainsi dire pas d'intrigue. Son but est avant tout, en 1909, dans un élan patriotique, de dénoncer la barbarie et la balourdise des occupants allemands et, parallèlement, d'exalter le haut degré de civilisation des Français. Il glorifie la résistance des Messins contre la dangereuse germanisation à laquelle les autorités prussiennes se livrent, à commencer par l'obligation de parler allemand à l'école et l'adhésion à une vision allemande de l'histoire dans laquelle, entre autres, Napoléon Ier est un menteur qui gouverne les hommes par leurs vices. De nombreuses descriptions nous montrent par exemple la beauté et le raffinement de la ville de Metz, en partie gâchés par les transformations prussiennes, mais c'est dans tous les domaines que la supériorité française, malgré une défaite militaire due d'après l'auteur non au courage des soldats mais à des erreurs d'état-major, est mise en valeur. ● Le problème est que tout cela est bien caricatural. Comment croire aux Teutons ridicules de Barrès qui manquent du plus élémentaire savoir-vivre ? Ce n'est paradoxalement pas sans lourdeurs qu'il dénonce leur balourdise : j'en veux pour preuve (mais on pourrait multiplier les exemples) le dialogue formellement ahurissant entre « le pangermaniste » et le Dr Asmus, qui se fige dans des démonstrations lourdingues avec des répliques qui font entre une demi-page et une page. Intervenant à tout bout de champ dans son récit en disant « je », Barrès aurait mieux fait d'écrire un essai, car son livre ne ressemble pas à grand-chose. Quant à son style devant lequel d'aucuns se pâment, il m'a paru certes relever d'une belle langue classique mais sans grande originalité.
Que reste-t-il aujourd'hui de Maurice Barrès, de son oeuvre abondante, de son engagement politique (à l'extrême droite la plus cocardière), de la vénération qui l'a entouré ? Bien peu de choses, en fait : quelques pages dans les encyclopédies, un chapitre du Lagarde & Michard. Guère plus.
Pourtant, il a été un temps adulé par toute une génération de jeunes gens, dont certains se sont fait un nom, tels Malraux, Yourcenar ou Bernanos et, quand il meurt, en 1923, l'État n'hésite pas à lui organiser, comme à Victor Hugo, des obsèques nationales...
Il est vrai qu'en ouvrant « La colline inspirée », son livre le plus connu, on est frappé par l'écart qui existe entre cette esthétique et celle de certains de ses jeunes contemporains : le livre est publié en 1913, la même année que « Du côté de Chez Swann », « Alcools » ou « La prose du Transsibérien ». Entre ces livres fondateurs de la modernité et le roman de Barrès, la comparaison est écrasante : loin des audaces de ses cadets, c'est plutôt du côté De Chateaubriand et d'un certain romantisme incantatoire et suranné, que lorgne l'écrivain national.
Il n'empêche que, même pour un lecteur d'aujourd'hui, le roman de Barrès ne manque pas d'intérêt. Centré sur un « lieu de mémoire » lorrain, la colline de Sion-Vaudémont, où les Celtes vénéraient Wotan et Rosmerta, et où la religion catholique a imposé le culte de la Vierge, « La colline inspirée » raconte le destin véridique de trois prêtres, les frères Baillard, bien décidés à en découdre avec le rationalisme façon Lumières. Ils restaurent le vieux sanctuaire, y organisent des pèlerinages, raniment la ferveur populaire… jusqu'au jour où ils croisent le chemin de Vintras, un illuminé comme il y en avait tant dans la seconde moitié du XIXè siècle : « … on ne rêvait que miracles et prophéties, raconte Barrès ; plusieurs voyants annoncèrent le règne de l'Antéchrist et la fin du monde ; d'autres, au contraire, le triomphe définitif du grand Roi et du grand Pape... »
Vintras est des premiers, qui prédit l'« année noire », la disparition d'une grande partie de l'humanité, sa régénération grâce aux prières d'une poignée d'élus… Pour les malheureux Baillard commence alors une longue descente aux enfers, qui va faire d'eux des parias : rejetés par leur hiérarchie et leurs paroissiens, puis excommuniés, ils sont bientôt réduits à prêcher dans le désert.
Au-delà de cette histoire, qui interroge les racines du sentiment religieux (cette soif d'irrationnel et de merveilleux qui forme le substrat de la ferveur populaire), ce que met en scène le roman de Barrès c'est la revendication d'un culte et d'une culture autochtones face à un dogme venu de Rome. Pour les lecteurs de 1913, cette opposition entre Gaulois et envahisseurs romains sonne bien sûr comme un vigoureux coup de clairon, alors qu'une partie de la Lorraine est encore occupée par une puissance étrangère...
Ce qui personnellement m'a le plus intéressé, ce sont moins ces débats d'un autre âge (et vaguement nauséabonds, disons-le) que la plongée quasi documentaire qu'offre ce roman dans la France de la seconde moitié du XIXè siècle ; une France villageoise, groupée autour de l'église et du curé (mais où le sorcier a encore son mot à dire), et vivant au rythme lent des attelages et des saisons.
Une curiosité, baignée par la lumière sépia des très anciennes photographies.
Pourtant, il a été un temps adulé par toute une génération de jeunes gens, dont certains se sont fait un nom, tels Malraux, Yourcenar ou Bernanos et, quand il meurt, en 1923, l'État n'hésite pas à lui organiser, comme à Victor Hugo, des obsèques nationales...
Il est vrai qu'en ouvrant « La colline inspirée », son livre le plus connu, on est frappé par l'écart qui existe entre cette esthétique et celle de certains de ses jeunes contemporains : le livre est publié en 1913, la même année que « Du côté de Chez Swann », « Alcools » ou « La prose du Transsibérien ». Entre ces livres fondateurs de la modernité et le roman de Barrès, la comparaison est écrasante : loin des audaces de ses cadets, c'est plutôt du côté De Chateaubriand et d'un certain romantisme incantatoire et suranné, que lorgne l'écrivain national.
Il n'empêche que, même pour un lecteur d'aujourd'hui, le roman de Barrès ne manque pas d'intérêt. Centré sur un « lieu de mémoire » lorrain, la colline de Sion-Vaudémont, où les Celtes vénéraient Wotan et Rosmerta, et où la religion catholique a imposé le culte de la Vierge, « La colline inspirée » raconte le destin véridique de trois prêtres, les frères Baillard, bien décidés à en découdre avec le rationalisme façon Lumières. Ils restaurent le vieux sanctuaire, y organisent des pèlerinages, raniment la ferveur populaire… jusqu'au jour où ils croisent le chemin de Vintras, un illuminé comme il y en avait tant dans la seconde moitié du XIXè siècle : « … on ne rêvait que miracles et prophéties, raconte Barrès ; plusieurs voyants annoncèrent le règne de l'Antéchrist et la fin du monde ; d'autres, au contraire, le triomphe définitif du grand Roi et du grand Pape... »
Vintras est des premiers, qui prédit l'« année noire », la disparition d'une grande partie de l'humanité, sa régénération grâce aux prières d'une poignée d'élus… Pour les malheureux Baillard commence alors une longue descente aux enfers, qui va faire d'eux des parias : rejetés par leur hiérarchie et leurs paroissiens, puis excommuniés, ils sont bientôt réduits à prêcher dans le désert.
Au-delà de cette histoire, qui interroge les racines du sentiment religieux (cette soif d'irrationnel et de merveilleux qui forme le substrat de la ferveur populaire), ce que met en scène le roman de Barrès c'est la revendication d'un culte et d'une culture autochtones face à un dogme venu de Rome. Pour les lecteurs de 1913, cette opposition entre Gaulois et envahisseurs romains sonne bien sûr comme un vigoureux coup de clairon, alors qu'une partie de la Lorraine est encore occupée par une puissance étrangère...
Ce qui personnellement m'a le plus intéressé, ce sont moins ces débats d'un autre âge (et vaguement nauséabonds, disons-le) que la plongée quasi documentaire qu'offre ce roman dans la France de la seconde moitié du XIXè siècle ; une France villageoise, groupée autour de l'église et du curé (mais où le sorcier a encore son mot à dire), et vivant au rythme lent des attelages et des saisons.
Une curiosité, baignée par la lumière sépia des très anciennes photographies.
Faut-il, peut-on encore lire Maurice Barrès aujourd’hui ? La question se pose ; en tout cas, je la pose. Son plus célèbre roman « Les Déracinés », publié en 1897 (la même année que « Les Nourritures terrestres » de Gide), attire à peine quelques dizaines de lecteurs sur Babelio. Le jugement de l’histoire semble sévère…
Mais un nombre élevé d’entrés au Box-Office suffit-il pour faire d’un film un chef-d’œuvre ? Dans un scrutin, une majorité d’électeurs se portant sur un candidat est-elle la garantie d’une bonne gouvernance ? Une marée de lecteurs de Babelio annonce-t-elle un grand, un bon livre ? Poser la question, c’est déjà y répondre.
Pour autant, et aussi sévère soit-il, ce jugement est-il immérité ? Car les faits sont accablants pour cet auteur :
- d’abord, et c’est tant mieux, l’homme appartient à un passé qui est passé. Il fut une figure de proue de la vie politique française de la fin du XIXe siècle, en s’inscrivant dans une droite anti-républicaine, anti-dreyfusarde, bonapartiste et nationale. Bref, le type parfait du réactionnaire que l’Histoire avec un grand H a condamné (le préfacier de l’édition de poche Folio nous apprend même qu’en 1893, il chassait les électeurs de gauche avec comme mot d’ordre « socialisme, nationalisme, protectionnisme » !)
- ensuite, le thème du livre semble aller à contre-courant de notre époque qui valorise l’ouverture des frontières, la mobilité des individus et les échanges culturels. Par son enseignement d’un humanisme abstrait, un professeur de lycée, qui vient d’être muté en province, conduit un groupe de sept jeunes gens à quitter leur Lorraine natale pour aller chercher fortune à Paris. Ils vont tomber de Charybde en Scylla jusqu’au dénouement tragique. Malheur à ceux qui oublient leurs racines et se laissent transplanter, telle est la thèse développée et illustrée dans Les Déracinés. On mesure le décalage avec notre époque. « L’arbre a des racines, l’homme a des jambes, et c’est là un progrès immense », rétorque George Steiner. Qui n’aime pas Barrès. Et on peut le comprendre. La critique ne fut pas moins vive non plus de la part de Gide.
- enfin, j’ai trouvé quelques longueurs, qui desservent l’histoire.
Alors Barrès, à la poubelle comme tant d’autres ? Et bien, sans chercher à ramer à contre-courant (épuisant, n’est-ce pas ?), ni jouer l’avocat du Diable (car c’est le Diable, n’est-ce pas ?) je lui conserve malgré tout 3 étoiles Babelio sur 5 :
- en présence d’un écrivain engagé, il faut en premier lieu toujours resituer une œuvre dans son contexte historique. Barrès fut un réactionnaire, de surcroît antisémite, c’est entendu. Mais il fut l’un des plus brillants écrivains de son temps, « le prince de la jeunesse » a-t-on été jusqu’à le surnommer. Et son rôle historique, par son activité littéraire, fut reconnu par Léon Blum en personne. Pour ma part, j’ai toujours trouvé plus de substances et matière à réflexion chez les réac’ que parmi un grand nombre d’écrivains dits « progressistes ». « C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes », prétend le dicton ; et c’est aussi chez les vieux réac’ qu’on trouve les meilleures potées !
- ensuite, la question des racines des individus conserve toute son acuité et sa portée universelle. La boutade de George Steiner ne suffit pas à discréditer la tentative de Barrès pour appréhender cette question consubstantielle à la condition humaine. L’auteur a dénoncé le phénomène croissant des individus isolés, dissociés, qui ne s’assemblent plus que pour répondre aux exigences imprévisibles de forces économiques aveugles. Plus proche de nous, ce sujet a été brillamment étudié par la philosophe Simone Weil dans son livre « L’enracinement ». « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. » nous enseigne-t-elle. On le voit bien, la mondialisation n’est pas un long fleuve tranquille et le nomadisme actuel des personnes est plus contraint que volontairement partagé. Il faut s’échapper du discours dominant pour s’apercevoir que «Les Déracinés » ont en fait une résonance très contemporaine.
La doctrine du déracinement est faite pour les forts, elle supprime les faibles. La thèse inverse met au contraire en lumière l'importance de tout ce qui peut permettre à l'individu le maintien de son ancrage dans un environnement toujours précaire. Les premiers idéalisent un être humain aérien, les seconds insistent sur l'appartenance à un milieu.
Alors oui, malgré les réserves ci-dessus, avec les précautions d’usage et toute la distanciation requise, et même s’il ne s’agit pas d’un chef-d’œuvre, on peut encore lire avec profit et plaisir « Les Déracinés » de Maurice Barrès, au début du 21e siècle !
Mais un nombre élevé d’entrés au Box-Office suffit-il pour faire d’un film un chef-d’œuvre ? Dans un scrutin, une majorité d’électeurs se portant sur un candidat est-elle la garantie d’une bonne gouvernance ? Une marée de lecteurs de Babelio annonce-t-elle un grand, un bon livre ? Poser la question, c’est déjà y répondre.
Pour autant, et aussi sévère soit-il, ce jugement est-il immérité ? Car les faits sont accablants pour cet auteur :
- d’abord, et c’est tant mieux, l’homme appartient à un passé qui est passé. Il fut une figure de proue de la vie politique française de la fin du XIXe siècle, en s’inscrivant dans une droite anti-républicaine, anti-dreyfusarde, bonapartiste et nationale. Bref, le type parfait du réactionnaire que l’Histoire avec un grand H a condamné (le préfacier de l’édition de poche Folio nous apprend même qu’en 1893, il chassait les électeurs de gauche avec comme mot d’ordre « socialisme, nationalisme, protectionnisme » !)
- ensuite, le thème du livre semble aller à contre-courant de notre époque qui valorise l’ouverture des frontières, la mobilité des individus et les échanges culturels. Par son enseignement d’un humanisme abstrait, un professeur de lycée, qui vient d’être muté en province, conduit un groupe de sept jeunes gens à quitter leur Lorraine natale pour aller chercher fortune à Paris. Ils vont tomber de Charybde en Scylla jusqu’au dénouement tragique. Malheur à ceux qui oublient leurs racines et se laissent transplanter, telle est la thèse développée et illustrée dans Les Déracinés. On mesure le décalage avec notre époque. « L’arbre a des racines, l’homme a des jambes, et c’est là un progrès immense », rétorque George Steiner. Qui n’aime pas Barrès. Et on peut le comprendre. La critique ne fut pas moins vive non plus de la part de Gide.
- enfin, j’ai trouvé quelques longueurs, qui desservent l’histoire.
Alors Barrès, à la poubelle comme tant d’autres ? Et bien, sans chercher à ramer à contre-courant (épuisant, n’est-ce pas ?), ni jouer l’avocat du Diable (car c’est le Diable, n’est-ce pas ?) je lui conserve malgré tout 3 étoiles Babelio sur 5 :
- en présence d’un écrivain engagé, il faut en premier lieu toujours resituer une œuvre dans son contexte historique. Barrès fut un réactionnaire, de surcroît antisémite, c’est entendu. Mais il fut l’un des plus brillants écrivains de son temps, « le prince de la jeunesse » a-t-on été jusqu’à le surnommer. Et son rôle historique, par son activité littéraire, fut reconnu par Léon Blum en personne. Pour ma part, j’ai toujours trouvé plus de substances et matière à réflexion chez les réac’ que parmi un grand nombre d’écrivains dits « progressistes ». « C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes », prétend le dicton ; et c’est aussi chez les vieux réac’ qu’on trouve les meilleures potées !
- ensuite, la question des racines des individus conserve toute son acuité et sa portée universelle. La boutade de George Steiner ne suffit pas à discréditer la tentative de Barrès pour appréhender cette question consubstantielle à la condition humaine. L’auteur a dénoncé le phénomène croissant des individus isolés, dissociés, qui ne s’assemblent plus que pour répondre aux exigences imprévisibles de forces économiques aveugles. Plus proche de nous, ce sujet a été brillamment étudié par la philosophe Simone Weil dans son livre « L’enracinement ». « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. » nous enseigne-t-elle. On le voit bien, la mondialisation n’est pas un long fleuve tranquille et le nomadisme actuel des personnes est plus contraint que volontairement partagé. Il faut s’échapper du discours dominant pour s’apercevoir que «Les Déracinés » ont en fait une résonance très contemporaine.
La doctrine du déracinement est faite pour les forts, elle supprime les faibles. La thèse inverse met au contraire en lumière l'importance de tout ce qui peut permettre à l'individu le maintien de son ancrage dans un environnement toujours précaire. Les premiers idéalisent un être humain aérien, les seconds insistent sur l'appartenance à un milieu.
Alors oui, malgré les réserves ci-dessus, avec les précautions d’usage et toute la distanciation requise, et même s’il ne s’agit pas d’un chef-d’œuvre, on peut encore lire avec profit et plaisir « Les Déracinés » de Maurice Barrès, au début du 21e siècle !
La colline n'a inspiré que lui, j'ai abandonné au milieu, je n'ai rien compris! Ces histoires de curés de saints, de processions, c'était usant...Il y avait quelques fulgurances par moment, mais très vite on retombait avec toutes ces références à l'église...présenté comme son chef d'œuvre je ne suis pas poussé à lire autre chose de lui.
Un ami avait retenu comme plus grand livre du XIXème siècle Le Culte du Moi, lui qui, pour le XXème, attribuait ce prix aux Deux Etendards. Ayant aimé ce dernier ouvrage, j'étais intrigué de lire le premier, bien que partant avec certains a-priori sur Barrès : que sa plume était ampoulée, peu fine, politique.
Je ne vis pourtant rien de cela dans Le Culte du Moi. L'écriture est certes très poétique, fine et précise - et en ce sens les moins poètes de notre siècle et ses plus mauvais lecteurs y trouveront de l'emphase - pourtant le style sert le récit : une histoire très forte qui nous plonge dans la métaphysique d'un jeune homme, qui passe par l'égotisme le plus acharné au sentiment amoureux le plus subtil.
Un très grand roman, malheureusement méconnu et relativement difficile à trouver.
Je ne vis pourtant rien de cela dans Le Culte du Moi. L'écriture est certes très poétique, fine et précise - et en ce sens les moins poètes de notre siècle et ses plus mauvais lecteurs y trouveront de l'emphase - pourtant le style sert le récit : une histoire très forte qui nous plonge dans la métaphysique d'un jeune homme, qui passe par l'égotisme le plus acharné au sentiment amoureux le plus subtil.
Un très grand roman, malheureusement méconnu et relativement difficile à trouver.
Lu d’une traite, passionant tout du long! Ce prêtre qui par l’exaltation poétique(et disons le nationaliste) que lui procure la colline de Sion tombe dans la plus folle hérésie, n’est certes pas un personnage accessible aux rationalistes...Mais ceux qui savent vibrer aux chants lyriques, dont Barrès est un maître, ne pourront que tressaillir devant les aventures de cette âme puissante, déchue et touchante. Le premier et le dernier chapitre sont particulierement magnifiques, et délivre une profonde sagesse qui reste plus que jamais d’actualité: la necessité d’unir à l’extravagante inspiration qui nous vient de la terre sauvage la discipline raisonnable de nos pères. Encore un chef d’oeuvre tombé indignement dans l’oubli, et dont j’ai appris l’existence grâce à un notoire facho: Mitterand! Il en parle en effet avec admiration dans son passage à Apostrophe, et on comprends alors d’où vient sa fameuse confession: « je crois aux forces de l’esprit »...
« Il est des lieux qui tirent l’âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l’émotion religieuse. »
Lorsqu’un roman commence comme ceci, on se dit, sans trop s’avancer, qu’il est plein de promesses…Promesses tenues.
Qu’est-ce que cette colline mystique, si convoitée par les hommes de foi depuis la nuit des temps, sinon un symbole de l’élévation vers Dieu, peu importent les chemins de traverse parcourus pour y accéder ?
La Colline inspirée, c’est effectivement une affaire de ferveur religieuse qui conduit un homme de Dieu – Léopold Baillard – à rétablir la grandeur de cette colline abandonnée, s’aidant pour ce faire de méthodes peu orthodoxes qui ne plaisent pas à la hiérarchie ecclésiastique. Il se fourvoiera même dans un illuminisme inspiré par un certain Vintras, mais pour autant ne trichera jamais avec sa ferveur mystique, accompagné de fidèles qui se réduiront comme peau de chagrin. Grandeur et décadence seront le lot de Léopold qui, à la toute fin, déposera les armes face à l’Église officielle...en apparence sûrement.
Un destin qui pose une question cruciale : la foi précède-t-elle le dogme ou ce dernier est-il la condition sine qua non pour y accéder ?
Dans un style limpide, entrecoupé d’envolées lyriques savoureuses pour qui aime lire du texte à défaut de le consommer, l’auteur narre donc cette illumination, dans une atmosphère sombre et inquiète car : « Il y a des sujets qui sont des gouffres », confiait l’auteur.
Bien entendu, il se trouvera toujours de vertueux détracteurs de Maurice Barrès, mus par un goût immodéré de la chasse aux sorcières et oubliant qu’il arrive parfois qu’une œuvre ne vaille que pour elle-même et pas ce que pense son auteur. Un peu de structuralisme ne fait parfois pas de mal. Barrès était-il un extrémiste ? Je me garderai, pour ma part, de répondre à cette question simpliste à seule fin de satisfaire la nouvelle morale. Pour autant il savait manier superbement la langue français et s’en priver, au motif que ses opinions ne correspondent pas aux canons d’une élite bien-pensante, relève du ridicule achevé !
Lorsqu’un roman commence comme ceci, on se dit, sans trop s’avancer, qu’il est plein de promesses…Promesses tenues.
Qu’est-ce que cette colline mystique, si convoitée par les hommes de foi depuis la nuit des temps, sinon un symbole de l’élévation vers Dieu, peu importent les chemins de traverse parcourus pour y accéder ?
La Colline inspirée, c’est effectivement une affaire de ferveur religieuse qui conduit un homme de Dieu – Léopold Baillard – à rétablir la grandeur de cette colline abandonnée, s’aidant pour ce faire de méthodes peu orthodoxes qui ne plaisent pas à la hiérarchie ecclésiastique. Il se fourvoiera même dans un illuminisme inspiré par un certain Vintras, mais pour autant ne trichera jamais avec sa ferveur mystique, accompagné de fidèles qui se réduiront comme peau de chagrin. Grandeur et décadence seront le lot de Léopold qui, à la toute fin, déposera les armes face à l’Église officielle...en apparence sûrement.
Un destin qui pose une question cruciale : la foi précède-t-elle le dogme ou ce dernier est-il la condition sine qua non pour y accéder ?
Dans un style limpide, entrecoupé d’envolées lyriques savoureuses pour qui aime lire du texte à défaut de le consommer, l’auteur narre donc cette illumination, dans une atmosphère sombre et inquiète car : « Il y a des sujets qui sont des gouffres », confiait l’auteur.
Bien entendu, il se trouvera toujours de vertueux détracteurs de Maurice Barrès, mus par un goût immodéré de la chasse aux sorcières et oubliant qu’il arrive parfois qu’une œuvre ne vaille que pour elle-même et pas ce que pense son auteur. Un peu de structuralisme ne fait parfois pas de mal. Barrès était-il un extrémiste ? Je me garderai, pour ma part, de répondre à cette question simpliste à seule fin de satisfaire la nouvelle morale. Pour autant il savait manier superbement la langue français et s’en priver, au motif que ses opinions ne correspondent pas aux canons d’une élite bien-pensante, relève du ridicule achevé !
Colette Baudoche est un hymne à la résistance "passive" (silencieuse et invisible) des messins d'origine française après l'annexion de la Lorraine par les Allemands (1870). Maurice Barrés y décrit le quotidien d'un jeune professeur allemand, Frédéric Asmus, nouvellement arrivé à Metz. Locataire chez Madame Baudoche et sa petite-fille Colette, il va se familiariser en leur compagnie au mode de vie français et à sa langue tout en plaçant peu à peu les messins sur un piédestal dont son amour pour Colette sera l'incarnation. Cette trame principale n'est en réalité qu'un prétexte servant à l'auteur pour dresser une caricature de l'occupant, de ses mœurs et de critiquer ses apports dans le paysage urbain et sa politique d'assimilation des vaincus à la cause allemande. Parallèlement, Maurice Barrés glorifie la résistance et la fidélité des messins à leurs racines françaises.
Ce qui m'a principalement intéressée dans ce roman sont les descriptions du paysage urbain alors en pleine mutation (démolition des remparts, création du nouveau quartier allemand, modification de l'Esplanade...) et les impressions de chaque personnage sur ce bouleversement. Celles-ci même si elles sont exagérées, et parfois poussées à l'extrême, témoignent d'une certaine manière des réactions que purent avoir les Lorrains à cette époque.
L'auteur décrit également des éléments qui ont en partie disparu aujourd'hui mais qui subsistent dans les mémoires ou le paysage. La vie quotidienne était rythmée par les cloches de la Tour de Mutte, beffroi municipal, avec Melle de Turmel sonnant le couvre-feu ou la cloche Mutte sonnant les grands événements civils comme l'entrée de Guillaume II dans la ville. Il décrit aussi la campagne messine avec ses jardins fruitiers et ses vignes, le jardin d'Amour aujourd'hui remplacé par le temple protestant....
Lecteur averti et amateur du passé de Metz, ce livre est fait pour vous car il recèle des descriptions urbaines parfois très intéressantes malgré le discours largement pro-lorrain du roman.
Ce qui m'a principalement intéressée dans ce roman sont les descriptions du paysage urbain alors en pleine mutation (démolition des remparts, création du nouveau quartier allemand, modification de l'Esplanade...) et les impressions de chaque personnage sur ce bouleversement. Celles-ci même si elles sont exagérées, et parfois poussées à l'extrême, témoignent d'une certaine manière des réactions que purent avoir les Lorrains à cette époque.
L'auteur décrit également des éléments qui ont en partie disparu aujourd'hui mais qui subsistent dans les mémoires ou le paysage. La vie quotidienne était rythmée par les cloches de la Tour de Mutte, beffroi municipal, avec Melle de Turmel sonnant le couvre-feu ou la cloche Mutte sonnant les grands événements civils comme l'entrée de Guillaume II dans la ville. Il décrit aussi la campagne messine avec ses jardins fruitiers et ses vignes, le jardin d'Amour aujourd'hui remplacé par le temple protestant....
Lecteur averti et amateur du passé de Metz, ce livre est fait pour vous car il recèle des descriptions urbaines parfois très intéressantes malgré le discours largement pro-lorrain du roman.
Il faut lire ce chef d’oeuvre, qui résume toute son époque et eut dessus une influence capitale, et qui est très injustement oublié aujourd’hui à cause du prétendu proto-fascisme de l’écrivain(admiré par pourtant à peu près tout le monde intellectuel d’alors-à part Gide, qui contribua a forger sa mauvaise réputation-, et en politique notamment par Léon Blum, qui l’a loué jusqu’à le considérer comme plus grand que Zola, étonnante préférence de la part de ce grand socialiste...). C’est peut-être moins un roman qu’une analyse à tous les niveaux, mais le style exceptionnel le sauve même pour ceux hostiles à ses idées(en particulier lors de la description sublime de l’enterrement de Victor Hugo.)
Désigné en 1950 comme l’un des 12 lauréats du « grand prix des Meilleurs romans du demi-siècle », La colline inspirée de Maurice Barrès est tombé de nos jours dans l’oubli, en témoigne l’impossibilité de trouver une édition neuve. Cela est bien dommage. Qualifié de « bouleversant » par Marguerite Yourcenar, le roman s’inspire de l’histoire réelle de trois religieux, les frères Baillard, qui se sont évertués à mettre en valeur la colline de Sion-Vaudémont, en Lorraine, avant d’être excommuniés de l’Eglise. C’est surtout un roman très poétique, où transparaît l’amour de Barrès pour la Lorraine mais aussi son attachement au christianisme.
"Une volonté a marqué ici la terre ; un cachet s’est enfoncé dans la cire."
Maurice Barrès a été l’un des écrivains majeurs de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle. Figure de la droite traditionnaliste, anti-dreyfusard, il fut même député boulangiste et a participé à la tentative de coup d’Etat de Déroulède en 1899. Dans la préface rédigée par Marie-Pierre Blancquart dans la présente édition, il est rappelé que le nationalisme et l’antisémitisme sont certes deux aspects de Barrès, mais pas les seuls ; c’est un romantique, un enraciné. Les thèmes développés dans La colline inspirée le corroborent.
Avant de parler du livre, arrêtons-nous aussi sur cette colline de Sion-Vaudémont qui, située à environ 30 km au sud de Nacy, offre un joli point de vue sur le plateau lorrain environnant. Considéré comme l’un des lieux du tourisme lorrain, doté depuis le 17ème siècle d’un pélerinage marial, la colline inspire à Maurice Barrès un grand nombre de très jolis passages du livre, à l’image de celui-ci :
"L’horizon qui cerne cette plaine, c’est celui qui cerne toute vie ; il donne une place d’honneur à notre soif d’infini, en même temps qu’il nous rappelle nos limites."
C’est justement cette citation que l’on peut dire sur l’un des quatre côtés de base du monument à Barrès, érigé en 1928 sur la Colline de Sion. Et à la lecture du roman, on se dit que la façon dont l’écrivain célèbre ce lieu méritait en effet que son souvenir y soit inscrit.
"Il est des lieux qui tirent l’âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l’émotion religieuse. (…) Illustres ou inconnus, oubliés ou à naître, de tels lieux nous entraînent, nous font admettre insensiblement un ordre de faits supérieurs à ceux où tourne à l’ordinaire notre vie. (…) Il y a des lieux où souffle l’esprit. (…) La Lorraine possède un de ces lieux inspirés. C’est la colline de Sion-Vaudémont, faible éminence sur une terre la plus usée de France, sorte d’autel dressé au milieu du plateau qui va des falaises champenoises jusqu’à la chaîne des Vosges."
Le passage ci-dessus (dont le célèbre « il y a des lieux où souffle l’esprit ») est extrait du début du livre et nous emmène donc sur la colline de Sion, dont le pélerinage était tombé en désuétude depuis la Révolution française et que trois prêtres (les frères Baillard : Léopold, François et Quirin) vont rétablir. C’est donc une histoire vraie qui est à la base du roman, mais une histoire que Barrès va magnifier par sa plume :
"Voici ce livre, tel qu’il est sorti d’une infinie méditation au grand air, en toute liberté, d’une complète soumission aux influences de la colline sainte, et puis d’une étude méthodique des documents les plus rebutants. (…) J’ai surpris la poésie au moment où elle s’élève comme une brume des terres solides du réel."
Les frères Baillard restaurent des bâtiments d’Eglise, réimplantent des religieux dans les environs de, et sur la colline ; prenant certaines libertés dans leur action, ils sont rattrapés par leur hiérarchie et « leur entreprise » fait faillite en 1848. A l’occasion d’une retraite religieuse imposée par l’évêque, Léopold entend parler de la doctrine de Vintras, l’Oeuvre de la Miséricorde, et part le rejoindre en Normandie, avant de développer ce culte à Sion. Prophète, escroc, hérétique ? Quoi qu’il en soit, les frères Baillard finissent par être excommuniés par l’Église, et doivent s’exiler.
Si l’on analyse froidement cette affaire, on se dit que c’est l’histoire d’une hérésie et que les frères Baillard étaient, à l’image de Vintras et ses hosties ensanglantées, des illuminés. Il n’en est rien : que ce soit dans leur ascension et dans leur superbe d’avant 1848, dans leur pratique « vintrasienne », ou plus encore dans la chute qui les entraîne dans le dénuement, on ne peut que s’attacher qu’à Léopold, à sa sincérité. C’est le mérite de l’écriture de Barrès de générer cette empathie et cette émotion ; il sublime le personnage, d’autant plus en comparaison un ordre religieux « froid » ou vengeur, ou des habitants médiocres qui conspuent les Baillard. Voici également la façon dont il décrit les dernières années du prêtre, âgé alors de plus de 80 ans :
"Ces interminables divagations mortuaires où le vieux pontife s’égarait, plus fréquentes à mesure qu’il cédait à l’assoupissement du grand âge, qui pourrait nous en donner la clef ? Il y laisse abîmer sa raison. Il ne fournit plus rien au monde et n’accueille plus rien du monde, sinon le souffle des tempêtes dans sa cime. Par son seul tronc, il fait encore l’effet le plus imposant, mais il a passé la saison des feuilles. Les tempêtes l’ont ébranché ; nul oiseau, même d’hiver, ne vient se reposer sur lui, et la seule touffe verdoyante qu’il tende vers le ciel, c’est, comme un bouquet de gui parasitaire, la pensée vintrasienne. Dans cette intelligence entourée de brumes, quelques souvenirs, toujours les mêmes, passent à de longs intervalles, rappelant ces vols de buses qui, sous un ciel neigeux, s’élèvent des taillis de la côte, y reviennent, en repartent, obéissent à quelque rythme indiscernable."
Enfin, on perçoit l’attachement de Barrès au christianisme ; pas uniquement à celui de l’ordre représenté par l’évêque, mais à une synthèse entre l’enthousiasme de liberté religieuse (dans ce cas, Léopold) la hiérarchie de l’Eglise :
"Qu’est-ce qu’un enthousiasme qui demeure une fantaisie individuelle ? Qu’est-ce qu’un ordre qu’aucun enthousiasme ne vient plus animer ?"
Ce fut pour moi une très belle lecture, de celle qui laisse une trace. Je vous invite donc à vous plonger sans plus attendre dans ce livre et à profiter d’un voyage en Lorraine pour aller humer l’esprit qui anime la colline de Sion !
Lien : https://evabouquine.wordpres..
"Une volonté a marqué ici la terre ; un cachet s’est enfoncé dans la cire."
Maurice Barrès a été l’un des écrivains majeurs de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle. Figure de la droite traditionnaliste, anti-dreyfusard, il fut même député boulangiste et a participé à la tentative de coup d’Etat de Déroulède en 1899. Dans la préface rédigée par Marie-Pierre Blancquart dans la présente édition, il est rappelé que le nationalisme et l’antisémitisme sont certes deux aspects de Barrès, mais pas les seuls ; c’est un romantique, un enraciné. Les thèmes développés dans La colline inspirée le corroborent.
Avant de parler du livre, arrêtons-nous aussi sur cette colline de Sion-Vaudémont qui, située à environ 30 km au sud de Nacy, offre un joli point de vue sur le plateau lorrain environnant. Considéré comme l’un des lieux du tourisme lorrain, doté depuis le 17ème siècle d’un pélerinage marial, la colline inspire à Maurice Barrès un grand nombre de très jolis passages du livre, à l’image de celui-ci :
"L’horizon qui cerne cette plaine, c’est celui qui cerne toute vie ; il donne une place d’honneur à notre soif d’infini, en même temps qu’il nous rappelle nos limites."
C’est justement cette citation que l’on peut dire sur l’un des quatre côtés de base du monument à Barrès, érigé en 1928 sur la Colline de Sion. Et à la lecture du roman, on se dit que la façon dont l’écrivain célèbre ce lieu méritait en effet que son souvenir y soit inscrit.
"Il est des lieux qui tirent l’âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l’émotion religieuse. (…) Illustres ou inconnus, oubliés ou à naître, de tels lieux nous entraînent, nous font admettre insensiblement un ordre de faits supérieurs à ceux où tourne à l’ordinaire notre vie. (…) Il y a des lieux où souffle l’esprit. (…) La Lorraine possède un de ces lieux inspirés. C’est la colline de Sion-Vaudémont, faible éminence sur une terre la plus usée de France, sorte d’autel dressé au milieu du plateau qui va des falaises champenoises jusqu’à la chaîne des Vosges."
Le passage ci-dessus (dont le célèbre « il y a des lieux où souffle l’esprit ») est extrait du début du livre et nous emmène donc sur la colline de Sion, dont le pélerinage était tombé en désuétude depuis la Révolution française et que trois prêtres (les frères Baillard : Léopold, François et Quirin) vont rétablir. C’est donc une histoire vraie qui est à la base du roman, mais une histoire que Barrès va magnifier par sa plume :
"Voici ce livre, tel qu’il est sorti d’une infinie méditation au grand air, en toute liberté, d’une complète soumission aux influences de la colline sainte, et puis d’une étude méthodique des documents les plus rebutants. (…) J’ai surpris la poésie au moment où elle s’élève comme une brume des terres solides du réel."
Les frères Baillard restaurent des bâtiments d’Eglise, réimplantent des religieux dans les environs de, et sur la colline ; prenant certaines libertés dans leur action, ils sont rattrapés par leur hiérarchie et « leur entreprise » fait faillite en 1848. A l’occasion d’une retraite religieuse imposée par l’évêque, Léopold entend parler de la doctrine de Vintras, l’Oeuvre de la Miséricorde, et part le rejoindre en Normandie, avant de développer ce culte à Sion. Prophète, escroc, hérétique ? Quoi qu’il en soit, les frères Baillard finissent par être excommuniés par l’Église, et doivent s’exiler.
Si l’on analyse froidement cette affaire, on se dit que c’est l’histoire d’une hérésie et que les frères Baillard étaient, à l’image de Vintras et ses hosties ensanglantées, des illuminés. Il n’en est rien : que ce soit dans leur ascension et dans leur superbe d’avant 1848, dans leur pratique « vintrasienne », ou plus encore dans la chute qui les entraîne dans le dénuement, on ne peut que s’attacher qu’à Léopold, à sa sincérité. C’est le mérite de l’écriture de Barrès de générer cette empathie et cette émotion ; il sublime le personnage, d’autant plus en comparaison un ordre religieux « froid » ou vengeur, ou des habitants médiocres qui conspuent les Baillard. Voici également la façon dont il décrit les dernières années du prêtre, âgé alors de plus de 80 ans :
"Ces interminables divagations mortuaires où le vieux pontife s’égarait, plus fréquentes à mesure qu’il cédait à l’assoupissement du grand âge, qui pourrait nous en donner la clef ? Il y laisse abîmer sa raison. Il ne fournit plus rien au monde et n’accueille plus rien du monde, sinon le souffle des tempêtes dans sa cime. Par son seul tronc, il fait encore l’effet le plus imposant, mais il a passé la saison des feuilles. Les tempêtes l’ont ébranché ; nul oiseau, même d’hiver, ne vient se reposer sur lui, et la seule touffe verdoyante qu’il tende vers le ciel, c’est, comme un bouquet de gui parasitaire, la pensée vintrasienne. Dans cette intelligence entourée de brumes, quelques souvenirs, toujours les mêmes, passent à de longs intervalles, rappelant ces vols de buses qui, sous un ciel neigeux, s’élèvent des taillis de la côte, y reviennent, en repartent, obéissent à quelque rythme indiscernable."
Enfin, on perçoit l’attachement de Barrès au christianisme ; pas uniquement à celui de l’ordre représenté par l’évêque, mais à une synthèse entre l’enthousiasme de liberté religieuse (dans ce cas, Léopold) la hiérarchie de l’Eglise :
"Qu’est-ce qu’un enthousiasme qui demeure une fantaisie individuelle ? Qu’est-ce qu’un ordre qu’aucun enthousiasme ne vient plus animer ?"
Ce fut pour moi une très belle lecture, de celle qui laisse une trace. Je vous invite donc à vous plonger sans plus attendre dans ce livre et à profiter d’un voyage en Lorraine pour aller humer l’esprit qui anime la colline de Sion !
Lien : https://evabouquine.wordpres..
Il est des auteurs à la plume notoirement lumineuse qu'on se retient de lire par désaccord avec leurs idées. Pour ne pas mourir idiote et être passée à côté des génies de la littérature, on se fait violence. Maurice Barrès fait partie du lot et j'ai entamé son œuvre avec Un jardin sur l'Oronte.
L'écriture est effectivement parfaite, la maîtrise de la langue française est totale, le Français de Barrès est souple, naturel, cristallin. Le code civil ou l'annuaire du Maine-et-Loire (remplacez par le département que vous voulez) doivent devenir lisible réécrit par Maurice Barrès. Pourquoi alors raconter avec un tel talent une histoire aussi peu signifiante ? Un chevalier chrétien du XIIIe siècle s'éprend de l'épouse d'un émir ; différentes péripéties vont les réunir ou les éloigner.
L'histoire d'amour est ici dissymétrique : le chevalier est preux, naïf et pieux quand la dame est manipulatrice, intéressée, versatile et tentatrice. Même si on admet que l'amour est sincère et réciproque, vous avez compris que la femme a le mauvais rôle, celui d'une créature maligne pour ne pas dire diabolique. Si ce conte a fait scandale à sa sortie, il apparaît aujourd'hui comme très conservateur.
Je persévérerai néanmoins avec La colline inspirée ...
L'écriture est effectivement parfaite, la maîtrise de la langue française est totale, le Français de Barrès est souple, naturel, cristallin. Le code civil ou l'annuaire du Maine-et-Loire (remplacez par le département que vous voulez) doivent devenir lisible réécrit par Maurice Barrès. Pourquoi alors raconter avec un tel talent une histoire aussi peu signifiante ? Un chevalier chrétien du XIIIe siècle s'éprend de l'épouse d'un émir ; différentes péripéties vont les réunir ou les éloigner.
L'histoire d'amour est ici dissymétrique : le chevalier est preux, naïf et pieux quand la dame est manipulatrice, intéressée, versatile et tentatrice. Même si on admet que l'amour est sincère et réciproque, vous avez compris que la femme a le mauvais rôle, celui d'une créature maligne pour ne pas dire diabolique. Si ce conte a fait scandale à sa sortie, il apparaît aujourd'hui comme très conservateur.
Je persévérerai néanmoins avec La colline inspirée ...
Un homme libre est le deuxième volume de la trilogie de Barrès consacrée au Culte du Moi. Une œuvre faite pour exalter l’Individualité, et qui a donc prit la forme la plus égotiste qui soit : celle du journal.
Le narrateur relate plusieurs étapes de sa vie intérieure qui se concrétisent par autant de voyages. D’abord, il part se réfugier avec son ami Simon dans sa Lorraine natale pour échapper à la mesquinerie du monde et analyser à loisir les mouvements de son âme. Mais plongé dans une tristesse accablante, il décide de visiter Venise, qui lui redonne goût à la vie. Il retourne ensuite à Paris, où il a une brève liaison qui se finit mal. Alors il se rend sur la côte d’azur pour soigner sa mélancolie, puis revient définitivement à Paris, prêt à affronter le monde.
Racontée ainsi, cette histoire peut paraître d’une banalité affligeante. Pourtant, elle est soutenue par une pensée très vigoureuse et relativement étonnante pour un jeune homme, puisque Barrès l’a écrit autour de sa vingt-cinquième année. Il part d’un sentiment assez commun aux écrivains de la fin du dix-neuvième siècle, en particulier aux écrivains catholiques : la tentation de se couper du monde et de s’enfermer dans un cloître. C’est bien la vulgarité de ses contemporains qui le pousse à se réfugier d’abord dans son Moi, ensuite à Saint-Germain, en Lorraine. Mais, alors que ses aînés du siècle précédent, se sont arrêtés là, éteignant tout espoir, sous-entendant que cette fois c’était bien fini, qu’il n’y avait plus rien à attendre que la décadence toujours plus profonde des mœurs, Barrès ouvre une porte sur le vingtième siècle. Cette porte, c’est celle de l’idéologie. Même si elle n’est pas vraiment encore tout à fait systématisée dans ce livre, on peut se rendre compte que Barrès utilise un certain vocabulaire. Pour évoquer cet Autre qui assaille son Moi, il parle de « barbares », et il les assimile à tous les étrangers qui ont soumis son peuple, la « race lorraine ». Mais je le répète, dans Un homme libre, on ne retrouve de l’idéologie nationaliste que la terminologie, la place prépondérante reste celle du Moi. Pourtant, même si cela n’est qu’anecdotique dans ce livre, c’est intéressant de voir la manière avec laquelle Barrès passe si facilement du Moi à une certaine communauté, une « race ». Cette manière c’est une sorte de magie de l’esprit : l’analogie.
Bref, Barrès n’est pas autant accablé par la solitude que d’autres écrivains du dix-neuvième siècle, il a un fort sentiment d’appartenir à une forme de communauté à travers les âges, un Etre, une civilisation, dont son Moi n’est qu’une petite partie. Et pour retourner l’analogie, ce Moi est lui aussi traversé par de multiples émotions, parfois contradictoires, qui le sauvent également du désespoir, de la sécheresse des sentiments. Car toutes ces émotions sont les chemins qu’aime parcourir Barrès et tant pis si elles ne le mènent nulle part, car « Les désirs, les ardeurs, les aspirations sont tout ; le but rien. »
En résumé, une écriture savante mais très sobre, sans emportement, avec juste ce qu’il faut de philosophie, de culture et d’art. Un livre plein de réflexions et d’auto-analyses étrangement froides, non sans paradoxes.
Le narrateur relate plusieurs étapes de sa vie intérieure qui se concrétisent par autant de voyages. D’abord, il part se réfugier avec son ami Simon dans sa Lorraine natale pour échapper à la mesquinerie du monde et analyser à loisir les mouvements de son âme. Mais plongé dans une tristesse accablante, il décide de visiter Venise, qui lui redonne goût à la vie. Il retourne ensuite à Paris, où il a une brève liaison qui se finit mal. Alors il se rend sur la côte d’azur pour soigner sa mélancolie, puis revient définitivement à Paris, prêt à affronter le monde.
Racontée ainsi, cette histoire peut paraître d’une banalité affligeante. Pourtant, elle est soutenue par une pensée très vigoureuse et relativement étonnante pour un jeune homme, puisque Barrès l’a écrit autour de sa vingt-cinquième année. Il part d’un sentiment assez commun aux écrivains de la fin du dix-neuvième siècle, en particulier aux écrivains catholiques : la tentation de se couper du monde et de s’enfermer dans un cloître. C’est bien la vulgarité de ses contemporains qui le pousse à se réfugier d’abord dans son Moi, ensuite à Saint-Germain, en Lorraine. Mais, alors que ses aînés du siècle précédent, se sont arrêtés là, éteignant tout espoir, sous-entendant que cette fois c’était bien fini, qu’il n’y avait plus rien à attendre que la décadence toujours plus profonde des mœurs, Barrès ouvre une porte sur le vingtième siècle. Cette porte, c’est celle de l’idéologie. Même si elle n’est pas vraiment encore tout à fait systématisée dans ce livre, on peut se rendre compte que Barrès utilise un certain vocabulaire. Pour évoquer cet Autre qui assaille son Moi, il parle de « barbares », et il les assimile à tous les étrangers qui ont soumis son peuple, la « race lorraine ». Mais je le répète, dans Un homme libre, on ne retrouve de l’idéologie nationaliste que la terminologie, la place prépondérante reste celle du Moi. Pourtant, même si cela n’est qu’anecdotique dans ce livre, c’est intéressant de voir la manière avec laquelle Barrès passe si facilement du Moi à une certaine communauté, une « race ». Cette manière c’est une sorte de magie de l’esprit : l’analogie.
Bref, Barrès n’est pas autant accablé par la solitude que d’autres écrivains du dix-neuvième siècle, il a un fort sentiment d’appartenir à une forme de communauté à travers les âges, un Etre, une civilisation, dont son Moi n’est qu’une petite partie. Et pour retourner l’analogie, ce Moi est lui aussi traversé par de multiples émotions, parfois contradictoires, qui le sauvent également du désespoir, de la sécheresse des sentiments. Car toutes ces émotions sont les chemins qu’aime parcourir Barrès et tant pis si elles ne le mènent nulle part, car « Les désirs, les ardeurs, les aspirations sont tout ; le but rien. »
En résumé, une écriture savante mais très sobre, sans emportement, avec juste ce qu’il faut de philosophie, de culture et d’art. Un livre plein de réflexions et d’auto-analyses étrangement froides, non sans paradoxes.
Léopold Baillard est un prêtre ambitieux. Il rêve de construire un temple sur sa chère colline de Lorraine, un lieu de pélerinage, dont il serait le maître, et où les pélerins écouteraient ses prêches, renforceraient leur foi: un sanctuaire à la gloire de Dieu. Dans un premier temps, il y parviendra. Mais ses excès, son orgueil, et quelques erreurs, l'éloigneront de la ligne officielle de l'Eglise, et il deviendra, d'abord malgré lui, et ensuite de manière assumée, un déviant par rapport à l'institution et aux dogmes officiels, ce qui le conduira même à se rapprocher de Vintras, qui lui, était clairement un escroc, meneur d'une ligue sectaire sous prétexte de foi. Et l'on assistera à la chute du prêtre, à l'effondrement de son oeuvre, à son exclusion de l'Eglise, lui, si sûr de sa foi. La fin du livre sera consacrée à sa vieillesse, isolée et triste.
Le sujet est magnifiquement traité. Le personnage est fort, le pays de Lorraine est là, formidablement décrit: l'auteur maîtrise son sujet et la forme choisie. Ce livre, appartenant à la liste des 10 meilleurs romans de la 1° moitié du XX° siècle, - mais ce n'est pas un roman, puisque l'homme et sont histoire sont bien réels - mérite incontestablement son statut: on n'est pas loin des sommets de la littérature.
Le sujet est magnifiquement traité. Le personnage est fort, le pays de Lorraine est là, formidablement décrit: l'auteur maîtrise son sujet et la forme choisie. Ce livre, appartenant à la liste des 10 meilleurs romans de la 1° moitié du XX° siècle, - mais ce n'est pas un roman, puisque l'homme et sont histoire sont bien réels - mérite incontestablement son statut: on n'est pas loin des sommets de la littérature.
En Lorraine, un professeur, M. Bouteiller, met dans la tête de ses élèves l’idée d’élévation dans leur vie. Il s’en va ensuite vers d’autres cieux et un groupe parmi ces élèves – de différentes conditions sociales, cela a son importance – monte à Paris pour y poursuivre, avec des fortunes diverses, ses études et rencontrer son destin. Élèves qui seront des déracinés, favorisés pour certains et pas pour d’autres, faisant mentir l’idée kantienne rappelée par l’auteur : « Si l’individu doit servir la collectivité, celle-ci doit servir l’individu. » Mais l’esprit de caste sociale supplante aisément des amitiés superficielles.
Dès lors, ces provinciaux, après quelques tâtonnements dans la vie parisienne avec des succès divers, scelleront un pacte devant le tombeau de Napoléon, ce « professeur d’énergie » près duquel ils viennent chercher un sens à leur existence : « Cette mystérieuse réunion présente les caractères d’une transfiguration. » Sauf que les individualités auront raison de cette exaltation collective, et les plus humbles subiront le joug de leur condition quand les autres s’en sortiront mieux.
On pourrait y voir là un certain déterminisme mais j’y vois plus, pour ma part, l’effet du déracinement, l’opposition entre le mirage parisien, qui ne convient pas à tous, et la réalité solide de la terre d’origine. N’est-ce pas là le reproche que le père d’un de ces jeunes adresse à son fils empêtré dans ses dettes, tandis qu’il aurait pu mener une vie solide au pays ? Ce roman serait aussi la théorie à l’épreuve du réel, étant entendu que : « Nos vaines prétentions sont une des parties les plus réelles de notre être. »
Barrès signe ici un roman d’initiation sous la jeune Troisième République. Tantôt laissant le fil de la narration se dérouler, tantôt focalisant sur une situation, l’auteur – qu’il est de bon ton, de nos jours, d’invectiver sans jamais l’avoir lu ! – creuse ses personnages dans les moindres recoins pour en extraire des généralités fortes. Car, « pour qui cherche à juger avec moralité, c’est un bon système de se dégager de l’accidentel et de se placer à un point de vue éternel ».
Mais à la fin, après un tremblement terrible, après la mort et les obsèques d’un géant – Victor Hugo, « le chef mystique, le voyant moderne » – les déchets de ce groupe de jeunes Lorrains idéalistes sont rejetés et tout rentre dans l’ordre. Quant au professeur Bouteiller – qui fait de loin en loin songer à la « gloire » finale du pharmacien Homais de Madame Bovary –, par sa réussite politique, il répond exactement à cette phrase du roman : « On n’atteint un but qu’en subissant les conditions du terrain à parcourir. »
Enfin, le récit de Barrès nous amène inévitablement à cette question fondamentale : le déracinement ne serait-il pas cause de bien des maux et des désordres ? L’auteur, enraciné dans la France quant à lui, y répond à sa manière. Un auteur qui écrit encore : « On met le désordre dans notre pays par l’importation de vérités exotiques »…
Dès lors, ces provinciaux, après quelques tâtonnements dans la vie parisienne avec des succès divers, scelleront un pacte devant le tombeau de Napoléon, ce « professeur d’énergie » près duquel ils viennent chercher un sens à leur existence : « Cette mystérieuse réunion présente les caractères d’une transfiguration. » Sauf que les individualités auront raison de cette exaltation collective, et les plus humbles subiront le joug de leur condition quand les autres s’en sortiront mieux.
On pourrait y voir là un certain déterminisme mais j’y vois plus, pour ma part, l’effet du déracinement, l’opposition entre le mirage parisien, qui ne convient pas à tous, et la réalité solide de la terre d’origine. N’est-ce pas là le reproche que le père d’un de ces jeunes adresse à son fils empêtré dans ses dettes, tandis qu’il aurait pu mener une vie solide au pays ? Ce roman serait aussi la théorie à l’épreuve du réel, étant entendu que : « Nos vaines prétentions sont une des parties les plus réelles de notre être. »
Barrès signe ici un roman d’initiation sous la jeune Troisième République. Tantôt laissant le fil de la narration se dérouler, tantôt focalisant sur une situation, l’auteur – qu’il est de bon ton, de nos jours, d’invectiver sans jamais l’avoir lu ! – creuse ses personnages dans les moindres recoins pour en extraire des généralités fortes. Car, « pour qui cherche à juger avec moralité, c’est un bon système de se dégager de l’accidentel et de se placer à un point de vue éternel ».
Mais à la fin, après un tremblement terrible, après la mort et les obsèques d’un géant – Victor Hugo, « le chef mystique, le voyant moderne » – les déchets de ce groupe de jeunes Lorrains idéalistes sont rejetés et tout rentre dans l’ordre. Quant au professeur Bouteiller – qui fait de loin en loin songer à la « gloire » finale du pharmacien Homais de Madame Bovary –, par sa réussite politique, il répond exactement à cette phrase du roman : « On n’atteint un but qu’en subissant les conditions du terrain à parcourir. »
Enfin, le récit de Barrès nous amène inévitablement à cette question fondamentale : le déracinement ne serait-il pas cause de bien des maux et des désordres ? L’auteur, enraciné dans la France quant à lui, y répond à sa manière. Un auteur qui écrit encore : « On met le désordre dans notre pays par l’importation de vérités exotiques »…
En 1879 sept jeunes hommes affamés de gloire, galvanisés qu'il furent par les discours d'un professeur kantien et gambettiste, quittèrent leur Lorraine natale pour s'en aller à la conquête de Paris. C'est donc dans les pas d' Eugène de Rastignac et de Julien Sorel, et sous le haut patronage De Balzac et de Stendhal que Barrès place ses personnages du premier volet de la trilogie du roman de l'énergie nationale, les Déracinés.
Le propos du roman réside dans la critique du système de l'éducation universitaire qui arrache les jeunes forces de leur terroir, de leur substrat d'origine, pour en faire des déracinés. La charge contre la petite cuisine politicarde du parlementarisme faisandé est acerbe, le roman illustrant la corruption et les conflits d'intérêts ayant cours dans l'espace du triangle infernal délimité par les banques, la presse et le parlement, sur fond de scandale du canal de Panama. Le roman évoque avec brio les milieux bohèmes et estudiantins, le monde interlope des brasseries de femmes, la déveine des carabins. L'oeuvre culmine avec deux morceaux de bravoure, envolées lyriques au spectacle du tombeau de l'Empereur et des funérailles de Victor Hugo, deux figures qui surent en leur temps canaliser les forces composites de la France. Cela étant dit, le style de Barrès est plutôt ampoulé, parfois grandiloquent, le livre fait son âge, les personnages manquent aussi de profondeur, l'intérêt du livre en souffre notablement.
Le propos du roman réside dans la critique du système de l'éducation universitaire qui arrache les jeunes forces de leur terroir, de leur substrat d'origine, pour en faire des déracinés. La charge contre la petite cuisine politicarde du parlementarisme faisandé est acerbe, le roman illustrant la corruption et les conflits d'intérêts ayant cours dans l'espace du triangle infernal délimité par les banques, la presse et le parlement, sur fond de scandale du canal de Panama. Le roman évoque avec brio les milieux bohèmes et estudiantins, le monde interlope des brasseries de femmes, la déveine des carabins. L'oeuvre culmine avec deux morceaux de bravoure, envolées lyriques au spectacle du tombeau de l'Empereur et des funérailles de Victor Hugo, deux figures qui surent en leur temps canaliser les forces composites de la France. Cela étant dit, le style de Barrès est plutôt ampoulé, parfois grandiloquent, le livre fait son âge, les personnages manquent aussi de profondeur, l'intérêt du livre en souffre notablement.
Il est des romans dont l'incipit, ou même les premières pages, capturent immédiatement le lecteur, et semblent laisser profondément leur trace en sa mémoire. La colline inspirée est de ceux-là. Un à un, les grands monuments de France sont cités. Loin de leurs atours touristiques que les guides, les affiches ou encore les spots publicitaires mettent en valeur désormais, ils sont évoqués en un mot, en une phrase, par un Maurice Barrès qui en dresse là un portrait essentiel. Parmi ces monuments, parmi ces lieux, apparaît la colline de Sion-Vaudémont, sise en Lorraine. Là, pour Maurice Barrès, se loge une part de l'âme lorraine, de cette région si fermement française - et d'autant plus lorsque l'on pense que, lorsque Maurice Barrès publie ce roman en 1913, une partie de cette région et l'Alsace toute entière appartient, depuis la défaite de 1870, à l'Allemagne -, de cette ancienne Lotharingie, de cet ancien duché partagé un temps entre la France et la Pologne, de cette région qui, comme d'autres régions françaises, a abrité en son sein une population paysanne humble et pourtant vaillante, et une aristocratie fière et redoutable. La colline de Sion, aussi, se confond avec l'histoire religieuse de la région et du pays. Un sanctuaire dédié à la Vierge y a été bâti. Et, prenant prétexte de l'histoire récente - Barrès indique avoir interrogé certains témoins de l'époque qui, il est vrai, n'est guère éloignée de la période d'écriture -, l'auteur évoque l'histoire des frères Baillard qui, là-haut, insufflèrent un élan de vie et de foi à la colline auparavant abandonnée, et ravagée par la Révolution. Histoire d'une Passion, histoire d'un fait religieux et, il faut bien le dire, examen de cet esprit français dont on devait, quelques mois après la publication de La colline inspirée, se glorifier au moment d'aller combattre l’Allemagne, le roman de Barrès est aussi un livre remarquable, qu'il faut lire pour son style qui fait de la simplicité le vecteur de la grandeur.
C'est l'histoire d'une lutte, d'une ascension et d'une chute. Sous l'impulsion de l'aîné Léopold, François et Quirin Baillard, ordonnés tous trois prêtres, entreprennent de redonner à la colline de Sion sa primauté religieuse. Ils restaurent et rebâtissent une église, forment une communauté vers laquelle les dons affluent. A tel point que l'évêché de Nancy s'en émeut et décide de priver la communauté des dons des fidèles. A la suite de ce premier avertissement, qui conduira les frères Baillard à faire retraite dans un monastère des environs, Léopold prend connaissance de la foi de Vintras, un prêtre normand dont les prêches annoncent la prochaine fin du monde, et sa propre élection par les anges et par Dieu. Conquis spirituellement par cet homme, Léopold Baillard retourne à Sion, y fonde une nouvelle communauté, financée cette fois par les activités de François et Quirin (ce dernier, notamment, se fait négociant en vins de Bourgogne). L'Église, cette fois, dépêche le père Aubry, fervent défenseur de la foi catholique et romaine, qui sera l'ardent opposant de Léopold. Face à la détermination des trois frères, l'Église décide de les excommunier. L'anathème fait fuir les derniers fidèles, et autorise toutes les bassesses, toutes les haines à l'encontre des trois frères. Ceux-ci se dispersent : Quirin choisit la vie paisible, retirée de Sion ; François meurt. Quant à Léopold, sa fidélité à Vintras finit par choir, et celui qui restaura Sion finit par abjurer pour retourner dans le giron de l'Église catholique et romaine à l'heure de sa mort.
Figure centrale du roman, Léopold est une figure paradoxale. Meneur entre tous ses frères, directeur spirituel d'une communauté qui le voit comme un saint homme, il pourrait être qualifié d'illuminé, au sens premier du mot, détaché des basses tâches matérielles pourtant nécessaires à la gestion de son œuvre. Son autorité, son charisme, cette part inébranlable qui font douter même les prêtres les plus orthodoxes, tel le père Aubry, il les tient de l'étude des textes, dont il fait une lecture radicale. Dieu, par exemple, est Amour, et s'Il est Tout, alors le Malin ne peut être, ni l'Enfer. L'humilité forcée que lui impose l'Église, en lui interdisant les quêtes auprès des fidèles, en fait le lointain descendant des Vaudois, des paysans allemands du seizième siècle, ou bien encore de Luther condamnant la richesse de l'Église. Sa foi, il la tient du dogme catholique, mais aussi de ce Vintras, personnage mystique, dont les transes hallucinées impressionnent l'auditoire. Léopold Baillard en est l'un des apôtres. Ainsi son aura de grand homme, de saint homme, s'oppose à cette seconde place, derrière Vintras, qu'il assume et revendique. Ainsi tire-t-il de sa relation épistolaire avec le prêtre normand une partie de sa consolation lorsqu'il est en exil à Londres durant cinq ans (l'autre partie de sa consolation provient du souvenir de Sion, ravivé par les échanges épistolaires avec son frère François). Apôtre et prophète en même temps, la seconde partie de son chemin est celle de la Passion. Battu, insulté, chassé par celles et ceux qu'il a baptisés, qu'il a communiés, par les enfants de ceux-ci - ainsi le petit-fils de son ami, à peine ordonné prêtre, qui lui demande de ne plus franchir la porte de sa maison -, il voit aussi les siens - à commencer par son frère, Quirin - le trahir, tel Pierre qui renie le Christ. Hérésiarque aux yeux de l'Église, il est celui qui, pourtant, restaura le culte de Sion par son amour pour ce lieu. Le père Aubry le reconnaîtra lui-même. Sa foi, son amour, son humilité obligent même ses plus féroces adversaires. Pourtant, c'est bien lui, Léopold Baillard, qui abjure quelques instants avant sa mort. Victoire de l'Église, défaite de l'hérésie ; mais quelle est cette hérésie qui célèbre Dieu, qui restaure la foi des fidèles, qui épouse le message christique d'amour et de pauvreté ?
En bien des points, l'histoire de ces frères est édifiante. Elle dit beaucoup du fait religieux en France, au dix-neuvième siècle. Elle dit d'abord le besoin de foi des populations paysannes, que la liturgie des Baillard stimule et enthousiasme. L'Église, cependant, conserve un très fort pouvoir, particulièrement visible lorsque l'excommunication est prononcée, et qu'alors se déchaînent contre les frères ces violences, hélas bien humaines, et que ne viennent pas tempérer ces hommes qui se disent de foi et qui disent propager un message d'amour. Oubliées les bonnes œuvres des frères et des sœurs de la communauté. Pourtant, c'est bien encouragés qu'ils cultivèrent la terre et les âmes. Car, comme la terre a besoin d'eau, l'âme, probablement, a besoin d'un secours spirituel. Cette dimension, qu'on pourrait dire religieuse, mais qui en réalité transcende les époques et les dieux qu'on a célébrés sur cette antique terre gauloise (Barrès fait remonter le culte sur la colline aux anciens Celtes, et il compare les oblats du père Aubry aux légionnaires romains qui s'attaquèrent aux Gaulois), traverse le roman et parle d'autant plus à notre époque qu'elle a majoritairement disparu. L’Église, on le voit, qu'elle soit officielle ou hérésiarque, détient un rôle central dans les communautés paysannes. Elle structure la vie des hommes et des femmes, les éduque, les console dans les moments de grande peine (ainsi l'invasion prussienne de 1870). Lire La colline inspirée, c'est aussi retrouver le quotidien de nos aïeux, dont la vie se déroulait dans un cadre géographique et spirituel absolument défini, voire rigide, dont les limites étaient rarement dépassées.
Le fait religieux que Barrès étudie à travers l'exemple des frères Baillard parle aussi de cette France du dix-neuvième siècle, de la monarchie de Juillet, du Second Empire, de la Troisième République. Lorsque Barrès publie le roman, la situation diplomatico-politique est à l'emballement, qui conduira, environ seize mois après, au déclenchement de la Première guerre mondiale. Derrière la ligne bleue des Vosges, c'est l'Allemagne, ce Reich qui a pris une capturé une partie du pays. Point de bellicisme dans les pages de La colline inspirée ; mais là souffle l'esprit français, non pas défini par l'attachement à la République - bien que celui-ci soit réel depuis la fin du siècle précédent -, mais par une transcendance. Associée à Rosmerta, déesse celte de la fertilité et de l'abondance, la Vierge Marie veille sur ses fidèles qui, à Sion, lui rendent hommage. Léopold Baillard, en cela, symbolise cet esprit français, et sa lutte contre l’Église est résumée, en épilogue, par la métaphore de la prairie et de la chapelle. La prairie, dit Barrès, c'est la nature, c'est l'immanence de Dieu et de la terre natale en chacun de nous, c'est la transcendance de ces mêmes choses à travers les lieux, les époques et les générations de femmes et d'hommes. La chapelle, c'est l'ordre, c'est la maîtrise de ces principes, appliquée pour tirer le meilleur des corps et des âmes. Pour un homme comme Barrès, il est impossible de choisir, de condamner. Condamner Léopold Baillard, son entreprise pour restaurer Sion, c'est renoncer à la terre natale, aux générations antérieures. Renoncer à l’Église, pour un homme tel que lui, c'est strictement impossible ou, mieux, inconcevable intellectuellement ; ce serait aussi renoncer à tirer de ces sentiments immanents décrits plus hauts la force nécessaire pour bâtir plus grand encore. On serait tentés, et à raison, d'opposer à ces sentiments de grandeur et d'attachement à ce que l'on peut nommer la patrie, le grand drame destructeur et meurtrier que fut la Première guerre mondiale. Lire Barrès aujourd'hui, cependant, permet d'entrevoir une partie de cette histoire de France qui, si elle fut celle des thuriféraires du nationalisme et des bellicistes, fut aussi celle d'une grande partie du monde paysan et, partant, de nos propres aïeux.
C'est l'histoire d'une lutte, d'une ascension et d'une chute. Sous l'impulsion de l'aîné Léopold, François et Quirin Baillard, ordonnés tous trois prêtres, entreprennent de redonner à la colline de Sion sa primauté religieuse. Ils restaurent et rebâtissent une église, forment une communauté vers laquelle les dons affluent. A tel point que l'évêché de Nancy s'en émeut et décide de priver la communauté des dons des fidèles. A la suite de ce premier avertissement, qui conduira les frères Baillard à faire retraite dans un monastère des environs, Léopold prend connaissance de la foi de Vintras, un prêtre normand dont les prêches annoncent la prochaine fin du monde, et sa propre élection par les anges et par Dieu. Conquis spirituellement par cet homme, Léopold Baillard retourne à Sion, y fonde une nouvelle communauté, financée cette fois par les activités de François et Quirin (ce dernier, notamment, se fait négociant en vins de Bourgogne). L'Église, cette fois, dépêche le père Aubry, fervent défenseur de la foi catholique et romaine, qui sera l'ardent opposant de Léopold. Face à la détermination des trois frères, l'Église décide de les excommunier. L'anathème fait fuir les derniers fidèles, et autorise toutes les bassesses, toutes les haines à l'encontre des trois frères. Ceux-ci se dispersent : Quirin choisit la vie paisible, retirée de Sion ; François meurt. Quant à Léopold, sa fidélité à Vintras finit par choir, et celui qui restaura Sion finit par abjurer pour retourner dans le giron de l'Église catholique et romaine à l'heure de sa mort.
Figure centrale du roman, Léopold est une figure paradoxale. Meneur entre tous ses frères, directeur spirituel d'une communauté qui le voit comme un saint homme, il pourrait être qualifié d'illuminé, au sens premier du mot, détaché des basses tâches matérielles pourtant nécessaires à la gestion de son œuvre. Son autorité, son charisme, cette part inébranlable qui font douter même les prêtres les plus orthodoxes, tel le père Aubry, il les tient de l'étude des textes, dont il fait une lecture radicale. Dieu, par exemple, est Amour, et s'Il est Tout, alors le Malin ne peut être, ni l'Enfer. L'humilité forcée que lui impose l'Église, en lui interdisant les quêtes auprès des fidèles, en fait le lointain descendant des Vaudois, des paysans allemands du seizième siècle, ou bien encore de Luther condamnant la richesse de l'Église. Sa foi, il la tient du dogme catholique, mais aussi de ce Vintras, personnage mystique, dont les transes hallucinées impressionnent l'auditoire. Léopold Baillard en est l'un des apôtres. Ainsi son aura de grand homme, de saint homme, s'oppose à cette seconde place, derrière Vintras, qu'il assume et revendique. Ainsi tire-t-il de sa relation épistolaire avec le prêtre normand une partie de sa consolation lorsqu'il est en exil à Londres durant cinq ans (l'autre partie de sa consolation provient du souvenir de Sion, ravivé par les échanges épistolaires avec son frère François). Apôtre et prophète en même temps, la seconde partie de son chemin est celle de la Passion. Battu, insulté, chassé par celles et ceux qu'il a baptisés, qu'il a communiés, par les enfants de ceux-ci - ainsi le petit-fils de son ami, à peine ordonné prêtre, qui lui demande de ne plus franchir la porte de sa maison -, il voit aussi les siens - à commencer par son frère, Quirin - le trahir, tel Pierre qui renie le Christ. Hérésiarque aux yeux de l'Église, il est celui qui, pourtant, restaura le culte de Sion par son amour pour ce lieu. Le père Aubry le reconnaîtra lui-même. Sa foi, son amour, son humilité obligent même ses plus féroces adversaires. Pourtant, c'est bien lui, Léopold Baillard, qui abjure quelques instants avant sa mort. Victoire de l'Église, défaite de l'hérésie ; mais quelle est cette hérésie qui célèbre Dieu, qui restaure la foi des fidèles, qui épouse le message christique d'amour et de pauvreté ?
En bien des points, l'histoire de ces frères est édifiante. Elle dit beaucoup du fait religieux en France, au dix-neuvième siècle. Elle dit d'abord le besoin de foi des populations paysannes, que la liturgie des Baillard stimule et enthousiasme. L'Église, cependant, conserve un très fort pouvoir, particulièrement visible lorsque l'excommunication est prononcée, et qu'alors se déchaînent contre les frères ces violences, hélas bien humaines, et que ne viennent pas tempérer ces hommes qui se disent de foi et qui disent propager un message d'amour. Oubliées les bonnes œuvres des frères et des sœurs de la communauté. Pourtant, c'est bien encouragés qu'ils cultivèrent la terre et les âmes. Car, comme la terre a besoin d'eau, l'âme, probablement, a besoin d'un secours spirituel. Cette dimension, qu'on pourrait dire religieuse, mais qui en réalité transcende les époques et les dieux qu'on a célébrés sur cette antique terre gauloise (Barrès fait remonter le culte sur la colline aux anciens Celtes, et il compare les oblats du père Aubry aux légionnaires romains qui s'attaquèrent aux Gaulois), traverse le roman et parle d'autant plus à notre époque qu'elle a majoritairement disparu. L’Église, on le voit, qu'elle soit officielle ou hérésiarque, détient un rôle central dans les communautés paysannes. Elle structure la vie des hommes et des femmes, les éduque, les console dans les moments de grande peine (ainsi l'invasion prussienne de 1870). Lire La colline inspirée, c'est aussi retrouver le quotidien de nos aïeux, dont la vie se déroulait dans un cadre géographique et spirituel absolument défini, voire rigide, dont les limites étaient rarement dépassées.
Le fait religieux que Barrès étudie à travers l'exemple des frères Baillard parle aussi de cette France du dix-neuvième siècle, de la monarchie de Juillet, du Second Empire, de la Troisième République. Lorsque Barrès publie le roman, la situation diplomatico-politique est à l'emballement, qui conduira, environ seize mois après, au déclenchement de la Première guerre mondiale. Derrière la ligne bleue des Vosges, c'est l'Allemagne, ce Reich qui a pris une capturé une partie du pays. Point de bellicisme dans les pages de La colline inspirée ; mais là souffle l'esprit français, non pas défini par l'attachement à la République - bien que celui-ci soit réel depuis la fin du siècle précédent -, mais par une transcendance. Associée à Rosmerta, déesse celte de la fertilité et de l'abondance, la Vierge Marie veille sur ses fidèles qui, à Sion, lui rendent hommage. Léopold Baillard, en cela, symbolise cet esprit français, et sa lutte contre l’Église est résumée, en épilogue, par la métaphore de la prairie et de la chapelle. La prairie, dit Barrès, c'est la nature, c'est l'immanence de Dieu et de la terre natale en chacun de nous, c'est la transcendance de ces mêmes choses à travers les lieux, les époques et les générations de femmes et d'hommes. La chapelle, c'est l'ordre, c'est la maîtrise de ces principes, appliquée pour tirer le meilleur des corps et des âmes. Pour un homme comme Barrès, il est impossible de choisir, de condamner. Condamner Léopold Baillard, son entreprise pour restaurer Sion, c'est renoncer à la terre natale, aux générations antérieures. Renoncer à l’Église, pour un homme tel que lui, c'est strictement impossible ou, mieux, inconcevable intellectuellement ; ce serait aussi renoncer à tirer de ces sentiments immanents décrits plus hauts la force nécessaire pour bâtir plus grand encore. On serait tentés, et à raison, d'opposer à ces sentiments de grandeur et d'attachement à ce que l'on peut nommer la patrie, le grand drame destructeur et meurtrier que fut la Première guerre mondiale. Lire Barrès aujourd'hui, cependant, permet d'entrevoir une partie de cette histoire de France qui, si elle fut celle des thuriféraires du nationalisme et des bellicistes, fut aussi celle d'une grande partie du monde paysan et, partant, de nos propres aïeux.
Les modernes esprit moqueurs pourront se moquer du style jugé précieux et emphatique, et du fond mystique, mais les âmes restées sensibles ne pourront qu’être transportées par ce court récit splendide!
Colette Baudoche et sa grand-mère vivent à Metz, ville annexée par l'Allemagne après 1870. Elles prennent en pension un professeur allemand, le Docteur Frédéric Asmus, qui a pour mission de germaniser la Lorraine. Peu à peu, il tombe sous le charme de la jeune Colette, au point de lui demander sa main. La vengeance de celle-ci consiste à refuser toute union avec ce prétendant, par une sorte de résistance passive.
Il s'agit donc bien d'un roman patriotique, qui exalte l'âme lorraine, et la fidélité à la nation française. Barrès n'est toutefois pas le nationaliste belliqueux qu'a dépeint Bernard-Henry Lévy. Le portrait de l'universitaire allemand est plutôt nuancé, malgré quelques stéréotypes (Asmus représentant l'ennemi, le colonisateur), et le roman demeure fort lisible si l'on veut bien ne pas perdre de vue le contexte historique qui en est à l'origine.
En outre, les paysages y jouent un rôle de premier plan. Comme l'écrit Alain Brossat, "ce qui constitue le trait proprement barrésien, dans ce roman comme dans d’autres, c’est l’application et la constance avec laquelle la fable est enracinée dans une topographie, reconduite à la terre, aux lieux, à l’espace, aux paysages. Ce que l’ennemi ne saurait s’approprier, ce qui échappe résolument à ses prises, c’est cette géographie habitée, car chaque monument, chaque colline, chaque vignoble, chaque village porte la marque d’un génie autochtone qui résiste à son emprise et auquel en tant qu’étranger, semi-barbare venu de l’Est, il ne saurait être, d’emblée du moins, sensible."
(« Barrès ou la nationalisation du paysage », Appareil [En ligne], 11 | 2013)https://appareil.revues.org/1794.)
Il s'agit donc bien d'un roman patriotique, qui exalte l'âme lorraine, et la fidélité à la nation française. Barrès n'est toutefois pas le nationaliste belliqueux qu'a dépeint Bernard-Henry Lévy. Le portrait de l'universitaire allemand est plutôt nuancé, malgré quelques stéréotypes (Asmus représentant l'ennemi, le colonisateur), et le roman demeure fort lisible si l'on veut bien ne pas perdre de vue le contexte historique qui en est à l'origine.
En outre, les paysages y jouent un rôle de premier plan. Comme l'écrit Alain Brossat, "ce qui constitue le trait proprement barrésien, dans ce roman comme dans d’autres, c’est l’application et la constance avec laquelle la fable est enracinée dans une topographie, reconduite à la terre, aux lieux, à l’espace, aux paysages. Ce que l’ennemi ne saurait s’approprier, ce qui échappe résolument à ses prises, c’est cette géographie habitée, car chaque monument, chaque colline, chaque vignoble, chaque village porte la marque d’un génie autochtone qui résiste à son emprise et auquel en tant qu’étranger, semi-barbare venu de l’Est, il ne saurait être, d’emblée du moins, sensible."
(« Barrès ou la nationalisation du paysage », Appareil [En ligne], 11 | 2013)https://appareil.revues.org/1794.)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Maurice Barrès
Quiz
Voir plus
Créatures, dieux et héros mythologiques et légendaires
Quel est le nom romain de Héraclès ?
Bacchus
Pluton
Mars
Hercule
22 questions
178 lecteurs ont répondu
Thèmes :
mythes et légendesCréer un quiz sur cet auteur178 lecteurs ont répondu