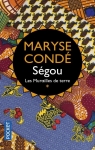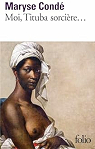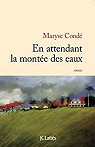Critiques de Maryse Condé (354)
Si le premier tome de la série Ségou m’avait plu, j’y découvrais l’Afrique de l’Ouest, ses gens, ses traditions. Dans le deuxième, La terre en miettes, toute la nouveauté avait disparu. Puisqu’une grande partie de son intrigue est basée sur des événements historiques (guerres d’El-Hadj Omar, constitution de l’empire toucouleur, colonisation française, sort réservé aux Noirs dans les Amériques, etc.), sa lecture demeure pertinente. Malheureusement, je n’ai pas autant accroché et, pour être franc, je me suis ennuyé à plus d’un moment pendant ma lecture. C’est peut-être, justement, parce que son auteure Maryse Condé visait trop grand? Je m’étais attaché à plusieurs personnages des première et deuxième générations de la famille Douskila. Toutefois, comme je l’avais écrit précédemment, beaucoup d’entre eux ont été expédiés rapidement avant que j’ai eu le temps de m’intéresser à leur sort. C’est d’autant plus vrai pour les troisième et quatrième générations. Je suivais les aventures de Mohammed, Eucaristus, Olubunmi et de tous les autres de manière très détachée. Pour tout dire, rendu vers la fin, j’avais surtout hâte d’arriver à la fin pour savoir ce qui allait arriver au Mali en général. Ça et l’aspect historique évoqué plus haut, la montée et la chute de l’empire d’El-Hadj Omar, beaucoup plus que les péripéties des Douskila. Encore une fois, les appendices (arbre généalogiques, cartes, notes) m’ont été d’un grand secours, je suggère qu’ils soient consultés avant d’entreprendre la lecture de ce roman, ne serait-ce que pour se remémorer ce qui s’est passé dans le premier tome.
Ségou est une immense fresque qui raconte l’Afrique de l’Ouest, essentiellement au XIXe siècle. Cette région du monde magnifique, aux cultures et aux traditions riches et millénaires est souvent négligées, tant dans la littérature que dans l’actualité. L’autrice Maryse Condé, bien qu’originaire de la Guadeloupe et ayant fait une partie de sa scolarité en France, voyage et travaille une dizaine d’année en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Ghana, au Sénégal. Même de retour en Occident, elle continue à s’intéresser à cette région du monde. Et c’est sans doute ce qui lui inspira Ségou.
Le premier tome de cette saga s’intitule Les murailles de terre. Il raconte le déclin de l’empire des Bambaras, l’ordre ancien renversé par des dissensions internes (intrigues de palais) mais surtout la progression de l’islam et du christianisme ainsi que le colonialisme et l’esclavagisme (traite négrière et déportation outre-Atlantique).
La famille Douskila est au cœur de cette grande saga, au cœur également des thèmes mentionnés plus haut. Le fils aîné Tiékoro Traoré se convertit tôt à l’islam et sera persécuté pour cela. En effet, pour le fils d’un grand dignitiaire dans une société aux croyances fétichistes, c’est osé. Le deuxième frère est capturé par des esclavagistes et transite par le Nigéria avant d’être vendu au Sénégal. Par la suite, il s’embarque pour le Brésil, travaillant dans une fazenda. Quant au troisième, Malobali, il se fait mercenaire dans l’empire Ashanti. Un autre frère, fils d’une esclave, exerce différents métiers qui le font voyager dans la région, même jusqu’au Maroc.
Ainsi, la fratrie voyage dans toute l’Afrique de l’Ouest et dans des régions où les populations locales se sont retrouvées par la suite, souvent malgré elles. Beaucoup d’aventures, beaucoup de souffrance également. Je crois que c’est la meilleure façon de résumer (à l’extrême) ce roman dense sans le dénaturer.
Les murailles de terre est un roman de fiction, toutefois, il incorpore beaucoup d’éléments historiques. Par exemple, le voyage de l’explorateur Mungo Park, la présence des officiers et des signares (femmes métis) à Gorée et Saint-Louis (au Sénégal), la montée en puissance d’El Hadj Omar et de son empire toucouleur.
L’intrigue est certes pertinente et accrocheuse. Le rythme est très rapide, il se passe beaucoup, vraiment beaucoup de choses. Aussi, le mode de vie des gens des différents peuples (bambaras, peuls, wolofs, ashantis, yorubas, etc.) est très bien décrit. J’arrivais facilement à les imaginer dans ma tête, à les différencier les uns des autres. Pour nous aider, plusieurs notes de bas de page ainsi que, à la fin, des notes historiques et ethnographiques (afin de pousser notre compréhension sur plusieurs éléments effleurés dans le roman). Aussi, des cartes et un arbre généalogique présentant la fratrie, mais aussi leurs épouses, leurs enfants et leurs petits-enfants. Très utile!
Toutefois, si Les murailles de terre permettent de reconstituer une époque, un petit je-ne-sais-quoi m’agaçait tout le long de ma lecture. Je n’arrivais pas à me sentir complètement investi dans l’histoire de ces trois frères et cela malgré un début prometteur. Je mets ça sur trois facteurs. Le premier, c’est que tout déboule rapidement (à mon goût), avant que l’on ait eu le temps d’assoir les personnages. Le deuxième, ce sont les sauts dans le temps, ce qui se produit à plusieurs endroits. Tout d’un coup, un, trois, cinq ans se sont écoulés, à peine une phrase ou deux pour signaler que la narration est propulsée de l’avant. Par exemple, alors qu’il se trouve encore à Tombouctou, Tiékolo songe à prendre pour épouse Nadié sa concubine, malgré son rang inférieur. Le chapitre suivant, ils sont mariés, parents de trois enfants et de retour à Ségou. When did that happen! Au début, je croyais avoir sauté des pages, avoir été dans la lune, d’autant plus que parfois l’on passe des aventures d’un frère à celles d’un autre. C’était mélangeant, et pas rien qu’un peu.
La troisième raison rejoint un peu la première : plusieurs personnages secondaires sont peu exploités, décrits seulement de manière superficielle, avec une certaine distance. Ça va pour des individus qui ne font que croiser la route des protagonistes mais certains tiennent des rôles importants (comme les différentes épouses ou les dignitaires du royaume de Ségou). Pourtant, l’auteure en fait peu de cas et plusieurs sont expédiés (pour ne pas dire tués) très rapidement une fois leur utilité dans l’intrigue finie. J’aurai aimé avoir la chance de les comprendre mieux, d’apprécier leurs tourments intérieurs. Ceci dit, avec déjà deux tomes de presque 500 pages en grand format, cela aurait sans doute fait déborder cette histoire déjà complexe.
Dans tous les cas, j’ai bien aimé Les murailles de terre, un roman captivant qui m’a fait découvrir davantage l’histoire de cette partie du monde.
Le premier tome de cette saga s’intitule Les murailles de terre. Il raconte le déclin de l’empire des Bambaras, l’ordre ancien renversé par des dissensions internes (intrigues de palais) mais surtout la progression de l’islam et du christianisme ainsi que le colonialisme et l’esclavagisme (traite négrière et déportation outre-Atlantique).
La famille Douskila est au cœur de cette grande saga, au cœur également des thèmes mentionnés plus haut. Le fils aîné Tiékoro Traoré se convertit tôt à l’islam et sera persécuté pour cela. En effet, pour le fils d’un grand dignitiaire dans une société aux croyances fétichistes, c’est osé. Le deuxième frère est capturé par des esclavagistes et transite par le Nigéria avant d’être vendu au Sénégal. Par la suite, il s’embarque pour le Brésil, travaillant dans une fazenda. Quant au troisième, Malobali, il se fait mercenaire dans l’empire Ashanti. Un autre frère, fils d’une esclave, exerce différents métiers qui le font voyager dans la région, même jusqu’au Maroc.
Ainsi, la fratrie voyage dans toute l’Afrique de l’Ouest et dans des régions où les populations locales se sont retrouvées par la suite, souvent malgré elles. Beaucoup d’aventures, beaucoup de souffrance également. Je crois que c’est la meilleure façon de résumer (à l’extrême) ce roman dense sans le dénaturer.
Les murailles de terre est un roman de fiction, toutefois, il incorpore beaucoup d’éléments historiques. Par exemple, le voyage de l’explorateur Mungo Park, la présence des officiers et des signares (femmes métis) à Gorée et Saint-Louis (au Sénégal), la montée en puissance d’El Hadj Omar et de son empire toucouleur.
L’intrigue est certes pertinente et accrocheuse. Le rythme est très rapide, il se passe beaucoup, vraiment beaucoup de choses. Aussi, le mode de vie des gens des différents peuples (bambaras, peuls, wolofs, ashantis, yorubas, etc.) est très bien décrit. J’arrivais facilement à les imaginer dans ma tête, à les différencier les uns des autres. Pour nous aider, plusieurs notes de bas de page ainsi que, à la fin, des notes historiques et ethnographiques (afin de pousser notre compréhension sur plusieurs éléments effleurés dans le roman). Aussi, des cartes et un arbre généalogique présentant la fratrie, mais aussi leurs épouses, leurs enfants et leurs petits-enfants. Très utile!
Toutefois, si Les murailles de terre permettent de reconstituer une époque, un petit je-ne-sais-quoi m’agaçait tout le long de ma lecture. Je n’arrivais pas à me sentir complètement investi dans l’histoire de ces trois frères et cela malgré un début prometteur. Je mets ça sur trois facteurs. Le premier, c’est que tout déboule rapidement (à mon goût), avant que l’on ait eu le temps d’assoir les personnages. Le deuxième, ce sont les sauts dans le temps, ce qui se produit à plusieurs endroits. Tout d’un coup, un, trois, cinq ans se sont écoulés, à peine une phrase ou deux pour signaler que la narration est propulsée de l’avant. Par exemple, alors qu’il se trouve encore à Tombouctou, Tiékolo songe à prendre pour épouse Nadié sa concubine, malgré son rang inférieur. Le chapitre suivant, ils sont mariés, parents de trois enfants et de retour à Ségou. When did that happen! Au début, je croyais avoir sauté des pages, avoir été dans la lune, d’autant plus que parfois l’on passe des aventures d’un frère à celles d’un autre. C’était mélangeant, et pas rien qu’un peu.
La troisième raison rejoint un peu la première : plusieurs personnages secondaires sont peu exploités, décrits seulement de manière superficielle, avec une certaine distance. Ça va pour des individus qui ne font que croiser la route des protagonistes mais certains tiennent des rôles importants (comme les différentes épouses ou les dignitaires du royaume de Ségou). Pourtant, l’auteure en fait peu de cas et plusieurs sont expédiés (pour ne pas dire tués) très rapidement une fois leur utilité dans l’intrigue finie. J’aurai aimé avoir la chance de les comprendre mieux, d’apprécier leurs tourments intérieurs. Ceci dit, avec déjà deux tomes de presque 500 pages en grand format, cela aurait sans doute fait déborder cette histoire déjà complexe.
Dans tous les cas, j’ai bien aimé Les murailles de terre, un roman captivant qui m’a fait découvrir davantage l’histoire de cette partie du monde.
Tituba fille d'esclave, naît sur l'île de la Barbade à la fin du XVIIe siècle. Elle est élevée et initiée aux pouvoirs du monde invisible par Man Yaya, une guérisseuse, crainte pour sa pratique de la sorcellerie.
Peu après son mariage avec un esclave, elle part pour les États-Unis, Boston puis le village de Salem où elle travaille au service d'un homme d'Église.
"Le devoir d'un esclave, c'est de survivre. Tu m'entends ? C'est de survivre."
Alors que son époux s'évertue à satisfaire ses maîtres et à répondre aux stéréotypes du bon esclave, Tituba reste fidèle à elle-même. Naïve ? En tout cas libre, authentique, n'adhérant pas aux dogmes chrétiens, elle use de son art pour soigner et réconforter. Elle donne et se donne par amour pour son prochain. Elle aime peut-être un peu trop d'ailleurs...
Très vite, Tituba est accusée de sorcellerie et jetée en prison. Libérée deux ans plus tard, elle rentre à la Barbade où elle côtoie les Nègres Marrons.
C'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher 🤩. Il y a tellement de choses à en dire. Beaucoup de thématiques sont abordées et suggérées : l'horreur de l'esclavage, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'hystérie des puritains, le monde invisible...
Tituba a vraiment existé. Son savoir médicinal et la couleur de sa peau en font naturellement une sorcière. Noire et esclave, elle est oubliée dans les récits du Procès des sorcières de Salem.
Maryse Condé lui donne, ici, une voix et une histoire.
Histoire et fiction se mêlent, à certains moments mieux que d'autres...
J'avais beaucoup entendu parler de ce livre et je vous le recommande pour sa richesse.
Parfois j'ai eu l'impression que Tituba et Maryse se confondaient, qu'elles ne faisaient qu'une seule et même personne...
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Peu après son mariage avec un esclave, elle part pour les États-Unis, Boston puis le village de Salem où elle travaille au service d'un homme d'Église.
"Le devoir d'un esclave, c'est de survivre. Tu m'entends ? C'est de survivre."
Alors que son époux s'évertue à satisfaire ses maîtres et à répondre aux stéréotypes du bon esclave, Tituba reste fidèle à elle-même. Naïve ? En tout cas libre, authentique, n'adhérant pas aux dogmes chrétiens, elle use de son art pour soigner et réconforter. Elle donne et se donne par amour pour son prochain. Elle aime peut-être un peu trop d'ailleurs...
Très vite, Tituba est accusée de sorcellerie et jetée en prison. Libérée deux ans plus tard, elle rentre à la Barbade où elle côtoie les Nègres Marrons.
C'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher 🤩. Il y a tellement de choses à en dire. Beaucoup de thématiques sont abordées et suggérées : l'horreur de l'esclavage, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'hystérie des puritains, le monde invisible...
Tituba a vraiment existé. Son savoir médicinal et la couleur de sa peau en font naturellement une sorcière. Noire et esclave, elle est oubliée dans les récits du Procès des sorcières de Salem.
Maryse Condé lui donne, ici, une voix et une histoire.
Histoire et fiction se mêlent, à certains moments mieux que d'autres...
J'avais beaucoup entendu parler de ce livre et je vous le recommande pour sa richesse.
Parfois j'ai eu l'impression que Tituba et Maryse se confondaient, qu'elles ne faisaient qu'une seule et même personne...
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Dans ce petit livre Maryse Condé nous raconte des moments forts de sa vie, de sa naissance à son adolescence. Enfant inattendue d'un couple de bourgeois de Pointe-à-Pitre, elle grandit dans la Guadeloupe des années 40-50. Coupée de sa culture créole, n'ayant qu'une très minime connaissance de son île, son père est indifférent et sa mère sévère et hautaine lui répète sans cesse qu'elle ne fera rien de bon dans la vie. L'auteure se construit en opposition à ses modèles parentaux. Surdouée, toujours première de sa classe, elle s'envolera pour Paris à l'âge de 16ans, pour rejoindre un lycée où elle a été admise en hypokhâgne.
Elle brosse un dur portrait familial, sans s'apitoyer sur son sort, sans non plus nier l'amour et la tendresse qu'on lui a témoigné. J'ai été très surprise par le ton des souvenirs qu'elle partage. Ce livre aurait pu s'appeler "Les malheurs de Maryse". J'ai rigolé, j'ai eu de la peine pour cette enfant qui s'exprime sans filtre dans une culture où la retenue est de rigueur. On ne parle pas de choses désagréables comme l'esclavage ou le divorce.
J'adore les créolismes qu'elle emploie, la façon dont elle décrit les choses, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre les récits de mes grands-mères sur la Guadeloupe de cette époque.
Maryse Condé m'a fait voyagé avec ce livre touchant.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Elle brosse un dur portrait familial, sans s'apitoyer sur son sort, sans non plus nier l'amour et la tendresse qu'on lui a témoigné. J'ai été très surprise par le ton des souvenirs qu'elle partage. Ce livre aurait pu s'appeler "Les malheurs de Maryse". J'ai rigolé, j'ai eu de la peine pour cette enfant qui s'exprime sans filtre dans une culture où la retenue est de rigueur. On ne parle pas de choses désagréables comme l'esclavage ou le divorce.
J'adore les créolismes qu'elle emploie, la façon dont elle décrit les choses, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre les récits de mes grands-mères sur la Guadeloupe de cette époque.
Maryse Condé m'a fait voyagé avec ce livre touchant.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Il y a tellement de choses à dire sur ce livre ! Babakar, malien par son père, guadeloupéen par sa mère est médecin gynécologue obstétricien. Après moult péripéties, il quitte le continent Africain pour s’installer en Guadeloupe. Un jour Movar, un jeune haïtien le fait venir au chevet de sa compagne. Malheureusement la jeune femme ne survit pas à son accouchement, Babakar décide d’adopter l’enfant. Commence alors une toute autre aventure.
Authentique, les créolismes m’ont transporté aux Antilles. Dynamique, les tableaux se succèdent et m’ont tenu en haleine. Relations humaines, relations internationales, relations historiques...
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Authentique, les créolismes m’ont transporté aux Antilles. Dynamique, les tableaux se succèdent et m’ont tenu en haleine. Relations humaines, relations internationales, relations historiques...
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Victoire Élodie Quidal, la grand-mère de Maryse Conde est une cuisinière exceptionnelle.
Mûlatresse aux yeux clairs, elle est élevée et protégée par sa grand-mère, à Marie-Galante.
Très discrète, quasi-muette, jalousée, voire détestée, elle ne parlait que le créole. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais alliait les saveurs avec virtuosité.
À partir des souvenirs de sa mère, d'habitants de Pointe-à-Pitre et de recherches historiques, l'auteure retrace la vie de cette grand-mère qu'elle n'a pas connu. De sa naissance à son décès, en passant par sa vie chez les Walberg, des blancs pays, à La Pointe.
Quelle vie ! Quelle narration. On s'y croit presque.
Victoire était une femme forte, dont le principal objectif était de donner un avenir à son enfant.
J'ai aimé découvrir un nouveau morceau du puzzle de l'histoire de Maryse Condé.
La société post-esclavagiste à deux vitesses est fascinante sous sa plume. J'ai été plongée dans la Guadeloupe d'Antan, absorbée par cette histoire. Pas tant pour le récit en lui même, plutôt pour tout ce qu'il révèle l'histoire de la Guadeloupe, de la vie à cette époque, pas si lointaine.
Certaines choses ont beaucoup changé et d'autres non...
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Mûlatresse aux yeux clairs, elle est élevée et protégée par sa grand-mère, à Marie-Galante.
Très discrète, quasi-muette, jalousée, voire détestée, elle ne parlait que le créole. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais alliait les saveurs avec virtuosité.
À partir des souvenirs de sa mère, d'habitants de Pointe-à-Pitre et de recherches historiques, l'auteure retrace la vie de cette grand-mère qu'elle n'a pas connu. De sa naissance à son décès, en passant par sa vie chez les Walberg, des blancs pays, à La Pointe.
Quelle vie ! Quelle narration. On s'y croit presque.
Victoire était une femme forte, dont le principal objectif était de donner un avenir à son enfant.
J'ai aimé découvrir un nouveau morceau du puzzle de l'histoire de Maryse Condé.
La société post-esclavagiste à deux vitesses est fascinante sous sa plume. J'ai été plongée dans la Guadeloupe d'Antan, absorbée par cette histoire. Pas tant pour le récit en lui même, plutôt pour tout ce qu'il révèle l'histoire de la Guadeloupe, de la vie à cette époque, pas si lointaine.
Certaines choses ont beaucoup changé et d'autres non...
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Maryse Condé se livre a un exercice difficile écrire sur elle sans artifice, sans embellir la réalité, sans se présenter sous son meilleur jour. Quel courage! Se mettre à nu devant ses lectrices et lecteurs. Mais surtout qu'elle vie!
Telle une suite de " Le coeur à rire et à pleurer" on retrouve l'auteure à son arrivée à Paris. Elle a été admise en hypokhâgne au Lycée Fénelon, elle envisage une grande école et des études de lettre. Mais sa nouvelle vie ne commence pas exactement comme prévu, un événement va tout bouleverser.
Dans ce petit livre très riche, Maryse Condé raconte sa vie d'étudiante, d'épouse, de mère et surtout de femme.
De Paris à Saint-Louis du Sénégal, en passant par Abidjan, Conakry, Dakar, Accra et Londres, elle raconte comment elle est brutalement sortie de la vie de jeune-fille
On trouve dans ce livre, des faits, des références et des noms bien connus : Hamilcar Cabral, Malcom X, Kwame Nkrumah, Césaire, Fanon, Ousmane Sembène...
Les guadeloupéen-ne-s reconnaîtront quelques noms bien connus chez nous aussi.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Telle une suite de " Le coeur à rire et à pleurer" on retrouve l'auteure à son arrivée à Paris. Elle a été admise en hypokhâgne au Lycée Fénelon, elle envisage une grande école et des études de lettre. Mais sa nouvelle vie ne commence pas exactement comme prévu, un événement va tout bouleverser.
Dans ce petit livre très riche, Maryse Condé raconte sa vie d'étudiante, d'épouse, de mère et surtout de femme.
De Paris à Saint-Louis du Sénégal, en passant par Abidjan, Conakry, Dakar, Accra et Londres, elle raconte comment elle est brutalement sortie de la vie de jeune-fille
On trouve dans ce livre, des faits, des références et des noms bien connus : Hamilcar Cabral, Malcom X, Kwame Nkrumah, Césaire, Fanon, Ousmane Sembène...
Les guadeloupéen-ne-s reconnaîtront quelques noms bien connus chez nous aussi.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Maryse Condé est une magnifique conteuse qui nous emmène avec ce roman en Afrique et dans les Caraïbes, pour une bonne part à Haïti. Les personnages, simples hommes et femmes déracinés sont pris dans l'histoire, dans les tourments politiques qui dévorent les vies, séparent les être qu'ils aiment et qui se ressemblent tous. Désabusé, Babakar s'accroche a l'enfant que la vie lui offre et à son beau métier "de femme". Il s'attache aux gens, se lie de fortes amitiés qui se délient ensuite tandis qu'il continue, son destin monte et descend - comme la marée, en attendant que tout soit englouti par la mer.
Un roman très proches des âmes, avec de belles personnes à la recherche non pas tant d'eux-même que de leur tribu.
Un roman très proches des âmes, avec de belles personnes à la recherche non pas tant d'eux-même que de leur tribu.
Maryse Condé rouvre une Affaire Classée à Salem.
L'écrivaine française lauréate du Prix Nobel de Littérature alternatif, nous offre une ensorcelante aventure de la Barbade, perle des Caraïbes, aux bois sombres et glacés du Massachusetts. Elle redonne chair et souffle à Tituba, l'une des sorcières des célèbres procès de Salem, à la fin du XVIIème siècle.
Condé veut rendre sa belle innocence à l'impétueuse, naïve, ingénieuse et sensuelle Tituba. Ces épithètes, l'héroïne les partagent avec le style de l'ouvrage, à la fois très abordable et marqué d'un style personnel à l'auteure.
La personnalité de Tituba, sorcière, dont les procès verbaux exacts sont retranscrits par Condé, est très bien campée, nous avons une femme d'un grand courage, d'une bonté et compassion naturelles, lesquelles sont mises à rude épreuve… Mais avant tout et une amoureuse de la vie, pour qui faire l'amour, être auprès d'un homme (ou d'une femme…) est comme prendre un congé presque mystique de l'enfer de son existence.
A travers cette histoire, Condé explore immanquablement la mémoire de sa Guadeloupe, elle dont la famille n'abordait jamais les tourments de l'esclavage. Mais, généreuse, elle veut embrasser dans son roman, mettre en lumière toutes les minorités et leurs oppressions celle des noirs bien sûr, mais aussi des femmes, et des juifs.
Un roman divertissant, entre récit de voyage et d'aventure, roman historique et portrait d'une affranchie qui veut parler à notre époque.
Qu'en pensez-vous ?
L'écrivaine française lauréate du Prix Nobel de Littérature alternatif, nous offre une ensorcelante aventure de la Barbade, perle des Caraïbes, aux bois sombres et glacés du Massachusetts. Elle redonne chair et souffle à Tituba, l'une des sorcières des célèbres procès de Salem, à la fin du XVIIème siècle.
Condé veut rendre sa belle innocence à l'impétueuse, naïve, ingénieuse et sensuelle Tituba. Ces épithètes, l'héroïne les partagent avec le style de l'ouvrage, à la fois très abordable et marqué d'un style personnel à l'auteure.
La personnalité de Tituba, sorcière, dont les procès verbaux exacts sont retranscrits par Condé, est très bien campée, nous avons une femme d'un grand courage, d'une bonté et compassion naturelles, lesquelles sont mises à rude épreuve… Mais avant tout et une amoureuse de la vie, pour qui faire l'amour, être auprès d'un homme (ou d'une femme…) est comme prendre un congé presque mystique de l'enfer de son existence.
A travers cette histoire, Condé explore immanquablement la mémoire de sa Guadeloupe, elle dont la famille n'abordait jamais les tourments de l'esclavage. Mais, généreuse, elle veut embrasser dans son roman, mettre en lumière toutes les minorités et leurs oppressions celle des noirs bien sûr, mais aussi des femmes, et des juifs.
Un roman divertissant, entre récit de voyage et d'aventure, roman historique et portrait d'une affranchie qui veut parler à notre époque.
Qu'en pensez-vous ?
Le coeur a rire et à pleurer est un tout petit livre - à peine 150 pages - où Maryse Condé nous raconte son enfance dans la Guadeloupe des années 1940 et 1950.
Un livre beaucoup trop bref à mon goût (j'aurais préféré plutôt quatre tomes comme l'a fait Patrick Chamoiseau sur son enfance en Martinique), mais un livre très plaisant à lire.
L'écriture de Maryse Condé est fluide et agréable. Pour qui connaît un peu la Guadeloupe, ou y vit (comme moi) on suit la jeune Maryse dans le Pointe à Pitre de l'après guerre et du début des années 50.
A ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur la Guadeloupe an tan lontan - comme on dit ici - je recommande tout particulièrement Victoire, les saveurs et les mots, du même auteur, sur la vie de sa grand-mère marie-galantaise, à l'écriture magnifique également.
Un livre beaucoup trop bref à mon goût (j'aurais préféré plutôt quatre tomes comme l'a fait Patrick Chamoiseau sur son enfance en Martinique), mais un livre très plaisant à lire.
L'écriture de Maryse Condé est fluide et agréable. Pour qui connaît un peu la Guadeloupe, ou y vit (comme moi) on suit la jeune Maryse dans le Pointe à Pitre de l'après guerre et du début des années 50.
A ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur la Guadeloupe an tan lontan - comme on dit ici - je recommande tout particulièrement Victoire, les saveurs et les mots, du même auteur, sur la vie de sa grand-mère marie-galantaise, à l'écriture magnifique également.
Hubert Gagneur est un mulâtre (1) guadeloupéen à qui son béké (2) de père a légué "L'Engoulvent", domaine isolé, prétentieux mais décrépit et battu par les vents. Depuis le décès de son épouse, il élève seul ses deux enfants, Justin et Cathy.
De retour d'une visite en ville, il ramène un jour un petit garçon trouvé dans les roseaux, noir comme l'ébène, qu'il prénomme Razyé.
Il se passionne rapidement pour le jeune orphelin, dont la vivacité le fascine, et avec lequel il passe beaucoup de temps. Inévitablement, Justin devient jaloux de l'attention que Razyé suscite chez son père, d'autant plus que ce dernier a également noué avec Cathy une relation fusionnelle et trouble dont il est exclus.
Quelques années plus tard, à la mort d'Hubert, Justin fait payer à Razyé l'indifférence qu'il a subie. Il le chasse de l'Engoulvent, puis, ayant pris soin d'acquérir un minimum d'instruction, il épouse Marie-France, une béké dont les parents ont accepté cette union en sachant que la jeune femme, gravement malade, ne vivra pas longtemps.
Quant à Cathy, elle fait la connaissance d'Aymeric, cousin de sa récente belle-sœur, qui, séduit par la beauté sauvage et la spontanéité de la jeune Gagneur, la demande en mariage, avec succès.
Fou de jalousie, anéanti par la trahison de celle qu'il considère comme son âme sœur, Razyé fuit la Guadeloupe, au grand désespoir de Cathy...
Si cette histoire vous semble familière, c'est normal...
Oui, Maryse Condé s'est bien inspirée du célèbre roman d'Emily Brontë, "Les Hauts de Hurlevent", pour écrire "La migration des cœurs". Son récit n'en est pas pour autant une pâle copie ou un vulgaire plagiat, mais bien une œuvre à part entière, avec son caractère propre.
En transposant l'histoire inventée par Emily Brontë dans les Caraïbes de la fin du XIXème, début du XXème siècle, elle la colore d'un contexte bien particulier.
L'abolition de l'esclavage est encore trop récente pour que la condition des noirs, misérables et souvent illettrés, ait véritablement évolué. Cantonnés aux métiers pénibles, ils sont toujours au service de blancs qui possèdent la plupart des terres et des usines caribéennes. C'est pourquoi la révolte gronde, la cause noire et la cause ouvrière se mêlant avec l'émergence des mouvements syndicaux.
Le racisme et la haine sont omniprésents, les différentes communautés -noire, blanche, et indienne, notamment- limitent les contacts au strict minimum, qui va de la nécessité pour certains colons à assouvir des besoins sexuels que leurs épouses légitimes sont incapables d'étancher, au recrutement de main d’œuvre à bas prix pour travailler dans les champs de cannes ou de tabac...
Ce qui fait aussi la particularité du roman de Maryse Condé, c'est son atmosphère, à la fois sensuelle et vénéneuse. L'environnement naturel, tantôt exubérant et généreux, tantôt violent et mortel, y participe pour beaucoup, mais il n'est pas le seul. La culture caribéenne, dont les traditions se nourrissent des apports des populations multiples et variées qui y vivent ou y ont vécu, où sorcellerie et superstition chrétienne parviennent à faire bon ménage, nourrit aussi l'ambiance du récit, qui en acquiert un caractère inquiétant, presque surnaturel.
Que vous ayez lu ou pas "Les Hauts de Hurlevent", ne passez pas à côté de "La migration des cœurs". C'est un roman passionnant, riche, dont les personnages haut en couleurs n'ont rien à envier aux héros d'Emily Brontë !
>> Un autre titre pour découvrir Maryse Condé :
"Histoire de la femme cannibale".
(1) Métis né d'un père noir et d'une mère blanche, ou d'un père blanc et d'une mère noire.
(2) Antillais non issu de métissage, descendant direct des premiers colons blancs.
Lien : https://bookin-ingannmic.blo..
De retour d'une visite en ville, il ramène un jour un petit garçon trouvé dans les roseaux, noir comme l'ébène, qu'il prénomme Razyé.
Il se passionne rapidement pour le jeune orphelin, dont la vivacité le fascine, et avec lequel il passe beaucoup de temps. Inévitablement, Justin devient jaloux de l'attention que Razyé suscite chez son père, d'autant plus que ce dernier a également noué avec Cathy une relation fusionnelle et trouble dont il est exclus.
Quelques années plus tard, à la mort d'Hubert, Justin fait payer à Razyé l'indifférence qu'il a subie. Il le chasse de l'Engoulvent, puis, ayant pris soin d'acquérir un minimum d'instruction, il épouse Marie-France, une béké dont les parents ont accepté cette union en sachant que la jeune femme, gravement malade, ne vivra pas longtemps.
Quant à Cathy, elle fait la connaissance d'Aymeric, cousin de sa récente belle-sœur, qui, séduit par la beauté sauvage et la spontanéité de la jeune Gagneur, la demande en mariage, avec succès.
Fou de jalousie, anéanti par la trahison de celle qu'il considère comme son âme sœur, Razyé fuit la Guadeloupe, au grand désespoir de Cathy...
Si cette histoire vous semble familière, c'est normal...
Oui, Maryse Condé s'est bien inspirée du célèbre roman d'Emily Brontë, "Les Hauts de Hurlevent", pour écrire "La migration des cœurs". Son récit n'en est pas pour autant une pâle copie ou un vulgaire plagiat, mais bien une œuvre à part entière, avec son caractère propre.
En transposant l'histoire inventée par Emily Brontë dans les Caraïbes de la fin du XIXème, début du XXème siècle, elle la colore d'un contexte bien particulier.
L'abolition de l'esclavage est encore trop récente pour que la condition des noirs, misérables et souvent illettrés, ait véritablement évolué. Cantonnés aux métiers pénibles, ils sont toujours au service de blancs qui possèdent la plupart des terres et des usines caribéennes. C'est pourquoi la révolte gronde, la cause noire et la cause ouvrière se mêlant avec l'émergence des mouvements syndicaux.
Le racisme et la haine sont omniprésents, les différentes communautés -noire, blanche, et indienne, notamment- limitent les contacts au strict minimum, qui va de la nécessité pour certains colons à assouvir des besoins sexuels que leurs épouses légitimes sont incapables d'étancher, au recrutement de main d’œuvre à bas prix pour travailler dans les champs de cannes ou de tabac...
Ce qui fait aussi la particularité du roman de Maryse Condé, c'est son atmosphère, à la fois sensuelle et vénéneuse. L'environnement naturel, tantôt exubérant et généreux, tantôt violent et mortel, y participe pour beaucoup, mais il n'est pas le seul. La culture caribéenne, dont les traditions se nourrissent des apports des populations multiples et variées qui y vivent ou y ont vécu, où sorcellerie et superstition chrétienne parviennent à faire bon ménage, nourrit aussi l'ambiance du récit, qui en acquiert un caractère inquiétant, presque surnaturel.
Que vous ayez lu ou pas "Les Hauts de Hurlevent", ne passez pas à côté de "La migration des cœurs". C'est un roman passionnant, riche, dont les personnages haut en couleurs n'ont rien à envier aux héros d'Emily Brontë !
>> Un autre titre pour découvrir Maryse Condé :
"Histoire de la femme cannibale".
(1) Métis né d'un père noir et d'une mère blanche, ou d'un père blanc et d'une mère noire.
(2) Antillais non issu de métissage, descendant direct des premiers colons blancs.
Lien : https://bookin-ingannmic.blo..
Stephen a lâchement abandonné Rosélie, après 20 ans de vie commune, en se faisant assassiner dans une rue du Cap alors qu'il était parti acheter des cigarettes... C'est du moins ainsi que le ressent Rosélie : le décès de son compagnon la laisse complètement démunie. Le fait de se retrouver seule est une épreuve profondément intime et déstructurante ; elle ne peut plus se définir comme l'élément d'un couple, et doit s'interroger sur celle qu'elle est vraiment, afin d'exister au monde comme une personne à part entière... Il faut dire que Rosélie est une héroïne qui pourrait a priori sembler insignifiante. Elle-même s'imagine comme une "invisible woman", d'après ce qu'elle lit dans le regard indifférent, voire condescendant, que les autres lui accordent. Et le fait qu'elle soit noire (guadeloupéenne, pour être plus précise) n'aide pas ! Dans cette Afrique du Sud post-apartheid, les préjugés ont la vie dure. Du vivant de Stephen, qui lui, était blanc, combien de fois a-t-elle déjà du affronter le mépris des membres de leurs communautés respectives, outrés par cette union mixte ?
Et puis Rosélie manque de présence, de charisme, d'ambition. Elle n'a d'opinion sur rien, ne milite pour aucune cause, ne se sent pas spécialement fière d'être noire, ni d'être femme. Elle n'a d'ailleurs jamais eu d'enfant car la maternité "l’écœure"... Elle a bien un "don", pour guérir ceux qui souffrent d'insomnie, d'angoisses ou de traumatismes, mais elle ne s'est remise à l'exploiter qu'au moment où elle a eu besoin de gagner sa vie. Son seul centre d'intérêt semble être la peinture, art qu'elle pratique de façon instinctive.
En conclusion, Rosélie EST, sans chercher un instant à le revendiquer. Elle RESSENT, plus qu'elle ne raisonne. Elle VIT, sans se soucier de savoir si elle le fait en accord avec les codes établis ou une quelconque morale. Et parce qu'elle ne se réclame d'aucune terre, d'aucune race, d'aucun mouvement, elle ne paraît pas digne d'intérêt. D'apparence passive, c'est une femme dont nous découvrons pourtant peu à peu la richesse intérieure.
J'ai bien aimé, moi, Rosélie, et cette "Histoire de la femme cannibale". Au départ, l'écriture de Maryse Condé m'a un peu désarçonnée : on a parfois du mal à distinguer ce que dit l'héroïne de ce qu'elle pense seulement (cela donne à certains moments de drôles de dialogues), et c'est souvent sans transition que l'on passe du présent à ses souvenirs. Mais une fois accoutumée à ces particularités, j'ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture.
Au-delà de son personnage principal, c'est aussi une sorte d'état des lieux de la condition africaine que dresse l'auteure. En Afrique du sud, où se déroule ce roman, nombreux sont ceux qui ont immigré pour fuir des dictatures, des pays en proie à la guerre et à la violence. Elle mentionne aussi les fléaux que sont la délinquance, le sida, la pauvreté, et qui déciment pour l'essentiel les populations noires. Et puis le racisme est également omniprésent dans ce récit, sous formes diverses, plus ou moins pernicieuses...
Ceci dit j'avoue que l' "Histoire de la femme cannibale" restera surtout pour moi celle de Rosélie, femme discrète mais pas si banale, remarquable par son intime conviction de l'universalité de l'Homme.
Guadeloupe Mémorables héroïnes Romans
Lien : https://bookin-ingannmic.blo..
Et puis Rosélie manque de présence, de charisme, d'ambition. Elle n'a d'opinion sur rien, ne milite pour aucune cause, ne se sent pas spécialement fière d'être noire, ni d'être femme. Elle n'a d'ailleurs jamais eu d'enfant car la maternité "l’écœure"... Elle a bien un "don", pour guérir ceux qui souffrent d'insomnie, d'angoisses ou de traumatismes, mais elle ne s'est remise à l'exploiter qu'au moment où elle a eu besoin de gagner sa vie. Son seul centre d'intérêt semble être la peinture, art qu'elle pratique de façon instinctive.
En conclusion, Rosélie EST, sans chercher un instant à le revendiquer. Elle RESSENT, plus qu'elle ne raisonne. Elle VIT, sans se soucier de savoir si elle le fait en accord avec les codes établis ou une quelconque morale. Et parce qu'elle ne se réclame d'aucune terre, d'aucune race, d'aucun mouvement, elle ne paraît pas digne d'intérêt. D'apparence passive, c'est une femme dont nous découvrons pourtant peu à peu la richesse intérieure.
J'ai bien aimé, moi, Rosélie, et cette "Histoire de la femme cannibale". Au départ, l'écriture de Maryse Condé m'a un peu désarçonnée : on a parfois du mal à distinguer ce que dit l'héroïne de ce qu'elle pense seulement (cela donne à certains moments de drôles de dialogues), et c'est souvent sans transition que l'on passe du présent à ses souvenirs. Mais une fois accoutumée à ces particularités, j'ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture.
Au-delà de son personnage principal, c'est aussi une sorte d'état des lieux de la condition africaine que dresse l'auteure. En Afrique du sud, où se déroule ce roman, nombreux sont ceux qui ont immigré pour fuir des dictatures, des pays en proie à la guerre et à la violence. Elle mentionne aussi les fléaux que sont la délinquance, le sida, la pauvreté, et qui déciment pour l'essentiel les populations noires. Et puis le racisme est également omniprésent dans ce récit, sous formes diverses, plus ou moins pernicieuses...
Ceci dit j'avoue que l' "Histoire de la femme cannibale" restera surtout pour moi celle de Rosélie, femme discrète mais pas si banale, remarquable par son intime conviction de l'universalité de l'Homme.
Guadeloupe Mémorables héroïnes Romans
Lien : https://bookin-ingannmic.blo..
Etant passée à côté du livre, j'ai tenté de lire le Profil pour mieux comprendre ce qui m'avait échappé, mais j'ai été une nouvelle fois déçue.
Le Profil commente beaucoup le contexte historique, politique et biographique (que je connaissais et que j'avais compris), et très peu le texte en lui-même (sur lequel j'avais buté).
Le Profil commente beaucoup le contexte historique, politique et biographique (que je connaissais et que j'avais compris), et très peu le texte en lui-même (sur lequel j'avais buté).
Après avoir lu "le cœur à rire et à pleurer", où Maryse Condé employait ses talents de conteuse au service de sa propre histoire, je viens de terminer "Moi, Tituba sorcière...", roman de 273 pages où elle fait entendre la voix d'une esclave née à la Barbade d'une mère violée par un marin anglais sur un vaisseau négrier. Il sera ensuite question des tristement célèbres procès des sorcières de Salem en 1692, mais ils ne constituent pas l'essentiel d'un récit qui embrassent d'autres questions : droits des femmes, critique de l'antisémitisme et de la ségrégation raciale, du puritanisme et des lettres écarlates. Dans un style puissant, parfois lyrique, Maryse Condé évoque la plupart des maux qui rongent ou ont rongé l'Amérique, hormis le massacre des Indiens, à travers la voix d'une femme qui se voudrait libre mais finit toujours victime de son attirance pour les hommes : on ne reprocherait jamais à un homme d'aimer et on ne lui ferait jamais porter une lettre écarlate en cas d'adultère. À travers son héroïne, Maryse Condé tire à boulets rouges sur la société tout entière dans un roman par ailleurs mouvementé. Étonnant que ce roman français ne soit pas d'ores et déjà plus célèbre et ne fasse pas figure de classique.
Lien : https://www.instagram.com/fo..
Lien : https://www.instagram.com/fo..
Je suis malheureuse de l'admettre tant j'aurais aimé pouvoir encenser ce roman de la grande écrivaine Maryse Condé qui traite de la condition de femme noire esclave et en dénonce toute la violence. Et pourtant, j'ai beau être en total accord avec la pensée de l'auteure, je n'ai pas vraiment apprécié cette lecture. On découvre sous la plume de Maryse Condé une Tituba un brin nympho qui pour les beaux yeux de John Indien troque sa liberté contre l'asservissement. Et pourtant c'est une femme intelligente, qui sait dialoguer avec les puissances invisibles puisqu'elle est la digne héritière d'une lignée de guérisseuses. Déjà, là ça coince. Et puis, il y a cette diabolisation constante des hommes blancs dans le texte qui m'a aussi pas mal gênée. Heureusement, j'ai bien aimé les passages où Tituba se connecte avec les esprits ou elle a du recul sur elle même et la frivolité qui l'a conduite à se faire volontairement esclave. Mais globalement, j'ai eu beaucoup de mal à finir, raison pour laquelle cette lecture a autant traîné.
Une merveilleuse histoire fantastique! Les victimes de la chasse aux sorcières n'ont toutes jamais été coupables de sorcellerie telles ont été souvent rapportées des accusations. C'est de même avec Tituba accusée à tort de sorcière et d'empoisonneuse à Salem, simplement parce qu'elle est une femme douée, pleine de connaissances, surtout de celles de la nature;, et elle manifeste un esprit de liberté assez aberrant pour l'époque. Il y a aussi son passé qui la poursuit comme une charge électrique sous ses pieds .. eh oui sa mère, jugée d'avoir un esprit beaucoup trop rebelle, a été décapitée. Recueillie par une guérisseuse, c'est avec elle que Tituba apprendra le secret de la nature...
J'ai beaucoup aimée cette belle écriture de Maryse Condé, à la fois majestueuse et truffée des faits historiques très intéressants,.
J'ai beaucoup aimée cette belle écriture de Maryse Condé, à la fois majestueuse et truffée des faits historiques très intéressants,.
Maryse Condé prend le parti de nous raconter l’histoire des procès de Salem à travers les yeux de Tituba, toujours personnage secondaire chez les auteurs qui l’ont précédée.
L’auteure nous raconte l’histoire de Tituba, née esclave à la Barbade, de sa petite enfance à sa mort – fictive, car l’Histoire n’a gardé aucune trace d’elle après sa sortie de prison. Elle devient vite attachante, peut-être à cause des malheurs qui s’abattent sur elle continuellement, sans doute grâce à un bon cœur qui ne change pas malgré ses envies de vengeance et de rancœur. Elle demeure une guérisseuse qui souhaite aider ceux qui souffrent, les plus faibles, les victimes : les esclaves et les femmes.
Ecrit en 1986, ce récit résonne étrangement avec l’actualité américaine. Car Tituba découvre dès son enfance la malédiction d’être noire : esclave, elle subit cruautés et humiliations ; puis jeune fille, elle découvre la malédiction d’être une femme : promise à la dépendance à l’ombre des hommes.
En nous racontant l’histoire d’une esclave aux Antilles puis en Amériques du 17ème siècle, Maryse Condé nous renvoie subtilement à la situation présente. Car la traite trouve encore des échos dans nos sociétés et les femmes indépendantes – celles visées lors des procès de Salem – sont toujours des cibles de choix.
Une très bonne lecture, donc, malgré les faiblesses de la dernière partie du récit : celui de la fin totalement inventée par l’auteure faute de documentations.
L’auteure nous raconte l’histoire de Tituba, née esclave à la Barbade, de sa petite enfance à sa mort – fictive, car l’Histoire n’a gardé aucune trace d’elle après sa sortie de prison. Elle devient vite attachante, peut-être à cause des malheurs qui s’abattent sur elle continuellement, sans doute grâce à un bon cœur qui ne change pas malgré ses envies de vengeance et de rancœur. Elle demeure une guérisseuse qui souhaite aider ceux qui souffrent, les plus faibles, les victimes : les esclaves et les femmes.
Ecrit en 1986, ce récit résonne étrangement avec l’actualité américaine. Car Tituba découvre dès son enfance la malédiction d’être noire : esclave, elle subit cruautés et humiliations ; puis jeune fille, elle découvre la malédiction d’être une femme : promise à la dépendance à l’ombre des hommes.
En nous racontant l’histoire d’une esclave aux Antilles puis en Amériques du 17ème siècle, Maryse Condé nous renvoie subtilement à la situation présente. Car la traite trouve encore des échos dans nos sociétés et les femmes indépendantes – celles visées lors des procès de Salem – sont toujours des cibles de choix.
Une très bonne lecture, donc, malgré les faiblesses de la dernière partie du récit : celui de la fin totalement inventée par l’auteure faute de documentations.
Excellent bouquin! On est plongé tout de suite dans l'atmosphère mystique du roman avec ses paysages luxuriants, ses personnages tourmentés et malheureux. L'écriture est percutante et suscite l'émotion comme toujours avec Maryse Condé.
Un roman assez complexe dans sa structure, un enchevêtrement de témoignages, qui n'est pas sans rappeler l'excellent Texaco de Patrick Chamoiseau publié un an plus tard. On est entre roman détective et fresque sociale de la Guadeloupe, mon île natale. Le nombre de personnages m'a un peu désorienté cette fois, je n'ai pas accroché autant qu'avec la saga de Ségou et Tituba, moi sorcière.
Un roman assez complexe dans sa structure, un enchevêtrement de témoignages, qui n'est pas sans rappeler l'excellent Texaco de Patrick Chamoiseau publié un an plus tard. On est entre roman détective et fresque sociale de la Guadeloupe, mon île natale. Le nombre de personnages m'a un peu désorienté cette fois, je n'ai pas accroché autant qu'avec la saga de Ségou et Tituba, moi sorcière.
Critique globale pour les deux tomes, le découpage ne semblant être qu'éditorial...
"Il faut que tout change pour que rien ne change" est une phrase qui revient en boucle dans le Guépard. Oui, je sais bien que ce n'est pas du tout le même contexte géographique et historique. Mais cette phrase signifie que malgré les bouleversements politiques, religieux, les guerres, les guerres civiles, les déchirures dans les familles, les souffrances des femmes pendant que les hommes combattent, les élites économiques et politiques retrouveront leur place, peut-être sous un autre nom, mais les inégalités se perpétueront.
Et c'est l'impression que j'ai eu à lire cette fresque qui s'étend sur plusieurs générations - quitte à m'y perdre un peu d'ailleurs dans les personnages et leurs liens de parenté, et à trouver un manque de profondeur de plus en plus important aux personnages, là où Nya par exemple avait du caractère, les autres femmes qui apparaissent ensuite dans l'intrigue sont plus effacées. L'intrigue est donc pour moi trop longue, avec des répétitions. Et surtout, j'ai eu le sentiment que l'autrice voulait "tout" caser : chasseurs, commerçants à travers tout le Sahara, arrivée de l'islam, esclaves dans les plantations brésiliennes, missions chrétiennes, explorateurs anglais... Cela donne une impression de trop-plein, plutôt irréaliste que tout ceci arrive aux personnages de la même famille.
Mais la grande réussite, c'est le cadre de l'intrigue, son décor et son époque, la rencontre entre plusieurs mondes, ou plutôt, la domination d'un monde, l'Europe coloniale, sur un autre lui-même fracturé entre ethnies et surtout entre religions. Car ce n'est pas l'Afrique au début de la traite atlantique, mais celle de la fin du XVIIIème et du début du XIXème : la Révolution française a ses conséquences sur les territoires, les Anglais interdisent - officiellement - la traite et rapatrient d'anciens esclaves, les marchandises circulent de plus, dans tous les sens. C'est la reconstitution minutieuse et érudite jusqu'aux détails des objets qui s'imposent dans les cases que j'ai particulièrement appréciée. Un bon complément à un de mes cours de cette année sur le patrimoine malien, déjà au XIXème siècle menacé par une vision intégriste de la religion, et encore plus aujourd'hui.
"Il faut que tout change pour que rien ne change" est une phrase qui revient en boucle dans le Guépard. Oui, je sais bien que ce n'est pas du tout le même contexte géographique et historique. Mais cette phrase signifie que malgré les bouleversements politiques, religieux, les guerres, les guerres civiles, les déchirures dans les familles, les souffrances des femmes pendant que les hommes combattent, les élites économiques et politiques retrouveront leur place, peut-être sous un autre nom, mais les inégalités se perpétueront.
Et c'est l'impression que j'ai eu à lire cette fresque qui s'étend sur plusieurs générations - quitte à m'y perdre un peu d'ailleurs dans les personnages et leurs liens de parenté, et à trouver un manque de profondeur de plus en plus important aux personnages, là où Nya par exemple avait du caractère, les autres femmes qui apparaissent ensuite dans l'intrigue sont plus effacées. L'intrigue est donc pour moi trop longue, avec des répétitions. Et surtout, j'ai eu le sentiment que l'autrice voulait "tout" caser : chasseurs, commerçants à travers tout le Sahara, arrivée de l'islam, esclaves dans les plantations brésiliennes, missions chrétiennes, explorateurs anglais... Cela donne une impression de trop-plein, plutôt irréaliste que tout ceci arrive aux personnages de la même famille.
Mais la grande réussite, c'est le cadre de l'intrigue, son décor et son époque, la rencontre entre plusieurs mondes, ou plutôt, la domination d'un monde, l'Europe coloniale, sur un autre lui-même fracturé entre ethnies et surtout entre religions. Car ce n'est pas l'Afrique au début de la traite atlantique, mais celle de la fin du XVIIIème et du début du XIXème : la Révolution française a ses conséquences sur les territoires, les Anglais interdisent - officiellement - la traite et rapatrient d'anciens esclaves, les marchandises circulent de plus, dans tous les sens. C'est la reconstitution minutieuse et érudite jusqu'aux détails des objets qui s'imposent dans les cases que j'ai particulièrement appréciée. Un bon complément à un de mes cours de cette année sur le patrimoine malien, déjà au XIXème siècle menacé par une vision intégriste de la religion, et encore plus aujourd'hui.
J'ai beaucoup aimé ce livre qui se passe au XVIIIe siècle au Mali, dans le royaume de Ségou. D'un côté les Blancs, d'un autre l'Isam, tous veulent, à couvert de faire découvrir la vrais Foi, mettre la main sur les richesses de cette région d'Afrique.
Le lecteur suit les destinées d'une famille Bambara, les troré, en particuier des fils.
L'auteure ne porte pas de jugements de valeur. Simplement, elle raconte... L'histoire est trop dense et impossible à résumer, quelquefois on se perd un peu dans tous les nombreux personnages... Mais on ne parvient pas à lâcher ce livre, qui nous touche vraiment et ne nous laisse pas indifférents. Ça nous fait réléchir à tous ces évènements et leur vraie motivation!
J'ai lu Ségou pour la première fois dans les années 80. Mintenant je l'ai repris et relu avec le même bonheur et la même indignation.
Je le recommande vivement!
Le lecteur suit les destinées d'une famille Bambara, les troré, en particuier des fils.
L'auteure ne porte pas de jugements de valeur. Simplement, elle raconte... L'histoire est trop dense et impossible à résumer, quelquefois on se perd un peu dans tous les nombreux personnages... Mais on ne parvient pas à lâcher ce livre, qui nous touche vraiment et ne nous laisse pas indifférents. Ça nous fait réléchir à tous ces évènements et leur vraie motivation!
J'ai lu Ségou pour la première fois dans les années 80. Mintenant je l'ai repris et relu avec le même bonheur et la même indignation.
Je le recommande vivement!
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Maryse Condé
Quiz
Voir plus
Bougies et compagnie
Qu'utilisait-on pendant longtemps pour éclairer avant que ne soit inventée la lampe à huile et la bougie ?
la lampe à pétrole
le jonc
la laine
un morceau de bois
11 questions
46 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, ÉclairageCréer un quiz sur cet auteur46 lecteurs ont répondu