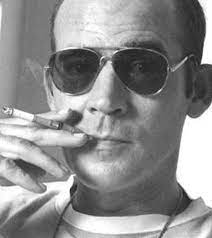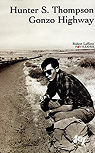Critiques de Hunter S. Thompson (86)
Dernier « réel » livre du plus génialement incompétent journaliste de l’histoire (hors compilations d’articles ou d’interviews), illustré à nouveau par son talentueux acolyte et souffre-douleur anglais Ralph Steadman, « The Curse of Lono » sort en 1983 alors que les meilleures années du Gonzo Journalism sont derrière eux…
…
(et si vous ne savez pas de quoi je parle, une mise à niveau est fortement conseillée, le plus simple étant le visionnage du film « Las Vegas Parano »)
…
Sa naissance fut terriblement chaotique, achevant malheureusement de démontrer les difficultés grandissantes de l’auteur à écrire quoi que ce soit de structuré…
L’histoire veut que son éditeur ait fini par en voler le manuscrit, constitué de fragments sur divers morceaux de papier, pour assembler ce qui deviendra un « presque-livre » très mal reçu par la critique, ré-édité seulement après le suicide de Thompson en 2005 dans une édition limitée signée par Steadman, faisant de cet objet, à défaut d’une oeuvre littéraire correctement torchée, une pièce de collectionneurs.
…
Les éditions Tristram, à qui l’on doit déjà certaines sorties récentes du Docteur Gonzo (chaque fois avec un graphisme de couverture plus que douteux… du genre : « Waaa ! on-est-défoncé-trop-cool-j’en-ai-jamais-pris ») vont nous la rendre disponible dans une version expurgée de ses illustrations, cette fois-ci avec une photo de couverture sachant rester sobre.
…
La tentation de cantonner ce livre aux sorties « réservées aux fans » ne doit pas faire oublier le bonheur de retrouver ces authentiques morceaux de bravoure, maintes fois imités sans jamais être égalés, fantôme vivant de la presse branchouille mondiale.
…
Certains passages ont failli me clouer définitivement au parquet, transformant en rires cinglés le peu de respiration qu’il me restait…
Merde, j’en pleure encore… que c’est bon !
…
(et si vous ne savez pas de quoi je parle, une mise à niveau est fortement conseillée, le plus simple étant le visionnage du film « Las Vegas Parano »)
…
Sa naissance fut terriblement chaotique, achevant malheureusement de démontrer les difficultés grandissantes de l’auteur à écrire quoi que ce soit de structuré…
L’histoire veut que son éditeur ait fini par en voler le manuscrit, constitué de fragments sur divers morceaux de papier, pour assembler ce qui deviendra un « presque-livre » très mal reçu par la critique, ré-édité seulement après le suicide de Thompson en 2005 dans une édition limitée signée par Steadman, faisant de cet objet, à défaut d’une oeuvre littéraire correctement torchée, une pièce de collectionneurs.
…
Les éditions Tristram, à qui l’on doit déjà certaines sorties récentes du Docteur Gonzo (chaque fois avec un graphisme de couverture plus que douteux… du genre : « Waaa ! on-est-défoncé-trop-cool-j’en-ai-jamais-pris ») vont nous la rendre disponible dans une version expurgée de ses illustrations, cette fois-ci avec une photo de couverture sachant rester sobre.
…
La tentation de cantonner ce livre aux sorties « réservées aux fans » ne doit pas faire oublier le bonheur de retrouver ces authentiques morceaux de bravoure, maintes fois imités sans jamais être égalés, fantôme vivant de la presse branchouille mondiale.
…
Certains passages ont failli me clouer définitivement au parquet, transformant en rires cinglés le peu de respiration qu’il me restait…
Merde, j’en pleure encore… que c’est bon !
J’avais envie d'une virée avec ces Anges de l'enfer en mode gonzo. Cette rencontre s'est révélée tenir moins du roman que du journalisme ultra-subjectif, une expérience rapportée. Pour Hunter S. Thomson, l'objectivité des journalistes est une légende, un mensonge vendu pour de la vérité. Selon ce journaliste frondeur, qui sait comme l'information peut être déformée, le meilleur moyen de rétablir la vérité est de vivre l'aventure que l'on décrit. Car si le récit en sort éminemment subjectif, décrivant ce que l'auteur a vu et ressenti, il constitue au moins sa vérité à lui, et donc une forme de vérité, contrairement à la plupart des papiers régulièrement déformés pour correspondre à ce que veut le lectorat, l'éditeur, le pouvoir politique… Ainsi, le journaliste doit être l'un des protagonistes de son reportage, qu'il écrit à la première personne. Raconter ce gang de motards, pour HS Thomson, c'est donc d'abord l'infiltrer… à ses risques et périls !
J'avais aimé le style sans filtre d'Hunter THOMSON dans son recueil de correspondances « Gonzo Highway ». Je me disais que ce genre de plume racontant les Hell's Angels, ça pouvait dépoter, brosser de jolis portraits ! Après avoir lu l'Acide test de Tom Wolfe, issu de la vague du nouveau journalisme et qui plonge son lecteur au coeur de ses délires les plus fous, je m'attendais à du lourd. Eh bien non. Sur la forme, la plume est alerte mais presque policée ou bridée, comme si, au fond, elle ne donnait qu'une partie de sa vision des faits. L'auteur s'appuie sur des articles de presse, les compare avec des écrits de justice, des témoignages de Hell's Angels, ainsi qu'à sa propre expérience. Les mêlant, il prétend faire la lumière sur la réputation de ce gang de motards, qui serait déformée par les journaux. Il imbrique les points de vue pour nous faire sentir dans un palais des glaces, avec des miroirs grossissants, amincissants, ondulants ; Et ces différents points du vue, ces différents reflets d'une même réalités, sont réfléchis, repensés par notre cerveau qui s'en fait son image de ce qu'il pense approcher la vérité, cette « réalité objective » dont on a du mal à vouloir se défaire.
Pour cela, l'auteur colle aux faits : de la statistique, de la mécanique, de la stylistique du gang, de l'art d'éviter les flics sur la route, de nier ce que les journalistes disent sur le gang, mais de dérouiller ceux qui en douteraient… Mon ressenti, c'est qu'au fond, on n'est pas plus fixé après qu'avant, et on en oublie un peu les personnages principaux : J'aurais trouvé intéressant de rencontrer les individus qui se cachent derrière leurs noms de clan (Zorro, Petit Jésus, Minus, le Parano, Terry le Clodo, Ed le Dégueulasse, la Brute…), leurs barbes décolorées, leurs tatouages et leurs piercings. J'étais venue faire leur connaissance mais ils demeurent en toile de fond : on approche plus le gang en tant qu'entité. Ça se défend, dans la mesure où leur devise est « Un pour tous, tous pour un » : Ce gang existe pour qu'aucun d'entre eux ne soit seul ; Il fait peur parce qu'aucun d'entre eux n'est seul ; Ils survivent parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils font front ensemble face à une société qui les a, selon eux, rejetés comme étant des moins que rien, et qu'ils rejettent à leur tour en ignorant ses lois, ne suivant que les leurs. Mais ça me laisse une impression de survol.
Pour partie, je comprends ce choix : D'une part, si les Angels attendaient une chose de Thomson c'était « la vérité », ou du moins « leur vérité », par opposition à ce que les journaux et flics disaient d'eux ; D'autre part, il était difficile d'écrire des choses personnelles sur chacun sachant que tous allaient les lire. Enfin, l'auteur se méfiait certainement de ce qu'il écrivait sur ces personnages à la dérouille facile, car si l'emblème du gonzo est un poing à deux pouces, ceux des Hell's Angels sont réels et aguerris, comme Thomson en a fait les frais pour de vrai… Cependant, si je referme l'ouvrage avec quelques images crédibles de l'ambiance, c'est également avec le souvenir de quelques moments d'ennui, et surtout la déception d'être restée sur ma faim, de n'avoir pas appris grand chose : Pour m'intéresser à eux, j'aurais aimé les toucher de la plume, même s'il vaut mieux éviter de les chatouiller. Pour le coup, j'ai trouvé son journalisme subjectif un peu trop objectif et superficiel, à mon goût, contrairement à l'Acide test de Tom Wolfe : Lui avait su à la fois conserver sa vison journalistique, et m'immerger totalement dans le monde qu'il décrivait. J'espère donc que Las Vegas Parano sera moins sagement descriptif, Monsieur Raoul Duke ! En attendant, moi, je rêve juste de liberté avec Loevenbruck…
« le reportage gonzo allie la plume d'un maître-reporter, le talent d'un photographe de renom et les couilles en bronze d'un acteur. » (Hunter S. Thompson)
J'avais aimé le style sans filtre d'Hunter THOMSON dans son recueil de correspondances « Gonzo Highway ». Je me disais que ce genre de plume racontant les Hell's Angels, ça pouvait dépoter, brosser de jolis portraits ! Après avoir lu l'Acide test de Tom Wolfe, issu de la vague du nouveau journalisme et qui plonge son lecteur au coeur de ses délires les plus fous, je m'attendais à du lourd. Eh bien non. Sur la forme, la plume est alerte mais presque policée ou bridée, comme si, au fond, elle ne donnait qu'une partie de sa vision des faits. L'auteur s'appuie sur des articles de presse, les compare avec des écrits de justice, des témoignages de Hell's Angels, ainsi qu'à sa propre expérience. Les mêlant, il prétend faire la lumière sur la réputation de ce gang de motards, qui serait déformée par les journaux. Il imbrique les points de vue pour nous faire sentir dans un palais des glaces, avec des miroirs grossissants, amincissants, ondulants ; Et ces différents points du vue, ces différents reflets d'une même réalités, sont réfléchis, repensés par notre cerveau qui s'en fait son image de ce qu'il pense approcher la vérité, cette « réalité objective » dont on a du mal à vouloir se défaire.
Pour cela, l'auteur colle aux faits : de la statistique, de la mécanique, de la stylistique du gang, de l'art d'éviter les flics sur la route, de nier ce que les journalistes disent sur le gang, mais de dérouiller ceux qui en douteraient… Mon ressenti, c'est qu'au fond, on n'est pas plus fixé après qu'avant, et on en oublie un peu les personnages principaux : J'aurais trouvé intéressant de rencontrer les individus qui se cachent derrière leurs noms de clan (Zorro, Petit Jésus, Minus, le Parano, Terry le Clodo, Ed le Dégueulasse, la Brute…), leurs barbes décolorées, leurs tatouages et leurs piercings. J'étais venue faire leur connaissance mais ils demeurent en toile de fond : on approche plus le gang en tant qu'entité. Ça se défend, dans la mesure où leur devise est « Un pour tous, tous pour un » : Ce gang existe pour qu'aucun d'entre eux ne soit seul ; Il fait peur parce qu'aucun d'entre eux n'est seul ; Ils survivent parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils font front ensemble face à une société qui les a, selon eux, rejetés comme étant des moins que rien, et qu'ils rejettent à leur tour en ignorant ses lois, ne suivant que les leurs. Mais ça me laisse une impression de survol.
Pour partie, je comprends ce choix : D'une part, si les Angels attendaient une chose de Thomson c'était « la vérité », ou du moins « leur vérité », par opposition à ce que les journaux et flics disaient d'eux ; D'autre part, il était difficile d'écrire des choses personnelles sur chacun sachant que tous allaient les lire. Enfin, l'auteur se méfiait certainement de ce qu'il écrivait sur ces personnages à la dérouille facile, car si l'emblème du gonzo est un poing à deux pouces, ceux des Hell's Angels sont réels et aguerris, comme Thomson en a fait les frais pour de vrai… Cependant, si je referme l'ouvrage avec quelques images crédibles de l'ambiance, c'est également avec le souvenir de quelques moments d'ennui, et surtout la déception d'être restée sur ma faim, de n'avoir pas appris grand chose : Pour m'intéresser à eux, j'aurais aimé les toucher de la plume, même s'il vaut mieux éviter de les chatouiller. Pour le coup, j'ai trouvé son journalisme subjectif un peu trop objectif et superficiel, à mon goût, contrairement à l'Acide test de Tom Wolfe : Lui avait su à la fois conserver sa vison journalistique, et m'immerger totalement dans le monde qu'il décrivait. J'espère donc que Las Vegas Parano sera moins sagement descriptif, Monsieur Raoul Duke ! En attendant, moi, je rêve juste de liberté avec Loevenbruck…
« le reportage gonzo allie la plume d'un maître-reporter, le talent d'un photographe de renom et les couilles en bronze d'un acteur. » (Hunter S. Thompson)
Qu'ai-je été fourrer mon nez dans cette Great Red Shark chargée à bloc de toutes les drogues accessibles en l'an de défonce 1971 ( deux sacoches d'herbe, soixante-quinze pastilles de mescaline, cinq feuilles d'acide-buvard, une demi-salière de cocaïne, des remontants, des tranquillisants, des hurlants, des désopilants, un demi-litre d'éther pur et deux douzaines d'ampoules de nitrite d'amyle ) et conduite par deux allumés, deux hallucinés, deux toxicos libertaires émules de Timothy Leary, purs produits du rêve des sixties dans lequel "les tripeurs pouvaient s'offrir pour trois dollars d'acide l'Amour et l'Entente universelle" ?
Une culture héritée de vieux mystiques dont " « la supposition désespérée était que quelqu’un –ou au moins quelque force – entretient la Lumière au bout du tunnel. »
Depuis, beaucoup ont overdosé leurs espoirs et se sont offert le grand voyage... quelques autres ont eu le temps de redescendre.
Donc, nos deux pratiquants de la Culture de l'Acide, nos deux adeptes du reportage gonzo : « Le reportage gonzo conjugue la vivacité de plume du reporter confirmé, l’acuité visuelle du photographe de guerre et les couilles du quaterback au moment du lancer », que sont Raoul Duke, journaliste, et son avocat, Dr Gonzo, sont missionnés pour aller faire un reportage sur le Mint 400, une course de buggy à travers le désert de Las Vegas.
Cette virée, cette épopée est le prétexte fou pour enquêter sur le mythe encore plus fou du Rêve Américain... et quelle ville peut symboliser le mieux le Rêve d'Horatio Alger que Vegas ?
Là, on accroche sa ceinture, on se bourre de Dramamine et on se tape un méga grand huit à fond la caisse.
Ils vont réussir en moins de cinq jours à terroriser un gamin qui fait du stop, shooter et violer une gamine fugueuse obsédée par Barbra Streisand qu'elle passe son temps à portraiturer, prendre en otage une vieille femme de chambre venue nettoyer leur chambre d'hôtel, qu'ils ont commencé à saccager, convaincre un flic et un barman qu'ils sont des coupeurs de têtes, tenter de se suicider ( Gonzo totalement défoncé force Duke à lui balancer dans son bain une radio branchée dont il veut écouter la musique à la " Claude François "... sorry pour l'anachronisme ), être invités et participer ( je vous le jure ) au congrès des procureurs « sur les narcotiques et les drogues dangereuses » !
Tout ça après quatre nuits blanches, des tonnes de drogues, d'alcool, de clopes, de médocs, de tas de vomissements incoercibles... avec bien évidemment les crises d'angoisse, de parano, les hallucinations en 3D et j'en passe, inhérentes à ce genre de régime... de nos jours, on dirait d'hygiène de vie...
Une petite parenthèse s'impose : ce ne sont là que quelques-unes de leurs "aventures"...
Road Trip déjanté, livre culte d'une génération, radioscopie d'une certaine Amérique avec sa guerre du Vietnam, ses Nixon, Manson et autres cauchemars, le tout sur fond de rock'n roll à vous en faire péter vos tympans de lecteur ; ça n'arrête pas.
La morale de l'histoire, j'y ai déjà fait illusion.
Pour être soft, on pourrait s'en tirer avec un "les illusions perdues".
Pour finir, j'ai envie de préciser que l'auteur Hunter S. Thompson était un accro aux drogues dures, aux armes à feu et qu'en 2005 il s'est mis une dernière fois la tête à l'envers avec une bastos bien dosée.
À lire ou pas... ça déchire ou on déchire les pages de ce satané bouquin et on les bouffe... au cas où quelques traces d'acide auraient été oubliées ( je plaisante ! )
À voir...
Une culture héritée de vieux mystiques dont " « la supposition désespérée était que quelqu’un –ou au moins quelque force – entretient la Lumière au bout du tunnel. »
Depuis, beaucoup ont overdosé leurs espoirs et se sont offert le grand voyage... quelques autres ont eu le temps de redescendre.
Donc, nos deux pratiquants de la Culture de l'Acide, nos deux adeptes du reportage gonzo : « Le reportage gonzo conjugue la vivacité de plume du reporter confirmé, l’acuité visuelle du photographe de guerre et les couilles du quaterback au moment du lancer », que sont Raoul Duke, journaliste, et son avocat, Dr Gonzo, sont missionnés pour aller faire un reportage sur le Mint 400, une course de buggy à travers le désert de Las Vegas.
Cette virée, cette épopée est le prétexte fou pour enquêter sur le mythe encore plus fou du Rêve Américain... et quelle ville peut symboliser le mieux le Rêve d'Horatio Alger que Vegas ?
Là, on accroche sa ceinture, on se bourre de Dramamine et on se tape un méga grand huit à fond la caisse.
Ils vont réussir en moins de cinq jours à terroriser un gamin qui fait du stop, shooter et violer une gamine fugueuse obsédée par Barbra Streisand qu'elle passe son temps à portraiturer, prendre en otage une vieille femme de chambre venue nettoyer leur chambre d'hôtel, qu'ils ont commencé à saccager, convaincre un flic et un barman qu'ils sont des coupeurs de têtes, tenter de se suicider ( Gonzo totalement défoncé force Duke à lui balancer dans son bain une radio branchée dont il veut écouter la musique à la " Claude François "... sorry pour l'anachronisme ), être invités et participer ( je vous le jure ) au congrès des procureurs « sur les narcotiques et les drogues dangereuses » !
Tout ça après quatre nuits blanches, des tonnes de drogues, d'alcool, de clopes, de médocs, de tas de vomissements incoercibles... avec bien évidemment les crises d'angoisse, de parano, les hallucinations en 3D et j'en passe, inhérentes à ce genre de régime... de nos jours, on dirait d'hygiène de vie...
Une petite parenthèse s'impose : ce ne sont là que quelques-unes de leurs "aventures"...
Road Trip déjanté, livre culte d'une génération, radioscopie d'une certaine Amérique avec sa guerre du Vietnam, ses Nixon, Manson et autres cauchemars, le tout sur fond de rock'n roll à vous en faire péter vos tympans de lecteur ; ça n'arrête pas.
La morale de l'histoire, j'y ai déjà fait illusion.
Pour être soft, on pourrait s'en tirer avec un "les illusions perdues".
Pour finir, j'ai envie de préciser que l'auteur Hunter S. Thompson était un accro aux drogues dures, aux armes à feu et qu'en 2005 il s'est mis une dernière fois la tête à l'envers avec une bastos bien dosée.
À lire ou pas... ça déchire ou on déchire les pages de ce satané bouquin et on les bouffe... au cas où quelques traces d'acide auraient été oubliées ( je plaisante ! )
À voir...
« - Exactement ! On est venus ici pour se bourrer, pour prendre du bon temps et pour… se laisser aller ! »
EXACTEMENT ! Belle entrée en matière. Il y a des livres où je me sens bien. Parce que parfois, il faut savoir se laisser aller, se lâcher. Il est temps de se servir un verre de rhum et d’ouvrir ce bouquin de Hunter S. Thompson. En plus, c’est facile, une chemise froissée, un bermuda et des claquettes, direction l’aéroport pour atterrir quelques heures plus tard à San Juan, Porto Rico. Là-bas, Paul Kemp m’attend avec sa bouteille de rhum. Lui est un grand journaliste, officieusement New-York Times, officiellement San Juan Daily News, un journal minable et sans envergure pour les amerloques un peu paumés de l’île. « Rhum Express », Porto Rico le paradis.
Que dire de plus de ce livre. A boire sans modération. J’ai oublié combien de verres de rhum j’ai pu boire avec Paul Kemp et ses acolytes. Combien de hamburgers bien gras pour accompagner ces verres de rhum ? Une île paradisiaque, des plages de sable blanc mais surtout des verres de rhum presqu’à volonté tout au long de la journée et de la nuit. Que dire de plus d’un pays où les glaçons sont plus chers que le verre de rhum qui les accompagnent.
Du rhum, des femmes et des verres de rhum. En prime, le carnaval, un rythme endiablé où les gens dansent, et boivent, et se laissent aller. Je suis tout proche du bonheur et de la béatitude. Une lecture loin d’être saine qui dresse le portrait de quelques paumés expatriés sur une terre paradisiaque. Tu penses boire du rhum à chaque page ? Et tu auras raison ! Sauf que ce n’est pas tout, je ne peux pas résumer ce livre à ce simple fait. Il y a bien plus : la recherche des glaçons. Tout aussi important, bien plus chers et bien plus rares, les glaçons sont les Saint Graal de ces journalistes. Mais à travers ces personnages, peu enviables, l’auteur y distille ses notes de cynisme, ce parfum de supériorité américaine, ces effluves d’impérialisme.
Mais je comprends parfaitement Paul Kemp. Je me mets à sa place, presque à l’envier. Je débarque sur une île, sans rien qu’une chemise froissée, l’envie de faire du pognon et de prendre du bon temps. Bon, pour le pognon, c’est raté. Mais question bon temps, entre les chaudes nanas, et les bars miteux, il y a de quoi faire. Quoique au rayon nana, il n’y a en qu’une qui vaille le coup, la belle Chenault que j’ai croisé à l’aéroport avec Kemp.
Tu aimes ou pas. Après tout, tu n’es pas forcément alcoolique et tu n’apprécies peut-être pas autant le rhum. Dans ce cas-là, tu ne comprendras pas ce roman, aux consonances fortement autobiographiques, Paul Kemp étant l’alter-ego de Hunter S. Thompson, fondées sur des souvenirs de l’auteur lors de son passage sur l’île.
« - Euh, ça te dérange, si je me soûle tout nu ? »
Lien : http://leranchsansnom.free.f..
EXACTEMENT ! Belle entrée en matière. Il y a des livres où je me sens bien. Parce que parfois, il faut savoir se laisser aller, se lâcher. Il est temps de se servir un verre de rhum et d’ouvrir ce bouquin de Hunter S. Thompson. En plus, c’est facile, une chemise froissée, un bermuda et des claquettes, direction l’aéroport pour atterrir quelques heures plus tard à San Juan, Porto Rico. Là-bas, Paul Kemp m’attend avec sa bouteille de rhum. Lui est un grand journaliste, officieusement New-York Times, officiellement San Juan Daily News, un journal minable et sans envergure pour les amerloques un peu paumés de l’île. « Rhum Express », Porto Rico le paradis.
Que dire de plus de ce livre. A boire sans modération. J’ai oublié combien de verres de rhum j’ai pu boire avec Paul Kemp et ses acolytes. Combien de hamburgers bien gras pour accompagner ces verres de rhum ? Une île paradisiaque, des plages de sable blanc mais surtout des verres de rhum presqu’à volonté tout au long de la journée et de la nuit. Que dire de plus d’un pays où les glaçons sont plus chers que le verre de rhum qui les accompagnent.
Du rhum, des femmes et des verres de rhum. En prime, le carnaval, un rythme endiablé où les gens dansent, et boivent, et se laissent aller. Je suis tout proche du bonheur et de la béatitude. Une lecture loin d’être saine qui dresse le portrait de quelques paumés expatriés sur une terre paradisiaque. Tu penses boire du rhum à chaque page ? Et tu auras raison ! Sauf que ce n’est pas tout, je ne peux pas résumer ce livre à ce simple fait. Il y a bien plus : la recherche des glaçons. Tout aussi important, bien plus chers et bien plus rares, les glaçons sont les Saint Graal de ces journalistes. Mais à travers ces personnages, peu enviables, l’auteur y distille ses notes de cynisme, ce parfum de supériorité américaine, ces effluves d’impérialisme.
Mais je comprends parfaitement Paul Kemp. Je me mets à sa place, presque à l’envier. Je débarque sur une île, sans rien qu’une chemise froissée, l’envie de faire du pognon et de prendre du bon temps. Bon, pour le pognon, c’est raté. Mais question bon temps, entre les chaudes nanas, et les bars miteux, il y a de quoi faire. Quoique au rayon nana, il n’y a en qu’une qui vaille le coup, la belle Chenault que j’ai croisé à l’aéroport avec Kemp.
Tu aimes ou pas. Après tout, tu n’es pas forcément alcoolique et tu n’apprécies peut-être pas autant le rhum. Dans ce cas-là, tu ne comprendras pas ce roman, aux consonances fortement autobiographiques, Paul Kemp étant l’alter-ego de Hunter S. Thompson, fondées sur des souvenirs de l’auteur lors de son passage sur l’île.
« - Euh, ça te dérange, si je me soûle tout nu ? »
Lien : http://leranchsansnom.free.f..
Relire Hunter S. Thompson des années après ma première incursion dans ce monde de barjots déjantés à l’acide, c’est replonger pour un trip de 300 pages dans le siècle précédent. Avec Las Vegas Parano traduit par Philippe Mikriammos, Thompson nous immerge dans un genre et une époque que les moins de vingt ans, patati, patata... Adeptes des belles histoires, rationnelles et cohérentes, châtiées et soutenues, passez votre chemin !
Les autres, embarquez avec l’auteur himself, ou plutôt son double, Raoul Duke, dans une Chevy Great Red Shark remplie à bloc d’alcools et de drogues (cachets, acides, éther, LSD, amyle, amphets, marijuana, adrénochrome… il ne manque rien) qui seront remplacés après rapide épuisement des substances illicites par 600 bâtons de savon Neutrogena. Et ne cherchez pas à comprendre, c’est juste histoire de planter le décor… Immanquablement flanqué de son avocat le Docteur Gonzo, Duke arrive à Vegas pour couvrir la course de motos Mint 400 puis dans un deuxième temps, la convention annuelle des Procureurs des États-Unis, consacrée, fort à propos, aux méfaits de la drogue.
La suite : un délire déambulatoire entre chambres d’hôtels, bars, salles de jeux, filles et excursions dans le désert du Nevada, au début de ces années 70 où l’Amérique commence à émerger de son fameux rêve qui a guidé tant des siens jusque-là. Le désenchantement hippie, le Vietnam, les années Nixon, les armes ou les travers de la religion sont en toile de fond de ce roman bien plus profond que son style direct et décousu peut le laisser paraître, modèle iconique du genre Gonzo qui incarnera durablement ce journalisme de terrain, revendiqué comme hautement subjectif et sulfureux.
À travers cette satire outrancière joliment barrée, Thompson lance Duke et Gonzo sur les traces du Rêve Américain mais malgré cette défonce ininterrompue, la fête est bel et bien terminée. Et en repoussant toujours un peu plus les limites sacrées de la liberté individuelle si chère aux Américains, Duke et Gonzo en frôlent l’absurdité pour mieux la dénoncer.
Las Vegas Parano entre dans ces livres qu’on adore ou que l’on déteste. Moi je prends !
Les autres, embarquez avec l’auteur himself, ou plutôt son double, Raoul Duke, dans une Chevy Great Red Shark remplie à bloc d’alcools et de drogues (cachets, acides, éther, LSD, amyle, amphets, marijuana, adrénochrome… il ne manque rien) qui seront remplacés après rapide épuisement des substances illicites par 600 bâtons de savon Neutrogena. Et ne cherchez pas à comprendre, c’est juste histoire de planter le décor… Immanquablement flanqué de son avocat le Docteur Gonzo, Duke arrive à Vegas pour couvrir la course de motos Mint 400 puis dans un deuxième temps, la convention annuelle des Procureurs des États-Unis, consacrée, fort à propos, aux méfaits de la drogue.
La suite : un délire déambulatoire entre chambres d’hôtels, bars, salles de jeux, filles et excursions dans le désert du Nevada, au début de ces années 70 où l’Amérique commence à émerger de son fameux rêve qui a guidé tant des siens jusque-là. Le désenchantement hippie, le Vietnam, les années Nixon, les armes ou les travers de la religion sont en toile de fond de ce roman bien plus profond que son style direct et décousu peut le laisser paraître, modèle iconique du genre Gonzo qui incarnera durablement ce journalisme de terrain, revendiqué comme hautement subjectif et sulfureux.
À travers cette satire outrancière joliment barrée, Thompson lance Duke et Gonzo sur les traces du Rêve Américain mais malgré cette défonce ininterrompue, la fête est bel et bien terminée. Et en repoussant toujours un peu plus les limites sacrées de la liberté individuelle si chère aux Américains, Duke et Gonzo en frôlent l’absurdité pour mieux la dénoncer.
Las Vegas Parano entre dans ces livres qu’on adore ou que l’on déteste. Moi je prends !
Il s'agit d'un recueil complètement… gonzo ! de correspondances entre cet auteur / journaliste et ses éditeurs, confrères, familles, etc… ATTENTION ça dépote !
Hunter THOMPSON aspire à écrire des romans, mais doit pour cela gagner sa vie comme pigiste. Sauf que le journalisme pratiqué comme la plupart de ses confrères n'inspire que son plus grand mépris. Selon lui, ce journalisme sonne faux et creux, est formaté, totalement mensonger, ne reflète pas la réalité ni ne provoque de réaction chez le lecteur. Son style à lui… est explosif. Un peu trop, au goût des journaux, qui ne prennent pas toujours le risque de le publier.
« Il est notre dingue officiel, celui qui patrouille à la lisière ».
Son style, farouchement subjectif, ne laisse pas indifférent : Il le rend aussi génialement extraordinaire que tristement marginalisé. Quand on lui commande des articles sur des thèmes particuliers, ça détonne, et il commence à se faire un nom dans la presse libre.
Mais s'il se vend mal au début, c'est qu'il ne rentre pas dans les cases : Ses écrits se situent entre journalisme et fiction. Ils n'ont donc pas vraiment leur place dans un journal national qui traite de thèmes d'actualité, de société, etc… car « sa plume spirituelle trempée dans le curare » provoquerait au bas mot des polémiques ou procès, et ce n'est pas ce qu'attend le lectorat d'un journal d'informations ; Mais ce ne peut pas non-plus être présenté comme de la fiction tellement le réalisme piquant risquerait de choquer.
Cependant, THOMSON est sûr de son génie et persiste : Son style à part porte désormais un nom : le journalisme gonzo. Il s'agit de ce « nouveau journalisme » qui semble émerger dans les années 1965, dont l'écriture emprunte à la fiction. Ce style, encore appelé « journalisme impressionniste », l'auteur en a été l'un des représentants les plus marquants. Même si pour lui, Georges Orwell, Jack London, Mark Twain ou encore Hemingway en étaient les précurseurs, qui « capturaient la dimension explosive de l'aventure journalistique à la première personne ».
Car selon Hunter THOMSON, « pour que le journalisme n'ait rien à envier à la fiction, il fallait que l'article résonne pour l'éternité ».
Pour parler d'un thème choisi, il en sera donc l'auteur autant que le héros.
Douglas Brinkley, éditeur, explique comment Orwell a influencé le style de THOMSON : « si Orwell était capable de vivre une misère noire en compagnie de clochards pour écrire sur le sujet [« dans la dèche à Paris et à Londres »], alors THOMSON ferait de même. »
Ainsi devinez ce qu'il a fait lorsqu'on lui a commandé un papier sur les Hell's Angels ? Il est devenu Hell's Angel. Et dans quel état il en est revenu, avec sa personnalité…?
Car pour THOMSON, « La fiction est une passerelle vers la vérité, que le journalisme ne peut pas atteindre. Les faits sont des mensonges lorsqu'on se contente de les ajouter les uns aux autres ».
Il faut donc les vivre, les ressentir ou expérimenter, puis donner son point de vue subjectif mais, au moins, réel et avéré, sur cette expérience.
Ce recueil, donc, fait rire, réfléchir, choque, intrigue, attise notre soif de culture et titille notre envie d'aventure. L'intérêt de cette correspondance, en plus de nous faire découvrir l'homme et son franc parler, c'est aussi de découvrir la vie instable de pigiste qu'il mène à cette époque et, à travers elle, l'Amérique des années 50-70. Ses correspondances retracent à la fois ses voyages, ses victoires, ses claques magistrales, sa façon d'y répondre. La manière dont il pense et prépare ses sujets, aussi.
On y rencontre des destinataires incroyables : Il écrit au Président des Etats-Unis, à Faulkner (Le bruit et la fureur), Tom Wolfe (Le bûcher des vanités), Ken Kesey (Vol au dessus d'un nid de coucou), et bien d'autres. le personnage que THOMSON se crée peut sembler infecte, mais ça le protège de tous les obstacles mis sur sa route pour le faire entrer dans un moule qui n'est pas le sien. Comment faire entrer un triangle piquant dans un rond tout doux…? HST sait qu'il ne pourra révéler le grand écrivain qu'il est qu'en conservant son propre style, même s'il dérange. Et son personnage, sans filtre, devient comique et attachant même pour ceux à qui parle mal, qui lui répondent sur le même ton et deviennent des correspondants de choix pour l'original qu'il est.
Avant de nous plonger dans cet univers totalement gonzo, l'édition nous introduit judicieusement le personnage via la présentation d'employeurs et éditeurs de l'auteur. Par la suite, chaque lettre est précédée de trois lignes de contexte. Un recueil aussi instructif que décapant qui m'a incitée à commander les écrits de ce personnage fascinant, car ils semblent d'anthologie !
Hunter THOMPSON aspire à écrire des romans, mais doit pour cela gagner sa vie comme pigiste. Sauf que le journalisme pratiqué comme la plupart de ses confrères n'inspire que son plus grand mépris. Selon lui, ce journalisme sonne faux et creux, est formaté, totalement mensonger, ne reflète pas la réalité ni ne provoque de réaction chez le lecteur. Son style à lui… est explosif. Un peu trop, au goût des journaux, qui ne prennent pas toujours le risque de le publier.
« Il est notre dingue officiel, celui qui patrouille à la lisière ».
Son style, farouchement subjectif, ne laisse pas indifférent : Il le rend aussi génialement extraordinaire que tristement marginalisé. Quand on lui commande des articles sur des thèmes particuliers, ça détonne, et il commence à se faire un nom dans la presse libre.
Mais s'il se vend mal au début, c'est qu'il ne rentre pas dans les cases : Ses écrits se situent entre journalisme et fiction. Ils n'ont donc pas vraiment leur place dans un journal national qui traite de thèmes d'actualité, de société, etc… car « sa plume spirituelle trempée dans le curare » provoquerait au bas mot des polémiques ou procès, et ce n'est pas ce qu'attend le lectorat d'un journal d'informations ; Mais ce ne peut pas non-plus être présenté comme de la fiction tellement le réalisme piquant risquerait de choquer.
Cependant, THOMSON est sûr de son génie et persiste : Son style à part porte désormais un nom : le journalisme gonzo. Il s'agit de ce « nouveau journalisme » qui semble émerger dans les années 1965, dont l'écriture emprunte à la fiction. Ce style, encore appelé « journalisme impressionniste », l'auteur en a été l'un des représentants les plus marquants. Même si pour lui, Georges Orwell, Jack London, Mark Twain ou encore Hemingway en étaient les précurseurs, qui « capturaient la dimension explosive de l'aventure journalistique à la première personne ».
Car selon Hunter THOMSON, « pour que le journalisme n'ait rien à envier à la fiction, il fallait que l'article résonne pour l'éternité ».
Pour parler d'un thème choisi, il en sera donc l'auteur autant que le héros.
Douglas Brinkley, éditeur, explique comment Orwell a influencé le style de THOMSON : « si Orwell était capable de vivre une misère noire en compagnie de clochards pour écrire sur le sujet [« dans la dèche à Paris et à Londres »], alors THOMSON ferait de même. »
Ainsi devinez ce qu'il a fait lorsqu'on lui a commandé un papier sur les Hell's Angels ? Il est devenu Hell's Angel. Et dans quel état il en est revenu, avec sa personnalité…?
Car pour THOMSON, « La fiction est une passerelle vers la vérité, que le journalisme ne peut pas atteindre. Les faits sont des mensonges lorsqu'on se contente de les ajouter les uns aux autres ».
Il faut donc les vivre, les ressentir ou expérimenter, puis donner son point de vue subjectif mais, au moins, réel et avéré, sur cette expérience.
Ce recueil, donc, fait rire, réfléchir, choque, intrigue, attise notre soif de culture et titille notre envie d'aventure. L'intérêt de cette correspondance, en plus de nous faire découvrir l'homme et son franc parler, c'est aussi de découvrir la vie instable de pigiste qu'il mène à cette époque et, à travers elle, l'Amérique des années 50-70. Ses correspondances retracent à la fois ses voyages, ses victoires, ses claques magistrales, sa façon d'y répondre. La manière dont il pense et prépare ses sujets, aussi.
On y rencontre des destinataires incroyables : Il écrit au Président des Etats-Unis, à Faulkner (Le bruit et la fureur), Tom Wolfe (Le bûcher des vanités), Ken Kesey (Vol au dessus d'un nid de coucou), et bien d'autres. le personnage que THOMSON se crée peut sembler infecte, mais ça le protège de tous les obstacles mis sur sa route pour le faire entrer dans un moule qui n'est pas le sien. Comment faire entrer un triangle piquant dans un rond tout doux…? HST sait qu'il ne pourra révéler le grand écrivain qu'il est qu'en conservant son propre style, même s'il dérange. Et son personnage, sans filtre, devient comique et attachant même pour ceux à qui parle mal, qui lui répondent sur le même ton et deviennent des correspondants de choix pour l'original qu'il est.
Avant de nous plonger dans cet univers totalement gonzo, l'édition nous introduit judicieusement le personnage via la présentation d'employeurs et éditeurs de l'auteur. Par la suite, chaque lettre est précédée de trois lignes de contexte. Un recueil aussi instructif que décapant qui m'a incitée à commander les écrits de ce personnage fascinant, car ils semblent d'anthologie !
Hymne baroque à la défonce largement inspiré de la vie d'Hunter Thompson, "Las Vegas parano" nous embarque pour un trip déjanté dans la ville de tous les vices. Un journaliste et un avocat munis d'une valise remplie de drogues vont s'y perdre et tutoyer les frontières de la folie. Ici pas de morale ni de recul par rapport au sujet (la drogue c'est mal), juste un voyage halluciné pied au plancher qui donne le tournis autant qu'il fait marrer. Livre incontournable dans son genre, l'adaptation avec Johnny Depp et Benitio del Toro est également une grande réussite.
A vos risques et périls...
A vos risques et périls...
« Fear and Loathing in Las Vegas » a été écrit par Hunter S. Thompson en 1971. Publié en 1972 aux éditions Paladin en Grande-Bretagne, « Fear and Loathing in Las Vegas » est l’histoire d’une virée sauvage au cœur du rêve américain. Brillamment illustré par Ralph Steadman, dédicacé à Bob Geiger (journaliste américain ayant largement décrit les problèmes de réinsertion des anciens combattants du Vietnam) et à Bob Dylan pour son « Mister Tambourine Man » (une chanson invitant à l’évasion par la drogue), « Fear and Loathing in Las Vegas » a été adapté au cinéma dans un film sorti en 1998, « Las Vegas Parano ». C’est d’ailleurs sous ce titre qu’est connu en France l’ouvrage écrit par Hunter S. Thompson.
L’histoire du livre ? Comme indiqué en 4ème de couverture, « Hunter S. Thompson is driving to Las Vegas with his attorney, the Samoan, to find the dark side of the American dream. Roaring down the desert highway from Los Angeles, they realise there's only one way to go about such a perilous task, getting very, very twisted. Armed with a drug arsenal of stupendous proportions, the duo engage in a manic, surreal tour of the sleaze capital of the world ». Nous sommes dans les années 1970. Le lecteur est parachuté dans un casino à Las Vegas, puis dans le désert, dans la poussière, le sable et les cactus, un paysage sans fin et quasi-irréel ; la drogue et la bière faisant leur effet, notre lecteur, comme nos deux héros, se trouve plongé ensuite en pleine hallucination : lézards géants, chauves-souris et autres bestioles traversent son champ de vision. Enfin, en pleine défonce, notre lecteur traverse un cauchemar effrayant et répugnant (d’où le titre du livre), au volant de sa Cadillac blanche décapotable ; tentant de finaliser un reportage sur les 400 miles de Las Vegas - une course de motos aux allures de kermesse populaire - notre lecteur saute de beuverie en beuverie et de prise de drogues en prise de drogues, s’engluant dans un univers désordonné et chaotique dont il ne peut s’évader.
L’intérêt de « Fear and Loathing in Las Vegas » ne réside pas dans la découverte des différentes substances (cannabis, marijuana, LSD, mescaline, amphétamine, éther, adrénochrome, etc.) avalées par nos héros ou par les phases hallucinatoires qu’ils traversent, baignant dans l’alcool (bière, Gold téquila, rhum, cuba libres, Chivas Regal, etc.) qu’ils ingurgitent en grande quantité et à tout bout de champ. Le livre se veut une « représentation fidèle d’une époque, d’un endroit et de gens particuliers ». Au-delà de la chronique provocatrice de ce couple de drogués et de l’apologie de leur défonce, le livre est un « flashback » nostalgique et plein de désillusions sur ce que fut le rêve de nombreux hippies américains. Rappelez-vous : dans les années soixante, l’Amérique - en pleine autarcie - est confrontée à de dures réalités, à commencer Nixon et sa guerre du Vietnam, la difficile réinsertion des anciens du Vietnam, la marchandisation croissante des biens et des individus, les excès de la société de consommation, le fric facile et la montée irréversible de la violence. Cette dure réalité s’oppose fortement à l’idée que se faisait chaque Américain selon laquelle toute personne vivant aux États-Unis pouvait, par son travail, son courage et sa détermination, devenir riche, être reconnu et trouver la gloire. Dénonçant ce monde qu’ils exècrent, rejetant les valeurs traditionnelles et le mode de vie légué par leurs parents, les hippies font leur apparition : ils se veulent pacifistes, refusent la guerre et toute forme d’autorité (notamment policière), adoptent des tenues vestimentaires incroyables (voyez les lunettes extravagantes du héros de « Las Vegas Parano »), militent pour une grande liberté sexuelle (jusqu’à essayer de faire dépénaliser le viol ?) et recherchent de nouvelles perceptions sensorielles (n’ont-ils pas absorbé des tranquillisants pour chevaux ?). Mais le mouvement hippie a vécu ! Regardant dans le rétroviseur, ayant mauvaise conscience de son passage comme rebelle dans un univers défoncé qui lui a procuré bien des plaisirs, Hunter S. Thompson, surfant sur une vague moralisatrice et mélancolique, se livre dans « Fear and Loathing in Las Vegas » à une révolte, réelle ou de façade : coincé entre un monde réel - qui envoie le citoyen américain dans le mur et dans lequel l’auteur considère ne plus avoir sa place - et un monde plus attrayant mais imaginaire et qui va disparaître à tout jamais, Hunter S. Thompson déroule pour nous le film cauchemardesque, nauséeux, débraillé, sans queue ni tête, déjanté et outrancier du côté obscur de ce rêve américain. La virée tourne au drame : ce rêve impossible conduira Hunter S. Thompson à se suicider en se tirant une balle dans la tête, à son domicile, au Colorado, en février 2005.
Hunter S. Thompson avait inventé et développé une nouvelle forme de journalisme, le journalisme « gonzo » (en argot irlandais, le « gonzo » est le dernier homme à être encore debout après une nuit entière à boire de l’alcool); cette nouvelle forme de journalisme préférait - en réaction contre la déontologie du journalisme traditionnel – l’enquête ultra-subjective, de 1er jet et lucide : fait de récits à la première personne, de rencontres, de beuveries et de prises de drogues, le produit de ce journalisme de terrain est caractérisé par une plume trempée dans le vitriol, un style surréaliste et un fort engagement politique. Hunter S. Thompson disait d’ailleurs que « le reportage gonzo allie la plume d’un maître-reporter, le talent d’un photographe de renom et les couilles en bronze d’un acteur ».
Avec « Fear and Loathing in Las Vegas », vous disposez d’un exemple frappant de ce journalisme « gonzo ». Jugez plutôt. Les raisons de la virée de nos deux héros ? En page 6 : « We’re on our way to Las Vegas to find the American Dream. This is a very ominous assignment-with overtones of extreme personal danger ». Leur démarche ? En page 12 : « The only way to prepare for a trip like this was to dress up like human peacocks and get crazy, the screech off across the desert and cover the story. The only cure is to load up on heinous chemicals and then drive like a bastard from Hollywood to Las Vegas and move out with the music at top volume, and at least a pint of ether ». Pourquoi ne pas couvrir la course de motos en faisant du journalisme ordinaire ? En page 39 : « This idea was absurd : It was like trying to keep track of a swimming meet in an Olympic-sized pool filled with talcum powder instead of water ». Du gros délire ? En page 154 : « The guy said: Those tires want 28 in the front and 32 in the rear. Hell, 50’s dangerous, but 75 is crazy. They’ll explode! I replied: I want to see how they corner with 75. He chuckled. You won’t even get to the corner, Mister. We’ll see, I said ». Des incidents pendant leur virée ? En page 13, le loueur de voiture leur fait observer: « You just backed over that two foot concrete abutment and you didn’t even slow down! Forty-five in reverse! And you barely missed the pump! ». Et que fait la police ? En page 14 : « Cops are good vicious Catholics. Can you imagine what those bastards would do to us if we got busted all drugged-up and drunk in stolen vestments? Jesus, they’d castrate us! ». Les hallucinations de nos deux héros ? En page 24 : « Terrible things were happening all around us. Right next to me a huge reptile was gnawing on a woman’s neck, the carpet was a blood-soaked sponge, and lizards were moving around in this muck ». En page 85 : « Jesus, bad waves of paranoia, madness, fear and loathing-intolerable vibrations in this place ». En page 133 : « I couldn’t move. Total paralysis now. Every muscle in my body was contracted. I couldn’t even move my eyeballs, much less turn my head or talk. I needed artificial respiration, but I couldn’t open my mouth to say so. I was going to die ». De la violence ? En page 146 : « What did they do to her? Jesus Christ man. They chopped her goddam head off right there in the parking lot! Then they cut all kinds of holes in her and sucked out the blood! ». Une certaine idée de la femme ? En page 118 : « First you kidnap the girl, then you rape her, and now you want to have her locked up! He shrugged. It just occurred to me that she has no witnesses. Anything she says about us is completely worthless ». De l’engagement politique ? En page 74 : « Muhammad Ali had been sentenced to five years in prison for refusing to kill « lopes ». « I ain’t got nothin’ against them Viet Congs, he said ».
Arrivé au terme de ma lecture, je suis groggy et un rien songeur. Sous une apparence amusante, déboutonnée, folle, obscène et corrosive, « Fear and Loathing in Las Vegas » est probablement un témoignage psychédélique, engagé et désespéré sur ce que fut l’expérience de gens qui croyaient au rêve Américain. Et Hunter S. Thompson était de ceux-là ! A lire, à moins que vous ne supportiez pas la vulgarité, l’alcool, les drogues et les excès de toutes sortes …
L’histoire du livre ? Comme indiqué en 4ème de couverture, « Hunter S. Thompson is driving to Las Vegas with his attorney, the Samoan, to find the dark side of the American dream. Roaring down the desert highway from Los Angeles, they realise there's only one way to go about such a perilous task, getting very, very twisted. Armed with a drug arsenal of stupendous proportions, the duo engage in a manic, surreal tour of the sleaze capital of the world ». Nous sommes dans les années 1970. Le lecteur est parachuté dans un casino à Las Vegas, puis dans le désert, dans la poussière, le sable et les cactus, un paysage sans fin et quasi-irréel ; la drogue et la bière faisant leur effet, notre lecteur, comme nos deux héros, se trouve plongé ensuite en pleine hallucination : lézards géants, chauves-souris et autres bestioles traversent son champ de vision. Enfin, en pleine défonce, notre lecteur traverse un cauchemar effrayant et répugnant (d’où le titre du livre), au volant de sa Cadillac blanche décapotable ; tentant de finaliser un reportage sur les 400 miles de Las Vegas - une course de motos aux allures de kermesse populaire - notre lecteur saute de beuverie en beuverie et de prise de drogues en prise de drogues, s’engluant dans un univers désordonné et chaotique dont il ne peut s’évader.
L’intérêt de « Fear and Loathing in Las Vegas » ne réside pas dans la découverte des différentes substances (cannabis, marijuana, LSD, mescaline, amphétamine, éther, adrénochrome, etc.) avalées par nos héros ou par les phases hallucinatoires qu’ils traversent, baignant dans l’alcool (bière, Gold téquila, rhum, cuba libres, Chivas Regal, etc.) qu’ils ingurgitent en grande quantité et à tout bout de champ. Le livre se veut une « représentation fidèle d’une époque, d’un endroit et de gens particuliers ». Au-delà de la chronique provocatrice de ce couple de drogués et de l’apologie de leur défonce, le livre est un « flashback » nostalgique et plein de désillusions sur ce que fut le rêve de nombreux hippies américains. Rappelez-vous : dans les années soixante, l’Amérique - en pleine autarcie - est confrontée à de dures réalités, à commencer Nixon et sa guerre du Vietnam, la difficile réinsertion des anciens du Vietnam, la marchandisation croissante des biens et des individus, les excès de la société de consommation, le fric facile et la montée irréversible de la violence. Cette dure réalité s’oppose fortement à l’idée que se faisait chaque Américain selon laquelle toute personne vivant aux États-Unis pouvait, par son travail, son courage et sa détermination, devenir riche, être reconnu et trouver la gloire. Dénonçant ce monde qu’ils exècrent, rejetant les valeurs traditionnelles et le mode de vie légué par leurs parents, les hippies font leur apparition : ils se veulent pacifistes, refusent la guerre et toute forme d’autorité (notamment policière), adoptent des tenues vestimentaires incroyables (voyez les lunettes extravagantes du héros de « Las Vegas Parano »), militent pour une grande liberté sexuelle (jusqu’à essayer de faire dépénaliser le viol ?) et recherchent de nouvelles perceptions sensorielles (n’ont-ils pas absorbé des tranquillisants pour chevaux ?). Mais le mouvement hippie a vécu ! Regardant dans le rétroviseur, ayant mauvaise conscience de son passage comme rebelle dans un univers défoncé qui lui a procuré bien des plaisirs, Hunter S. Thompson, surfant sur une vague moralisatrice et mélancolique, se livre dans « Fear and Loathing in Las Vegas » à une révolte, réelle ou de façade : coincé entre un monde réel - qui envoie le citoyen américain dans le mur et dans lequel l’auteur considère ne plus avoir sa place - et un monde plus attrayant mais imaginaire et qui va disparaître à tout jamais, Hunter S. Thompson déroule pour nous le film cauchemardesque, nauséeux, débraillé, sans queue ni tête, déjanté et outrancier du côté obscur de ce rêve américain. La virée tourne au drame : ce rêve impossible conduira Hunter S. Thompson à se suicider en se tirant une balle dans la tête, à son domicile, au Colorado, en février 2005.
Hunter S. Thompson avait inventé et développé une nouvelle forme de journalisme, le journalisme « gonzo » (en argot irlandais, le « gonzo » est le dernier homme à être encore debout après une nuit entière à boire de l’alcool); cette nouvelle forme de journalisme préférait - en réaction contre la déontologie du journalisme traditionnel – l’enquête ultra-subjective, de 1er jet et lucide : fait de récits à la première personne, de rencontres, de beuveries et de prises de drogues, le produit de ce journalisme de terrain est caractérisé par une plume trempée dans le vitriol, un style surréaliste et un fort engagement politique. Hunter S. Thompson disait d’ailleurs que « le reportage gonzo allie la plume d’un maître-reporter, le talent d’un photographe de renom et les couilles en bronze d’un acteur ».
Avec « Fear and Loathing in Las Vegas », vous disposez d’un exemple frappant de ce journalisme « gonzo ». Jugez plutôt. Les raisons de la virée de nos deux héros ? En page 6 : « We’re on our way to Las Vegas to find the American Dream. This is a very ominous assignment-with overtones of extreme personal danger ». Leur démarche ? En page 12 : « The only way to prepare for a trip like this was to dress up like human peacocks and get crazy, the screech off across the desert and cover the story. The only cure is to load up on heinous chemicals and then drive like a bastard from Hollywood to Las Vegas and move out with the music at top volume, and at least a pint of ether ». Pourquoi ne pas couvrir la course de motos en faisant du journalisme ordinaire ? En page 39 : « This idea was absurd : It was like trying to keep track of a swimming meet in an Olympic-sized pool filled with talcum powder instead of water ». Du gros délire ? En page 154 : « The guy said: Those tires want 28 in the front and 32 in the rear. Hell, 50’s dangerous, but 75 is crazy. They’ll explode! I replied: I want to see how they corner with 75. He chuckled. You won’t even get to the corner, Mister. We’ll see, I said ». Des incidents pendant leur virée ? En page 13, le loueur de voiture leur fait observer: « You just backed over that two foot concrete abutment and you didn’t even slow down! Forty-five in reverse! And you barely missed the pump! ». Et que fait la police ? En page 14 : « Cops are good vicious Catholics. Can you imagine what those bastards would do to us if we got busted all drugged-up and drunk in stolen vestments? Jesus, they’d castrate us! ». Les hallucinations de nos deux héros ? En page 24 : « Terrible things were happening all around us. Right next to me a huge reptile was gnawing on a woman’s neck, the carpet was a blood-soaked sponge, and lizards were moving around in this muck ». En page 85 : « Jesus, bad waves of paranoia, madness, fear and loathing-intolerable vibrations in this place ». En page 133 : « I couldn’t move. Total paralysis now. Every muscle in my body was contracted. I couldn’t even move my eyeballs, much less turn my head or talk. I needed artificial respiration, but I couldn’t open my mouth to say so. I was going to die ». De la violence ? En page 146 : « What did they do to her? Jesus Christ man. They chopped her goddam head off right there in the parking lot! Then they cut all kinds of holes in her and sucked out the blood! ». Une certaine idée de la femme ? En page 118 : « First you kidnap the girl, then you rape her, and now you want to have her locked up! He shrugged. It just occurred to me that she has no witnesses. Anything she says about us is completely worthless ». De l’engagement politique ? En page 74 : « Muhammad Ali had been sentenced to five years in prison for refusing to kill « lopes ». « I ain’t got nothin’ against them Viet Congs, he said ».
Arrivé au terme de ma lecture, je suis groggy et un rien songeur. Sous une apparence amusante, déboutonnée, folle, obscène et corrosive, « Fear and Loathing in Las Vegas » est probablement un témoignage psychédélique, engagé et désespéré sur ce que fut l’expérience de gens qui croyaient au rêve Américain. Et Hunter S. Thompson était de ceux-là ! A lire, à moins que vous ne supportiez pas la vulgarité, l’alcool, les drogues et les excès de toutes sortes …
Plutot amateur du politiquement incorrect et possédant un superbe 103 SP sport , guidon torsadé , queue de raton laveur du plus bel effet sur selle en cuir chopper ( engin ne manquant pas de faire baver d'envie tout le quartier en me voyant fendre la bise à plus de 28 km / h vent de dos ) , ce bouquin présentait tous les signes du moment tres sympathique en perspective . Ecrit , de plus , par un jeune auteur subversif , adepte du journalisme gonzo , futur papa du délirant Las Végas Parano , alors là , aucune faute de gout à l'horizon ! Le temps d'enfourcher " la bete " , de faire le plein vital de drogues et de bieres et me voilà partie prenante d'un récit qui aura soufflé le chaud et le froid sur pres de 400 pages...
1965 : Thompson , la petite trentaine , décide alors de se pencher sur le phénomene Hell's Angels . Pour se faire , il les suit sur pres d'un an pour , au final , nous délivrer un récit personnalisant l'adage du verre à moitié vide et à moitié plein .
Zorro , Petit Jésus , Minus , le Parano , Terry le Clodo , Ed le Dégueulasse , la Brute... voilà quelques uns des doux sobriquetes avec lesquels l'auteur aura à se familiariser , surnoms faisant désormais office d'état civil . Comme l'aurait dit Coluche , on est une bande de jeunes , on s'fend la gueule sauf que tout le monde ne l'entend pas de cette oreille ! Notamment le sénateur Murphy qui les perçoit comme une bande de brutes dégénérées et qui s'empressera , des lors , de les appréhender sous la forme d'un rapport peu flatteur . Alors , ces Anges de l'Enfer , véritables démons apocalyptiques ou phenomene societal minoritaire exagérement déformé par une presse avide de lecteurs ?
Hell's Angel , c'est avant tout un art de vivre . Le refus de toute loi , de tout systeme . Le biker inculte sans foi ni loi , cradingue et aviné , symbole d'une liberté ultime dans une Amérique puritaine . Meme s'il est fortement fantasmé , le gars à la rossinante pétaradante détonne dans le paysage ! Cheveux hirsutes , tatouages expréssifs , il passe rarement inaperçu . Majoritairement issus des classes moyennes , peu d'entre eux bossent à temps plein , préférant de loin se consacrer à leur famille de coeur : les Hell's Angels . Définition toute personnelle de l'amour : penser à une femme comme l'on pense à sa bécane , véritable prolongement du biker . Il n'existe pas deux Harley identiques au monde ! Loisirs favoris de ce rebelle des temps modernes : rouler de concert avec tous ses potes ; castagner du quidam ; organiser des réunions , propices aux plus grosses gueules de bois jamais endurées sur le continent ! L'alcool , c'est bien , mais sans la drogue , ça pique moins les yeux . Benzédrine , Méthédrine , LSD , le biker en goguette aime varier les plaisirs et étancher sa soif de connaissance ! Et la femme dans tout ça ? Elle y a sa place et se doit d'etre plutot tolérante quand à ses légers écarts de conduite . Le biker aime sa mémé ( femme ) mais également celle des autres , n'hésitant pas à donner de sa personne afin d'apporter un peu de bonheur dans ce triste monde ! Oui , le biker est altruiste ! A noter que lors de réunions organisées , nombre de ces femmes participaient de leur plein gré , au risque d'etre la source de dérapages inévitables , l'alcool et la drogue les justifiant pleinement . Les plaintes pour viol n'étaient pas inaccoutumées mais paradoxalement , elles débouchaient rarement sur des condamnations , la femme déçue et frustrée ayant alors noirci le tableau et passant de " victime " consentante à plaignante régulierement déboutée . Il est également un paradoxe ambulant . Il rejette tout systeme mais se plie sans broncher aux regles de son gang . Il semble anti patriotique mais castagne à tout va lors d'une manifestation anti-vietnam . Son leader emblématique et fondateur , Ralph Barger Jr , n'hésitant pas à offrir les services de ses membres à Lyndon Johnson , sous couvert d'une lettre . Lettre restée toujours sans réponse à ce jour . J'ai comme dans l'idée que c'est foutu...
Le biker a trois ennemis : les motos asiatiques , les flics et les journaleux ! Ce sont ces memes journalistes qui en feront des parias , des rebuts de la société , en n'hésitant pas à les accuser systématiquement de tous les méfaits possibles et inimaginables . Une altercation faisant un blessé finira par déboucher sur un triple meurtre dans les journaux . Deux gars patibulaires arrétés pour vol , viol ou baston et portant des vetements ressemblant vaguement à la tenue si caractéristique de ces nouveaux hors la loi et c'est , une nouvelle fois , le biker qui est montré du doigt . Les exemples sont légion . Les journalistes font désormais leur beurre sur un sujet porteur et instaurent une crainte injustifiée du barbu à la Harley . Il est devenu le pestiféré , le paria associal et bestial qu'il faut à tout prix éradiquer ! Loin d'etre des enfants de coeur , ils ne furent pas ces sauvages irrévérencieux et sanguinaires si injustement décriés ! Les bikers charrient bon nombres de fantasmes majoritairement imputables aux journaleux ! Des lors en découleront logiquement une véritable terreur de la populace à leur encontre et un harcelement policier sans répit , objets de nombreuses représailles inévitables . Mais les gars , aussi atypiques soient-ils , ont un code d'honneur . On ne touche pas à un membre impunément . Le couvert et le gite sont assurés de jour comme de nuit à n'importe quel Hell's Angel et ceci sur tout le territoire...Bref , on l'aura compris , les anges de l'enfer sont un univers à part entiere qu'il est difficile d'integrer ! Un univers aussi intrigant qu'attrayant : Easy Rider d'Hopper et l'Equipée Sauvage de Brando au cinéma en étant de parfaits exemples .
Un bouquin interessant sur le plan structurel de ces gangs et leur " way of life " si particulier mais qui me laisse cependant sur ma faim , faute de détails historiques . J'aurais aimé découvrir les prémices de ce mouvement contestataire , son évolution . L'auteur s'est , ici , borné à en décrire son quotidien , certes instructif mais au gout d'inachevé ! A l'instar de Thompson , j'ai entamé ce bouquin tres curieux , limite admiratif pour finalement en sortir désabusé...
Les Hell's Angels m'apparaissant désormais beaucoup plus comme un épiphenomene , instrumentalisé de toutes pieces que comme une légende Américaine...
Boooorn to be wiiiiiillld...
1965 : Thompson , la petite trentaine , décide alors de se pencher sur le phénomene Hell's Angels . Pour se faire , il les suit sur pres d'un an pour , au final , nous délivrer un récit personnalisant l'adage du verre à moitié vide et à moitié plein .
Zorro , Petit Jésus , Minus , le Parano , Terry le Clodo , Ed le Dégueulasse , la Brute... voilà quelques uns des doux sobriquetes avec lesquels l'auteur aura à se familiariser , surnoms faisant désormais office d'état civil . Comme l'aurait dit Coluche , on est une bande de jeunes , on s'fend la gueule sauf que tout le monde ne l'entend pas de cette oreille ! Notamment le sénateur Murphy qui les perçoit comme une bande de brutes dégénérées et qui s'empressera , des lors , de les appréhender sous la forme d'un rapport peu flatteur . Alors , ces Anges de l'Enfer , véritables démons apocalyptiques ou phenomene societal minoritaire exagérement déformé par une presse avide de lecteurs ?
Hell's Angel , c'est avant tout un art de vivre . Le refus de toute loi , de tout systeme . Le biker inculte sans foi ni loi , cradingue et aviné , symbole d'une liberté ultime dans une Amérique puritaine . Meme s'il est fortement fantasmé , le gars à la rossinante pétaradante détonne dans le paysage ! Cheveux hirsutes , tatouages expréssifs , il passe rarement inaperçu . Majoritairement issus des classes moyennes , peu d'entre eux bossent à temps plein , préférant de loin se consacrer à leur famille de coeur : les Hell's Angels . Définition toute personnelle de l'amour : penser à une femme comme l'on pense à sa bécane , véritable prolongement du biker . Il n'existe pas deux Harley identiques au monde ! Loisirs favoris de ce rebelle des temps modernes : rouler de concert avec tous ses potes ; castagner du quidam ; organiser des réunions , propices aux plus grosses gueules de bois jamais endurées sur le continent ! L'alcool , c'est bien , mais sans la drogue , ça pique moins les yeux . Benzédrine , Méthédrine , LSD , le biker en goguette aime varier les plaisirs et étancher sa soif de connaissance ! Et la femme dans tout ça ? Elle y a sa place et se doit d'etre plutot tolérante quand à ses légers écarts de conduite . Le biker aime sa mémé ( femme ) mais également celle des autres , n'hésitant pas à donner de sa personne afin d'apporter un peu de bonheur dans ce triste monde ! Oui , le biker est altruiste ! A noter que lors de réunions organisées , nombre de ces femmes participaient de leur plein gré , au risque d'etre la source de dérapages inévitables , l'alcool et la drogue les justifiant pleinement . Les plaintes pour viol n'étaient pas inaccoutumées mais paradoxalement , elles débouchaient rarement sur des condamnations , la femme déçue et frustrée ayant alors noirci le tableau et passant de " victime " consentante à plaignante régulierement déboutée . Il est également un paradoxe ambulant . Il rejette tout systeme mais se plie sans broncher aux regles de son gang . Il semble anti patriotique mais castagne à tout va lors d'une manifestation anti-vietnam . Son leader emblématique et fondateur , Ralph Barger Jr , n'hésitant pas à offrir les services de ses membres à Lyndon Johnson , sous couvert d'une lettre . Lettre restée toujours sans réponse à ce jour . J'ai comme dans l'idée que c'est foutu...
Le biker a trois ennemis : les motos asiatiques , les flics et les journaleux ! Ce sont ces memes journalistes qui en feront des parias , des rebuts de la société , en n'hésitant pas à les accuser systématiquement de tous les méfaits possibles et inimaginables . Une altercation faisant un blessé finira par déboucher sur un triple meurtre dans les journaux . Deux gars patibulaires arrétés pour vol , viol ou baston et portant des vetements ressemblant vaguement à la tenue si caractéristique de ces nouveaux hors la loi et c'est , une nouvelle fois , le biker qui est montré du doigt . Les exemples sont légion . Les journalistes font désormais leur beurre sur un sujet porteur et instaurent une crainte injustifiée du barbu à la Harley . Il est devenu le pestiféré , le paria associal et bestial qu'il faut à tout prix éradiquer ! Loin d'etre des enfants de coeur , ils ne furent pas ces sauvages irrévérencieux et sanguinaires si injustement décriés ! Les bikers charrient bon nombres de fantasmes majoritairement imputables aux journaleux ! Des lors en découleront logiquement une véritable terreur de la populace à leur encontre et un harcelement policier sans répit , objets de nombreuses représailles inévitables . Mais les gars , aussi atypiques soient-ils , ont un code d'honneur . On ne touche pas à un membre impunément . Le couvert et le gite sont assurés de jour comme de nuit à n'importe quel Hell's Angel et ceci sur tout le territoire...Bref , on l'aura compris , les anges de l'enfer sont un univers à part entiere qu'il est difficile d'integrer ! Un univers aussi intrigant qu'attrayant : Easy Rider d'Hopper et l'Equipée Sauvage de Brando au cinéma en étant de parfaits exemples .
Un bouquin interessant sur le plan structurel de ces gangs et leur " way of life " si particulier mais qui me laisse cependant sur ma faim , faute de détails historiques . J'aurais aimé découvrir les prémices de ce mouvement contestataire , son évolution . L'auteur s'est , ici , borné à en décrire son quotidien , certes instructif mais au gout d'inachevé ! A l'instar de Thompson , j'ai entamé ce bouquin tres curieux , limite admiratif pour finalement en sortir désabusé...
Les Hell's Angels m'apparaissant désormais beaucoup plus comme un épiphenomene , instrumentalisé de toutes pieces que comme une légende Américaine...
Boooorn to be wiiiiiillld...
Tout le monde ou presque connaît Hunter S. Thomson. Un des grands inventeurs du nouveau journalisme avec Tom Wolfe, et auteur de son œuvre la plus connue Las Vegas parano. Ici sont réunis tout style de correspondances écrites entre 1955 et 1976, elles parlent de tout et n'importe quoi : des lettres à Tom Wolfe, à la NRA, à Jimmy Carter, des coups de gueule pour des fringues de mauvaise qualité, des impossibilités de paiement, des protestations etc...
Bien avant les tweets, il y avait ses missives pour exprimer tout ce qu'il pensait, super gouaille, un magnifique prisme afin d'humer l'air de cette époque à travers l'esprit d'un homme libre
Bien avant les tweets, il y avait ses missives pour exprimer tout ce qu'il pensait, super gouaille, un magnifique prisme afin d'humer l'air de cette époque à travers l'esprit d'un homme libre
Le film réalisé par T. Gilliam en 1998 a popularisé cet œuvre publiée bien avant (en 1971), voire l’a vampirisé tant la performance des acteurs est magistrale.
Revenir sur le texte –inclassable-, où l’on ne sait plus si l’auteur est le narrateur/acteur ou si tout a été écrit par l’auteur, Hunter S. Thompson, depuis sa chambre, sous influence. Une parfaite illustration, d’après les critiques, du mouvement du journalisme gonzo (qui ne prétend pas à l’objectivité et où le journaliste est un protagoniste du reportage qu’il écrit à la première personne, cf wikipedia).
En substance, Las Vegas parano, ce sont les aventures fictives de Raoul Duke et de son avocat, le Dr Gonzo, lors d'un voyage hallucinatoire à Las Vegas pour couvrir une course de motos dans le désert.
Elles sont écrites dans un style extrêmement audacieux, provocateur avec des descriptions extravagantes, des métaphores puissantes et des monologues intérieurs, qui créent une ambiance étrange et déjantée tout au long de l'histoire, prétexte à une description, voire une dénonciation de la fin du rêve américain hippie des années 60 et de l’entrée dans « l’âge sombre » symbolisé par cette ville de Las Vegas, personnalisation complète du capitalisme stupide de l’époque, comme pourrait l’être Dubaï, aujourd’hui.
En filigrane, la guerre du Viet-Nam est un autre symbole de la fin de ce rêve : l’american dream de l’après-guerre devient un cauchemar qui a du sang sur les doigts, vendu par Hollywood comme un paquet de lessive.
Le roman est riche, il explore divers thèmes : la drogue bien sûr, mais surtout l'obsession du pouvoir, la quête de liberté, la décadence de la société occidentale.
Entendons-nous bien, il ne s’agit pas ici de la décadence au sens « droite des valeurs » mais la critique de l'idéal américain au sens de H. S. Thompson, c’est-à-dire une société du calcul, du profit, qui enferme ses individus dans des aspirations bassement matérielles, sous contrôle d’une morale télévisée par une religiosité d’état.
L’absurdité de Las Vegas : on se divertit en perdant de l’argent tout en croyant pouvoir en gagner facilement – le serpent qui se mord la queue.
L’utilisation massif de drogue (rôle central dans l’expérience hallucinatoire qui crée leur voyage virtuel) et l’inadéquation sociale qui en découle est pour l’auteur un moyen de libération parodique et le prétexte pour décrire les actions de marginaux, losers magnifiques du système, dont ils se moquent. La réalité se mue en une série d’évènements surréalistes.
C’est très drôle. Beaucoup plus fin dans son cynisme que ne laisse présager la 4ème de couverture.
Je le recommande… pour compléter l’expérience du film.
Revenir sur le texte –inclassable-, où l’on ne sait plus si l’auteur est le narrateur/acteur ou si tout a été écrit par l’auteur, Hunter S. Thompson, depuis sa chambre, sous influence. Une parfaite illustration, d’après les critiques, du mouvement du journalisme gonzo (qui ne prétend pas à l’objectivité et où le journaliste est un protagoniste du reportage qu’il écrit à la première personne, cf wikipedia).
En substance, Las Vegas parano, ce sont les aventures fictives de Raoul Duke et de son avocat, le Dr Gonzo, lors d'un voyage hallucinatoire à Las Vegas pour couvrir une course de motos dans le désert.
Elles sont écrites dans un style extrêmement audacieux, provocateur avec des descriptions extravagantes, des métaphores puissantes et des monologues intérieurs, qui créent une ambiance étrange et déjantée tout au long de l'histoire, prétexte à une description, voire une dénonciation de la fin du rêve américain hippie des années 60 et de l’entrée dans « l’âge sombre » symbolisé par cette ville de Las Vegas, personnalisation complète du capitalisme stupide de l’époque, comme pourrait l’être Dubaï, aujourd’hui.
En filigrane, la guerre du Viet-Nam est un autre symbole de la fin de ce rêve : l’american dream de l’après-guerre devient un cauchemar qui a du sang sur les doigts, vendu par Hollywood comme un paquet de lessive.
Le roman est riche, il explore divers thèmes : la drogue bien sûr, mais surtout l'obsession du pouvoir, la quête de liberté, la décadence de la société occidentale.
Entendons-nous bien, il ne s’agit pas ici de la décadence au sens « droite des valeurs » mais la critique de l'idéal américain au sens de H. S. Thompson, c’est-à-dire une société du calcul, du profit, qui enferme ses individus dans des aspirations bassement matérielles, sous contrôle d’une morale télévisée par une religiosité d’état.
L’absurdité de Las Vegas : on se divertit en perdant de l’argent tout en croyant pouvoir en gagner facilement – le serpent qui se mord la queue.
L’utilisation massif de drogue (rôle central dans l’expérience hallucinatoire qui crée leur voyage virtuel) et l’inadéquation sociale qui en découle est pour l’auteur un moyen de libération parodique et le prétexte pour décrire les actions de marginaux, losers magnifiques du système, dont ils se moquent. La réalité se mue en une série d’évènements surréalistes.
C’est très drôle. Beaucoup plus fin dans son cynisme que ne laisse présager la 4ème de couverture.
Je le recommande… pour compléter l’expérience du film.
Au milieu des année 1960, Hunter S. Thompson passe un an avec le plus célèbre des gangs de bikers : les Hell's Angels.
Alors que le club est au sommet de sa célébrité, les médias en donnent une image extrêmement négative ; les motards sont présentés comme des violeurs, des pilleurs, semant la destruction et la désolation sur leur passage, tels les Huns.
En s'intégrant au groupe, l'auteur donne une version plus nuancée et certainement plus proche de la réalité. Loin d'être des enfants de cœur, les agissements et motivations sont tout de même plus complexes que ce qui est présenté par les grands journaux, et pris pour argent comptant par l'opinion publique.
Entre récit et réflexion, sur fond de guerre du Vietnam, on découvre avec ce récit l'Amérique des années 60 par le prisme des parias, des rebuts de la société.
Un livre parfois un peu décousu, mais vraiment prenant, à condition toutefois d'être au préalable intéressé par le sujet.
Alors que le club est au sommet de sa célébrité, les médias en donnent une image extrêmement négative ; les motards sont présentés comme des violeurs, des pilleurs, semant la destruction et la désolation sur leur passage, tels les Huns.
En s'intégrant au groupe, l'auteur donne une version plus nuancée et certainement plus proche de la réalité. Loin d'être des enfants de cœur, les agissements et motivations sont tout de même plus complexes que ce qui est présenté par les grands journaux, et pris pour argent comptant par l'opinion publique.
Entre récit et réflexion, sur fond de guerre du Vietnam, on découvre avec ce récit l'Amérique des années 60 par le prisme des parias, des rebuts de la société.
Un livre parfois un peu décousu, mais vraiment prenant, à condition toutefois d'être au préalable intéressé par le sujet.
"Gonzo highway" a longtemps trôné dans ma salle de bain où, dans l'intimité, je me délectais de quelques missives impertinentes et parfois hilarantes qu'Hunther Thompson expédiait selon ses humeurs (disons... changeantes) à ceux qui d'une manière on d'une autre l'exaspéraient. Et ils étaient nombreux.. Des redacteurs en chef de journaux aux services de recouvrement en passant par les assureurs, Hunther balançait sans aucun filtre son fiel et sa prose inimitable. Forçant volontier le trait et flirtant parfois avec la mauvaise foi et le syndrôme de Gilles de la Tourette, il utilisait son franc-parler, sa gouille et sa clairvoyance (ou pas) pour mettre à jours les travers et contradictions de ceux qu'il avait dans son viseur. Jubilatoire...
C’est avec un inédit de Hunter S. Thompson que l’on découvre la collection de poche des éditions Tristram. On peut sans doute faire bien pire en la matière, d’autant plus que Thompson est bien entouré pour débuter cette collection hétéroclite, avec Laurence Sterne (la moindre des choses pour des éditions appelées Tristram), Joyce Carol Oates, Mark Twain ou Lester Bangs.
Mais revenons à nos moutons et à ce texte inédit de Thompson racontant par le menu un séjour à Hawaï où il est parti couvrir le marathon d’Honolulu pour un magazine consacré au running. Comme de bien entendu avec Hunter S. Thompson, le sujet a tôt fait de dévier sous l’influence conjuguée des psychotropes, de l’alcool et de la folie mégalomaniaque de l’écrivain. Du marathon d’Honolulu, on saura donc pour l’essentiel qu’il s’agit de gens qui courent et que Thompson s’est contenté de les regarder passer depuis le jardin d’une maison où il est allé voir un match de football américain, les insultant copieusement au passage. Et de se poser la question de ce qu’est devenu l’esprit de contestation des années 60 et 70 :
« Courir pour la vie… le sport, parce qu’il ne reste plus que ça. Ceux-là même qui brûlèrent leur ordre d’incorporation dans les années 60, et qui s’égarèrent dans les années 70, sont désormais à fond dans la course à pied. Quand la politique a échoué et que les relations interpersonnelles se sont avérées ingérables ; après que McGovern est tombé et que Nixon a explosé sous nos yeux… après que Ted Kennedy a chopé le syndrome Harold Stassen du type qui se présente à chaque coup et ne gagne jamais et que Jimmy Carter a déçu jusqu’au dernier de ses fidèles, et après que la nation s’est massivement ralliée à la sagesse atavique de Ronald Reagan.
Ma foi, nous voilà, après tout, dans les Années 80, et l’heure est enfin venue de savoir qui a des dents et qui n’en a pas. Ce qui peut éventuellement, mais ce n’est pas une certitude, expliquer l’étrange spectacle de deux générations de militants politiques se transformant finalement – vingt ans plus tard – en joggeurs.
Pourquoi cela ? »
Une question à laquelle, bien sûr, il ne répondra pas, obsédé qu’il est par une pêche au marlin compromise par une météo exécrable, par l’histoire de la mort du capitaine Cook, par la fabrication de bombes artisanales à partir de pétards chinois et, d’une façon générale, par l’absorption massive d’acides, de cocaïne, de bière et de gin.
Cela donne au final des pages génialement délirantes qui alternent avec d’autres beaucoup moins passionnantes, voire relativement plates et bien souvent répétitives. On y retrouve le Thompson de Las Vegas Parano dans toute sa splendeur, mais aussi, dans une certaine mesure, sur la voie d’une déchéance qui s’exprime à travers l’égocentrisme de plus en plus prégnant de l’auteur. En fin de compte, ce dont parle Thompson, c’est tout de même surtout de lui. Voilà donc un livre pour les curieux, pour les fans de Hunter Thompson, mais peut-être pas pour ceux qui veulent vraiment le découvrir. À ces derniers on conseillera plutôt la lecture de Hell’s Angels ou de Las Vegas Parano.
Lien : http://www.encoredunoir.com/..
Mais revenons à nos moutons et à ce texte inédit de Thompson racontant par le menu un séjour à Hawaï où il est parti couvrir le marathon d’Honolulu pour un magazine consacré au running. Comme de bien entendu avec Hunter S. Thompson, le sujet a tôt fait de dévier sous l’influence conjuguée des psychotropes, de l’alcool et de la folie mégalomaniaque de l’écrivain. Du marathon d’Honolulu, on saura donc pour l’essentiel qu’il s’agit de gens qui courent et que Thompson s’est contenté de les regarder passer depuis le jardin d’une maison où il est allé voir un match de football américain, les insultant copieusement au passage. Et de se poser la question de ce qu’est devenu l’esprit de contestation des années 60 et 70 :
« Courir pour la vie… le sport, parce qu’il ne reste plus que ça. Ceux-là même qui brûlèrent leur ordre d’incorporation dans les années 60, et qui s’égarèrent dans les années 70, sont désormais à fond dans la course à pied. Quand la politique a échoué et que les relations interpersonnelles se sont avérées ingérables ; après que McGovern est tombé et que Nixon a explosé sous nos yeux… après que Ted Kennedy a chopé le syndrome Harold Stassen du type qui se présente à chaque coup et ne gagne jamais et que Jimmy Carter a déçu jusqu’au dernier de ses fidèles, et après que la nation s’est massivement ralliée à la sagesse atavique de Ronald Reagan.
Ma foi, nous voilà, après tout, dans les Années 80, et l’heure est enfin venue de savoir qui a des dents et qui n’en a pas. Ce qui peut éventuellement, mais ce n’est pas une certitude, expliquer l’étrange spectacle de deux générations de militants politiques se transformant finalement – vingt ans plus tard – en joggeurs.
Pourquoi cela ? »
Une question à laquelle, bien sûr, il ne répondra pas, obsédé qu’il est par une pêche au marlin compromise par une météo exécrable, par l’histoire de la mort du capitaine Cook, par la fabrication de bombes artisanales à partir de pétards chinois et, d’une façon générale, par l’absorption massive d’acides, de cocaïne, de bière et de gin.
Cela donne au final des pages génialement délirantes qui alternent avec d’autres beaucoup moins passionnantes, voire relativement plates et bien souvent répétitives. On y retrouve le Thompson de Las Vegas Parano dans toute sa splendeur, mais aussi, dans une certaine mesure, sur la voie d’une déchéance qui s’exprime à travers l’égocentrisme de plus en plus prégnant de l’auteur. En fin de compte, ce dont parle Thompson, c’est tout de même surtout de lui. Voilà donc un livre pour les curieux, pour les fans de Hunter Thompson, mais peut-être pas pour ceux qui veulent vraiment le découvrir. À ces derniers on conseillera plutôt la lecture de Hell’s Angels ou de Las Vegas Parano.
Lien : http://www.encoredunoir.com/..
Ou comment lire un récit qui ne parle quasiment pas de marathon, mais beaucoup des difficultés du journaliste qui n’a pas vraiment envie de faire un reportage, qui n’aime pas le sport (je le comprends), qui a quelques soucis avec les hôteliers et autres personnes croisées pendant son séjour. Un journaliste qui a usé et abusé de quelques psychotropes, pour ne pas dire de beaucoup de psychotropes, tandis que son ami Ralph Steadman était aussi victime d’un malencontreux accident de surf. Ce sont des choses qui arrivent quand on s’essaie au sport et que le seul que l’on ait pratiqué jusque là, c’est :
– regarder un match de football ;
– suivi une course automobile, toujours sous psychotropes ;
– couru pour échapper à des poursuivants divers et variés.
Oui, je sais, je ne suis pas très sympa avec le sus-dit comparse, mais Thompson ne s’embarrasse pas non plus de finesse, lui qui n’hésite pas entre plusieurs substances alcoolisées, il les testera toutes. Le fond de ce reportage qui part dans tous les sens, c’est aussi ce constat sur les origines de l’engouement pour la course à pieds, et cela fait assez mal. Ou comment est-on passé du militantisme pur et dur des années 60, puis 70 à la course au jogging ?
Nous n’aurons pas la réponse à ce questionnement, peut-être est-ce avant tout à nous de la trouver, ou pas, à moins de nous inscrire nous aussi au prochain marathon. Et après cela, le reportage dégénère complètement, entre deux extraits du dernier voyage du capitaine Cook. Le livre part dans à peu près tous les sens, sauf celui de la course, il parlera de pêche aussi, et de la masse d’ennui générés par les excès en tout genre de notre valeureux reporter. Je ne connais rien au journalisme gonzo, et ne cherche pas forcément à enrichir ma culture sur le sujet. Je pense cependant qu’il faudra un certain temps avant que je ne me replonge dans la lecture d’un des ouvrages d’Hunter S. Thompson.
– regarder un match de football ;
– suivi une course automobile, toujours sous psychotropes ;
– couru pour échapper à des poursuivants divers et variés.
Oui, je sais, je ne suis pas très sympa avec le sus-dit comparse, mais Thompson ne s’embarrasse pas non plus de finesse, lui qui n’hésite pas entre plusieurs substances alcoolisées, il les testera toutes. Le fond de ce reportage qui part dans tous les sens, c’est aussi ce constat sur les origines de l’engouement pour la course à pieds, et cela fait assez mal. Ou comment est-on passé du militantisme pur et dur des années 60, puis 70 à la course au jogging ?
Nous n’aurons pas la réponse à ce questionnement, peut-être est-ce avant tout à nous de la trouver, ou pas, à moins de nous inscrire nous aussi au prochain marathon. Et après cela, le reportage dégénère complètement, entre deux extraits du dernier voyage du capitaine Cook. Le livre part dans à peu près tous les sens, sauf celui de la course, il parlera de pêche aussi, et de la masse d’ennui générés par les excès en tout genre de notre valeureux reporter. Je ne connais rien au journalisme gonzo, et ne cherche pas forcément à enrichir ma culture sur le sujet. Je pense cependant qu’il faudra un certain temps avant que je ne me replonge dans la lecture d’un des ouvrages d’Hunter S. Thompson.
The Rum Diary
Traduction : Bernard Cohen
Merci aux Editions Gallimard qui, en partenariat avec Babélio, nous ont gracieusement permis de découvrir "Rhum Express." ;o)
Ce livre, je l'ai dévoré en un après-midi. Pourtant - oserai-je l'avouer ? - dans la liste que j'avais choisie parmi les exemplaires proposés, il me tentait bien moins par exemple que "Kornwolf" de Tristan Egolf. Pauvre sotte que j'étais ! Sans la bienveillance du grand dieu des Scribes, je serais passée à côté d'un texte dont, s'il appartenait à notre espèce, on dirait qu'il possède une incroyable présence.
Non par le style, plus littéraire certes qu'on pouvait s'y attendre mais sans plus puisque Thompson ne se démarque pas encore ici par la férocité de sa griffe. Encore moins par l'histoire, surtout envisagée de loin, dans un résumé de quatrième de couverture. Grosso modo, il y est question d'un journaliste free-lance qui, sur un coup de tête et parce qu'il a envie de voir du pays, accepte un poste à Porto Rico, au sein d'un journal américain qui commence à être mangé aux mites. De récit de beuveries au rhum blanc en rapports de magouilles minables, il raconte l'année qu'il a passée dans la chaleur des Caraïbes et les expériences - limitées compte tenu de la situation - qu'il y a vécues.
Oui, tout cela est bien banal. Mais ...
Mais il y a Hunter S. Thompson.
Sous sa plume, Porto Rico prend des airs de gros fruit à demi pourri et très satisfait de l'être, les Etats-Unis affichent, avec une fatuité de dindon, leur volonté de colonisateurs sans complexes, Paul Kemp, le narrateur soit-disant paumé, se révèle intelligent et volontaire alors que son collègue déjà sur place, le solide Yeamon, ne va pas tarder à mettre sur la place sa nature d'authentique tête brûlée, la rédaction du "Daily News" se transforme en un exotique panier de crabes à l'agonie, les autochtones avancent comme des ombres indifférentes ou hautement malveillantes, le rhum trouble l'esprit ou le remet à flots, la chaleur moite des Caraïbes vous dégouline dans le dos et "Rhum Express" s'affirme comme un roman très, très prenant.
En le lisant, on songe à Malcolm Lowry et à "Au-dessous du volcan", l'un des plus grands romans qui aient jamais été écrits sur le mal de vivre, la solitude intérieure et leurs conséquences, l'angoisse et le ou les addictions censées la combattre. Mais si l'auteur britannique est plus flamboyant, plus lyrique - et moins cynique - l'Américain, lui, vit la dépendance à l'alcool comme un parcours initiatique et non comme une volonté autodestructrice. Thompson reste lucide et ne s'apitoie pas. Le cynisme total qui est le sien et que maîtrisait si peu Lowry, lui sert de garde-fou. Le vide l'attire, on n'en doute pas un seul instant et il n'en fait pas mystère, mais il parvient toujours à empêcher la face la plus sombre de lui-même d'y sombrer. On l'entend bien penser "A quoi bon, finalement ?" mais une curiosité qu'on peut qualifier d'extraordinaire, d'inhabituelle même, le pousse à dépasser ce raisonnement trop simple. Au-delà des cuites au rhum dont son alter ego ne conserve que bien peu de souvenirs, le romancier, lui, veut savoir ce qu'est le Vide avant d'accepter de s'y jeter.
... Question qui demeure sans réponse, bien sûr.
Quoi qu'il en soit, l'acharnement de Thompson à "voir plus loin" donne déjà à ce premier roman une puissance qui fascine et réveille en soi tout un flot de rêves (et de cauchemars) qu'on est étonné et ému de redécouvrir si jeunes, si pleins d'allant, si vigoureux. C'est l'éternel et incompréhensible miracle du conteur-né : le Temps n'est plus, les mots demeurent et le lecteur renaît à lui-même. ;o)
Traduction : Bernard Cohen
Merci aux Editions Gallimard qui, en partenariat avec Babélio, nous ont gracieusement permis de découvrir "Rhum Express." ;o)
Ce livre, je l'ai dévoré en un après-midi. Pourtant - oserai-je l'avouer ? - dans la liste que j'avais choisie parmi les exemplaires proposés, il me tentait bien moins par exemple que "Kornwolf" de Tristan Egolf. Pauvre sotte que j'étais ! Sans la bienveillance du grand dieu des Scribes, je serais passée à côté d'un texte dont, s'il appartenait à notre espèce, on dirait qu'il possède une incroyable présence.
Non par le style, plus littéraire certes qu'on pouvait s'y attendre mais sans plus puisque Thompson ne se démarque pas encore ici par la férocité de sa griffe. Encore moins par l'histoire, surtout envisagée de loin, dans un résumé de quatrième de couverture. Grosso modo, il y est question d'un journaliste free-lance qui, sur un coup de tête et parce qu'il a envie de voir du pays, accepte un poste à Porto Rico, au sein d'un journal américain qui commence à être mangé aux mites. De récit de beuveries au rhum blanc en rapports de magouilles minables, il raconte l'année qu'il a passée dans la chaleur des Caraïbes et les expériences - limitées compte tenu de la situation - qu'il y a vécues.
Oui, tout cela est bien banal. Mais ...
Mais il y a Hunter S. Thompson.
Sous sa plume, Porto Rico prend des airs de gros fruit à demi pourri et très satisfait de l'être, les Etats-Unis affichent, avec une fatuité de dindon, leur volonté de colonisateurs sans complexes, Paul Kemp, le narrateur soit-disant paumé, se révèle intelligent et volontaire alors que son collègue déjà sur place, le solide Yeamon, ne va pas tarder à mettre sur la place sa nature d'authentique tête brûlée, la rédaction du "Daily News" se transforme en un exotique panier de crabes à l'agonie, les autochtones avancent comme des ombres indifférentes ou hautement malveillantes, le rhum trouble l'esprit ou le remet à flots, la chaleur moite des Caraïbes vous dégouline dans le dos et "Rhum Express" s'affirme comme un roman très, très prenant.
En le lisant, on songe à Malcolm Lowry et à "Au-dessous du volcan", l'un des plus grands romans qui aient jamais été écrits sur le mal de vivre, la solitude intérieure et leurs conséquences, l'angoisse et le ou les addictions censées la combattre. Mais si l'auteur britannique est plus flamboyant, plus lyrique - et moins cynique - l'Américain, lui, vit la dépendance à l'alcool comme un parcours initiatique et non comme une volonté autodestructrice. Thompson reste lucide et ne s'apitoie pas. Le cynisme total qui est le sien et que maîtrisait si peu Lowry, lui sert de garde-fou. Le vide l'attire, on n'en doute pas un seul instant et il n'en fait pas mystère, mais il parvient toujours à empêcher la face la plus sombre de lui-même d'y sombrer. On l'entend bien penser "A quoi bon, finalement ?" mais une curiosité qu'on peut qualifier d'extraordinaire, d'inhabituelle même, le pousse à dépasser ce raisonnement trop simple. Au-delà des cuites au rhum dont son alter ego ne conserve que bien peu de souvenirs, le romancier, lui, veut savoir ce qu'est le Vide avant d'accepter de s'y jeter.
... Question qui demeure sans réponse, bien sûr.
Quoi qu'il en soit, l'acharnement de Thompson à "voir plus loin" donne déjà à ce premier roman une puissance qui fascine et réveille en soi tout un flot de rêves (et de cauchemars) qu'on est étonné et ému de redécouvrir si jeunes, si pleins d'allant, si vigoureux. C'est l'éternel et incompréhensible miracle du conteur-né : le Temps n'est plus, les mots demeurent et le lecteur renaît à lui-même. ;o)
Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream
Traduction : Philippe Mikkriamos
Publié pour la première fois sous forme de "feuilleton" dans "Rolling Stone" et tout au long du mois de novembre 1971, "Las Vegas Parano" est le récit fou, fou, fou de la virée à Las Vegas de deux hommes, le journaliste Raoul Duke, nom d'emprunt de Hunter S. Thompson, et son avocat, Oscar Zeta Acosta, rebaptisé pour la circonstance "Docteur Gonzo." Si l'identité réelle de Thompson est citée dans le livre, jamais on n'évoque celle d'Acosta, lequel est appelé à demeurer à jamais le Dr Gonzo, en tous cas pour les adeptes du romancier américain.
A l'origine, ce voyage mouvementé vers Las Vegas et le séjour qu'y font nos anti-héros ont pour but de couvrir la Mint 400, fameuse course qui se déroule dans le désert et qui, jusqu'en 1977, était ouverte exclusivement aux véhicules à deux roues. (De nos jours, les quatre-roues de tous types, ou presque, sont admis.) En d'autres termes, tout est réglé, et confortablement réglé, par un journal dont on est en droit de supposer qu'il s'agit de "Rolling Stone". Par la suite, abandonnant la course de motos et ses bikers, Duke et Dr Gonzo sont assaillis par l'impérieux besoin de couvrir une Convention de procureurs venus débattre à Vegas des mille-et-un dangers représentés par la drogue et plus encore par ceux qui en consomment.
Quand vous saurez que Raoul Duke, comme le Dr Gonzo, est chargé à bloc d'alcools forts, d'amphétamines, de mescaline, de coke, de nitrite d'amyle (ou poppers, si vous préférez) et même d'éther et d'extraits d'hypophyse humaine (!!!) et qu'il remet ça dès qu'il sent sa forme faiblir, vous comprendrez toute l'ironie de pareille participation à une si honnête Convention ...
Ceux qui s'imagineraient trouver ici une glorification des drogues et de leur consommation seront déçus : les hallucinations hideuses, comportements violents et inadaptés ainsi que les phénomènes divers observés tant chez Duke que chez le Dr Gonzo - chez celui-ci surtout, d'ailleurs - et fidèlement rapportés par un Hunter S. Thompson qui, on ne sait trop comment, réussit à préserver tout au fond de son cerveau la part de lucidité qui lui permettra de mener à terme ses articles, incitent plutôt le lecteur à vider dans ses toilettes tout produit un tant soit peu addictif, de l'innocente tablette de chocolat jusqu'aux flacons de Valium, avant de rayer définitivement de son vocabulaire le mot "drogue" et tout terme s'y rapportant.*
Dans ce tourbillon d'explosions psychédéliques qui métamorphosent le monde réel en le distordant à l'extrême, quand elles n'ouvrent pas les fameuses portes de la perception dont parlait Huxley sur des Angoisses épouvantables, insupportables, terrifiantes, il y a, en définitive, très peu de joie pure. Duke et Dr Gonzo se défoncent la tête, c'est là en fait leur seule joie - et elle est de nature sado-masochiste. Thompson ne l'exprime pas ainsi mais leur quête dans le dépassement de leurs limites physiques et mentales les a avant tout rendus accros à ces jouissances glauques et auto-destructrices qu'on trouve dans la douleur qu'on s'inflige de son propre chef. Et si c'est tel est le prix de leur quête, alors, il doit en être ainsi pour tous ceux qui se sont égarés dans la même voie.
Analyse lucide - eh ! oui, lu-ci-de ! - d'une époque en pleine mutation et du mal de vivre de ses contemporains, "Las Vegas Parano" est un récit brillant, drôlatique et féroce. A ne conseiller cependant qu'aux inconditionnels de Hunter S. Thompson et aux amateurs de second degré. Les autres feraient mieux de passer au large car tout ce qu'il y a ici de technique ébouriffante, de jubilation acide et aussi, malgré tout, de compassion pour l'Etre humain, risque fort de leur échapper.
* : Bon, d'accord, il y aura toujours des fêlés pour tomber en admiration devant l'attirail de drogues pas possible exhibé par nos deux compères. Mais il est impossible que, tout fêlés qu'ils soient, ils ne se rendent pas compte que la douleur - et elle seule - une douleur que Thompson décrit comme flamboyante, intense, corrosive, est toujours au rendez-vous. Cela observé, chacun détruit son cerveau comme il l'entend ... ;o)
Traduction : Philippe Mikkriamos
Publié pour la première fois sous forme de "feuilleton" dans "Rolling Stone" et tout au long du mois de novembre 1971, "Las Vegas Parano" est le récit fou, fou, fou de la virée à Las Vegas de deux hommes, le journaliste Raoul Duke, nom d'emprunt de Hunter S. Thompson, et son avocat, Oscar Zeta Acosta, rebaptisé pour la circonstance "Docteur Gonzo." Si l'identité réelle de Thompson est citée dans le livre, jamais on n'évoque celle d'Acosta, lequel est appelé à demeurer à jamais le Dr Gonzo, en tous cas pour les adeptes du romancier américain.
A l'origine, ce voyage mouvementé vers Las Vegas et le séjour qu'y font nos anti-héros ont pour but de couvrir la Mint 400, fameuse course qui se déroule dans le désert et qui, jusqu'en 1977, était ouverte exclusivement aux véhicules à deux roues. (De nos jours, les quatre-roues de tous types, ou presque, sont admis.) En d'autres termes, tout est réglé, et confortablement réglé, par un journal dont on est en droit de supposer qu'il s'agit de "Rolling Stone". Par la suite, abandonnant la course de motos et ses bikers, Duke et Dr Gonzo sont assaillis par l'impérieux besoin de couvrir une Convention de procureurs venus débattre à Vegas des mille-et-un dangers représentés par la drogue et plus encore par ceux qui en consomment.
Quand vous saurez que Raoul Duke, comme le Dr Gonzo, est chargé à bloc d'alcools forts, d'amphétamines, de mescaline, de coke, de nitrite d'amyle (ou poppers, si vous préférez) et même d'éther et d'extraits d'hypophyse humaine (!!!) et qu'il remet ça dès qu'il sent sa forme faiblir, vous comprendrez toute l'ironie de pareille participation à une si honnête Convention ...
Ceux qui s'imagineraient trouver ici une glorification des drogues et de leur consommation seront déçus : les hallucinations hideuses, comportements violents et inadaptés ainsi que les phénomènes divers observés tant chez Duke que chez le Dr Gonzo - chez celui-ci surtout, d'ailleurs - et fidèlement rapportés par un Hunter S. Thompson qui, on ne sait trop comment, réussit à préserver tout au fond de son cerveau la part de lucidité qui lui permettra de mener à terme ses articles, incitent plutôt le lecteur à vider dans ses toilettes tout produit un tant soit peu addictif, de l'innocente tablette de chocolat jusqu'aux flacons de Valium, avant de rayer définitivement de son vocabulaire le mot "drogue" et tout terme s'y rapportant.*
Dans ce tourbillon d'explosions psychédéliques qui métamorphosent le monde réel en le distordant à l'extrême, quand elles n'ouvrent pas les fameuses portes de la perception dont parlait Huxley sur des Angoisses épouvantables, insupportables, terrifiantes, il y a, en définitive, très peu de joie pure. Duke et Dr Gonzo se défoncent la tête, c'est là en fait leur seule joie - et elle est de nature sado-masochiste. Thompson ne l'exprime pas ainsi mais leur quête dans le dépassement de leurs limites physiques et mentales les a avant tout rendus accros à ces jouissances glauques et auto-destructrices qu'on trouve dans la douleur qu'on s'inflige de son propre chef. Et si c'est tel est le prix de leur quête, alors, il doit en être ainsi pour tous ceux qui se sont égarés dans la même voie.
Analyse lucide - eh ! oui, lu-ci-de ! - d'une époque en pleine mutation et du mal de vivre de ses contemporains, "Las Vegas Parano" est un récit brillant, drôlatique et féroce. A ne conseiller cependant qu'aux inconditionnels de Hunter S. Thompson et aux amateurs de second degré. Les autres feraient mieux de passer au large car tout ce qu'il y a ici de technique ébouriffante, de jubilation acide et aussi, malgré tout, de compassion pour l'Etre humain, risque fort de leur échapper.
* : Bon, d'accord, il y aura toujours des fêlés pour tomber en admiration devant l'attirail de drogues pas possible exhibé par nos deux compères. Mais il est impossible que, tout fêlés qu'ils soient, ils ne se rendent pas compte que la douleur - et elle seule - une douleur que Thompson décrit comme flamboyante, intense, corrosive, est toujours au rendez-vous. Cela observé, chacun détruit son cerveau comme il l'entend ... ;o)
Hell’s Angels. Un nom qui évoque tout de suite une série américaine quelconque, des grosses motos, du cuir, des barbes hirsutes, la bagarre. Pour moi, c’était cela, sans vraiment avoir d’autres éléments précis à donner. Et pourtant, j’étais loin du compte.
Ce livre, son auteur l’a écrit en s’immergeant parmi le groupe pendant plusieurs mois. Il les a suivis dans leurs beuveries, leurs bagarres, décrivant leurs mœurs sans concession, essayant de démêler le vrai du faux, l’instrumentalisation des autorités, les outrances journalistiques ; un vrai boulot d’investigation.
Au fil des pages, on se demande comment ils faisaient ces types pour survivre, dans un pays comme les Etats-Unis, si prompt à enfermer le premier qui passe la ligne de l’ongle de l’orteil. Eh bien, ils l’ont fait, plus ou moins longuement, plus ou moins en forme et ils ont laissé une légende, un road reality en quelque sorte.
Ce livre, son auteur l’a écrit en s’immergeant parmi le groupe pendant plusieurs mois. Il les a suivis dans leurs beuveries, leurs bagarres, décrivant leurs mœurs sans concession, essayant de démêler le vrai du faux, l’instrumentalisation des autorités, les outrances journalistiques ; un vrai boulot d’investigation.
Au fil des pages, on se demande comment ils faisaient ces types pour survivre, dans un pays comme les Etats-Unis, si prompt à enfermer le premier qui passe la ligne de l’ongle de l’orteil. Eh bien, ils l’ont fait, plus ou moins longuement, plus ou moins en forme et ils ont laissé une légende, un road reality en quelque sorte.
Je me souviens, c'était un dimanche après-midi du mois d'août, en 1998 précisément. Je tâtonnais laborieusement un certain temps dans la pénombre, espérant arriver sans encombres dans un des fauteuils aux accoudoirs élimés de la salle obscure d'un multiplex qui projetait pour la première fois le déjanté Las Vegas Parano de Terry Gilliam. Il faut dire que, deux heures auparavant, j'avais eu la bonne idée de mélanger une quantité non négligeable d'une substance psycho-active, à base de plantes médicinales, dans une proportion toute relative de dessert lacté. La conjonction inopinée des premiers effets du stupéfiant et de l'apparition tel un délire hallucinatoire sur le grand écran, en gros plan, de l'immense visage de Johnny Depp, affublé d'un bob, d'une paire de Ray-Ban Aviator aux montures dorées et d'un porte-cigarette, avait eu pour effet immédiat de me scotcher définitivement au velours sur lequel mon postérieur avait fini par céder à la force d'attraction terrestre. Pourtant, je décollais littéralement. Et pour cause. Les pérégrinations psychédéliques en CinémaScope du journaliste Raoul Duke & de son avocat le docteur Gonzo étaient en parfaite adéquation avec la lente digestion de mon psychotrope aux ferments lactiques. Je tripais en même temps que les personnages de ce road-movie sous acides. Ce n'est qu'après plusieurs visionnages, et cette fois-ci à jeun, que j'ai compris qu'il s'agissait d'une critique acerbe du rêve américain, perçu dans le film comme un cauchemar éveillé, et non une apologie de la défonce. En fait, l'auteur du livre dont est inspiré le scénario du film, très fidèle d'ailleurs, n'est autre que le reporter américain considéré comme le fondateur du journalisme Gonzo, art qui consiste à s'immerger dans son objet d'étude tout en revendiquant une grande subjectivité, le grand Hunter S.Thompson. Il avait l'immense talent de transformer les fiascos de ses reportages en littérature. C'était un véritable mythe vivant. Lisez-le, vous ne serez pas déçu du voyage !!!!
Hunter S. Thompson, je l'admire depuis que j’ai dévoré Gonzo Highway, un recueil de la correspondance de l’écrivain américain fervent pratiquant du journalisme gonzo. Ce type de journalisme, pour l’expliquer brièvement, est particulier dans le sens où il est ultra subjectif : le journaliste fait partie intégrante du reportage et considère que l’objectivité est un mythe. Par conséquent, les récits issus des reportages sont quasi de type fictionnel : inutile de tenter d’être objectif si l’objectivité n’existe pas. Si, à la manière de Thompson, le journaliste est justement sous l’emprise de drogues diverses, la réalité peut prendre alors une forme très particulière à travers les yeux du reporter, et aboutir à cette espèce de road-trip hallucinatoire que constitue Las Vegas Parano.
Bref, je ne veux pas pondre une note sur le journalisme gonzo, je maîtrise de toute façon trop mal le sujet, mais vous partager mes impressions sur cet ouvrage ouvrage de Thompson paru en 1972 aux Etats-Unis sous le titre original de Fear and Loathing in Las Vegas: a Savage Journey to the Heart of the American Dream (que l’on peut traduire par Peur et Dégoût à Las Vegas : un Parcours Sauvage au cœur du Rêve Américain). Thompson tente d’y raconter le plus fidèlement possible la période passée par lui-même (sous le surnom de Raoul Duke) et son avocat, Oscar Zeta Acosta (dit Dr Gonzo), à Las Vegas. Objectif avoué : trouver le Rêve Américain. Tout un programme.
Pour faire court, ce Fear and Loathing est le récit, raconté sous l’influence de la prise quasi constante de drogues diverses (de mémoire : mescaline, LSD, éther, alcool, marijuana, etc, etc), de ce qui à l’origine devait être la simple couverture d’une course de motos située en plein désert aux alentours de Las Vegas. Les péripéties autour de cette course, le Mint 400, constituent la première partie de l’ouvrage (la course en question n’est qu’un prétexte pour d’autres expériences impliquant notamment une baignoire, des pamplemousses ou encore un casino), tandis que la deuxième a un côté encore plus épicé car elle consiste en la couverture de la « convention nationale des procureurs sur les narcotiques et drogues dangereuses », ce qui ne manque pas de piquant. Prenez deux minutes pour tenter d’imaginer le risque pris par deux cinglés roulant dans une voiture de luxe louée à crédit dont le coffre est bourré de stupéfiants en tout genre lorsque qu’ils pénètrent dans un hôtel rempli à ras-bord de policiers dont l’objectif est d’éradiquer la drogue de l’Amérique : plutôt corsé n’est-ce pas ?
J’ai retrouvé dans Las Vegas Parano les mêmes thèmes que dans Gonzo Highway, avec comme toile de fond une espèce de dégoût profond de l’Amérique de Nixon et de la guerre du Vietnam, dont le récit constitue finalement une critique au vitriol, et une forme de nostalgie du début des sixties. Je ne peux pas prétendre avoir tout compris, j’ai eu à la lecture du roman une espèce d’impression constante d’irréalité, tout simplement parce-que je ne suis ni américain, ni sous l’emprise permanente de drogues, ni issu de l’époque en question, et encore moins spécialiste de la « culture de l’acide », je n’ai donc pu qu’au mieux tenter de comprendre ce que Thompson relate. L’impression d’irréalité est accentuée par le fait que les deux protagonistes semblent pouvoir tout se permettre et jouir d’une liberté totale, laquelle semble se payer par une sérieuse paranoïa soulignée selon les drogues utilisées.
Toujours est-il que le Las Vegas de Thompson m’évoque plus un cauchemar américain qu’un quelconque rêve. Est-ce que cela m’a dérangé ? Pas du tout ! J’avais adoré le style d’écriture de Thompson dans Gonzo Highway, je m’en suis régalé dans Fear and Loathing in Las Vegas. Pour conclure, il y a vraiment quelque-chose de jouissif dans cette manière d’écrire. Cela provient peut-être du fait que l’auteur ne prend pas de gants, il ne cherche pas à nous balader mais simplement à nous raconter les faits, ses faits tel que lui-même les perçoit ou les provoque, en se contrefichant puissamment de notre avis ou de celui qui éditera son récit.
Lien : http://nonivuniconnu.be/?p=611
Bref, je ne veux pas pondre une note sur le journalisme gonzo, je maîtrise de toute façon trop mal le sujet, mais vous partager mes impressions sur cet ouvrage ouvrage de Thompson paru en 1972 aux Etats-Unis sous le titre original de Fear and Loathing in Las Vegas: a Savage Journey to the Heart of the American Dream (que l’on peut traduire par Peur et Dégoût à Las Vegas : un Parcours Sauvage au cœur du Rêve Américain). Thompson tente d’y raconter le plus fidèlement possible la période passée par lui-même (sous le surnom de Raoul Duke) et son avocat, Oscar Zeta Acosta (dit Dr Gonzo), à Las Vegas. Objectif avoué : trouver le Rêve Américain. Tout un programme.
Pour faire court, ce Fear and Loathing est le récit, raconté sous l’influence de la prise quasi constante de drogues diverses (de mémoire : mescaline, LSD, éther, alcool, marijuana, etc, etc), de ce qui à l’origine devait être la simple couverture d’une course de motos située en plein désert aux alentours de Las Vegas. Les péripéties autour de cette course, le Mint 400, constituent la première partie de l’ouvrage (la course en question n’est qu’un prétexte pour d’autres expériences impliquant notamment une baignoire, des pamplemousses ou encore un casino), tandis que la deuxième a un côté encore plus épicé car elle consiste en la couverture de la « convention nationale des procureurs sur les narcotiques et drogues dangereuses », ce qui ne manque pas de piquant. Prenez deux minutes pour tenter d’imaginer le risque pris par deux cinglés roulant dans une voiture de luxe louée à crédit dont le coffre est bourré de stupéfiants en tout genre lorsque qu’ils pénètrent dans un hôtel rempli à ras-bord de policiers dont l’objectif est d’éradiquer la drogue de l’Amérique : plutôt corsé n’est-ce pas ?
J’ai retrouvé dans Las Vegas Parano les mêmes thèmes que dans Gonzo Highway, avec comme toile de fond une espèce de dégoût profond de l’Amérique de Nixon et de la guerre du Vietnam, dont le récit constitue finalement une critique au vitriol, et une forme de nostalgie du début des sixties. Je ne peux pas prétendre avoir tout compris, j’ai eu à la lecture du roman une espèce d’impression constante d’irréalité, tout simplement parce-que je ne suis ni américain, ni sous l’emprise permanente de drogues, ni issu de l’époque en question, et encore moins spécialiste de la « culture de l’acide », je n’ai donc pu qu’au mieux tenter de comprendre ce que Thompson relate. L’impression d’irréalité est accentuée par le fait que les deux protagonistes semblent pouvoir tout se permettre et jouir d’une liberté totale, laquelle semble se payer par une sérieuse paranoïa soulignée selon les drogues utilisées.
Toujours est-il que le Las Vegas de Thompson m’évoque plus un cauchemar américain qu’un quelconque rêve. Est-ce que cela m’a dérangé ? Pas du tout ! J’avais adoré le style d’écriture de Thompson dans Gonzo Highway, je m’en suis régalé dans Fear and Loathing in Las Vegas. Pour conclure, il y a vraiment quelque-chose de jouissif dans cette manière d’écrire. Cela provient peut-être du fait que l’auteur ne prend pas de gants, il ne cherche pas à nous balader mais simplement à nous raconter les faits, ses faits tel que lui-même les perçoit ou les provoque, en se contrefichant puissamment de notre avis ou de celui qui éditera son récit.
Lien : http://nonivuniconnu.be/?p=611
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

50 romans pour 50 états
Thyuig
50 livres

Îles maudites
Pecosa
83 livres

Le roman américain
HerveB
101 livres
Auteurs proches de Hunter S. Thompson
Lecteurs de Hunter S. Thompson (1450)Voir plus
Quiz
Voir plus
Juste la fin du monde
Comment commence la pièce ?
Par la scène d'arrivée de Louis chez lui
Par un dialogue entre Suzanne et son père
Par un monologue de Louis
Par la mort du père
10 questions
306 lecteurs ont répondu
Thème : Juste la fin du monde de
Jean-Luc LagarceCréer un quiz sur cet auteur306 lecteurs ont répondu