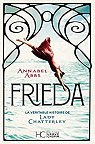Critiques de Annabel Abbs (187)
Merci tout d'abord à Pocket et à Babelio pour cette Masse Critique privilégié.
Frieda est l'histoire d'une femme mariée à un professeur de lettres anglais insipide. Elle s'ennuie dans sa petite vie fade à Nottingham elle qui est issue de la riche bourgeoisie allemande. Très vite sa soeur la pousse à venir à Munich où les choses bougent ainsi que les mentalités. Elle trouvera un homme qui va l'ouvrir à la liberté sexuelle et au féminisme. Revenant à sa vie britannique étriquée, elle continue à s'ennuyer malgré l'amour très fort qu'elle porte à ses enfants jusqu'au jour où elle rencontre un jeune étudiant de son mari M. Lawrence, alias Lorenzo le futur auteur de Lady Chatterley...mais je n'en dis pas plus sur le récit.
J'ai eu beaucoup de mal à lire ce roman, il y a trop de longueurs pour moi, un style qui aurait pu être plus attractif si l'auteure avait encore plus développé le côté charnel du personnage. Malgré les thèmes du féminisme, de la maternité, du rôle des femmes dans la société, ce n'est pas un coup de coeur pour moi. Les repères historiques et biographiques à la fin du livre sont par contre très enrichissants.
Frieda est l'histoire d'une femme mariée à un professeur de lettres anglais insipide. Elle s'ennuie dans sa petite vie fade à Nottingham elle qui est issue de la riche bourgeoisie allemande. Très vite sa soeur la pousse à venir à Munich où les choses bougent ainsi que les mentalités. Elle trouvera un homme qui va l'ouvrir à la liberté sexuelle et au féminisme. Revenant à sa vie britannique étriquée, elle continue à s'ennuyer malgré l'amour très fort qu'elle porte à ses enfants jusqu'au jour où elle rencontre un jeune étudiant de son mari M. Lawrence, alias Lorenzo le futur auteur de Lady Chatterley...mais je n'en dis pas plus sur le récit.
J'ai eu beaucoup de mal à lire ce roman, il y a trop de longueurs pour moi, un style qui aurait pu être plus attractif si l'auteure avait encore plus développé le côté charnel du personnage. Malgré les thèmes du féminisme, de la maternité, du rôle des femmes dans la société, ce n'est pas un coup de coeur pour moi. Les repères historiques et biographiques à la fin du livre sont par contre très enrichissants.
Coucou mes petits amis ! Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon avis sur La fille de Joyce, premier roman de la romancière anglaise Annabel Abbs. Je remercie infiniment les éditions Hervé Chopin pour ce très bel envoi !
Je ne vais pas y aller par quatre chemins : ce roman m'a fait mal, mais MAL. J'étais extrêmement curieuse à l'idée de lire ce titre basé sur une histoire vraie pour le moins singulière et incroyable mais je ne m'attendais pas à être autant indignée et folle de rage pendant ma lecture. J'ai même eu énormément de mal à finir le livre à cause de cela, c'est dire...
J'apprécie immensément le travail de recherches d'Annabel Abbs, son dévouement, sa volonté farouche de mettre en avant des femmes extraordinaires, talentueuses, ambitieuses, passionnées et pourtant injustement brimées et oubliées comme cela avait déjà été le cas avec Frieda (second roman de l'autrice mais premier traduit en France chez le même éditeur). J'ai véritablement souffert avec notre héroïne Lucia en lisant ce livre. Comme elle, je me suis sentie profondément trahie, bafouée, emprisonnée et j'ai ainsi refermé La fille de Joyce le cœur purement et simplement brisé mais également le cerveau en ébullition. Ce roman m'a mise hors de moi mais m'a aussi rappelé à quel point il était important de me battre aujourd'hui encore pour mes droits fondamentaux de femme, pour ma liberté d'expression et de choisir ma carrière et de façon plus générale mon destin sans laisser cette société patriarcale qui est malheureusement la nôtre me mettre des barrières.
En conclusion, je vous recommande fortement ce roman. Il vous fera faire la connaissance d'une jeune femme de chair et d'os d'un autre temps hors-du-commun qui méritait infiniment mieux...
Lien : https://lunartic.skyrock.com..
Je ne vais pas y aller par quatre chemins : ce roman m'a fait mal, mais MAL. J'étais extrêmement curieuse à l'idée de lire ce titre basé sur une histoire vraie pour le moins singulière et incroyable mais je ne m'attendais pas à être autant indignée et folle de rage pendant ma lecture. J'ai même eu énormément de mal à finir le livre à cause de cela, c'est dire...
J'apprécie immensément le travail de recherches d'Annabel Abbs, son dévouement, sa volonté farouche de mettre en avant des femmes extraordinaires, talentueuses, ambitieuses, passionnées et pourtant injustement brimées et oubliées comme cela avait déjà été le cas avec Frieda (second roman de l'autrice mais premier traduit en France chez le même éditeur). J'ai véritablement souffert avec notre héroïne Lucia en lisant ce livre. Comme elle, je me suis sentie profondément trahie, bafouée, emprisonnée et j'ai ainsi refermé La fille de Joyce le cœur purement et simplement brisé mais également le cerveau en ébullition. Ce roman m'a mise hors de moi mais m'a aussi rappelé à quel point il était important de me battre aujourd'hui encore pour mes droits fondamentaux de femme, pour ma liberté d'expression et de choisir ma carrière et de façon plus générale mon destin sans laisser cette société patriarcale qui est malheureusement la nôtre me mettre des barrières.
En conclusion, je vous recommande fortement ce roman. Il vous fera faire la connaissance d'une jeune femme de chair et d'os d'un autre temps hors-du-commun qui méritait infiniment mieux...
Lien : https://lunartic.skyrock.com..
Frieda von Richthofen, ou la femme qui a inspiré le célèbre et sulfureux roman L’Amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, publié en 1928 et interdit jusqu’en 1960 ! Je n’ai pas lu ce roman, et à vrai dire, la lecture de Frieda ne m’en a pas donné l’envie.
Mais voyons pourquoi…
L’histoire commence au début du XXème siècle où Frieda vit une vie rangée de mère au foyer, auprès de son mari Ernest et de ses trois enfants. Sa vie est monotone, manque de passion, et la comparaison avec la vie « déjantée » de ses sœurs en Allemagne n’est pas aisée à vivre.
Elle décide de rejoindre sa sœur à Munich, bien plus progressiste et avant-gardiste que l’Angleterre profonde où elle vit, où elle découvre le libertinage, et surtout, où elle se découvre elle-même.
Frieda, c’est avant tout une femme éprise de liberté, à une époque où les droits des femmes sont encore très limités et les mœurs très austères.
Cette biographie romancée autour de la vie de Frieda nous livre davantage de choses sur cette baronne Allemande qui a « abandonné » mari et enfants pour vivre une passion amoureuse avec son amant, ce qui a fait scandale à l’époque. Et au travers de ce roman, on se rend compte qu’il a rarement été question de choix pour Frieda, mais plutôt de sacrifices et que ce personnage épris de liberté quitte une jolie cage dorée pour s’enfermer dans une autre sorte de prison…
Sa relation avec D.H. Lawrence, si elle est passionnante par certains aspects, laisse tout de même une impression de malaise tant celle-ci est malsaine et dont l’emprise et la violence font peine à voir ; ce qui ne m’a pas conduit à vouloir découvrir l’œuvre de D.H. Lawrence.
S’il s’agit bien d’une biographie, c’est-à-dire basée sur une histoire vraie, celle-ci est romancée, l’auteur expliquant en fin du livre avoir pris quelques libertés pour favoriser l’architecture de son roman. Le tout est très bien rédigé, et se lit de façon fluide, avec des chapitres très courts et une écriture simple avec de nombreux dialogues.
En bref, j’ai trouvé intéressant cette lecture et la mise en lumière de la vie de Frieda, féministe avant l’heure, découvrant la liberté sexuelle, mais aussi les sacrifices qu’elle doit faire pour suivre ce chemin. Je trouve que Annabel Abbs a parfaitement su dépeindre cette ambivalence entre le désir de liberté de l’héroïne et le carcan étouffant de l’époque. Cependant, je n’ai pour ma part, pour le coup, pas ressenti d’empressement au fur et à mesure de ma lecture et n’est jamais réussi à me prendre à l’histoire.
Un grand merci à Babelio et aux éditions Pocket pour la lecture de ce roman.
Mais voyons pourquoi…
L’histoire commence au début du XXème siècle où Frieda vit une vie rangée de mère au foyer, auprès de son mari Ernest et de ses trois enfants. Sa vie est monotone, manque de passion, et la comparaison avec la vie « déjantée » de ses sœurs en Allemagne n’est pas aisée à vivre.
Elle décide de rejoindre sa sœur à Munich, bien plus progressiste et avant-gardiste que l’Angleterre profonde où elle vit, où elle découvre le libertinage, et surtout, où elle se découvre elle-même.
Frieda, c’est avant tout une femme éprise de liberté, à une époque où les droits des femmes sont encore très limités et les mœurs très austères.
Cette biographie romancée autour de la vie de Frieda nous livre davantage de choses sur cette baronne Allemande qui a « abandonné » mari et enfants pour vivre une passion amoureuse avec son amant, ce qui a fait scandale à l’époque. Et au travers de ce roman, on se rend compte qu’il a rarement été question de choix pour Frieda, mais plutôt de sacrifices et que ce personnage épris de liberté quitte une jolie cage dorée pour s’enfermer dans une autre sorte de prison…
Sa relation avec D.H. Lawrence, si elle est passionnante par certains aspects, laisse tout de même une impression de malaise tant celle-ci est malsaine et dont l’emprise et la violence font peine à voir ; ce qui ne m’a pas conduit à vouloir découvrir l’œuvre de D.H. Lawrence.
S’il s’agit bien d’une biographie, c’est-à-dire basée sur une histoire vraie, celle-ci est romancée, l’auteur expliquant en fin du livre avoir pris quelques libertés pour favoriser l’architecture de son roman. Le tout est très bien rédigé, et se lit de façon fluide, avec des chapitres très courts et une écriture simple avec de nombreux dialogues.
En bref, j’ai trouvé intéressant cette lecture et la mise en lumière de la vie de Frieda, féministe avant l’heure, découvrant la liberté sexuelle, mais aussi les sacrifices qu’elle doit faire pour suivre ce chemin. Je trouve que Annabel Abbs a parfaitement su dépeindre cette ambivalence entre le désir de liberté de l’héroïne et le carcan étouffant de l’époque. Cependant, je n’ai pour ma part, pour le coup, pas ressenti d’empressement au fur et à mesure de ma lecture et n’est jamais réussi à me prendre à l’histoire.
Un grand merci à Babelio et aux éditions Pocket pour la lecture de ce roman.
Annabel Abbs m’avait conquise avec «Frieda», qui vient de sortir en poche.
«La fille de Joyce» est sa première biographie romancée mais elle est traduite plus tardivement et publiée maintenant en France.
J’avais déjà découvert le triste destin de la fille de l’écrivain irlandais grâce au livre « Jérusalem ». Nous sommes dans la tête de Lucia Joyce, internée à l’asile psychiatrique de Northampton. Alan Moore rend hommage à cette figure de femme, malade certes, mais victime, peut-être, de la psychiatrie de l’époque.
Un spectacle théâtral est aussi dédié à la danseuse« Le Cas Lucia J »(Texte d’Eugène Durif)
Le récit dans le roman de Abbs alterne les événements de 1928 à Paris et ceux 1934 à Zurich mais nous découvrons aussi la façon dont les enfants de Joyce ont grandi, nés à Tieste dans la pauvreté Lucia et Giorgio avaient une relation très étroite, assez intense, car ils n’avaient d’autre compagnie que l’un avec l’autre. A Paris, Lucia Joyce tente de réaliser son rêve d’une carrière dans la danse. La fille de James Joyce, est contrariée dans son désir de renommée et d’indépendance par ses deux parents. Son père lui dit qu’elle est sa muse et ne peut pas travailler sans elle, tandis que sa mère considère la danse de Lucia comme immorale et est plus intéressée à promouvoir les talents et les ambitions de son fils Giorgio. Par l’intermédiaire de son père, Lucia, 21 ans, rencontre et tombe amoureuse de l’écrivain Samuel Beckett. Pendant ce temps en 1934 à Zurich, Lucia est traitée par Carl Gustav Jung, après une série de difficultés provoquées par la surprotection et l’étouffement de ses parents, ainsi que par ses déceptions avec des amours réels et imaginaires (Alexander Calder la rejettera également) C’est un regard fascinant sur la vie de Lucia Joyce et la ligne fine qui existe entre le génie et la folie. Lucia était-elle destinée à vivre dans un établissement psychiatrique, ou était-ce le produit de ses ambitions contrariées et de sa dynamique familiale.
Mademoiselle Joyce a été soignée à la clinique psychiatrique Burghölzli à Zurich. En 1951, elle a été transférée à l’hôpital St Andrew de Northampton, où elle est restée jusqu’à sa mort en 1982.
Livre tissé avec une force débordante, une belle prose et une touche d’humour, ce qui en fait une lecture fascinante.
Bien documenté et habilement écrit, c’est un roman qui plaira aux amateurs de fiction historique, biographique et psychologique.
J’ai également pensé à l’essai de Virginia Woolf «Une chambre à part» concernant la condition féminine.
«La fille de Joyce» est un récit tout simplement magnifique !
Lien : https://blog.lhorizonetlinfi..
«La fille de Joyce» est sa première biographie romancée mais elle est traduite plus tardivement et publiée maintenant en France.
J’avais déjà découvert le triste destin de la fille de l’écrivain irlandais grâce au livre « Jérusalem ». Nous sommes dans la tête de Lucia Joyce, internée à l’asile psychiatrique de Northampton. Alan Moore rend hommage à cette figure de femme, malade certes, mais victime, peut-être, de la psychiatrie de l’époque.
Un spectacle théâtral est aussi dédié à la danseuse« Le Cas Lucia J »(Texte d’Eugène Durif)
Le récit dans le roman de Abbs alterne les événements de 1928 à Paris et ceux 1934 à Zurich mais nous découvrons aussi la façon dont les enfants de Joyce ont grandi, nés à Tieste dans la pauvreté Lucia et Giorgio avaient une relation très étroite, assez intense, car ils n’avaient d’autre compagnie que l’un avec l’autre. A Paris, Lucia Joyce tente de réaliser son rêve d’une carrière dans la danse. La fille de James Joyce, est contrariée dans son désir de renommée et d’indépendance par ses deux parents. Son père lui dit qu’elle est sa muse et ne peut pas travailler sans elle, tandis que sa mère considère la danse de Lucia comme immorale et est plus intéressée à promouvoir les talents et les ambitions de son fils Giorgio. Par l’intermédiaire de son père, Lucia, 21 ans, rencontre et tombe amoureuse de l’écrivain Samuel Beckett. Pendant ce temps en 1934 à Zurich, Lucia est traitée par Carl Gustav Jung, après une série de difficultés provoquées par la surprotection et l’étouffement de ses parents, ainsi que par ses déceptions avec des amours réels et imaginaires (Alexander Calder la rejettera également) C’est un regard fascinant sur la vie de Lucia Joyce et la ligne fine qui existe entre le génie et la folie. Lucia était-elle destinée à vivre dans un établissement psychiatrique, ou était-ce le produit de ses ambitions contrariées et de sa dynamique familiale.
Mademoiselle Joyce a été soignée à la clinique psychiatrique Burghölzli à Zurich. En 1951, elle a été transférée à l’hôpital St Andrew de Northampton, où elle est restée jusqu’à sa mort en 1982.
Livre tissé avec une force débordante, une belle prose et une touche d’humour, ce qui en fait une lecture fascinante.
Bien documenté et habilement écrit, c’est un roman qui plaira aux amateurs de fiction historique, biographique et psychologique.
J’ai également pensé à l’essai de Virginia Woolf «Une chambre à part» concernant la condition féminine.
«La fille de Joyce» est un récit tout simplement magnifique !
Lien : https://blog.lhorizonetlinfi..
J'ai reçu ce livre dans le cadre de la Masse Critique spéciale Révélations 2021 Pocket.
Tout d'abord, je tiens à préciser que je lis peu de livres de ce genre, une femme d'une autre époque qui se libère ? Très bien ! Mais souvent rien qu'à la pensée de tout ce qu'elle va devoir affronter pour cela, je perds le courage de me lancer dans la lecture.
Qu'à cela ne tienne, la couverture et le résumé de ce livre m'avaient vraiment fait envie ! Une histoire vraie en plus ! Et j'ai drôlement bien fait de me lancer.
La narration alterne entre plusieurs personnages, dont Frieda, son mari Ernest, son fils Monty... J'ai aimé voir la progression de ces personnages, Monty qui grandit, Ernest qui est complètement paumé, que j'ai détesté par moments, qu'on apprend à comprendre... La plongée dans leurs pensées et leurs émotions vous retourne vraiment, c'est un portrait à vif, à charge parfois, mais surtout un portrait très juste en fait.
Le contexte du début du 20e siècle est très intéressant, surtout avec la plongée qu'on nous offre dans la société intellectuelle libérée de Munich, les débuts de la psychanalyse, les pistes d'émancipation des femmes... On voyage aussi pas mal, entre Angleterre, Allemagne et même Italie...
La liberté de Frieda, cette soif inextinguible qu'elle a en elle, sa façon de jouir de la vie et de ce qu'elle a à offrir, ce refus de se laisser agoniser pour sauver les apparences et pourtant ce déchirement de ne pas pouvoir se libérer ET être une mère présente pour ses enfants... Tout ça m'a vraiment chamboulée et je ressors de cette lecture encore un peu sonnée...
Par contre, on ne va pas se cacher que j'ai détesté D.H. Lawrence 😬 ah oui quel poète... Mais quel... Argh! Les mots (polis) me manquent, vous l'aurez compris. Cet aspect de l'émancipation de Frieda permet aussi de montrer à quel point ça a pu être difficile, controversé...
Il y a une notice historique à la fin et plein de références de livres, écrits par les personnages du livre (une part de moi trépigne à cette idée) ou de livres sur eux, et je pense y piocher !
Tout d'abord, je tiens à préciser que je lis peu de livres de ce genre, une femme d'une autre époque qui se libère ? Très bien ! Mais souvent rien qu'à la pensée de tout ce qu'elle va devoir affronter pour cela, je perds le courage de me lancer dans la lecture.
Qu'à cela ne tienne, la couverture et le résumé de ce livre m'avaient vraiment fait envie ! Une histoire vraie en plus ! Et j'ai drôlement bien fait de me lancer.
La narration alterne entre plusieurs personnages, dont Frieda, son mari Ernest, son fils Monty... J'ai aimé voir la progression de ces personnages, Monty qui grandit, Ernest qui est complètement paumé, que j'ai détesté par moments, qu'on apprend à comprendre... La plongée dans leurs pensées et leurs émotions vous retourne vraiment, c'est un portrait à vif, à charge parfois, mais surtout un portrait très juste en fait.
Le contexte du début du 20e siècle est très intéressant, surtout avec la plongée qu'on nous offre dans la société intellectuelle libérée de Munich, les débuts de la psychanalyse, les pistes d'émancipation des femmes... On voyage aussi pas mal, entre Angleterre, Allemagne et même Italie...
La liberté de Frieda, cette soif inextinguible qu'elle a en elle, sa façon de jouir de la vie et de ce qu'elle a à offrir, ce refus de se laisser agoniser pour sauver les apparences et pourtant ce déchirement de ne pas pouvoir se libérer ET être une mère présente pour ses enfants... Tout ça m'a vraiment chamboulée et je ressors de cette lecture encore un peu sonnée...
Par contre, on ne va pas se cacher que j'ai détesté D.H. Lawrence 😬 ah oui quel poète... Mais quel... Argh! Les mots (polis) me manquent, vous l'aurez compris. Cet aspect de l'émancipation de Frieda permet aussi de montrer à quel point ça a pu être difficile, controversé...
Il y a une notice historique à la fin et plein de références de livres, écrits par les personnages du livre (une part de moi trépigne à cette idée) ou de livres sur eux, et je pense y piocher !
Frieda est une jeune baronne allemande, mère de trois enfants et mariée à un professeur anglais ennuyeux comme la pluie, éprouvant de plus en plus souvent le sentiment de passer à côté de la vraie vie. Un séjour à Munich et les rencontres qu'elle va y faire vont réveiller son esprit d'insoumission et la pousser à prendre ses premières libertés : fumer, abandonner le corset, prendre un amant...
Sa rencontre avec Mr Lawrence va venir définitivement bouleverser sa vie : guidée par la passion, elle quitte mari et enfants pour lui. Or à l'époque, une femme reconnue coupable d'adultère pouvait être totalement privée de sa progéniture...
Privée d'une part vitale d'elle-même, écartelée entre son mari qui refuse le divorce et son amant qui prétend ne pas pouvoir vivre sans elle et devient imbuvable et jaloux, Frieda sait qu'elle devra payer le prix fort pour vivre sa vie. Par ses choix et son influence, ce personnage fort et complexe ouvrira la voie de la liberté érotique et inspirera plusieurs romans à D.H. Lawrence dont le plus célèbre, "L'Amant de Lady Chatterley", sera interdit pendant plus de trente ans. Passionnant !
Sa rencontre avec Mr Lawrence va venir définitivement bouleverser sa vie : guidée par la passion, elle quitte mari et enfants pour lui. Or à l'époque, une femme reconnue coupable d'adultère pouvait être totalement privée de sa progéniture...
Privée d'une part vitale d'elle-même, écartelée entre son mari qui refuse le divorce et son amant qui prétend ne pas pouvoir vivre sans elle et devient imbuvable et jaloux, Frieda sait qu'elle devra payer le prix fort pour vivre sa vie. Par ses choix et son influence, ce personnage fort et complexe ouvrira la voie de la liberté érotique et inspirera plusieurs romans à D.H. Lawrence dont le plus célèbre, "L'Amant de Lady Chatterley", sera interdit pendant plus de trente ans. Passionnant !
Je suis ravie d'avoir pu découvrir cette biographie. Merci à Babelio et à Pocket pour l'envoi de ce livre dans le cadre des Masses Critiques. J'ignorai tout de Frieda von Richthofen, et l'auteure a pourtant réussi à me happer dans l'histoire de cette femme au destin tortueux. Elle a sans aucun doute un don pour l'écriture de biographie romancée. Et je peux d'ores et déjà vous dire que je suivrai de près les publications d'Annabel Abbs ! L'auteure nous emmène en 1907 à Nottingham, où Frieda, jeune maman de trois enfants, vit une vie monotone et se sent délaissée par son mari Ernest. A la suite d'un séjour en Allemagne chez l'une de ses sœurs, elle va découvrir la liberté et la passion. Et à partir de ce moment, elle va collectionner les amants jusqu'à rencontrer D. H. Lawrence. Alors, j'ai eu beaucoup de mal Lorenzo (Frieda le surnommait ainsi) qui au début semblait sympathique et attentionné, et très vite on le découvre égoïste et violent. Pour lui, Frieda renoncera à ses enfants (ce qui est à mon sens le sacrifice ultime), et malgré cela, il ne supportera pas le chagrin qu'éprouve Frieda pour la perte de ses enfants. Si Frieda était à la recherche d'une libération sexuelle, j'ai trouvé qu'en tombant amoureuse de D. H. Lawrence, elle s'est enfermée dans une spirale avec un homme a qui j'ai trouvé beaucoup de points communs avec un pervers narcissique. L'auteure alterne les chapitres entre différents personnages: Frieda, Ernest mais aussi ses enfants. Et j'ai trouvé qu'avoir la vision de ses derniers étaient très intéressants. Ce livre est très bien documenté, on dispose à la fin de repères historiques pour en savoir plus sur chacun des personnages. C'est un portrait passionnant que je vous recommande de découvrir.
Lien : https://littlemeggy.wordpres..
Lien : https://littlemeggy.wordpres..
Joli portrait d'une femme courageuse qui ne craint pas de se confronter aux hommes dans le Munich des années 1900. de belles descriptions d'une société bien-pensante qui enferme dans des croyances limitantes et coupe les ailes du désir.
C'est également dans une large mesure la biographie de celle qui a inspiré le personnage de Lady Chatterley mais également un éclairage nouveau sur la personnalité de l'auteur DH Lawrence.
Le tout est plutôt bien écrit et plaisant.
C'est également dans une large mesure la biographie de celle qui a inspiré le personnage de Lady Chatterley mais également un éclairage nouveau sur la personnalité de l'auteur DH Lawrence.
Le tout est plutôt bien écrit et plaisant.
Frieda von Richtthofen, baronne allemande, vivant à Nottingham avec son mari et se enfants ne savaient pas qu'elle était malheureuse jusqu'à la visite de sa soeur chez elle. Cette dernière lui renvoie sans ambages sa piètre condition et son manque d'ouverture au monde en tant que femme mariée. Ce qu'il lui faut selon elle : un amant et un bouillon de culture.
Alors Frieda s'interroge. Est-elle heureuse avec Ernest ? Est-elle épanouie dans sa vie de tous les jours ? Est-ce conforme à ce qu'elle avait souhaité ? Il est certain qu'une escapade à Munich effacera ses doutes et la ramènera auprès des siens ! Mais voilà, on n'échappe pas si facilement à sa nature profonde. Une fois arrivée auprès de ses soeurs, Frieda va découvrir une vie qui lui correspond et à laquelle elle a renoncé. Si le meilleur moyen de résister à la tentation est d'y céder, cet adage va entraîner Frieda loin de ses repères et bouleverser sa vie à jamais. Dans les bras d'Otto, elle va découvrir la liberté. Celle du corps et de l'esprit. Et encore empreinte d'une foi en son mariage, elle va essayer d'ouvrir les yeux à son mari. Malgré ses tentatives de rapprochement, Ernest reste obstinément l'homme qu'il est. Pétri de conventions, adepte de la bienséance, ce dernier ne voit pas que sa femme lui échappe. Et c'est lors d'un déjeuner avec le jeune écrivain D. H Lawrence que tout bascule définitivement.
Frieda initie le jeune homme aux jeux de l'amour et de l'érotisme. Ce dernier embrasse la fibre révolutionnaire de son amante avec la ferveur de son génie. S'ensuit alors une histoire d'amour, étroitement liée à la création, qui fera tout perdre à Frieda. Séparée de ses enfants , elle renoncera à sa vie de mère pour son amant. Frieda se voudra libre mais s'enfermera dans le rôle de muse de l'auteur. C'est là tout le paradoxe de sa quête effrénée vers l'indépendance. Ce paradoxe des sentiments sera également exprimé par Ernest, ce mari si peu démonstratif qui laissera voir son amour pour elle dans cette haine farouche qu'il lui opposera.
Quoiqu'il en soit, découvrir Frieda fut pour moi une réelle surprise. Révolutionnaire dans sa façon de penser et d'agir, elle n'en reste pas moins un personnage rempli de mystère et qui parfois m'aura échappé dans ses raisonnements.
Les notes de l'auteur en fin de livre apporte au récit un réel bonus qui permet d'inscrire ce roman dans une part d'histoire de la littérature et qui aura eu pour moi le rôle de l'ancrer dans une vérité.
Merci à Babelio et aux éditions Pocket pour m'avoir permis de faire cette découverte.
Alors Frieda s'interroge. Est-elle heureuse avec Ernest ? Est-elle épanouie dans sa vie de tous les jours ? Est-ce conforme à ce qu'elle avait souhaité ? Il est certain qu'une escapade à Munich effacera ses doutes et la ramènera auprès des siens ! Mais voilà, on n'échappe pas si facilement à sa nature profonde. Une fois arrivée auprès de ses soeurs, Frieda va découvrir une vie qui lui correspond et à laquelle elle a renoncé. Si le meilleur moyen de résister à la tentation est d'y céder, cet adage va entraîner Frieda loin de ses repères et bouleverser sa vie à jamais. Dans les bras d'Otto, elle va découvrir la liberté. Celle du corps et de l'esprit. Et encore empreinte d'une foi en son mariage, elle va essayer d'ouvrir les yeux à son mari. Malgré ses tentatives de rapprochement, Ernest reste obstinément l'homme qu'il est. Pétri de conventions, adepte de la bienséance, ce dernier ne voit pas que sa femme lui échappe. Et c'est lors d'un déjeuner avec le jeune écrivain D. H Lawrence que tout bascule définitivement.
Frieda initie le jeune homme aux jeux de l'amour et de l'érotisme. Ce dernier embrasse la fibre révolutionnaire de son amante avec la ferveur de son génie. S'ensuit alors une histoire d'amour, étroitement liée à la création, qui fera tout perdre à Frieda. Séparée de ses enfants , elle renoncera à sa vie de mère pour son amant. Frieda se voudra libre mais s'enfermera dans le rôle de muse de l'auteur. C'est là tout le paradoxe de sa quête effrénée vers l'indépendance. Ce paradoxe des sentiments sera également exprimé par Ernest, ce mari si peu démonstratif qui laissera voir son amour pour elle dans cette haine farouche qu'il lui opposera.
Quoiqu'il en soit, découvrir Frieda fut pour moi une réelle surprise. Révolutionnaire dans sa façon de penser et d'agir, elle n'en reste pas moins un personnage rempli de mystère et qui parfois m'aura échappé dans ses raisonnements.
Les notes de l'auteur en fin de livre apporte au récit un réel bonus qui permet d'inscrire ce roman dans une part d'histoire de la littérature et qui aura eu pour moi le rôle de l'ancrer dans une vérité.
Merci à Babelio et aux éditions Pocket pour m'avoir permis de faire cette découverte.
Nouveau portrait de femme
Vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé de Frieda l’année dernière. Cette biographie romancée de la véritable Lady Chatterley avait été un vrai coup de cœur. La vie de cette femme forte et courageuse avait été aussi inspirante que douloureuse. Le format poche venant de sortir, je ne peux que vous recommander à nouveau cette belle lecture.
Avec son second roman, La fille de Joyce, Annabel Abbs reprend une recette identique : biographie romancée d’une femme de l’entourage d’un grand écrivain sulfureux.
Cette fois nous faisons la connaissance de Lucia, fille de James Joyce, auteur ayant fait scandale avec son Ulysse.
Lucia est une danseuse de génie dans le Paris de l’entre-deux guerres. Elle y fera la connaissance de son grand amour, Samuel Beckett.
Artiste ratée, aux ambitions brisées, femme malheureuse, elle finira sa vie en asile psychiatrique.
Mutique depuis des années, c’est dans le cabinet de Carl Jung que l’on fait la connaissance de la jeune femme.
Car la famille Joyce cache de sombres secrets...
J’avoue avoir moins aimé La fille de Joyce que Frieda.
La plume est toujours aussi agréable mais cela tient au personnage principal. Si j’ai trouvé que les deux femmes avaient en commun d’être victimes des mœurs de leurs époques, Frieda avait quelque chose de plus admirable que Lucia. Oui, j’ai admiré Frieda et j’ai eu de la peine pour Lucia.
On sent venir le drame, sans savoir vraiment de quel côté il va arriver et on se fait cueillir.
L'entourage de Lucia est tellement toxique...!
J’aime tout de même l’idée de découvrir ces femmes qui ont tant œuvré pour les carrières d’écrivains, de mettre en lumière celles qui ont toujours été dans l’ombre.
J'ai aimé également déambuler dans ce Paris des années folles, voir le désir d'émancipation émerger chez les femmes.
On sent toutes les recherches rigoureuses derrière ce roman.
Si cette lecture n'a pas été le coup de cœur qu'avait été Frieda, La fille de Joyce a tout de même été une lecture agréable.
Annabel Abbs croque une fois encore un portrait de femme brisée et rend hommage à celles qui ont été écrasées par le patriarcat.
Sur quel écrivain l'autrice nous fera-t-elle ouvrir les yeux dans son prochain titre ?
Lien : https://demoisellesdechatill..
Vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé de Frieda l’année dernière. Cette biographie romancée de la véritable Lady Chatterley avait été un vrai coup de cœur. La vie de cette femme forte et courageuse avait été aussi inspirante que douloureuse. Le format poche venant de sortir, je ne peux que vous recommander à nouveau cette belle lecture.
Avec son second roman, La fille de Joyce, Annabel Abbs reprend une recette identique : biographie romancée d’une femme de l’entourage d’un grand écrivain sulfureux.
Cette fois nous faisons la connaissance de Lucia, fille de James Joyce, auteur ayant fait scandale avec son Ulysse.
Lucia est une danseuse de génie dans le Paris de l’entre-deux guerres. Elle y fera la connaissance de son grand amour, Samuel Beckett.
Artiste ratée, aux ambitions brisées, femme malheureuse, elle finira sa vie en asile psychiatrique.
Mutique depuis des années, c’est dans le cabinet de Carl Jung que l’on fait la connaissance de la jeune femme.
Car la famille Joyce cache de sombres secrets...
J’avoue avoir moins aimé La fille de Joyce que Frieda.
La plume est toujours aussi agréable mais cela tient au personnage principal. Si j’ai trouvé que les deux femmes avaient en commun d’être victimes des mœurs de leurs époques, Frieda avait quelque chose de plus admirable que Lucia. Oui, j’ai admiré Frieda et j’ai eu de la peine pour Lucia.
On sent venir le drame, sans savoir vraiment de quel côté il va arriver et on se fait cueillir.
L'entourage de Lucia est tellement toxique...!
J’aime tout de même l’idée de découvrir ces femmes qui ont tant œuvré pour les carrières d’écrivains, de mettre en lumière celles qui ont toujours été dans l’ombre.
J'ai aimé également déambuler dans ce Paris des années folles, voir le désir d'émancipation émerger chez les femmes.
On sent toutes les recherches rigoureuses derrière ce roman.
Si cette lecture n'a pas été le coup de cœur qu'avait été Frieda, La fille de Joyce a tout de même été une lecture agréable.
Annabel Abbs croque une fois encore un portrait de femme brisée et rend hommage à celles qui ont été écrasées par le patriarcat.
Sur quel écrivain l'autrice nous fera-t-elle ouvrir les yeux dans son prochain titre ?
Lien : https://demoisellesdechatill..
Je remercie vivement l'opération Masse critique et les éditions Pocket: sans cela, je n'aurais jamais choisi de lire ce roman et cela aurait été TRES dommage!!!
L'écriture est fluide, les chapitres, courts, s'enchainent et nous font voir divers points de vue. Le roman a été fini en deux jours!!! Nous découvrons une femme qui souffre de son enfermement dans le mariage. Avant cela, elle était également prisonnière de sa position de troisième fille alors même que son père, militaire, attendait enfin un petit Frietzl!!! Personne ne connait réellement qui elle est. Elle non plus d'ailleurs! Jusqu'au jour où sa sœur vient titiller sa curiosité en même temps que sa fierté, la ramenant dans son pays natal où elle rencontrera le docteur Gross, proche de Freud... Je m'arrête là en ce qui concerne les grandes lignes du roman.
J'aime les lectures qui nous apportent quelque chose, qui nous donnent l'impression de nous coucher plus érudit. C'est clairement le cas avec ce roman. L'Allemagne, l'Angleterre du début du XXème nous sont dévoilées, la condition de la femme en marche vers sa libération est abordée, des touches étymologiques apparaissent par le biais du mari de Frieda, l'écrivain Lawrence est mis en avant en même temps que ses œuvres... Bref, une lecture intelligente bien que facile, avec un personnage fort attachant, blessé par la vie mais résilient. Encore un grand merci pour cette belle découverte!!!
L'écriture est fluide, les chapitres, courts, s'enchainent et nous font voir divers points de vue. Le roman a été fini en deux jours!!! Nous découvrons une femme qui souffre de son enfermement dans le mariage. Avant cela, elle était également prisonnière de sa position de troisième fille alors même que son père, militaire, attendait enfin un petit Frietzl!!! Personne ne connait réellement qui elle est. Elle non plus d'ailleurs! Jusqu'au jour où sa sœur vient titiller sa curiosité en même temps que sa fierté, la ramenant dans son pays natal où elle rencontrera le docteur Gross, proche de Freud... Je m'arrête là en ce qui concerne les grandes lignes du roman.
J'aime les lectures qui nous apportent quelque chose, qui nous donnent l'impression de nous coucher plus érudit. C'est clairement le cas avec ce roman. L'Allemagne, l'Angleterre du début du XXème nous sont dévoilées, la condition de la femme en marche vers sa libération est abordée, des touches étymologiques apparaissent par le biais du mari de Frieda, l'écrivain Lawrence est mis en avant en même temps que ses œuvres... Bref, une lecture intelligente bien que facile, avec un personnage fort attachant, blessé par la vie mais résilient. Encore un grand merci pour cette belle découverte!!!
Voilà un roman qui n'est pas seulement un portrait de femme, qui n'est pas seulement la biographie de celle qui a inspiré le personnage de Lady
Chatterley, mais c'est aussi le Munich des années 1900 et par défaut une biographie de l'auteur DH Lawrence sur lequel évidemment on est obligé de s'intéresser.
Frieda c'est 4 histoires en une seule. 4 histoires qui n'en font qu'une. L'écriture est fluide (traduit de l'anglais par Anne-Carole Grillot). le roman est dévoré en quelques jours. Sa construction basée sur de courts chapitres par personnage permet une lecture rapide et efficace. On plonge tête baissée dans le Munich 1920, accroché aux basques de Frieda, à l'image de Monty subjugué par sa mère.
Frieda étouffe dans une vie familiale à Nottingham entre un époux rigide qui voudrait mais n'a pas le courage d'oser et 3 enfants adorables. Il aurait peut être suffit de pas grand chose. Un peu plus d'attention et d'intérêt de la part d'Ernest, un autre cadre et tout aurait pu être différent.
La visite de la soeur de Frieda sera LE déclencheur. Frieda découvre, à Munich, une autre vie, la liberté sexuelle, l'épanouissement. Elle sort du carcan familial et se sent vivante en tant que femme et individu.
Frieda ne pourra pas tout avoir. Changer de vie, s'émanciper, être considérée, exister et garder ses enfants.
Page 214 :"Je veux une vie de courage. de liberté. Je veux être moi-même".
Elle devra faire des choix, faire face à la violence de Lawrence, renoncer à ses enfants pour pouvoir être libre ?
Où se trouve la liberté dans ce choix là ? Mais c'est un autre débat.
.....-----.....
Masse critique spéciale : Validé
Livre étranger du mois : Validé
MAJ culture générale : Validé
Découverte d'un excellent roman : Validé
Je n'aurais jamais lu ce livre sans cette masse critique spéciale et je l'ai adoré donc merci Babelio
Chatterley, mais c'est aussi le Munich des années 1900 et par défaut une biographie de l'auteur DH Lawrence sur lequel évidemment on est obligé de s'intéresser.
Frieda c'est 4 histoires en une seule. 4 histoires qui n'en font qu'une. L'écriture est fluide (traduit de l'anglais par Anne-Carole Grillot). le roman est dévoré en quelques jours. Sa construction basée sur de courts chapitres par personnage permet une lecture rapide et efficace. On plonge tête baissée dans le Munich 1920, accroché aux basques de Frieda, à l'image de Monty subjugué par sa mère.
Frieda étouffe dans une vie familiale à Nottingham entre un époux rigide qui voudrait mais n'a pas le courage d'oser et 3 enfants adorables. Il aurait peut être suffit de pas grand chose. Un peu plus d'attention et d'intérêt de la part d'Ernest, un autre cadre et tout aurait pu être différent.
La visite de la soeur de Frieda sera LE déclencheur. Frieda découvre, à Munich, une autre vie, la liberté sexuelle, l'épanouissement. Elle sort du carcan familial et se sent vivante en tant que femme et individu.
Frieda ne pourra pas tout avoir. Changer de vie, s'émanciper, être considérée, exister et garder ses enfants.
Page 214 :"Je veux une vie de courage. de liberté. Je veux être moi-même".
Elle devra faire des choix, faire face à la violence de Lawrence, renoncer à ses enfants pour pouvoir être libre ?
Où se trouve la liberté dans ce choix là ? Mais c'est un autre débat.
.....-----.....
Masse critique spéciale : Validé
Livre étranger du mois : Validé
MAJ culture générale : Validé
Découverte d'un excellent roman : Validé
Je n'aurais jamais lu ce livre sans cette masse critique spéciale et je l'ai adoré donc merci Babelio
J'ai reçu ce roman dans le cadre d'une MC privilégiée. Deux titres étaient au choix. Celui-ci n'était pas mon préféré, à cause de l'histoire en elle même. Cette femme quittant tout pour son amant.
Je n'avais pas réalisé alors qu'il s'agissait d'une biographie d'une femme ayant vraiment existé. En effet, Frieda est celle qui a inspiré "L'amant de Lady Chatterley" de D.H. Lawrence. Je ne l'ai pas lu, mais ce roman est très connu.
Je pensais donc lire une variation de ce thème.
Mais c'est bien une biographie de Frieda von Richthofen que vous trouverez ici.
Ici, ce n'est pas tant l'amante que nous allons découvrir, mais la figure de la mère. Frieda en "s'enfuyant" avec Lawrence se trouve en effet privée de ses 3 enfants.
C'est un récit terrible et douloureux, qui pose de nombreuses questions. Le récit est bien écrit, il alterne les voix de plusieurs personnages, nous permettant de découvrir les points de vue de chacun devant cette situation. On découvre cette femme, on découvre l'ambiance à Munich dans les années 1910, les idées révolutionnaires de Freud, la volonté d'échapper à toutes sortes de contraintes. Mais à quel prix ?!
L'autrice a réalisé de nombreuses recherches, et j'ai apprécié les annexes nous présentant les différents personnages du récit et son travail de recherche.
Je n'avais pas réalisé alors qu'il s'agissait d'une biographie d'une femme ayant vraiment existé. En effet, Frieda est celle qui a inspiré "L'amant de Lady Chatterley" de D.H. Lawrence. Je ne l'ai pas lu, mais ce roman est très connu.
Je pensais donc lire une variation de ce thème.
Mais c'est bien une biographie de Frieda von Richthofen que vous trouverez ici.
Ici, ce n'est pas tant l'amante que nous allons découvrir, mais la figure de la mère. Frieda en "s'enfuyant" avec Lawrence se trouve en effet privée de ses 3 enfants.
C'est un récit terrible et douloureux, qui pose de nombreuses questions. Le récit est bien écrit, il alterne les voix de plusieurs personnages, nous permettant de découvrir les points de vue de chacun devant cette situation. On découvre cette femme, on découvre l'ambiance à Munich dans les années 1910, les idées révolutionnaires de Freud, la volonté d'échapper à toutes sortes de contraintes. Mais à quel prix ?!
L'autrice a réalisé de nombreuses recherches, et j'ai apprécié les annexes nous présentant les différents personnages du récit et son travail de recherche.
Ce qu’il y a de bien (entre autres) dans la lecture est que cela emmène souvent sur des pistes impensées avant la lecture. Ainsi le programme de lecture de ce site m’a proposé de lire « Frieda » de Annabel Abbs traduit par Anne-Carole Grillot (2020, Editions Hervé Chopin, 464 p.). C’est la vie romancée de la vraie Lady Chatterley. Oui pourquoi pas. (Petit oui, car le sujet….). Il est plus dans la tendance actuelle (i.e. marketing) que dans l’intérêt littéraire.
Ce post, sur une biographie, ne peut éviter le spoiling. Il est cependant écrit pour comprendre la vie de la famille Joyce, c’est-à-dire James, Nora, les enfants Giorgio et Lucia. On renvoie systématiquement à ces personnes, et il convient de lire toutes les critiques sur chacun pour se faire une idée.
Dont le livre de Carol Loeb Shloss « Lucia Joyce, To Dance in the Wake » (2003, Bloomsbury, 561 p.) et « Nora - La Vérité sur les Rapports de Nora et James Joyce » de Brenda Maddox, traduit par Marianne Véron (1990, Albin-Michel, 564 p.). Et bien entendu « La Fille de Joyce »de Annabel Abbs, traduit par Anne-Carole Grillot (2021, Editions Hervé Chopin, 416 p.).
Donc, comme je le fais souvent, j’essaye de lire d’autres ouvrages de l’auteur, afin de me faire une opinion sur son style, genre et autres ambitions littéromanes. Annabel Abbs est la fille d’un docte écrivain anglais, décédé en décembre 2020. Il est l’auteur d’un remarquable « Against the Flow : Education, the Art and Postmodern Culture » (2003, Routledge, 224 p.) dans lequel il soutient que l'éducation contemporaine ne tient pas assez compte de l'esthétique et de l'éthique. Elle serait partiellement asservie à l'économie de marché et aux impératifs managériaux et fonctionnels. En tant que tel, le système éducatif est hostile à la créativité et à l'apprentissage, se concentrant plutôt sur la mesure quantitative des résultats.
Ces idées paternelles étant posées, je les trouve intéressantes, surtout dans le contexte d’écriture de sa fille Annabel Abbs et de ses deux livres bibliographiques. La vie romancée de Lady Chatterley, et la seconde plus récente « La Fille de Joyce » traduit par Anne-Carole Grillot (2021, Editions Hervé Chopin, 416 p.) qui vient d’être traduit et qui romance aussi le destin de Lucia, la fille de l’écrivain irlandais James Joyce. Fortement intéressé par Joyce, on ne peut que difficilement en faire l’impasse dans les auteurs du XXeme siècle, j’ai donc commencé par ce livre, avant d’attaquer celui proposé pour la masse critique.
Donc, j’ai lu (avec intérêt) et commenté « La Fille de Joyce » de Annabel Abbs dès sa sortie en France, mais non sans avoir également lu certaines critiques littéraires, notamment irlandaises, là où James Joyce possède une aura nationale, et donc là où les idées portées par Annabel Abbs, idées légèrement iconoclastes, risquaient d’être les plus virulentes. D’autant que Samuel Beckett et Alexander Calder ont aussi beaucoup compté dans la carrière de la danseuse-chanteuse de Lucia Joyce.
Actuellement, je ne sais pas trop penser de ce qui est histoire littéraire, familiale, ou managériale sur cet ouvrage. Je me donne quelques jours (juste après la sortie de la traduction en France) pour me faire une idée. Mais je comprends pourquoi les photos de James Joyce le représentent avec un chapeau : Ces idées décoiffent.
Un peu de faits pour commencer, et tout d’abord James Joyce (1882-1941), de Dublin à Zurich donc, avec des escales à Trieste, Zurich pendant la guerre (1915-1920), puis Paris et à nouveau Zurich. Il commence à écrire à Dublin et publie « Dedalus » (Portrait de l’artiste en jeune homme) en 1916. « Ulysse » date de 1922 et « Finnegans Wake » de 1939. Voilà pour les grandes dates. Du point de vue famillial, il y a le 16 juin 1904, jour James Joyce rencontre Nora Barnacle, qui sera sa femme, date gravée sur sa tombe, à l’origine du « Bloomsday » qui le célèbre chaque année à Dublin. A Trieste, nait Giorgio, le fils en 1905 et Lucia, la fille au printemps 1907. De cette époque aussi, des doutes sur la fidélité de Nora et des rumeurs sur la paternité de Giorgio. Il quitte Trieste pour Zurich en 1915, et commence à gagner un peu d’argent, souvent par l’intermédiaire de l'éditrice et féministe anglaise Harriet Shaw Weaver qui devient vite sa mécène, par Ezra Pound interposé.
Travail acharné, alors avant de partir pour Paris en 1921, où ils cohabitent tous dans des hôtels du 7eme arrondissement, notamment square de Robiac (j’y reviendrai) puis, avec un peu plus d’aisance, la famille part dans le 8eme, puis le 16eme. C’est la grande période jusqu’à la fin des années 30 où il devient célèbre. C’est la grande période, également, après la guerre, où les américains fortunés font la fête à Paris. C’est le lieu de rencontre entre les Joyce, Beckett, Alexander Calder et autres, dans la bande de Raymond Duncan, mais aussi Kay Boyle et Robert McAlmon qui ont publié ensemble « Being Genius Together » (1938), véritable biographie de la « Lost Generation and Literary Modernism » réimprimé depuis (1984, The Hogarth Press Ltd, 368 p.). C’est dans cette bande de Raymond Duncan, le frère de Isadora et Elisabeth Duncan, que Lucia Joyce va découvrir la danse. Tombée amoureuse de Samuel Beckett qui va la guider en écriture, la voilà qui va s’enticher de Alexander Calder qui l’oriente sur le dessin.
Mais ses conditions, à la fois santé et mentale, empirent et James Joyce la confie à Carl Jung, alors au faîte de ses recherches psychologiques. Chez lui, Lucia entre en consultations fréquentes à Zurich. Toute cette période, commencée avec l’abandon de la dance en 1929, les années de sanatoriums ou cliniques diverses jusqu’en 1932 n’arrangent rien. En 1935, elle entre en asile psychiatrique, puis d’asile en asile, sous la tutelle de Harriet Shaw Weaver, elle termine sa vie à St Andrews Hospital, Northampton en 1982.
De façon assez incompréhensible, tous les documents concernant ces années de cliniques, ses traitements et sa correspondance ont été détruits sur ordre de Stephen James Joyce, le petit-fils de l'écrivain, hélas décédé en janvier 2020. L’œuvre de Joyce tombe dans le domaine public 50 ans après sa mort, soit en 1991, mais la règlementation européenne reporte cette protection à 70 ans. En 2012, les droits de l’œuvre sont entrés dans le domaine public. Mais Stephen Joyce ne coopère pas vraiment et réclame des sommes faramineuses et s’indigne des critiques. « Je suis un Joyce, vous n’êtes que des joyciens ! C’est toute la différence ! ». Cela montre le niveau des débats. En 1998, Brenda Maddox publie « Nora, The real Life of Molly Bloom » (1988, Houghton Mifflin, 512 p.) dans lequel elle décrit l’intimité familiale de l’écrivain, de sa muse peu instruite, et qui n’a jamais lu « Ulysse ». En particulier elle dévoile Lucia Joyce, danseuse reconnue, mais en proie à de graves perturbations psychiatriques. Cela déplait aux adulateurs, et surtout au légataire de James Joyce. A Venise, lors d’un congrès « Bloomsday », Stephen révèle qu’il a détruit une partie de la correspondance de sa tante Lucia, dont le courrier avec Samuel Beckett de la fin des années 1920. Malgré tout cela, Carol Loeb Shloss, professeur de littérature à Stanford projette de publier une biographie de Lucia « Lucia Joyce : To dance in the Wake » (2003, Farrar Straus Giroux, 576 p.). En particulier, elle insinue que l’écrivain aurait entretenu avec sa fille des relations incestueuses. Puis procès intenté par Stephen. Procès que la bibliographe gagne d’ailleurs.
Le livre de Annabel Abbs est évidement romancé, surtout dans sa partie terminale en temps, dont l’hypothèse présentée est, et reste, une hypothèse. Je me garderai bien de prendre une position ou l’autre, n’ayant, de loin pas, les données (si elles existent encore) en mains. Néanmoins, on peut se faire une opinion (ou même plusieurs) à la lecture de spécialistes de James Joyce, ou de psychiatres, voire même de mages nécromanciens ou oniromanciens, comme cela devient très tendance de nos jours. Etant données les natures mêmes des protagonistes, leurs implications nationalistes, ou leurs penchants divers, on a le choix. Il est vrai que pour ces derniers, les irlandais catholiques ont très vite dénoncé James Joyce comme auteur pornographique, mettant en scènes des demoiselles de petite vertu, où des personnages centraux. « Que celui qui n'a jamais commis la faute freudienne, me jette la première excuse ! ». Dans « Ulysse » par exemple, ces personnages se livrent à diverses scènes de masturbation ou de jouissance bruyante (Maman, pourquoi la dame elle crie, ou pourquoi le monsieur, il garde ses mains dans ses poches). C’est lors des échanges visuels entre Leopold Bloom et Gerty MacDowell, la boiteuse sur la plage de Sandymount Strand, dans le chapitre « Nausicaa ». Plus tard, dans « Finnegans Wake », il existe des jeux de mots douteux sur « insect » et « incest » ou des notes de bas de page. Jeu de mots qui sera repris par Brenda Maddox comme titre pour un article sur Lucia Bloom dans le « Time Literary Supplement ». On aura donc vite fait de dénoncer celui qui justement dénonce les mœurs d’une société irlandaise sous la coupe d’une Eglise catholique toute puissante. (Ma Sœur, que faisiez vous dans vos couvents d’enfants ; filles ou garçons ?). Il y a des tas de références à ces pratiques, sans remonter aux nonnes sanglantes et moines lubriques des Romans Noirs et Gothiques Anglais (voire et lire par exemple la série du « Domaine Romantique » des Editions José-Corti).
Il est alors important d’aller voir ce qu’en ont dit des spécialistes de Joyce, et ils sont nombreux, et surtout d’examiner leurs réactions selon qu’ils sont américains, anglais, irlandais, ou autres. On fera la différence selon leur chapelle. Dans le même effort, il est intéressant d’aller lire ce que les psychiatres ou neurologues pensent de ces interprétations. Pour cela, il est évident qu’il faut lire la biographie de la famille, en particulier sur ce que l’on dit des rapports entre le père, la mère et les enfants. Le livre de Brenda Maddox « Nora. La Vérité sur les rapports de Nora et de James Joyce », traduit par Marianne Véron (1990, Albin Michel, 566 p.), ainsi que celui de Carol Loeb Shloss, « Lucia Joyce : To dance in the Wake » (2003, Farrar Straus Giroux, 576 p.) illustrent très bien les relations à l’intérieur de la famille. On y ajoute les livres plus centrés sur la vie de James Joyce, soit l’immense pavé bibliographique de Richard Ellmann, « James Joyce » (1982, Oxford University Press, 906 p.) et celui de Jen Shelton « Joyce and the Narrative Structure of Incest » (2006, University Press of Florida, 157 p.). Le tout est argumenté par de nombreux articles spécialisés dont le « James Joyce Literary Supplement » et le « James Joyce Quarterly » revues qui sont là pour cela.
Il est évident que la liaison entre Nora et James n’est pas une pure liaison platonique. La jeunesse même de Nora Barnacle est marquée par la mort de sa mère lorsqu’elle a cinq ans. Elle est alors placée chez sa grand-mère, puis à 19 ans, mort de cette dernière, elle va chez son oncle maternel qui la bat. Elle veut tout de même vivre sa vie, et sort le soir habillée en homme, ce qui était interdit. Elle part finalement pour Dublin, travailler comme femme de chambre au Finn’s Hotel. Lorsqu’elle rencontre James Joyce, ils vont se promener et sur les bords de la Liffey, Nora masturbe Jim. Scène rapportée dans « Ulysse » entre Molly et William Mulwey, avatars de Nora et Willie Mulvagh, lors du long monologue de Molly « comment avons-nous fini ça oui O oui je l’ai fait jouir dans mon mouchoir ».
Le couple s’embarque séparément pour l’Italie et débarquent finalement à Venise. Très vite Nora est enceinte de Giorgio. Il s’agissait pour le couple de fonder une famille. Lucia Anna, la fille naitra 2 ans plus tard à Trieste. Lucia est en l’honneur de sainte Lucie, alors qu’elle a un défaut à l’œil (elle louche) comme Peg, la sœur de Nora. Elle suit la famille à Zurich pendant la première guerre, avant d’aller à Paris, avec un peu plus d’argent au début des années 20. La famille parle alors l’italien, ou plutôt le triestin, dialecte local. Lucia va donc être ballottée entre sa famille, les pays et les langues jusqu’à sa majorité. Sa vie intime souffre aussi d’instabilité. Tout d’abord folle amoureuse de Samuel Beckett, alors assistant en anglais à l’ENS. Elle le presse de se déclarer en 1930, ils ont 23 ans chacun. Mais Beckett répond plus que mollement à ses avances, plus intéressé par les lectures du père et son attente de Godot. Quelques aventures plus tard, c’est Alexander Calder sur qui elle jette son dévolu. Mêmes effets ou plutôt de non-effets.
Un autre élément déstabilisant intervient alors qui est la notoriété soudaine de son père après 1922 et la parution d’« Ulysse ». Le rôle du père est difficile à cerner, car celui-ci peut être pris au sens physique ou moral. Dans le premier cas, la contrainte existe et elle est normalement réprouvée. Par contre, au sens moral, le père peut exercer une contrainte, synonyme de la dynamique de pouvoir. C’est la thèse de Shelton. Cela expliquerait l’émergence du thème en tant que narration dans le roman, soit un thème latent sans passage à l’action. Ce sont les fantasmes attribués à Gerty MacDowell ou Cissy Caffrey dans « Ulysse », mais aussi à Milly Bloom et bien sûr Issy dans « Finnegans Wake ». Celles que Shelton appelle « filles figuratives de Joyce ». il est vrai que cette période est aussi celle où il rédige « Les Bœufs du Soleil », avec Circé la magicienne, après « Nausicaa », le chapitre XIII
Plus tard, Lucia devient une belle femme, malgré son strabisme. Elle s’appelle ainsi en référence à la lumière qui commence à affecter la vue de James, mais lumière qui fait de l’ombre, si l’on peut dire à son œuvre. Le rôle de Nora, la mère, est plus simple. Les débuts de la famille sont difficiles. Quand Nora arrive à Trieste en 1907 avec ses deux enfants, elle a pour toute fortune une lire, ce qui est peu pour une famille de quatre bouches.
Celles-ci sont essentiellement orales, et surtout la discipline est encore à ses balbutiements. Dans un premier temps James Joyce et Carl Jung ne s’apprécient pas. Ce dernier, écrit, en 1932 dans « Europaische Revue » à propos d’« Ulysse » : « J'ai lu jusqu’à la page 135 avec le désespoir dans mon cœur, m'endormant deux fois en chemin ». Cela commence mal. « Le style de Joyce a un effet monotone et hypnotique ». Et pour finir « Il ne faut jamais fourre le nez du lecteur dans sa propre bêtise, mais c'est exactement ce que fait « Ulysse» »…Joyce se moquera de la psychanalyse de Jung (et de Freud), dans « Finnegans Wake ». II les appelle « le Tweedledum suisse à ne pas confondre avec le Tweedledee viennois »
Cependant Carl Jung va découvrir Joyce un peu plus tard, lorsque le père vient pour sa fille Lucia, déjà en proie à de graves troubles de la personnalité. En 1932, C.G. Jung lui fait parvenir un essai sous forme d’une longue lettre de 40 pages. « Votre livre dans son ensemble n'a aucun terme à mon trouble et j'y ai réfléchi pendant environ trois ans jusqu'à ce que je réussisse à m'y mettre » qui se termine par « Je suppose que la grand-mère du diable en sait tellement plus sur la vraie psychologie d’une femme, je ne le savais pas ». Habile rétropédalage du psychanalyste qui soutient que certains éléments des poèmes de Lucia montrent des dispositions schizoïdes. Alors ? Maladie ou livre anticipant une nouvelle littérature ? Plus tard, Jung jugera de même les néologismes et les mots-valises de « Finnegans Wake ». Et de plus, il déclare que Lucia, la danseuse selon lui, était une innovatrice dans son genre, pas encore comprise et appréciée à sa juste valeur. Pirouette finale du docteur et analyste. Le père et la fille étaient comme deux personnes allant au fond d'une rivière, l'une tombant et l'autre plongeant.
En fait, Carl Jung veut faire de Lucia la femme inspiratrice de James. A cet effet, le premier chapitre du livre de Annabel Abbs est d’une platitude rare, pour ne pas en dire plus méchamment. Je crois que, ayant un peu étudié la situation des Joyce, la seule lecture de ces 6-7 premières pages m’aurait fait l’effet des 135 pages de « Ulysse » pour C.G. Jung. Toutes les conversations entre Jung et Lucia sont très fortement orientées, avec des questions essentiellement fermées. Il est d’ailleurs surprenant que environ un tiers du livre résume les entretiens entre Lucia et Jung. Sachant que ce genre de conversation est essentiellement orale, donc sans notes, et que les quelque notes, prises par Jung ne sont pas abordables, les seuls documents de Jung concernent son analyse de « Ulysse » et de l’influence possible de Lucia sur la rédaction de « Finnegans Wake », qui ne paraîtront que bien après les consultations de Küsnacht. Il y a même une scène, fortement imaginée, pour ne pas dire fantasmée, dans laquelle Lucia subtilise le carnet de notes de Jung et y lit (très rapidement) le mot « insect ». Ce mot est à l’origine de l’hypothèse incestueuse entre le père et la fille. Toute cette écriture n’est que de la surinterprétation romancée.
D’ailleurs le courant ne passe pas, même dans le roman de Annabel Abbs, faisant de Jung le « vingtième docteur » de Lucia, montrant son dédain pour la psychanalyse. Je veux bien que cela ait pu être le cas en 1934. Par contre, on a l’impression que Jung insiste sur le côté « prophétique » de Lucia, ce qui corrobore d’autres remarques de Brenda Maddox. Il est vrai que Lucia est alors en pleine ascension artistique, suite à sa fréquentation de l’école de danse de Isadora Duncan.
Dans ses séminaires Jacques Lacan aborde le cas Joyce « Le Séminaire XXIII. Le Sinthome » (2005, Le Seuil, 254 p.) en citant ces mots de James qui « ne cessait de répéter que sa fille était clairvoyante […] et plus intelligente que tout le monde », « qu’elle le tient miraculeusement informé de tout ce qui arrive à un certain nombre de personnes, que pour elle, ces personnes n’ont pas de secret ». Par la suite, il attribue à la fille quelque chose qui est « dans le prolongement de son propre symptôme ». Ce sera le « sinthome » selon Lacan. Cela se traduit entre James et Lucia par l’écriture de « lettrines », sorte d’enluminures en couleurs, très jolies et d’un poème qui suit. Bel exemple de « transfert » et de « contre-transfert » entre le père et la fille. Ceci dit, il est plus facile de forger un nouveau mot, souvent plus par jeu de mot, que d’expliquer un phénomène que l’on ne comprend pas.
Il est difficile de conclure sur une bibliographie, ne serait-ce que pour un simple accès aux documents présentés. Ces bibliographies font état de la lecture d’une abondante correspondance entre les membres de la famille Joyce, leurs parents et amis. En général, une abondante liste de références ou de lectures est jointe, ainsi qu’un index. Ce n’est pas le cas dans le livre de Annabel Abbs. C’est donc un roman et non une biographie. Il est donc illusoire de formuler une hypothèse argumentée sur les conclusions avancées. On peut cependant émettre des suggestions sur certaines assertions qui reposent plus sur des on-dits, ou qui sont avancées en fonction d’un mode de raisonnement actuel, ou au moment de la rédaction, déconnecté d’une réalité passée dans un environnement différent. Cette hypothèse d’inceste me parait avoir été amplifié dans la version de Annabel Abbs, en particulier par le jeu de mots, dans « Finnegans Wake », donc daté des années 30 plutôt que 20. A ce moment Lucia n’est donc plus une adolescente, mais une femme proche de la vingtaine d’années. La dégradation de sa santé commence en effet en 1931. Son frère Giorgio est déjà marié, il peut être mis hors cause. Le père est surtout absorbé par l’écriture de son nouveau livre. Reste une rivalité entre mère et fille, ce qui est fréquent, d’autant plus que la fille est alors reconnue comme danseuse et commence à faire ombrage à Nora. Que ces désord
Ce post, sur une biographie, ne peut éviter le spoiling. Il est cependant écrit pour comprendre la vie de la famille Joyce, c’est-à-dire James, Nora, les enfants Giorgio et Lucia. On renvoie systématiquement à ces personnes, et il convient de lire toutes les critiques sur chacun pour se faire une idée.
Dont le livre de Carol Loeb Shloss « Lucia Joyce, To Dance in the Wake » (2003, Bloomsbury, 561 p.) et « Nora - La Vérité sur les Rapports de Nora et James Joyce » de Brenda Maddox, traduit par Marianne Véron (1990, Albin-Michel, 564 p.). Et bien entendu « La Fille de Joyce »de Annabel Abbs, traduit par Anne-Carole Grillot (2021, Editions Hervé Chopin, 416 p.).
Donc, comme je le fais souvent, j’essaye de lire d’autres ouvrages de l’auteur, afin de me faire une opinion sur son style, genre et autres ambitions littéromanes. Annabel Abbs est la fille d’un docte écrivain anglais, décédé en décembre 2020. Il est l’auteur d’un remarquable « Against the Flow : Education, the Art and Postmodern Culture » (2003, Routledge, 224 p.) dans lequel il soutient que l'éducation contemporaine ne tient pas assez compte de l'esthétique et de l'éthique. Elle serait partiellement asservie à l'économie de marché et aux impératifs managériaux et fonctionnels. En tant que tel, le système éducatif est hostile à la créativité et à l'apprentissage, se concentrant plutôt sur la mesure quantitative des résultats.
Ces idées paternelles étant posées, je les trouve intéressantes, surtout dans le contexte d’écriture de sa fille Annabel Abbs et de ses deux livres bibliographiques. La vie romancée de Lady Chatterley, et la seconde plus récente « La Fille de Joyce » traduit par Anne-Carole Grillot (2021, Editions Hervé Chopin, 416 p.) qui vient d’être traduit et qui romance aussi le destin de Lucia, la fille de l’écrivain irlandais James Joyce. Fortement intéressé par Joyce, on ne peut que difficilement en faire l’impasse dans les auteurs du XXeme siècle, j’ai donc commencé par ce livre, avant d’attaquer celui proposé pour la masse critique.
Donc, j’ai lu (avec intérêt) et commenté « La Fille de Joyce » de Annabel Abbs dès sa sortie en France, mais non sans avoir également lu certaines critiques littéraires, notamment irlandaises, là où James Joyce possède une aura nationale, et donc là où les idées portées par Annabel Abbs, idées légèrement iconoclastes, risquaient d’être les plus virulentes. D’autant que Samuel Beckett et Alexander Calder ont aussi beaucoup compté dans la carrière de la danseuse-chanteuse de Lucia Joyce.
Actuellement, je ne sais pas trop penser de ce qui est histoire littéraire, familiale, ou managériale sur cet ouvrage. Je me donne quelques jours (juste après la sortie de la traduction en France) pour me faire une idée. Mais je comprends pourquoi les photos de James Joyce le représentent avec un chapeau : Ces idées décoiffent.
Un peu de faits pour commencer, et tout d’abord James Joyce (1882-1941), de Dublin à Zurich donc, avec des escales à Trieste, Zurich pendant la guerre (1915-1920), puis Paris et à nouveau Zurich. Il commence à écrire à Dublin et publie « Dedalus » (Portrait de l’artiste en jeune homme) en 1916. « Ulysse » date de 1922 et « Finnegans Wake » de 1939. Voilà pour les grandes dates. Du point de vue famillial, il y a le 16 juin 1904, jour James Joyce rencontre Nora Barnacle, qui sera sa femme, date gravée sur sa tombe, à l’origine du « Bloomsday » qui le célèbre chaque année à Dublin. A Trieste, nait Giorgio, le fils en 1905 et Lucia, la fille au printemps 1907. De cette époque aussi, des doutes sur la fidélité de Nora et des rumeurs sur la paternité de Giorgio. Il quitte Trieste pour Zurich en 1915, et commence à gagner un peu d’argent, souvent par l’intermédiaire de l'éditrice et féministe anglaise Harriet Shaw Weaver qui devient vite sa mécène, par Ezra Pound interposé.
Travail acharné, alors avant de partir pour Paris en 1921, où ils cohabitent tous dans des hôtels du 7eme arrondissement, notamment square de Robiac (j’y reviendrai) puis, avec un peu plus d’aisance, la famille part dans le 8eme, puis le 16eme. C’est la grande période jusqu’à la fin des années 30 où il devient célèbre. C’est la grande période, également, après la guerre, où les américains fortunés font la fête à Paris. C’est le lieu de rencontre entre les Joyce, Beckett, Alexander Calder et autres, dans la bande de Raymond Duncan, mais aussi Kay Boyle et Robert McAlmon qui ont publié ensemble « Being Genius Together » (1938), véritable biographie de la « Lost Generation and Literary Modernism » réimprimé depuis (1984, The Hogarth Press Ltd, 368 p.). C’est dans cette bande de Raymond Duncan, le frère de Isadora et Elisabeth Duncan, que Lucia Joyce va découvrir la danse. Tombée amoureuse de Samuel Beckett qui va la guider en écriture, la voilà qui va s’enticher de Alexander Calder qui l’oriente sur le dessin.
Mais ses conditions, à la fois santé et mentale, empirent et James Joyce la confie à Carl Jung, alors au faîte de ses recherches psychologiques. Chez lui, Lucia entre en consultations fréquentes à Zurich. Toute cette période, commencée avec l’abandon de la dance en 1929, les années de sanatoriums ou cliniques diverses jusqu’en 1932 n’arrangent rien. En 1935, elle entre en asile psychiatrique, puis d’asile en asile, sous la tutelle de Harriet Shaw Weaver, elle termine sa vie à St Andrews Hospital, Northampton en 1982.
De façon assez incompréhensible, tous les documents concernant ces années de cliniques, ses traitements et sa correspondance ont été détruits sur ordre de Stephen James Joyce, le petit-fils de l'écrivain, hélas décédé en janvier 2020. L’œuvre de Joyce tombe dans le domaine public 50 ans après sa mort, soit en 1991, mais la règlementation européenne reporte cette protection à 70 ans. En 2012, les droits de l’œuvre sont entrés dans le domaine public. Mais Stephen Joyce ne coopère pas vraiment et réclame des sommes faramineuses et s’indigne des critiques. « Je suis un Joyce, vous n’êtes que des joyciens ! C’est toute la différence ! ». Cela montre le niveau des débats. En 1998, Brenda Maddox publie « Nora, The real Life of Molly Bloom » (1988, Houghton Mifflin, 512 p.) dans lequel elle décrit l’intimité familiale de l’écrivain, de sa muse peu instruite, et qui n’a jamais lu « Ulysse ». En particulier elle dévoile Lucia Joyce, danseuse reconnue, mais en proie à de graves perturbations psychiatriques. Cela déplait aux adulateurs, et surtout au légataire de James Joyce. A Venise, lors d’un congrès « Bloomsday », Stephen révèle qu’il a détruit une partie de la correspondance de sa tante Lucia, dont le courrier avec Samuel Beckett de la fin des années 1920. Malgré tout cela, Carol Loeb Shloss, professeur de littérature à Stanford projette de publier une biographie de Lucia « Lucia Joyce : To dance in the Wake » (2003, Farrar Straus Giroux, 576 p.). En particulier, elle insinue que l’écrivain aurait entretenu avec sa fille des relations incestueuses. Puis procès intenté par Stephen. Procès que la bibliographe gagne d’ailleurs.
Le livre de Annabel Abbs est évidement romancé, surtout dans sa partie terminale en temps, dont l’hypothèse présentée est, et reste, une hypothèse. Je me garderai bien de prendre une position ou l’autre, n’ayant, de loin pas, les données (si elles existent encore) en mains. Néanmoins, on peut se faire une opinion (ou même plusieurs) à la lecture de spécialistes de James Joyce, ou de psychiatres, voire même de mages nécromanciens ou oniromanciens, comme cela devient très tendance de nos jours. Etant données les natures mêmes des protagonistes, leurs implications nationalistes, ou leurs penchants divers, on a le choix. Il est vrai que pour ces derniers, les irlandais catholiques ont très vite dénoncé James Joyce comme auteur pornographique, mettant en scènes des demoiselles de petite vertu, où des personnages centraux. « Que celui qui n'a jamais commis la faute freudienne, me jette la première excuse ! ». Dans « Ulysse » par exemple, ces personnages se livrent à diverses scènes de masturbation ou de jouissance bruyante (Maman, pourquoi la dame elle crie, ou pourquoi le monsieur, il garde ses mains dans ses poches). C’est lors des échanges visuels entre Leopold Bloom et Gerty MacDowell, la boiteuse sur la plage de Sandymount Strand, dans le chapitre « Nausicaa ». Plus tard, dans « Finnegans Wake », il existe des jeux de mots douteux sur « insect » et « incest » ou des notes de bas de page. Jeu de mots qui sera repris par Brenda Maddox comme titre pour un article sur Lucia Bloom dans le « Time Literary Supplement ». On aura donc vite fait de dénoncer celui qui justement dénonce les mœurs d’une société irlandaise sous la coupe d’une Eglise catholique toute puissante. (Ma Sœur, que faisiez vous dans vos couvents d’enfants ; filles ou garçons ?). Il y a des tas de références à ces pratiques, sans remonter aux nonnes sanglantes et moines lubriques des Romans Noirs et Gothiques Anglais (voire et lire par exemple la série du « Domaine Romantique » des Editions José-Corti).
Il est alors important d’aller voir ce qu’en ont dit des spécialistes de Joyce, et ils sont nombreux, et surtout d’examiner leurs réactions selon qu’ils sont américains, anglais, irlandais, ou autres. On fera la différence selon leur chapelle. Dans le même effort, il est intéressant d’aller lire ce que les psychiatres ou neurologues pensent de ces interprétations. Pour cela, il est évident qu’il faut lire la biographie de la famille, en particulier sur ce que l’on dit des rapports entre le père, la mère et les enfants. Le livre de Brenda Maddox « Nora. La Vérité sur les rapports de Nora et de James Joyce », traduit par Marianne Véron (1990, Albin Michel, 566 p.), ainsi que celui de Carol Loeb Shloss, « Lucia Joyce : To dance in the Wake » (2003, Farrar Straus Giroux, 576 p.) illustrent très bien les relations à l’intérieur de la famille. On y ajoute les livres plus centrés sur la vie de James Joyce, soit l’immense pavé bibliographique de Richard Ellmann, « James Joyce » (1982, Oxford University Press, 906 p.) et celui de Jen Shelton « Joyce and the Narrative Structure of Incest » (2006, University Press of Florida, 157 p.). Le tout est argumenté par de nombreux articles spécialisés dont le « James Joyce Literary Supplement » et le « James Joyce Quarterly » revues qui sont là pour cela.
Il est évident que la liaison entre Nora et James n’est pas une pure liaison platonique. La jeunesse même de Nora Barnacle est marquée par la mort de sa mère lorsqu’elle a cinq ans. Elle est alors placée chez sa grand-mère, puis à 19 ans, mort de cette dernière, elle va chez son oncle maternel qui la bat. Elle veut tout de même vivre sa vie, et sort le soir habillée en homme, ce qui était interdit. Elle part finalement pour Dublin, travailler comme femme de chambre au Finn’s Hotel. Lorsqu’elle rencontre James Joyce, ils vont se promener et sur les bords de la Liffey, Nora masturbe Jim. Scène rapportée dans « Ulysse » entre Molly et William Mulwey, avatars de Nora et Willie Mulvagh, lors du long monologue de Molly « comment avons-nous fini ça oui O oui je l’ai fait jouir dans mon mouchoir ».
Le couple s’embarque séparément pour l’Italie et débarquent finalement à Venise. Très vite Nora est enceinte de Giorgio. Il s’agissait pour le couple de fonder une famille. Lucia Anna, la fille naitra 2 ans plus tard à Trieste. Lucia est en l’honneur de sainte Lucie, alors qu’elle a un défaut à l’œil (elle louche) comme Peg, la sœur de Nora. Elle suit la famille à Zurich pendant la première guerre, avant d’aller à Paris, avec un peu plus d’argent au début des années 20. La famille parle alors l’italien, ou plutôt le triestin, dialecte local. Lucia va donc être ballottée entre sa famille, les pays et les langues jusqu’à sa majorité. Sa vie intime souffre aussi d’instabilité. Tout d’abord folle amoureuse de Samuel Beckett, alors assistant en anglais à l’ENS. Elle le presse de se déclarer en 1930, ils ont 23 ans chacun. Mais Beckett répond plus que mollement à ses avances, plus intéressé par les lectures du père et son attente de Godot. Quelques aventures plus tard, c’est Alexander Calder sur qui elle jette son dévolu. Mêmes effets ou plutôt de non-effets.
Un autre élément déstabilisant intervient alors qui est la notoriété soudaine de son père après 1922 et la parution d’« Ulysse ». Le rôle du père est difficile à cerner, car celui-ci peut être pris au sens physique ou moral. Dans le premier cas, la contrainte existe et elle est normalement réprouvée. Par contre, au sens moral, le père peut exercer une contrainte, synonyme de la dynamique de pouvoir. C’est la thèse de Shelton. Cela expliquerait l’émergence du thème en tant que narration dans le roman, soit un thème latent sans passage à l’action. Ce sont les fantasmes attribués à Gerty MacDowell ou Cissy Caffrey dans « Ulysse », mais aussi à Milly Bloom et bien sûr Issy dans « Finnegans Wake ». Celles que Shelton appelle « filles figuratives de Joyce ». il est vrai que cette période est aussi celle où il rédige « Les Bœufs du Soleil », avec Circé la magicienne, après « Nausicaa », le chapitre XIII
Plus tard, Lucia devient une belle femme, malgré son strabisme. Elle s’appelle ainsi en référence à la lumière qui commence à affecter la vue de James, mais lumière qui fait de l’ombre, si l’on peut dire à son œuvre. Le rôle de Nora, la mère, est plus simple. Les débuts de la famille sont difficiles. Quand Nora arrive à Trieste en 1907 avec ses deux enfants, elle a pour toute fortune une lire, ce qui est peu pour une famille de quatre bouches.
Celles-ci sont essentiellement orales, et surtout la discipline est encore à ses balbutiements. Dans un premier temps James Joyce et Carl Jung ne s’apprécient pas. Ce dernier, écrit, en 1932 dans « Europaische Revue » à propos d’« Ulysse » : « J'ai lu jusqu’à la page 135 avec le désespoir dans mon cœur, m'endormant deux fois en chemin ». Cela commence mal. « Le style de Joyce a un effet monotone et hypnotique ». Et pour finir « Il ne faut jamais fourre le nez du lecteur dans sa propre bêtise, mais c'est exactement ce que fait « Ulysse» »…Joyce se moquera de la psychanalyse de Jung (et de Freud), dans « Finnegans Wake ». II les appelle « le Tweedledum suisse à ne pas confondre avec le Tweedledee viennois »
Cependant Carl Jung va découvrir Joyce un peu plus tard, lorsque le père vient pour sa fille Lucia, déjà en proie à de graves troubles de la personnalité. En 1932, C.G. Jung lui fait parvenir un essai sous forme d’une longue lettre de 40 pages. « Votre livre dans son ensemble n'a aucun terme à mon trouble et j'y ai réfléchi pendant environ trois ans jusqu'à ce que je réussisse à m'y mettre » qui se termine par « Je suppose que la grand-mère du diable en sait tellement plus sur la vraie psychologie d’une femme, je ne le savais pas ». Habile rétropédalage du psychanalyste qui soutient que certains éléments des poèmes de Lucia montrent des dispositions schizoïdes. Alors ? Maladie ou livre anticipant une nouvelle littérature ? Plus tard, Jung jugera de même les néologismes et les mots-valises de « Finnegans Wake ». Et de plus, il déclare que Lucia, la danseuse selon lui, était une innovatrice dans son genre, pas encore comprise et appréciée à sa juste valeur. Pirouette finale du docteur et analyste. Le père et la fille étaient comme deux personnes allant au fond d'une rivière, l'une tombant et l'autre plongeant.
En fait, Carl Jung veut faire de Lucia la femme inspiratrice de James. A cet effet, le premier chapitre du livre de Annabel Abbs est d’une platitude rare, pour ne pas en dire plus méchamment. Je crois que, ayant un peu étudié la situation des Joyce, la seule lecture de ces 6-7 premières pages m’aurait fait l’effet des 135 pages de « Ulysse » pour C.G. Jung. Toutes les conversations entre Jung et Lucia sont très fortement orientées, avec des questions essentiellement fermées. Il est d’ailleurs surprenant que environ un tiers du livre résume les entretiens entre Lucia et Jung. Sachant que ce genre de conversation est essentiellement orale, donc sans notes, et que les quelque notes, prises par Jung ne sont pas abordables, les seuls documents de Jung concernent son analyse de « Ulysse » et de l’influence possible de Lucia sur la rédaction de « Finnegans Wake », qui ne paraîtront que bien après les consultations de Küsnacht. Il y a même une scène, fortement imaginée, pour ne pas dire fantasmée, dans laquelle Lucia subtilise le carnet de notes de Jung et y lit (très rapidement) le mot « insect ». Ce mot est à l’origine de l’hypothèse incestueuse entre le père et la fille. Toute cette écriture n’est que de la surinterprétation romancée.
D’ailleurs le courant ne passe pas, même dans le roman de Annabel Abbs, faisant de Jung le « vingtième docteur » de Lucia, montrant son dédain pour la psychanalyse. Je veux bien que cela ait pu être le cas en 1934. Par contre, on a l’impression que Jung insiste sur le côté « prophétique » de Lucia, ce qui corrobore d’autres remarques de Brenda Maddox. Il est vrai que Lucia est alors en pleine ascension artistique, suite à sa fréquentation de l’école de danse de Isadora Duncan.
Dans ses séminaires Jacques Lacan aborde le cas Joyce « Le Séminaire XXIII. Le Sinthome » (2005, Le Seuil, 254 p.) en citant ces mots de James qui « ne cessait de répéter que sa fille était clairvoyante […] et plus intelligente que tout le monde », « qu’elle le tient miraculeusement informé de tout ce qui arrive à un certain nombre de personnes, que pour elle, ces personnes n’ont pas de secret ». Par la suite, il attribue à la fille quelque chose qui est « dans le prolongement de son propre symptôme ». Ce sera le « sinthome » selon Lacan. Cela se traduit entre James et Lucia par l’écriture de « lettrines », sorte d’enluminures en couleurs, très jolies et d’un poème qui suit. Bel exemple de « transfert » et de « contre-transfert » entre le père et la fille. Ceci dit, il est plus facile de forger un nouveau mot, souvent plus par jeu de mot, que d’expliquer un phénomène que l’on ne comprend pas.
Il est difficile de conclure sur une bibliographie, ne serait-ce que pour un simple accès aux documents présentés. Ces bibliographies font état de la lecture d’une abondante correspondance entre les membres de la famille Joyce, leurs parents et amis. En général, une abondante liste de références ou de lectures est jointe, ainsi qu’un index. Ce n’est pas le cas dans le livre de Annabel Abbs. C’est donc un roman et non une biographie. Il est donc illusoire de formuler une hypothèse argumentée sur les conclusions avancées. On peut cependant émettre des suggestions sur certaines assertions qui reposent plus sur des on-dits, ou qui sont avancées en fonction d’un mode de raisonnement actuel, ou au moment de la rédaction, déconnecté d’une réalité passée dans un environnement différent. Cette hypothèse d’inceste me parait avoir été amplifié dans la version de Annabel Abbs, en particulier par le jeu de mots, dans « Finnegans Wake », donc daté des années 30 plutôt que 20. A ce moment Lucia n’est donc plus une adolescente, mais une femme proche de la vingtaine d’années. La dégradation de sa santé commence en effet en 1931. Son frère Giorgio est déjà marié, il peut être mis hors cause. Le père est surtout absorbé par l’écriture de son nouveau livre. Reste une rivalité entre mère et fille, ce qui est fréquent, d’autant plus que la fille est alors reconnue comme danseuse et commence à faire ombrage à Nora. Que ces désord
Angleterre 1907. Nous suivons Frieda Von Richtofen, jeune allemande, mère de trois enfants et mariée à un professeur anglais. Frieda rêve d’une vie exaltante, romanesque et inspirante aux côtés de son mari mais celui-ci n’est pas enclin à ce genre de mœurs. Elle subit sa vie plutôt qu’elle ne la vit, tiraillée entre ses envies d’aventure et son rôle de mère et d’épouse.
C’est lors d’une visite chez sa sœur à Munich qu’elle découvre une nouvelle vie ou l’amour est libre et la liberté d’expression existe bel et bien.
Sur les conseils de sa sœur elle prend un amant et alors sa vraie personnalité explose et elle devient enfin la femme qu’elle a toujours été mais qu’elle ne peut montrer au grand jour.
A son retour, elle ne réussit pourtant pas à reprendre sa vie de mère et épouse dévouée.
Elle rencontre alors D.H.Lawrence, un jeune écrivain sans le sou mais très ambitieux qui deviendra son amant.
En sa présence elle s’épanouit et devient enfin la femme qu’elle souhaiterait être : libre, heureuse, avec une sexualité épanouie.
Mais pour vivre cette vie elle a du faire un choix et s’enfuir avec Lawrence en laissant ses enfants à son mari. Même si cette décision lui brise le cœur elle suit son amant et deviendra au fil des années sa muse et sa plus grande inspiration.
Grâce a elle, Lawrence va devenir un grand écrivain et Frieda deviendra son inspiration pour écrire « l’amant de Lady Chatterley ».
J’ai trouvé cette histoire passionnante et déchirante. Au départ on vit la vie morne et triste de Frieda, on comprend sa souffrance d’être enfermée dans une vie qui ne lui convient pas et où elle étouffe petit à petit.
Ensuite viendra sa liberté auprès de Lawrence mais alors quel sacrifice : devoir abandonner ses enfants.
Et en tant que mère c’est je crois pour moi le plus dur du roman.
C’est lors d’une visite chez sa sœur à Munich qu’elle découvre une nouvelle vie ou l’amour est libre et la liberté d’expression existe bel et bien.
Sur les conseils de sa sœur elle prend un amant et alors sa vraie personnalité explose et elle devient enfin la femme qu’elle a toujours été mais qu’elle ne peut montrer au grand jour.
A son retour, elle ne réussit pourtant pas à reprendre sa vie de mère et épouse dévouée.
Elle rencontre alors D.H.Lawrence, un jeune écrivain sans le sou mais très ambitieux qui deviendra son amant.
En sa présence elle s’épanouit et devient enfin la femme qu’elle souhaiterait être : libre, heureuse, avec une sexualité épanouie.
Mais pour vivre cette vie elle a du faire un choix et s’enfuir avec Lawrence en laissant ses enfants à son mari. Même si cette décision lui brise le cœur elle suit son amant et deviendra au fil des années sa muse et sa plus grande inspiration.
Grâce a elle, Lawrence va devenir un grand écrivain et Frieda deviendra son inspiration pour écrire « l’amant de Lady Chatterley ».
J’ai trouvé cette histoire passionnante et déchirante. Au départ on vit la vie morne et triste de Frieda, on comprend sa souffrance d’être enfermée dans une vie qui ne lui convient pas et où elle étouffe petit à petit.
Ensuite viendra sa liberté auprès de Lawrence mais alors quel sacrifice : devoir abandonner ses enfants.
Et en tant que mère c’est je crois pour moi le plus dur du roman.
un roman féministe sur la belle époque qui m’a fait énormément réfléchir à propos de ma condition en tant que femme et les droits qui étaient ceux des femmes à l’époque ; leur droit d’être d’abord femme puis mère, et d’allier les deux sans se priver d’un aspect de l’un ni de l’autre : le droit de s’aimer et de profiter de sa vie tout en aimant inconditionnellement ses enfants - le droit d’être heureuse et de quitter une relation dans laquelle on ne s’épanouit pas sans pour autant être privée de ses enfants.
Frieda m’a parue extrêmement courageuse, déterminée, aimante, solaire ; désirante d’une vie belle et simple, prête à tout pour l’obtenir. J’ai apprécié le double point de vue proposé par l’auteure ; celui de Frieda et de son mari, parfois aussi celui de son fils aîné - il nous est donc presque impossible de prendre parti pour Frieda tant la peine de son mari, qui a - semble-t-il- toujours essaye de la contenter, est retranscrite. Cette femme a eu une vie trépidante, quittant un mari passif pour un amant abusif, violent et possessif, mais de son plein gré : ses choix n’étaient peut-être pas les meilleurs, mais elle a eu le cran de les faire seule. J’ai par moments eu le cœur brisé, d’autres fois ressenti beaucoup d’espoir face à la détermination de Frieda.
C’est une femme qui a énormément influencé la littérature britannique et j’ai très envie de me renseigner à son sujet maintenant que je connais plus d’éléments de sa vie.
Frieda m’a parue extrêmement courageuse, déterminée, aimante, solaire ; désirante d’une vie belle et simple, prête à tout pour l’obtenir. J’ai apprécié le double point de vue proposé par l’auteure ; celui de Frieda et de son mari, parfois aussi celui de son fils aîné - il nous est donc presque impossible de prendre parti pour Frieda tant la peine de son mari, qui a - semble-t-il- toujours essaye de la contenter, est retranscrite. Cette femme a eu une vie trépidante, quittant un mari passif pour un amant abusif, violent et possessif, mais de son plein gré : ses choix n’étaient peut-être pas les meilleurs, mais elle a eu le cran de les faire seule. J’ai par moments eu le cœur brisé, d’autres fois ressenti beaucoup d’espoir face à la détermination de Frieda.
C’est une femme qui a énormément influencé la littérature britannique et j’ai très envie de me renseigner à son sujet maintenant que je connais plus d’éléments de sa vie.
Son nom ne vous dit rien ? Et pourtant vous la connaissez notamment sous les traits de lady Chatterley. Car oui la baronne fut la muse de l’auteur D. H Lawrence.
Qui est Frieda? Une question que la jeune femme s’est souvent posée jusqu’à ce qu’une rencontre lui ouvre les yeux.
Nous faisons connaissance avec la jeune femme début 1900. Elle a moins de trente ans, est mariée à un universitaire anglais, Ernest, et mère de trois enfants. Elle est loin de sa famille allemande et les échanges épistolaires avec ses sœurs lui font prendre conscience de l’étroitesse de sa vie. Son mari l’étouffe tout en ne lui prêtant guère attention... Cantonnée en femme potiche, elle rêve de stimulations intellectuelles, de plus d’amour et de sensualité...
Cette biographie romancée est découpée en huit parties et est agrémentée de repères historiques et d’une note de l’auteure. Un récit polyphonique qui se lit rapidement et est bien écrit. Cependant j’ai eu une petite baisse de régime entre la troisième et sixième partie mais à partir de cette de dernière le roman prend un autre rythme me permettant de plus apprécier l’histoire et d’être totalement plongée dans cette vie tumultueuse.
Je n’ai pas vraiment eu d’attachement pour Frieda. En fait, je suis passée par toutes les émotions la concernant! Une mère qui abandonne ses enfants pour un homme ... Mais il faut finalement voir plus loin que ça. En ce début du XXe siècle les mères n’ont que peu de droits. Reconnues coupables d’adultère ou divorcées elles ont le même statut légal que des enfants ou des aliénés. Frieda ne pourra rien contre Ernest. Ernest, le mari bafoué. Franchement, il m’a fait de la peine et en même temps quel empoté ! Une scène nous a fait rire avec Béa, celle où il s’offusque que sa femme lui touche les fesses et il suppose que cette invitation intime n’est forcément que dans le but de faire un autre enfant. C’est bien connu la femme ne veut que pour la procréation 🤣. Ce n’est qu’une anecdote mais elle démontre la pruderie de l’époque et notamment anglaise car nous constatons que les Allemands, au même titre que les Français, sont beaucoup moins prudes 😆.
Concernant Lawrence, et bien, son portrait n’est pas très reluisant. S’il est charmant au début on découvre rapidement son côté sombre et je ne l’ai absolument pas aimé cet homme ! Malgré tout je serai curieuse de découvrir ses œuvres ne serait-ce que pour rechercher Frieda !
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Qui est Frieda? Une question que la jeune femme s’est souvent posée jusqu’à ce qu’une rencontre lui ouvre les yeux.
Nous faisons connaissance avec la jeune femme début 1900. Elle a moins de trente ans, est mariée à un universitaire anglais, Ernest, et mère de trois enfants. Elle est loin de sa famille allemande et les échanges épistolaires avec ses sœurs lui font prendre conscience de l’étroitesse de sa vie. Son mari l’étouffe tout en ne lui prêtant guère attention... Cantonnée en femme potiche, elle rêve de stimulations intellectuelles, de plus d’amour et de sensualité...
Cette biographie romancée est découpée en huit parties et est agrémentée de repères historiques et d’une note de l’auteure. Un récit polyphonique qui se lit rapidement et est bien écrit. Cependant j’ai eu une petite baisse de régime entre la troisième et sixième partie mais à partir de cette de dernière le roman prend un autre rythme me permettant de plus apprécier l’histoire et d’être totalement plongée dans cette vie tumultueuse.
Je n’ai pas vraiment eu d’attachement pour Frieda. En fait, je suis passée par toutes les émotions la concernant! Une mère qui abandonne ses enfants pour un homme ... Mais il faut finalement voir plus loin que ça. En ce début du XXe siècle les mères n’ont que peu de droits. Reconnues coupables d’adultère ou divorcées elles ont le même statut légal que des enfants ou des aliénés. Frieda ne pourra rien contre Ernest. Ernest, le mari bafoué. Franchement, il m’a fait de la peine et en même temps quel empoté ! Une scène nous a fait rire avec Béa, celle où il s’offusque que sa femme lui touche les fesses et il suppose que cette invitation intime n’est forcément que dans le but de faire un autre enfant. C’est bien connu la femme ne veut que pour la procréation 🤣. Ce n’est qu’une anecdote mais elle démontre la pruderie de l’époque et notamment anglaise car nous constatons que les Allemands, au même titre que les Français, sont beaucoup moins prudes 😆.
Concernant Lawrence, et bien, son portrait n’est pas très reluisant. S’il est charmant au début on découvre rapidement son côté sombre et je ne l’ai absolument pas aimé cet homme ! Malgré tout je serai curieuse de découvrir ses œuvres ne serait-ce que pour rechercher Frieda !
Lien : https://www.instagram.com/p/..
J’ai eu un véritable coup de Coeur pour cette biographie de cette femme, cette mère qui fit scandale à son époque .
Ce livre est incroyablement bien documenté, il parvient à nous happer dès les premières pages.
On assiste au destin de cette jeune baronne allemande que rien ne préparait à choisir son amant à sa famille et ses 3 enfants qu’elle adore.
Elle devient la muse de D.H.Lawrence et la violence de leur passion va tout balayer sur son passage.
L’auteure a fait de cette biographie un véritable roman sensuel et captivant où l’on se prend à suivre avec envie le dilemme de Frieda: doit elle sacrifier ses 3 enfants afin de devenir elle-même ?
Un excellent moment de lecture
Ce livre est incroyablement bien documenté, il parvient à nous happer dès les premières pages.
On assiste au destin de cette jeune baronne allemande que rien ne préparait à choisir son amant à sa famille et ses 3 enfants qu’elle adore.
Elle devient la muse de D.H.Lawrence et la violence de leur passion va tout balayer sur son passage.
L’auteure a fait de cette biographie un véritable roman sensuel et captivant où l’on se prend à suivre avec envie le dilemme de Frieda: doit elle sacrifier ses 3 enfants afin de devenir elle-même ?
Un excellent moment de lecture
Fascinante Frieda.
Lumineuse Frieda.
Inspirante Frieda.
Frieda von Richthofen, c'est cette femme mariée qui a "quitté ses enfants" pour l'écrivain et poète D.H. Lawrence, plus jeune qu'elle de quelques années, et ayant vécu avec lui jusqu'à la mort de ce dernier, dix-huit ans plus tard.
Annabel Abbs a choisi de réhabiliter son image, en mettant en avant l'attachement fort de Frieda à ses enfants, ses tentatives pour les revoir, la blessure causée par cet éloignement forcé, la douleur quotidienne de ne pas les voir, d'en être séparée...
Par vengeance et parce qu'il se sent déshonoré, son mari fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher celle qui l'a abandonné de retrouver ses enfants et de les emmener vivre avec elle.
Les chapitres sont courts, donnent la parole à Frieda mais aussi à Monty, l'aîné de ses enfants, et plus rarement à Ernest, son mari.
L'empathie pour Frieda est immédiate, femme écartelée entre l'amour pour son amant et l'amour maternel, dans une société qui ne laisse pas une femme être une mère sans être une épouse.
La détresse des enfants est poignante ; des enfants qui souffrent de cette absence au point d'en ressentir des symptômes physiques.
Tant de choses qui font que j'ai adoré ce roman, qui a confirmé mon goût pour les biographies romancées.
L'addendum à la fin du roman est particulièrement intéressant, où l'auteure expose ses choix et explique certains "arrangements" pris avec la vérité.
Lumineuse Frieda.
Inspirante Frieda.
Frieda von Richthofen, c'est cette femme mariée qui a "quitté ses enfants" pour l'écrivain et poète D.H. Lawrence, plus jeune qu'elle de quelques années, et ayant vécu avec lui jusqu'à la mort de ce dernier, dix-huit ans plus tard.
Annabel Abbs a choisi de réhabiliter son image, en mettant en avant l'attachement fort de Frieda à ses enfants, ses tentatives pour les revoir, la blessure causée par cet éloignement forcé, la douleur quotidienne de ne pas les voir, d'en être séparée...
Par vengeance et parce qu'il se sent déshonoré, son mari fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher celle qui l'a abandonné de retrouver ses enfants et de les emmener vivre avec elle.
Les chapitres sont courts, donnent la parole à Frieda mais aussi à Monty, l'aîné de ses enfants, et plus rarement à Ernest, son mari.
L'empathie pour Frieda est immédiate, femme écartelée entre l'amour pour son amant et l'amour maternel, dans une société qui ne laisse pas une femme être une mère sans être une épouse.
La détresse des enfants est poignante ; des enfants qui souffrent de cette absence au point d'en ressentir des symptômes physiques.
Tant de choses qui font que j'ai adoré ce roman, qui a confirmé mon goût pour les biographies romancées.
L'addendum à la fin du roman est particulièrement intéressant, où l'auteure expose ses choix et explique certains "arrangements" pris avec la vérité.
Von Richtofen ? Weekley ? Chatterley ? Qu’importe le nom, puisque toutes sont Frieda, jeune baronne allemande du début du siècle dernier à la vie épique, qui inspira le grand D.H. Lawrence pour son best-seller sulfureux (mais si : L’amant de Lady Chatterley !). Et cette biographie romancée de Annabel Abbs – traduite par Anne-Carole Grillot - est loin d’être dénuée d’intérêt, tant la part de recherches historiques y apporte du contenu, transformant ce qui n’eut pu être qu’une simple bluette en un pageturner historique parfaitement sourcé.
Côté cœur, la Frieda fait du bovarisme à Nottingham, depuis le jour où elle quitta, sans dot, les bords de la Moselle pour se marier avec Ernest, lettré quasi-ermite ne rêvant que d’une chaire à Cambridge et perpétuellement reclus dans son bureau à terminer son anthologie de l’étymologie. Plusieurs devoirs conjugaux annuels plus tard, la voilà mère de trois beaux enfants qui deviennent le centre de sa vie. Jusqu’à…
Jusqu’à ce que sur l’insistance de sa sœur, un bref retour au pays loin de la prude Albion ne la mette au contact de la vraie vie et de ce nouveau monde qu’elle découvre comme une révélation : libertarisme des idées, débuts de la psychanalyse, émancipation féminine et libertinage sexuel. Pleinement incarnés par Lawrence, ancien élève de son mari, ces principes ne demandent qu’à être vécus et Frieda va quitter Ernest – et ses enfants - pour le jeune écrivain, devenant sa muse et inspirant ses futurs livres.
Côté esprit, Annabel Abbs nous immerge totalement dans cette révolution des mœurs et des sociétés du début du siècle dernier, où dans les cafés enfumés les conventions s’aplanissent, les esprits se libèrent et les idées circulent et se challengent. À travers Frieda, les femmes ne sont pas en reste et prennent toute leur part à ce nouvel ordre qui se dessine, payant au passage un lourd tribut à cette liberté soudaine par la perte de leurs droits sur leurs enfants éloignés. Si le corps de Frieda exulte et que son esprit exalte, son cœur de mère saigne…
Une lecture parenthèse, instructive, rafraîchissante et bienvenue entre deux nouveautés de cette rentrée littéraire.
Côté cœur, la Frieda fait du bovarisme à Nottingham, depuis le jour où elle quitta, sans dot, les bords de la Moselle pour se marier avec Ernest, lettré quasi-ermite ne rêvant que d’une chaire à Cambridge et perpétuellement reclus dans son bureau à terminer son anthologie de l’étymologie. Plusieurs devoirs conjugaux annuels plus tard, la voilà mère de trois beaux enfants qui deviennent le centre de sa vie. Jusqu’à…
Jusqu’à ce que sur l’insistance de sa sœur, un bref retour au pays loin de la prude Albion ne la mette au contact de la vraie vie et de ce nouveau monde qu’elle découvre comme une révélation : libertarisme des idées, débuts de la psychanalyse, émancipation féminine et libertinage sexuel. Pleinement incarnés par Lawrence, ancien élève de son mari, ces principes ne demandent qu’à être vécus et Frieda va quitter Ernest – et ses enfants - pour le jeune écrivain, devenant sa muse et inspirant ses futurs livres.
Côté esprit, Annabel Abbs nous immerge totalement dans cette révolution des mœurs et des sociétés du début du siècle dernier, où dans les cafés enfumés les conventions s’aplanissent, les esprits se libèrent et les idées circulent et se challengent. À travers Frieda, les femmes ne sont pas en reste et prennent toute leur part à ce nouvel ordre qui se dessine, payant au passage un lourd tribut à cette liberté soudaine par la perte de leurs droits sur leurs enfants éloignés. Si le corps de Frieda exulte et que son esprit exalte, son cœur de mère saigne…
Une lecture parenthèse, instructive, rafraîchissante et bienvenue entre deux nouveautés de cette rentrée littéraire.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Annabel Abbs
Lecteurs de Annabel Abbs (550)Voir plus
Quiz
Voir plus
La propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle protège:
Les idées
Les oeuvres finies
11 questions
112 lecteurs ont répondu
Thèmes :
Propriété intellectuelle
, droit d'auteurCréer un quiz sur cet auteur112 lecteurs ont répondu