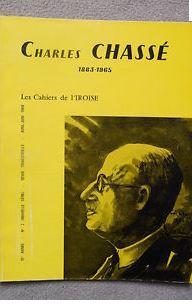Citations de Charles Chassé (20)
A l'entrée du golfe du Morbihan, voici d'un côté Port-Navalo d'une si belle luminosité, station balnéaire et port de relâche ; de l'autre Locmariaquer, puis tout autour du golfe où la température est d'une étonnante douceur, voici en face de Gavrinis, Larmor-Baden avec ses parcs d’ostréiculture, Arradon, autre centre ostréicole ; Séné, pays des bateaux sinagots dont les barques aux voiles rouges se déplacent dans tous les sens sur le golfe ; Noyalo qui possède à la fois des parcs à huîtres et des marais salants. Tout au fond du golfe, Vannes, chef-lieu du Morbihan, la ville d'où l'on s'embarque pour les îles et pour la presqu'île de Rhuys...
Malgré mes recherches, je n'ai pu glaner que très peu de renseignements sur ce premier séjour de Gauguin à Pont- Aven. Quand nous reparlerons tout à l'heure des influences subies en Bretagne 'par Gauguin, j'aurai l'occasion d'en reparler, car j'ai l'impression que c'est pendant ce premier séjour en Bretagne que Gauguin a vu ses conceptions artistiques se modifier de fond en comble. Mais Gauguin, tout à fait inconnu, n'entretenait pas alors de relations avec les autres peintres de la pension ; il était disciple de Pissarro et les peintres orthodoxes n'eussent point voulu se commettre avec pareils barbouilleurs. Quels étaient d'ailleurs ces peintres ? Nous ne connaissons point leurs noms.
Le livre de l'auberge nous apprend que Gauguin avait alors quarante-deux ans. Dans toute la force de l'âge et d'une santé encore intacte, il avait la taille élevée, le visage brun, les cheveux noirs et assez longs, le nez aquilin, de gros yeux verts, une légère barbe en fer à cheval et une moustache courte. Il possédait un aspect grave et imposant, un maintien calme et réfléchi qui devenait parfois ironique en présence des philistins et une grande vigueur musculaire dont il n'aimait pas à se servir. Sa démarche lente, son geste sobre, sa mine sévère lui donnaient beaucoup de dignité naturelle et tenaient à distance les inconnus et les étrangers. Sous ce masque de froideur impassible se dissimulaient des sens ardents et un tempérament de jouisseur toujours à l'affût de sensations nouvelles.
Puvis a mieux réussi que G. Moreau dans son entreprise, mais aussi, c'est que son ambition était moins haute. Il y a dans les fresques de Puvis une clarté particulière qui vous séduit mais, dans cette clarté-là, a-t-il fait passer plus que la surface de l'âme ? « Je suis — disait Voltaire — comme les ruisseaux de mon pays ; je suis clair parce que je ne suis pas profond. » « Puvis — déclarait Gauguin — expose son idée, oui mais il ne la peint pas ; il est grec tandis que, moi, je suis un Sauvage, un loup des bois sans collier. Puvis intitulera un tableau Pureté et, pour l'expliquer, peindra une jeune vierge avec un lys à la main ; un symbole comme cela, on le comprend. Gauguin, au titre Pureté, peindra un paysage aux eaux limpides. » Puvis lui-même confessait qu'il ne pouvait exprimer une sensation que lorsqu'elle en était devenue tout à fait claire. « Pour toutes les idées claires — assurait-il — il existe une pensée plastique qui les traduit. Mais les idées nous arrivent le plus souvent emmêlées et troubles. Il importe donc de les dégager d'abord pour pouvoir les tenir pures sous le regard intérieur. Une œuvre naît d'une sorte d'émotion confuse dans laquelle elle est contenue comme l'animal dans l'œuf. La pensée qui gît dans cette émotion, je la roule jusqu'à ce qu'elle soit élucidée à mes yeux et qu'elle apparaisse avec toute la netteté possible. Alors je cherche un spectacle qui la traduise avec exactitude... C'est du symbolisme, si vous voulez. »
Gauguin exposait aussi à ses amis et élèves les principes de son credo pictural. Il leur répétait les axiomes qui lui étaient chers, tels que : « La ligne, c'est la couleur ». Image frappante qui démontre que Gauguin avait pour le dessin autant de respect qu'Ingres et qui distingue de plus entre le genre de dessin qu'un coloriste doit cultiver et celui qu'il doit éviter. Il disait encore : « Un centimètre carré de vert au milieu d'un tapis de billard est plus vert qu'un centimètre carré de vert pris isolément ». Ainsi résumait-il, en quelques syllabes, toute une partie de son étude professionnelle, longuement poursuivie dans les directions les plus nouvelles : la variation des tons et la peinture de l'atmosphère.
Lui qui avait horreur d'entrer en communication avec des interlocuteurs hostiles, étrangers et inconnus, prenait au contraire plaisir à s'expliquer dès qu'il se sentait dans un milieu sympathique.
Lui qui avait horreur d'entrer en communication avec des interlocuteurs hostiles, étrangers et inconnus, prenait au contraire plaisir à s'expliquer dès qu'il se sentait dans un milieu sympathique.
Ce qui, au commencement, a cimenté l'union entre tous les Nabis, c'a été l'admiration pour le Talisman (toujours le vocabulaire mystique!) que Sérusier avait apporté de Pont-Aven et qui proclamait la condamnation de l'idée de ressemblance en peinture. Mais les Nabis étaient trop raffinés et trop éclectiques pour en rester à la notion de couleur pure qui pouvait satisfaire Gauguin parce n'avait pas passé par Lycée Condorcet!
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
Et d'abord Gauguin avait-il du sang breton dans les veines ? Que sa mère fût péruvienne, tout le monde est d'accord là-dessus ; mais le père était-il breton ? Sans doute, pour expliquer les voyages de Gauguin en Bretagne, quelqu'un l'a écrit un jour et bien d'autres ensuite ont répété l'information ; car le consentement universel ou quasi universel est presque une preuve de la non- véracité d'un fait. Non seulement on a répété ce pseudo-fait qui n'était probablement à l'origine qu'une déduction hasardeuse ; mais encore, de cette déduction, on a fait sourdre des déductions nouvelles.
Spiritualité et sensualité mêlées, voilà bien une des caractéristiques de Maurice Denis. Il existe dans toutes ses oeuvres une telle volupté chaste que ses formes féminines, même nues, peuvent presque indifféremment s'insérer dans une de ses compositions, soit d'église, soit de salle de concert. Il y a un beau nu dans un de ses vitraux de Saint-Paul à Genève, cette église dont l'intelligent curé n'acceptait de ses paroissiennes aucune statue mais leur demandait des dons en espèces, ce qui lui permettait de confier à un Maurice Denis toute une décoration d'ensemble où la gloire de Dieu se traduit sur les murailles par la figuration des splendeurs de la Nature, car « la beauté de la Nature est — a dit Maurice Denis — une preuve de Dieu. La beauté du corps humain donne à l'artiste l'idée du parfait. »
Les nabis, entre eux, se tenaient pour des « initiés » (les Nabis ayant été les prophètes de l'Ancien Testament tout comme les Félibres, à la même époque, se disaient les prêtres d'une loi nouvelle).
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
Leur respect de l'érudition universitaire les conduisait à vouloir donner une apparence de raison et de méthode à leur rêve, à fournir à leur métaphysique une base historique et scientifique. Il est étrange que presque tous les Nabis aient été séduits par la théosophie qui, alors, était considérée comme une synthèse de toutes les religions et de tous les systèmes philosophiques. Jusqu'à la fin, Sérusier est demeuré théosophe. Pour d'autres Nabis, comme Verkade, la théosophie a été une préparation au catholicisme, ce catholicisme dont Maurice Denis, dès son enfance, était imprégné, tout en étant, lui aussi, attiré par les théories de Schuré. Le plus singulier est que la théosophie, tant il s'agissait là d'une conception infiniment malléable, avait pris chez Ranson et chez le sculpteur Lacombe un aspect violemment anticlérical.
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
Un tableau n'avait de mérite que quand il possédait « du style », c'est-à-dire quand l'artiste avait réussi à changer la forme des objets qu'il regardait et à leur imposer des contours ou une couleur qui exprimassent la personnalité de l'exécutant. Peu importait la ressemblance ou plutôt, la ressemblance, c'était l'ennemi. Ce qui comptait, c'était, selon la formule de Sérusier, « l'image mentale » qu'ils avaient imaginée, la déformation que provoquait l'infléchissement d'une ligne ou l'exagération d'une teinte.
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
Au rebours des impressionnistes qui étaient presque exclusivement peintres et, se méfiant des intellectuels, ne fréquentaient ni les théâtres ni les librairies ni les concerts, les Nabis admiraient la musique de leur temps ; ils lisaient les poètes ; ils ont été, en conséquence, très influencés par le mouvement symboliste qui ne voyait, dans toute manifestation artistique, qu'un procédé permettant d'extérioriser son moi et non pas une manière de reproduire la nature. « L'art— disait Sérusier— est un moyen de communication entre les âmes. » « Les impressionnistes — avait signifié Gauguin — cherchent autour de l'œil et ne vont pas au centre mystérieux de la pensée. »
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
Et d'abord la certitude, quand ils se comparent aux autres peintres coudoyés par eux à l'Académie Julian, d'être des hommes supérieurs extrêmement cultivés et d'une culture qui n'est pas seulement d'ordre pictural mais qui embrasse aussi la littérature et la musique.
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
Sur la jeunesse des Nabis et les liens qui les unirent les uns aux autres, j'aurai plusieurs fois à revenir dans ce livre, mais il est bon que, dès le début, j'indique sommairement comment de futurs peintres, directeurs de théâtre ou de périodiques d'avant-garde qui allaient appartenir au groupe des Nabis avaient depuis leur enfance les mêmes habitudes de pensée, avaient gardé dans leurs yeux la vision des mêmes spectacles et dans leurs cerveaux les mêmes réactions devant les mêmes lectures. Il y avait là Lugné-Poe qui, lorsqu'il était encore élève, avait créé une troupe de comédiens amateurs, Lugné-Poe qui devait orienter vers l'art décoratif plusieurs de ses compagnons et qui, une certaine année, pendant qu'il était à Condorcet, enleva le prix de dessin à son ami Maurice Denis ; il y avait Vuillard et Roussel qui furent, eux aussi, exactement contemporains dans la même section (l'un eut le premier prix d'histoire, l'autre le second prix ; quelques années après, ils allaient devenir beaux-frères).
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
C'est autour de Paul Sérusier, ancien élève du Lycée Condorcet, que se réunirent ceux des élèves de cet établissement qui l'avaient connu ou qui avaient entendu parler de lui par d'anciens camarades. C'étaient naturellement ceux qui avaient été déjà attirés par l'art qui allèrent vers lui et tous ceux-là savaient son nom puisqu'il était massier de l'atelier Julian. Plus âgé que la plupart d'entre eux, il appartenait à la même classe sociale, son père étant directeur de la parfumerie Houbigant. Cette communauté d'origine bourgeoise ne pouvait manquer de fortifier des liens entre tous ces jeunes bourgeois, d'autant que le Lycée Condorcet était une institution d'espèce très particulière. « Si je me suis lié tout de suite avec Sérusier à l'Académie Julian — a dit Maurice Denis — c'est que, dans ce milieu assez vulgaire, il m'apparaissait comme un esprit d'une culture supérieure. » Aux rapins moins instruits, Sérusier arrivait aussi — nous signale Maurice Denis — à s'imposer par sa force physique, sa voix de ténor et son bon garçonnisme. Mais c'était surtout l'élite du Quartier latin qui le fréquentait assidûment. Les Nabis, en principe, ont été des bacheliers et presque tous des anciens de Condorcet.
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
I. Le lycée Condorcet, berceau des nabis
Les Nabis sont les peintres, et voilà qui délimite bien les contours de leur
mouvement (mouvement est tout à fait le terme convenant ici puisque, étant partis
de principes communs, ces jeunes gens se proposaient d'évoluer dans l'avenir en
toute liberté), qui se sont groupés sur l'initiative de Paul Sérusier en se réclamant
des doctrines que celui-ci venait, à Pont-Aven, de découvrir chez Gauguin.
I. LE LYCÉE CONDORCET, BERCEAU DES NABIS
mouvement (mouvement est tout à fait le terme convenant ici puisque, étant partis
de principes communs, ces jeunes gens se proposaient d'évoluer dans l'avenir en
toute liberté), qui se sont groupés sur l'initiative de Paul Sérusier en se réclamant
des doctrines que celui-ci venait, à Pont-Aven, de découvrir chez Gauguin.
I. LE LYCÉE CONDORCET, BERCEAU DES NABIS
C'est à Paul Sérusier qu'il convient de donner la place de beaucoup la plus importante parmi les Nabis puisque, sans Sérusier, le groupe des Nabis n'aurait pas été créé. C'est lui qui, en se convertissant à Pont- Aven aux idées de Gauguin et en amenant à l'Académie Julian le fameux couvercle de boite à cigares désigné comme le Talisman, a déterminé un mouvement général de protestation contre une stricte observance des doctrines impressionnistes. C'est Sérusier qui, grâce à son autorité personnelle, a rassemblé tous ces jeunes gens autour de lui, comme c'est lui qui, plus tard, a modifié les conceptions que, par son intermédiaire, ils avaient reçues de Gauguin. La plupart d'entre eux, en effet, n'ont eu de relations directes qu'avec Sérusier. Maurice Denis, par exemple, n'a pas connu Gauguin. Sérusier a eu moins de succès auprès d'eux quand, ensuite, il a tenté de gagner ses camarades à ses idées très particulières sur la palette chaude et la palette froide ; mais, dans d'autres milieux, des adeptes sont venus à lui. Qu'on n'oublie pas, non plus, que sous l'influence de son élève Verkade, devenu moine à Beuron, il a beaucoup aidé à répandre les théories du P. Desiderius Lenz sur les SaintesMesures et sur le Canon, ainsi causant dans le monde catholique un renoncement aux procédés de saint Sulpice et un élan vers des méthodes nouvelles d'art sacré. Ce que, dans son ABC de la Peinture, il a écrit sur la nécessité pour l'artiste d'une érudition géométrique, ce qu'il a exposé sur ce sujet quand il fut professeur à l'Académie Ranson, tout cela s'est infiltré dans les cerveaux de son époque, si bien que le cubisme, jusqu'à un certain point, a bénéficié de l'enseignement de Sérusier qui a été une des plus grandes sources intellectuelles de son temps.
IV. PAUL SÉRUSIER, FONDATEUR DU MOUVEMENT NABI
IV. PAUL SÉRUSIER, FONDATEUR DU MOUVEMENT NABI
Ce qui, au commencement, a cimenté l'union entre tous les Nabis, c'a été l'admiration pour le Talisman (toujours le vocabulaire mystique!) que Sérusier avait apporté de Pont-Aven et qui proclamait la condamnation de l'idée de ressemblance en peinture. Mais les Nabis étaient trop raffinés et trop éclectiques pour en rester à la notion de couleur pure qui pouvait satisfaire Gauguin parce qu'il n'avait pas passé par le Lycée Condorcet ! , Les Nabis allaient vite se caractériser comme les zélateurs des « beaux gris » et des teintes rompues. Que ce soient Sérusier, Vuillard, Bonnard ou Roussel, ils ont été des défenseurs de la nuance et des valeurs, ce qui était une façon pour eux de transposer dans le domaine de la couleur la notion d'arabesque qui leur était chère. Ainsi réalisaient-ils leur fantaisie et leur rêve car, quand on essaie de cerner le contour du nabisme, c'est toujours au concept de fantaisie et de rêve qu'on aboutit. La bienséance élégante, une bienséance frondeuse font en effet partie de l'atmosphère légère du Lycée Condorcet.
Mystérieux, voilà un terme que n'employaient pas les impressionnistes. Un autre terme auquel ils ne recouraient pas, c'était le terme d'arabesque, formule de décorateurs qui revient à chaque instant sous la plume des Nabis. Les impressionnistes, eux, ne connaissent pas la fantaisie; ils notent les reflets qui passent devant leurs yeux ; ils ne les inventent pas.
Sur la jeunesse des Nabis et les liens qui les unirent les uns aux autres, j'aurai plusieurs fois à revenir dans ce livre, mais il est bon que, dès le début, j'indique sommairement comment de futurs peintres, directeurs de théâtre ou de périodiques d'avant-garde qui allaient appartenir au groupe des Nabis avaient depuis leur enfance les mêmes habitudes de pensée, avaient gardé dans leurs yeux la vision des mêmes spectacles et dans leurs cerveaux les mêmes réactions devant les mêmes lectures. Il y avait là Lugné-Poe qui, lorsqu'il était encore élève, avait créé une troupe de comédiens amateurs, Lugné-Poe qui devait orienter vers l'art décoratif plusieurs de ses compagnons et qui, une certaine année, pendant qu'il était à Condorcet, enleva le prix de dessin à son ami Maurice Denis ; il y avait Vuillard et Roussel qui furent, eux aussi, exactement contemporains dans la même section (l'un eut le premier prix d'histoire, l'autre le second prix ; quelques années après, ils allaient devenir beaux-frères). Il y avait là Thadée Natanson, futur directeur de la Revue blanche. Grâce à l'amabilité de M. le proviseur et de M. le censeur de Condorcet, j'ai pu consulter et les palmarès et les bulletins trimestriels (ceux-ci tout couverts d'une poussière qui n'avait jamais encore été dérangée) et c'est toute la littérature comme tout l'art d'une époque qui, à travers cette fumée, reparaissait devant moi: je relevais l'entrée de Vuillard au lycée en 1879, celle de Roussel en 1876.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quoi de neuf Docteur ?
"Les Quatre Filles du docteur March" : Une année, avec ses joies et ses peines, de la vie de Meg, Jo, Beth et Amy March, quatre sœurs âgées de onze à seize ans. Leur père absent - la guerre de Sécession fait rage - elles aident leur mère à assumer les tâches quotidiennes. Célèbre roman de ................
Frances Hodgson Burnett
Louisa May Alcott
Caroline Quinn
13 questions
137 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, roman
, docteur
, médecin
, titres
, écrivainCréer un quiz sur cet auteur137 lecteurs ont répondu